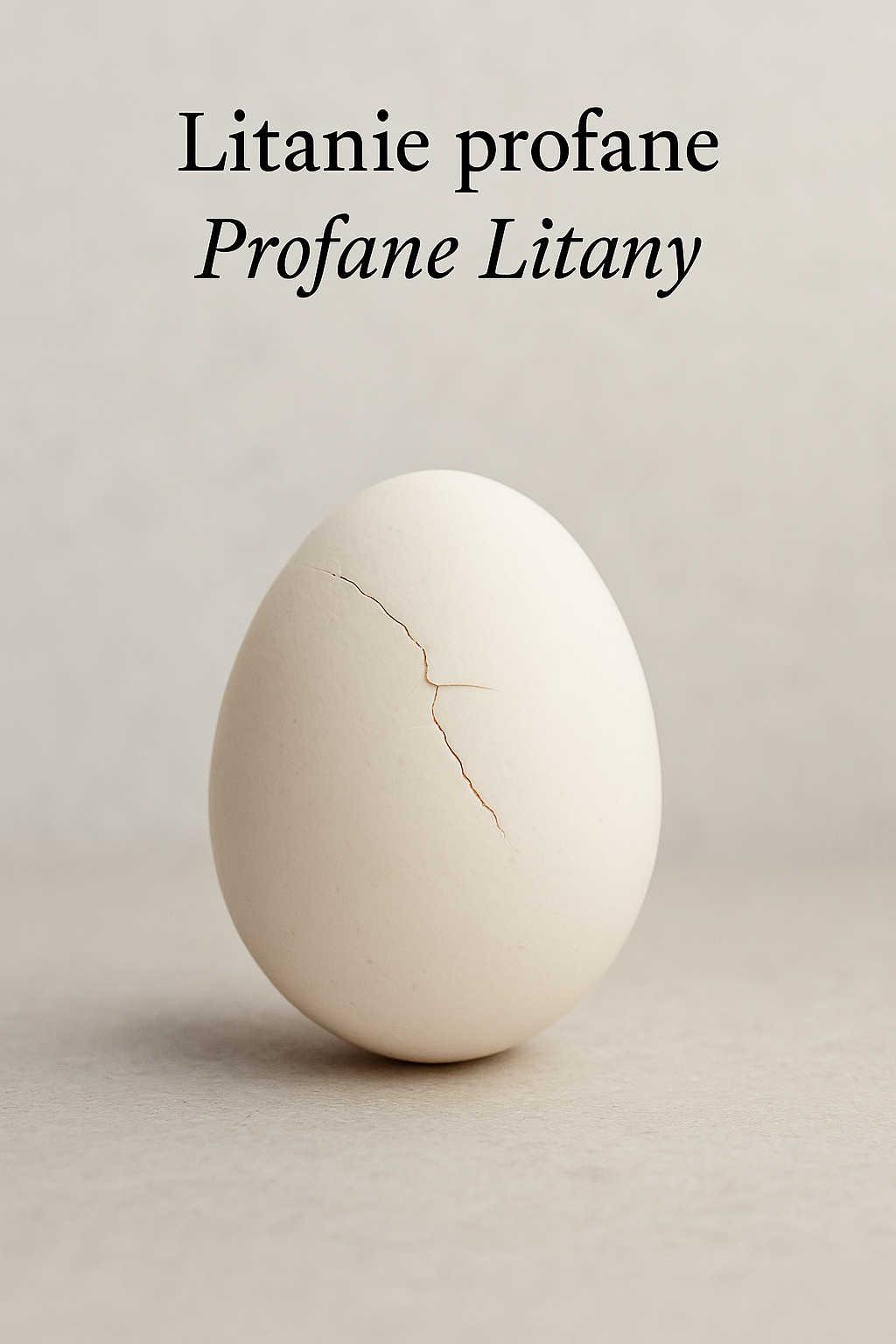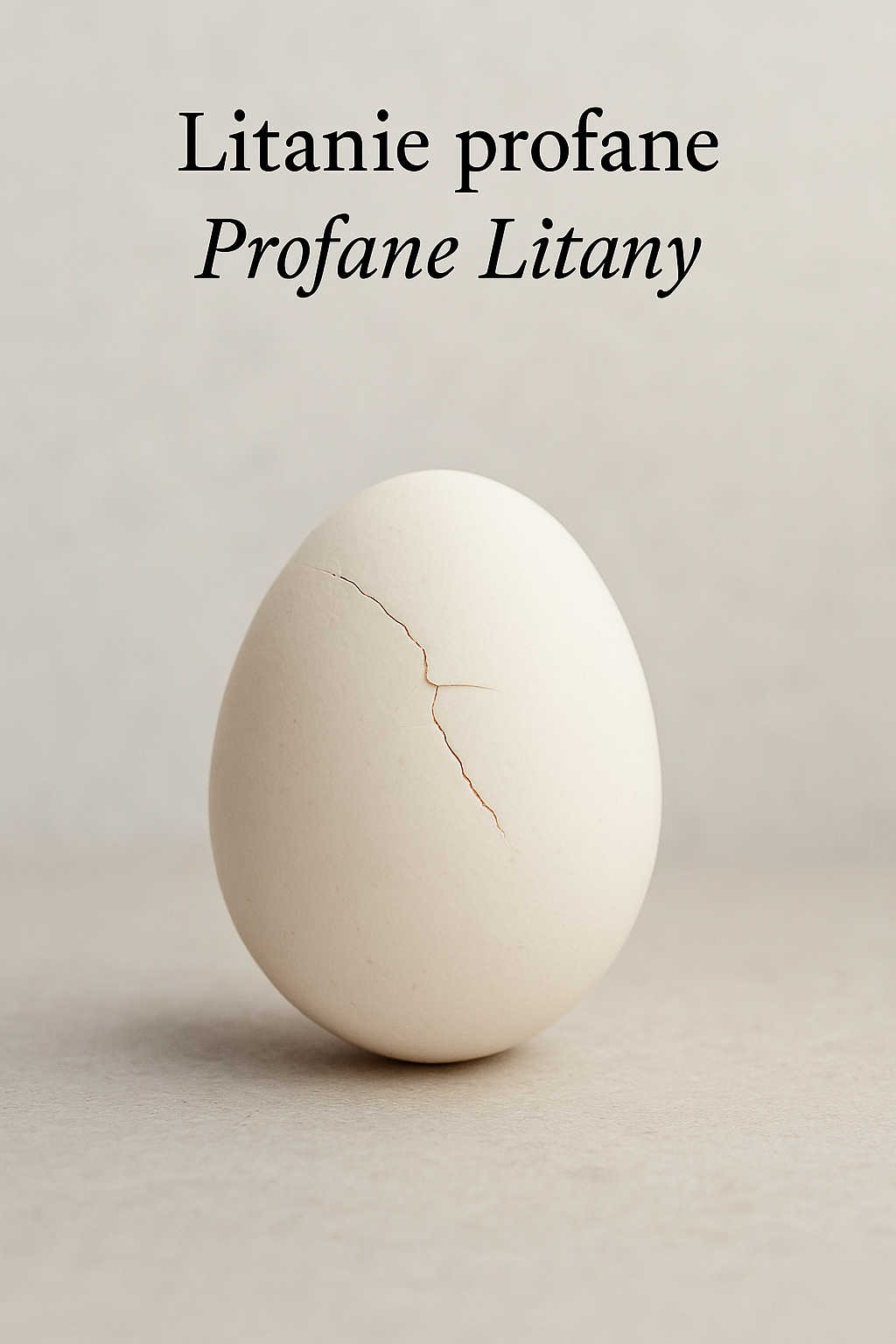Livre Flipbook - Le Dibbouk
recto_verso
Version feuilletable
Table des matières
Après ce qui a été écrit
(2025-09-03 19:25:37|affdate|oui)« Ils retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l’abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux que ce soit pour bientôt. » — Simone Weil, L’Iliade ou le poème de la force
Que la force soit avec toi, mais qui es-tu, toi — homme, femme, enfant, vieillard, rien de cela, tout cela ? Tu pourrais dire je ne suis rien, je suis tout, mais la force ne t’écouterait pas. Elle passe, indifférente. Face à elle, il reste la faiblesse.
Et puis vint le silence.
« Et j’ai appris comment s’effondrent les visages, Sous les paupières, comment émerge l’angoisse, Comment le rire se fane sur des lèvres soumises… » -- Anna Akhmatova, Requiem
Et puis vint le silence.
-- Calme-toi, tu n’es pas encore traîné dans la poussière. -- Mais je suis mort déjà. Avec les morts on ne s’agite plus. On use le temps, on épuise l’ennui, la haine, l’amour. Tout s’écrit dans un perpétuel présent. C’est le cadeau : étrange cadeau qu’on déballe au terme de sa vie.
Et puis vint le silence.
Mais ce silence avait des marches. On y descendait, une à une, chaque marche plus basse, plus étroite, chaque marche un gouffre.
« Chaque marche un cri, chaque marche une perte. Chaque marche un vide — un vide plus profond. » -- Marina Tsvetaeva, Poème de l’escalier
Et moi j’écris une marche, puis une autre, puis encore une. Je les efface l’une après l’autre, soit pour descendre plus bas, soit pour tenter de me hisser plus haut. Je sais déjà que ça ne servira à rien. Ce n’est pas l’importance d’une marche qui fait celle de l’escalier. Mais si je dois être vaincu par la force comme toute chose ici-bas, alors la forme d’un escalier me va — un gouffre ayant la forme d’une spirale, d’un colimaçon. Dans la descente comme dans l’ascension, on peut sans doute choisir son escale un moment. Chaque marche pouvait être aussi bien pic ou gouffre, et c’était bien de ne pas savoir d’avance.
Présentation des chiens
(2025-08-18 11:54:20|affdate|oui)Le décor n’a pas une grande importance. Imagine un bord de mer, de longues allées. Revêtement couleur sable, antidérapant.
D’un côté, la mer immense. Remonte la voix douce de Graeme Allwright : La mer est immense, je n’sais voyager.
De l’autre côté, de hauts pins tournesols dont les basses branches, secouées par un stress hydrique, tentent malgré tout d’offrir une stoïque apparence.
Ce qui manque au capitaine Achab, ce qu’il cherche à harponner, c’est cette forme immense, insubmersible, de couleur blanche. Cette paisible apparence. Le bonheur de ce qu’il imagine être la quiétude d’un poisson dans l’eau.
Un homme promène son chien. L’homme est long mais son ombre plus grande encore. Le chien est maigre, jeune, nerveux. La laisse qui le relie au maître est courte.
Bel exercice à conseiller si tu n’aimes pas te faire rôtir comme un spare-ribs au bord de l’eau. Avise un banc, assieds-toi. Observe la longueur des laisses tenues par ceux qui promènent leurs chiens.
Une femme promène son chien. La laisse est longue. L’animal n’en profite pas.
Elle a noué un paréo autour de sa taille, peut-être pour dissimuler des fesses qu’on supposera proéminentes. Sur sa cheville droite, un tatouage en forme de code-barres.
Les bestioles se sont humées tant et tant que cela les a apaisées. Leurs maîtres font semblant de ne pas voir cet assaut olfactif.
Comme la vie pourrait être plus drôle si l’on pouvait ainsi, comme les chiens, se sentir.
Le parfum est sans doute un des principaux fléaux de l’humanité. Et en même temps une entrée incontournable pour accéder à la civilisation.
Les Noirs disent que le Blanc sent le cadavre.
La mer est immense, celle qu’on voit danser le long, le long des golfes pas très clairs.
Le succès commercial du Parfum tient sans doute au fait qu’on ne puisse plus se sentir les uns les autres en dehors des conventions de l’intime.
Où s’arrête l’intime ? On dit la sphère du privé, et être rond comme une queue de pelle.
Chez les Esquimaux, la nourriture est mâchée par les plus jeunes durant des millénaires pour nourrir les vieux édentés. Leur sphère d’intimité s’est contractée après s’être dilatée avec l’apparition du premier dentiste.
Je ne sais pas vraiment pourquoi je devrais éprouver de l’aversion à ce qu’on me mâche ma viande.
Je ne mange plus que de la viande blanche. Jamais froide.
Manger de la viande froide me rend Noir : j’ai l’impression de manger du cadavre.
Suis allé me baigner ce matin dans le gris général ciel et mer, tout en songeant à l’étoile du Chien.
[…]
Les dents de la mer. Cette pensée en atteignant la bouée jaune : pourquoi les requins ne viendraient-ils pas se nourrir ici, vu la barbue à disposition ? Puis la langue des oiseaux pour se calmer. Revenir tranquillement vers le sable, l’aidant de la mère.
Après que mon frère a failli perdre un œil, on fit piquer le chien.
« Vous avez eu de la chance », dit le docteur à ma mère, comme si c’était elle qui s’était fait mordre.
Le chien fut enterré près du tas de fumier, au fond du jardin. Nous venions prier pour son âme de chien, mon frère pas rancunier et moi-même. Puis on allumait une liane et on fumait comme les adultes. Ça faisait tousser, c’était âcre.
Là-haut, dans le ciel, les nuages formaient des têtes de chien. On disait : « C’est lui, tu vois, il ne nous en veut pas, il est bien plus heureux là où il est. »
Au catéchisme, le curé essayait comme il le pouvait de nous extraire de notre animalité. Devenir humain, c’était déjà être propre.
Dans le feuilleton Thibaud des Croisades, les Sarrasins étaient aussi des Maures. Ils traitaient les chrétiens de sales chiens.
[…]
Ce chien a été renversé par une voiture dans le virage où nous habitions. Mon père a rentré la voiture dans la cour et a dit : « Bon, qu’est-ce qu’on mange ? »
Je suis ressorti de la maison ; le chien vivait encore. Son souffle était court et il pleurait. J’ai essayé de le caresser mais il a montré les dents.
Ma mère m’a appelé juste à ce moment-là : « Viens mettre la table. »
J’ai approché la main encore une fois et le chien n’a plus émis le moindre grognement. Il était mort.
Ce que les êtres humains ont dépensé en énergie, en inventivité, pour ne pas se sentir, tient du prodige. Un prodige bête à manger du foin, aurait dit mon grand-oncle, qui a toujours fait semblant d’être sourd.
Il disait les choses les plus insensées car il faisait semblant de ne pas prêter attention aux commentaires. Une sacrée force de caractère. Ou bien un égoïsme invraisemblable. Je n’ai jamais décidé vraiment qu’en penser.
Caractériser les gens par leur odeur. Mon grand-oncle sentait la foudre. Sa sœur, ma grand-mère, avait un souffle parfumé au grain de café.
Mon grand-père sentait l’essence et le cambouis. Sa vraie vocation aurait été d’être mécanicien auto mais au lieu de ça il avait senti le sang toute sa vie. D’abord à la guerre, il avait commencé à tuer des poulets dans une ferme allemande. Puis sur les marchés parisiens, où il vendait des lapins, des poules crevées.
Patty, la petite chienne caniche, sentait le chien mouillé.
J’ai longtemps fumé. Après mûre réflexion, c’était pour ne pas sentir l’odeur du monde. Trop d’émotions.
Quand j’ai arrêté, je n’ai pas découvert un nirvâna olfactif. J’ai noté que ma chatte n’a pas une haleine merdique, nonobstant le nombre de fois où elle lèche son derrière dans la journée.
On dit qu’il fait un temps de chien, malheureux comme les pierres. Aujourd’hui c’est canicule.
Je n’aborde pas les chiennes spécifiquement. Il faudrait un volume dédié.
Sortir le chien. C’est à l’aube ou à la nuit tombée. Un énorme chien, je m’en souviens.
Le poissonnier de la grand-rue de l’Isle-Adam devait dégager une odeur hostile. Le gros chien l’a mordu. Il a fallu le piquer lui aussi. Le chien, pas le poissonnier.
La peur et l’odeur. Sur quel critère culturel disons-nous : ça sent bon ou mauvais ?
L’ouïe c’est pareil. Quand tu dois dormir dans le tintamarre, tu découvres des rythmes internes insoupçonnés.
[…]
Je me demande si je ne suis pas un peu de ce chien qui mordit mon frère à l’œil. J’en ai longtemps éprouvé de la culpabilité.
J’aurais mérité d’être passé au fil de l’aiguille moi aussi. Piqué une bonne fois avec du sérum noir.
De tous les canidés que j’ai connus, seul un cocker savait faire de vrais yeux de cocker. Juste après vient un boxer, mais l’effort lui coûta tant qu’il mourut jeune.
Le fil utilisé pour recoudre l’œil de mon frère devait être une sorte de fil de pêche.
Que peut-on ressentir d’être piqué, quand on est vieux, qu’on a passé une vraie vie de chien auprès d’hommes frustrés, et qui pour un oui pour un non vous battent ?
Finalement je choisis une salade au poulet grillé, tomates, salade. Un mixte qui, dès la première bouchée, manque de me faire dégobiller.
Quand les gens s’ennuient je m’amuse. Et quand ils s’amusent je m’ennuie.
Toute agitation extérieure titille mon troisième œil, ce qui m’empêche de m’affoler.
C’est en grande partie à cause de cela qu’on m’a longtemps traité d’autiste.
Seules l’odeur d’ail ou d’oignon grillés réussissaient à me faire saliver. Je me plaçais devant les fourneaux, langue pendante.
[…]
L’homme et la femme se toisent en se concentrant en même temps sur ce que font leurs animaux.
Ce pourrait être l’occasion de quelque chose qui ne se produit pas. On sent cette tristesse dans la distance qui s’installe lorsque l’homme marche vers l’est et la femme vers l’ouest.
Pas un seul jappement chez les chiens.
14 août 2025
(2025-08-14 07:42:16|affdate|oui)Au moment où il va dire ce qu’il pense, l’image du mime Marceau apparaît. Et il comprend que ce qu’il pense n’a aucune importance. Qu’il vaut mieux aller sur la face cachée de ce qu’on pense toujours penser. Cette colère, cet amour, cette même vieille chose. Parfois ces textes me deviennent hostiles, imbuvables. Je cherche des rubriques. Je n’en trouve aucune qui vaille la peine. C’est comme si être seul me renvoyait à la marge de la marge. Ainsi, d’un seul coup d’œil, je vois les extrêmes comme des mains en train d’applaudir la farce. Le centre ne m’attire pas non plus. Rien.
Et dans trois siècles, il faut espérer que toute cette comédie soit achevée. Ne dis pas ce que tu penses, surtout ne le dis pas. Jean-Louis Barrault se superpose à l’image du mime Marceau. Le paradis n’est pas ce que l’on pense. Rare que les choses soient ce qu’on pense.
Il est possible d’écourter. De ratiboiser. Au moment de parler, le mime Marceau prend la place. Ce que je pense n’a pas d’importance. Mieux vaut la face cachée de ce qu’on croit penser. Même boucle : colère, amour. Les textes deviennent hostiles. Je cherche des rubriques : rien. Marges des marges. Les extrêmes applaudissent la farce. Le centre, non plus : rien. Souhait pour dans trois siècles : fin de la comédie. Ne dis pas ce que tu penses. Barrault se colle au mime.
Je pourrais décliner tout simplement. Dire non. Non merci. C’est souvent le premier mouvement de la valse hésitation. Je pense non mais ma bouche dit oui, machinalement. De toute façon, ce que je pense n’a aucune espèce d’importance. Mais tout de même cette bouche.
Il décida de partir dans le Grand Nord… en quelle année déjà ? Il faut des dates, sinon on perd la notion du temps. Des rubriques, des dates. Nous voici bien partis. Équipés pour la journée.
Et si tu décides de ne pas écrire plus que ça pour aujourd’hui, si tu décides de ne pas écrire durant toute une semaine, le seul à qui tu manquerais ne serait que toi, toujours toi.
Recommence. Écoute le mot. Recommence. Dis-le tout haut. Recommence. Au moment de parler, l’image du mime Marceau me coupe la voix : ce que je pense n’a pas d’importance, mieux vaut longer la face cachée de ce qu’on croit penser — la vieille boucle, colère et amour confondus. Les textes se hérissent, m’éjectent. Je cherche des rubriques, rien. Marges des marges : d’ici, les extrêmes se répondent comme deux mains qui applaudissent la farce. Le centre ne m’attire pas non plus, rien. J’aimerais croire qu’en trois siècles la comédie sera close. Ne dis pas ce que tu penses, surtout ne le dis pas : fais signe. Barrault se colle au mime. Je pourrais décliner, dire non, non merci ; je pense non, la bouche dit oui, par habitude. On me parle de dates pour ne pas perdre le fil : le Grand Nord, en quelle année déjà ? Des rubriques, des dates : équipés pour la journée. Et si je n’écris pas davantage, aujourd’hui ni cette semaine, le seul à qui je manquerai, ce sera moi — toujours moi.
Non, toujours pas. L’histoire de ma vie résumée en trois mots et une pause pour dissocier ce bruit.
Parler, ou faire signe. Le mime prend la place et le centre n’est qu’un néant tiède. Je range, je décline, je diffère — et j’espère qu’un jour la comédie s’achèvera.
Pas besoin de placer de rubrique. Les cimetières en sont remplis. Cénotaphes, épitaphes, toujours un taff de vouloir enterrer les choses. Tu allais dire « correctement ». Oui, en général, le correct ment — car on sait bien que rien ne l’est véritablement. « Véritable », aussi, je te l’accorde.
Le jour où j’ai trimé deux mois pour me payer cette guitare. Ce serait autobiographique encore. Tu y tiens vraiment ? Imagine qu’on tombe, dans mille ans, sur ta fiche de paie d’un de ces deux mois. Ça nous ferait une belle jambe. En revanche, si tu t’extrais totalement de cette histoire, si tu te biffes, tu peux parler des magasins Grizot & Launay de L’Isle-Adam. Mettons dans les années 1975. Tu pourrais trouver de la documentation. Une histoire de vinaigre. Quelles étaient les marques dont tu te souviens encore ? Procter & Gamble ? Des produits qui rendent la vie un peu plus facile.
Le mot « solfétique » remonte comme une acidité dans la bouche. Tu cherches de la doc mais grand-peine à en trouver. D’ailleurs tu ne sais même plus exactement ce que c’était. Était-ce l’outil pour placer le rouleau de scotch d’emballage, ou bien le pistolet pour créer les étiquettes de prix ?
-- ChatGPT, tu sais, toi ? -- Oui : très probablement les étiqueteuses manuelles — pistolets à étiqueter, pinces à étiqueter — utilisés en GMS pour imprimer et poser de petites étiquettes. (Tailles courantes, molette(s) à chiffres, rouleau encreur, avance et pose en un geste. Exemples de marques : Monarch, Meto, Sato, Blitz.)
Et bien voilà. Voilà exactement ce que l’on retiendra de Grizot & Launay. Dans mille ans, pas grand-chose de plus. Et tout sera déformé, comme tout de nos jours l’est déjà. C’est obligé.
Au moment de parler, Marceau me coupe la voix : ce que je pense n’a pas d’importance, mieux vaut longer la face cachée de ce qu’on croit penser — vieille boucle colère-amour. Les textes se cabrent, m’éjectent ; je cherche des rubriques, rien. Depuis la marge de la marge, je vois les extrêmes se répondre comme deux mains qui applaudissent la farce. Le centre n’attire pas, rien. J’espère qu’en trois siècles la comédie sera close. « Ne dis pas ce que tu penses » : fais signe. Barrault se colle au mime. Je pourrais décliner, dire non, mais la bouche dit oui par habitude. On réclame des dates : le Grand Nord, en quelle année déjà ? Des rubriques, des dates ; nous voilà équipés pour la journée. Si je n’écris pas davantage, aujourd’hui ni cette semaine, je ne manquerai qu’à moi. Pas besoin de rubrique : les cimetières en débordent. Le correct ment. Alors je dévie : Grizot & Launay à L’Isle-Adam, années 1975, Procter & Gamble peut-être, et ce mot « solfétique » qui pique la langue — un pistolet à étiqueter ? Peu importe : c’est cela qu’on retiendra, et mal encore. Tout se déforme, forcément.
Parler ou faire signe. Depuis la marge de la marge, les extrêmes applaudissent la farce et le centre n’est qu’un tiède néant. On classe, on date, on corrige — et tout se déforme quand même.
Le collectif des adorateurs du rien. Celui qui fait tout pour exhumer des archives qui ne disent rien de rien. Il fut crée vers 2025, en France. S’inspire d’Alfred Jarry. A ne pas confondre avec une secte religieuse autrefois nommée Catholique. Eux pronaient que tout est dans tout et surtout tous pour un.
Dans quoi je classe ça ?
- Rubrique "fourre tout "
Nous sommes en 5000 après la Simca 1000. De l’eau a coulé sous les ponts. Il ne reste d’ailleurs qu’un mince filet d’eau dans la Seine. Malgré tout les efforts, les décrets, les avenants aux décrets, les dictatures, les années noires, celles des vaches enragées, celles de la farine d’insecte empoisonnée, celles du virus Gog du virus Magog, celles de la révolution des fleurs, celles du départ pour Mars, celles de la découverte du vaisseau fantôme, celles du retour à la terre, celles du revenu universel, celles où l’IA a failli nous détruire.
Tu ne devrais pas lire ce genre d’ouvrage idiot , dépèche toi on a encore toutes ces antiquités à télécharger dans nos puces neuronales.
Y et X sont dans le même collectif nommé "on garde tout on ne sait jamais". en SIGLE ça donne OGTONSJ et ça se prononce comme on peut.
Le vieux livre " the Time Machine" est posé sur un coussin de velours rouge au centre d’une colonne de plexiglas. Tout autour le sable s’étend à l’infini. Un océan lent de dunes. De loin on peut apercevoir un point noir dans le ciel. Ce point noir grossit. C’est un engin volant. A l’intérieur des êtres humanoïdes.
What the fuck !? dit une voix en se penchant pour voir le paysage au travers d’un hublot.
Naissance d’un nouveau collectif en l’an 11200 après la chûte du Tyran Nosor. Les lecteurs de vieux papier. C’est en fait un jeu de rôle planétaire. Des vieux ouvrages ont été disséminés sur l’ensemble du système solaire. Ceux qui liront le plus seront récompensés par un prix extraordinaire : le droit d’écrire leur vie. On n’en tirera qu’un seul exemplaire que l’on mettra sous globe quelque part dans la galaxie du Centaure, soit sur une île entourée d’une mer de mercure, soit dans une chapelle au sommet d’une montagne de X428 ( voyage à réserver dès la naissance car les files d’attente sont longues comme le bras du géant de Syrius qui en fait est un pouple doté d’une mémoire infaillible, d’une intelligence rare, mais qui en cette année 11202 donne quelques signes de faiblesse. Heureusement la firme je répare tout (JRT) est déjà en train de pomper ses vastes connaissances dans une puce de génération 5.
12 août 2025
(2025-08-12 09:04:40|affdate|oui)Il a pleuré. Dans son coin je l’ai regardé et je l’ai vu pleurer. C’est un passage aussi nécessaire. Puis il a sorti un mouchoir d’une poche, preuve qu’il prévoyait ce moment depuis longtemps déjà. Enfin, il a repoussé le clavier. Il a chercher un stylo dans un tiroir, une feuille de papier et il a dit : tu es un corps, écris.
Se déplier. S’offrir ingénu. Silence. Non, ce n’est pas le moment, tu comprends. Peut-être une autre fois. Se replier, savant. Sache que de toi ils ne feront pas grand cas. Tituber. Aller seul sur quatre pattes. Tenter de se redresser. Retomber. Tenter encore. Retomber encore. Rire étrange. Il n’est pas volontaire. Sort de la gorge au mauvais moment. On serait tenté de dire : le pire. Tous se retournent. Qu’est-ce donc que ce rire. La question les rassemble et t’isole. Encore. Qu’une grille de contraintes ouvre sur une nouvelle grille — et ainsi de suite. Visiter ainsi, à ta façon, les abîmes. Ce n’est pas un jeu. C’est dire autrement le traumatisme. Parvenir au face-à-face, déjà, l’art n’a rien à voir. L’art ne voudra surtout rien voir. L’art dépassera de cent coudées ce que tu crus un jour avoir vu. À force de rabâcher, le silex se fend. Puissance de la redite. Du répété. Vacillement : entre ce qui fut ressenti et mal dit, et ce qui sera dit autrement, moins l’affect. Peu de chance, ou beaucoup, si tu parviens déjà à t’en sortir. Mais la chance n’est qu’une marche. Creuser n’est pas un choix : c’est la prise de conscience d’une nature. Tu ne peux faire autrement. Danger sur l’intersection. N’aie pas l’air. Étouffe en toute conscience. Ne négocie plus. Arrête avec tes mots d’ordre, tes mantras, ton chapelet, tes paris stupides. Si les mots soudain manquaient… Mais lesquels ? Ceux qui font obstacle au profond étranger. Peut-être le vacillement ne s’interrompt-il jamais. On voudrait un équilibre stable, définitif. On le fantasme. Fausse piste de la volonté. Offusqué, il se replie après s’être déplié. Les animaux marins. Les sensitives. Les pattes d’un insecte qui fait le mort. Tu fais le mort pour qu’on ne t’achève pas. Jamais. Dans le même temps, c’est un souhait secret. Avoue-le.
— -
Par la mort passer. En sortir, s’en sortir, sang sortir, sans sort ire. Rêver un désir neuf. Une étincelle. Une toute petite aspérité sur la paroi changée mentalement, physiquement, en levier. Grimper. Dépasser quelque chose. Prendre conscience du gouffre, du vertige, de la peur. Les affronter. Grimper encore. Tu n’as pas le choix. Dépasser quoi ? Il s’efface quand tu le dépasses. Tu ne sais plus ce que c’était.
— -
Arrivé au sommet : le ciel, l’air, les poumons se déploient. Respirer. Battements du cœur réguliers. Le rythme, la musique t’ont calmé. Par quoi es-tu passé pour que tout soit si vite, un jour, oublié ? Pas de réponse hâtive. Aujourd’hui, tu as seulement le droit de dessiner ce mouvement. Tu te donnes ce droit, et la contrainte afférente. Et tu verras bien demain si tout ça tient encore.
— -
Naïveté. Ne la répudie pas. La catharsis n’est pas un drame. C’est seulement un coquillage. Tu peux vivre à l’intérieur et dire voici mon monde, voici ma vie. T’en convaincre. Tu peux oublier le paradis, la terre promise, comme tu peux aussi oublier la malédiction d’avoir été élu. Car ce sont les élus qui parlent seuls d’élections. D’affinités élèctives. Tu n’es pas Goethe. Ou si tu l’as été cela suffit. tu ne l’es plus. Comme tu n’es plus Artaud, Van Gogh, Bataille, Duras, Pizarnik. Naïveté de penser le refuser, le choix. Naïveté et espoir toujours la petite musique infernale, celle des comptines des ritournelles, on fait feu de tout bois quand on se perd dans la forêt, petit.
10 août 2025
(2025-08-10 07:33:46|affdate|oui)Avant, quoi avant, avant qui a-t-il. Avant il y a le bruit brut du souffle, le craquement des tendons, des cartilages, des os. Avant le vent souffle dans une flûte de roseau et on dit Pan, tu diras que c’est de la musique tiens. Avant la musique, avant la parole, avant le jour, il y a la nuit, disent les présocratiques pas encore trop bourrés de tics. Avant qu’il y ait un après, qu’était donc l’avant ? Un infini avant ; ce n’était pas un long silence, rien ne nous le dit. C’est un bruit qui ne dit rien sauf qu’il est bruit. C’est après que ça se gâte, quand on veut lui faire dire ce qu’il ne veut pas dire. Parle ! Parle ! nous avons les moyens de te faire parler, sale petit bruit de merde qui nous gâche la vie, notre vie qu’on rêve si belle, si longue, si remplie d’actes et de paroles. Avant quoi qu’il y ait qu’on ne retrouve pas après tous ces actes, tous ces bruits, et où l’on comprend enfin la bienveillance des parenthèses. L’amplification sonore d’une suite de sons vaut exactement l’agrandissement d’une photographie 24x36 quand on la tire au-delà d’un 9x13 sur papier. L’effet choc — auditif ou visuel — demeure longtemps en écho dans l’ouïe, la rétine. Ce pourrait être un nom : Louis La Rétine, Louis de l’Ouïe. Oyez ce que vous voudrez ouïr, et que la foudre vous réveille de votre esprit en forme d’entonnoir. Il se trouva soudain qu’une phrase isolée, marchant seule sous un réverbère sur les quais de Seine, m’attira à un point tel que je demeurai comme en suspension.
avavant quaquoi avant kikqui a’t’il boubruit brut sousouffle cracraque ment tendons carti lage ossoss souffle fluflûte roseau Panmuzique tiens avavant muzique avavant parole avavant jour nuinuit présocratiques paspas trop bourrés tictic avant qu’y ait après avant infini pas long silence rienneledit bru bruit quedit rien parle parle nous avons mo moyens sale bruit mer mer gâche lavi vie belles parenthèses
sans éducation
(2025-08-10 06:53:04|affdate|oui)Sans éducation
Personnages :
VOIX (narrateur)
CHOEUR
VOIX
Sans éducation mais que feriez-vous donc dans la vie, me dit-elle.
sang et duck duck duck
cassons cassss cassss cas sion mmmmm é mmmmé
queue fffffffe ffffffe
riez vooooooussss
d’oncques don dondon don
queue dans dans dent lave
iiiiiii la vis l’avvvvvie
meuh meuh meuh
mmmmmmmmmmm
dddddi tel tel tel
tttttttttttt ’hell
VOIX
Mais que lui prend-t-il
qui lui prend quoi
quoi donc est pris
CHOEUR
-- la main dans l’sac.
VOIX
Le ressac le ressac
CHOEUR (bis)
-- Mais que lui prend-t-il
-- Mais que lui prend-t-il
VOIX
à cet hurluberlu
CHOEUR
-- Que lui prend-t-il à cet… à cet hurluberlu
-- Le ressac le ressac
VOIX
Sac âge ses tours mentent
zozotaient-ils les zozos
en levant les z’yeux z’o ciel
CHOEUR (trois fois)
-- En levant les z’yeux z’o ciel
VOIX
Il me prend dans ses bras
pas toujours dans ses rhoo
ajoute tas d’ailes
pas tou pas tou jour
dans ses dansez dansez maintenant
dans ses rhooo
VOIX
Roméo, Juliette a du monde au balcon
tiens au bal qu’on tient chez juju la layette
quel monde… c’est con
VOIX
Si si si… non
j’aurais j’orée j’or ai
jou jou joue contre joue
joué une séré… une sérénade
CHOEUR
-- Ilot rat joue et serré nade
notes de lecture_Hélène Gaudy / Un monde sans rivage
(2025-08-06 11:30:13|affdate|oui)J’ai téléchargé l’Epub. Il y a quelque chose qui m’attire sur la couverture. Un souvenir de photographie posé sur autre roman, {Je m’en vais } de Jean Echenoz. Je ne sais rien d’Hélène Gaudy. Je fais une recherche. ChatGpt, Qui est Hélène Gaudy ?
voici la réponse :
Voici ce que l’on peut dire sur Hélène Gaudy, écrivaine française contemporaine :
📚 Biographie
- Née à Paris en 1979, Hélène Gaudy est plasticienne de formation, diplômée de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg (Wikipédia).
- Membre du collectif Inculte depuis les années 2000, et du comité de rédaction des revues Inculte et La moitié du fourbi (Wikipédia).
- Elle vit et travaille à Paris, partageant un intérêt entre créativité visuelle et écriture littéraire (Fabrique du Littéraire).
🖋 Carrière littéraire
-
Auteure d’une demi-douzaine de romans pour adultes, ainsi que de nombreux albums et romans jeunesse (Wikipédia).
-
Parmi ses œuvres les plus marquantes :
- Vues sur la mer (2006) – sélectionné au Prix Médicis (Wikipédia).
- Plein hiver (2014) – roman au ton poétique et atmosphérique (Wikipédia).
- Une île, une forteresse (2016) – récit documentaire sur Terezín, camp modèle pendant la Seconde Guerre mondiale (Wikipédia).
- Un monde sans rivage (2019) – inspiré de l’expédition arctique suédoise de 1897, traduit en anglais (A World with No Shore), sélectionné pour le Prix Goncourt et lauréat du prix François Billetdoux en 2020 (Wikipédia).
- Archipels (2024) – explorant la vie de son père collectionneur, finaliste du Prix Goncourt 2024 (Wikipédia).
🎯 Thèmes et style
- Elle travaille souvent à la convergence du texte et de l’image, interrogeant la mémoire, le paysage, la trace (Observatoire d\’éthique universitaire).
- Ses romans mêlent fiction et investigation documentaire, souvent à partir de lieux chargés d’histoire (Terezín, Grand-Lieu, archipels polaires...) (Observatoire d\’éthique universitaire).
- Elle mène également des ateliers d’écriture avec divers publics (migrants, élèves, malades, etc.) et enseigne en Master de création littéraire à Paris VIII (Wikipédia).
✅ En résumé
Hélène Gaudy est une autrice originale, mêlant influences plastiques et littéraires. Ses récits allient tendresse, rigueur documentaire et poésie, souvent autour de thèmes de mémoire, paysage, exploration et identité familiale. Son œuvre récente Archipels, qui a décroché une place parmi les finalistes du prestigieux Prix Goncourt 2024, illustre parfaitement sa capacité à transformer la vie ordinaire en quête universelle.
Bon. Je ne saurais dire si j’en sais plus sur Hélène Gaudy comme ça. Certainement pas. F.B dit qu’il y a eu rencontre zoom. Il faut faire une recherche de ce côté là aussi. Je ne vais jamais sur les zooms. Il arrive que je le visionne en replay plus tard. Mais celui là ne me dit rien. J’ai dû zapper. Pas trouvé. Mais une autre vidéo : Du texte avant.
et encore une autre trouvé sur la chaine de Pierre Ménard
j’en vois d’autres encore. De quoi se faire peut-être des idées. Toute une liste. Mais bon. Lire le livre plutôt donc. Un monde sans rivage.
Puis je tombe sur une phrase :
les écrivains hors réseau marchant lentement à leurs ténèbres ? ça me flanque un frisson.
Je vais attendre encore un peu. Lire le livre en entier. Peut-être. Et une fois lu je pourrais en faire un résumé comme celui-ci
Le livre s’inspire d’un épisode réel : l’expédition polaire suédoise de Salomon August Andrée en 1897. Avec deux compagnons, il tente de rejoindre le pôle Nord en ballon dirigeable. Leur disparition, puis la redécouverte de leurs corps et de leurs carnets plus de trente ans plus tard, forment la trame narrative. Hélène Gaudy part de ces documents, de photos retrouvées et des traces laissées sur la banquise pour imaginer, combler les silences et explorer ce qui se joue dans cet espace entre l’histoire et la fiction.
Parlerais-je de sa structure ainsi vraiment ?
Structure :Trois mouvements principaux : L’avant : préparation de l’expédition, contexte historique, rêves de conquête et fascination pour les pôles à la fin du XIXᵉ siècle. Le voyage : récit fragmenté et non linéaire du périple, alternant descriptions des paysages, extraits réels ou imaginés des carnets, et moments d’hypothèse. L’après : redécouverte des corps en 1930, travail des archéologues et journalistes, et résonances contemporaines. Narration polyphonique : la voix de l’autrice dialogue avec celles des explorateurs, des témoins, des archives. Le récit avance par touches, comme un collage.
Et pourquoi pas aussi du style pendant que j’y suis ?
Prose poétique et sensorielle : Gaudy décrit les paysages arctiques comme des tableaux mouvants, travaillant sur la lumière, le blanc, les textures. Écriture fragmentaire : chapitres courts, ellipses, retours en arrière, montage d’images et de souvenirs. Mélange documentaire/fiction : rigueur dans les faits, mais liberté dans l’imagination des émotions, pensées ou gestes quotidiens. Dimension visuelle : influence de sa formation artistique, attention à la composition des scènes.
et forcément je me poserais la question du thème, des thèmes de la thématique.
La quête et ses illusions : l’obsession d’atteindre un but géographique comme métaphore d’un désir humain d’absolu. La mémoire et ses lacunes : comment on raconte après coup, comment on reconstruit avec des morceaux. L’échec héroïque : ces hommes ne reviennent pas, mais la postérité les érige en figures mythiques. Le rapport au paysage extrême : nature indifférente, sublime et mortelle.
En fin de compte en quoi un monde sans rivage est-il remarquable ?
Originalité de l’approche : plutôt qu’un récit d’aventure classique, c’est une exploration sensible du vide, de la trace et de l’oubli. Équilibre entre précision historique et poésie : on apprend, mais on rêve aussi. Structure fragmentaire qui reflète la discontinuité des sources et la difficulté de dire l’expérience polaire. Résonance contemporaine : interrogation sur notre rapport à l’exploration, à la mémoire et à l’image.
Je ne peux pas dire que je connais encore beaucoup de choses sur Hélène Gaudy.
ceci n’est pas une critique littéraire, pas du tout. Ce sont juste quelques notes de recherche, je n’ose pas encore dire de lecture Pour que je puisse le dire il faut que j’ouvre foliate. Que je charge l’Epub. Que je lise...
tiens j’aime déjà bien la citation :
Tout plonge dans un monde sans rivage, qui ne tolère aucune définition et face auquel, comme beaucoup l’ont déjà dit, toute affirmation est une solitude, une île. H. G. ADLER, Un voyage.
Emblème
(2025-08-05 23:30:07|affdate|oui)1965, La Varenne-Chennevières
Au-dessus du cosi, une plaque de bois sombre, veinée comme une vieille peau. Une tête de mort et deux poignards croisés, les lames fines se rejoignent dans un vide central. La poussière s’est incrustée dans les lettres cyrilliques, le vernis a craquelé par endroits. L’attache triangulaire pend légèrement, comme si elle avait perdu sa tension, et le clou nu, sans tête, traverse un éclat d’enduit.
Peut-être un trophée arraché dans une ville en flammes. Peut-être acheté dans une échoppe portuaire, offert par un homme déjà mourant. Peut-être qu’il n’a jamais rien eu à voir avec Kornilov. Peut-être qu’il sert seulement à habiller un silence.
Aujourd’hui, le crépi beige absorbe la lumière. Il n’y a plus de cosi, plus de plaque, plus d’attache. Je tente de placer mentalement l’objet au-dessus d’une fenêtre, mais il flotte dans l’air. Dans la vitrine du café, mon carnet reflète le passage d’un bus rouge qui déforme les lignes. Je note : rien ne colle.
mars 1975, Limeil-Brévannes
L’adolescent saute du premier étage, les pieds s’enfoncent dans la terre meuble. L’odeur d’humus froid remonte avec l’impact. La lune éclate derrière les nuages puis disparaît. Un frisson lui parcourt les bras.
Peut-être que le corps sait avant l’esprit. Peut-être qu’il porte du sang slave. Peut-être pas russe : estonien, finlandais, danois. Peut-être un sang sans patrie, sans drapeau. Peut-être que cette vérité restera endormie longtemps.
Le jardin est aujourd’hui grillagé. La fenêtre a été remplacée par un vitrage coulissant. Je ne saute pas. Je sirote un café tiède. Le ciel est vide. Pas de lune pour bondir.
Vacances d’hiver 1966, La Varenne-Chennevières
Sur la table, l’Assimil russe est ouvert à une page bleu pâle. Un homme robuste tient un enfant de six ans sur ses genoux. « Répète après moi : ia lioubliou, caco ia nié lioubliou tchaï. » L’haleine d’ail et d’oignon est chaude, insistante. Derrière un mur mince, une voix de femme : « Pourquoi lui apprendre le russe ? » — « Parce que je n’ai plus rien que mes souvenirs. »
Peut-être qu’il ne parlait pas vraiment la langue. Peut-être que ces phrases n’avaient jamais été prononcées ailleurs que dans ce manuel. Peut-être que l’enfant a gardé plus l’odeur que les mots. Peut-être que ce n’était pas une langue qu’il voulait transmettre, mais la persistance d’une voix.
L’appartement, aujourd’hui, est repeint d’un blanc sans nuance. Les volets sont en PVC, les jointures neuves. Il n’y a plus de table, plus de livre, plus de voix derrière la cloison. Au café, un reflet dans mon écran : mon visage sans haleine d’ail.
Fort de Vincennes, 1982
Un éclat de lumière glisse sur le métal des poignards. Badge, écusson, uniforme. Deux silhouettes se tiennent dans l’air sec. Un nom est prononcé : Kornilov.
Peut-être qu’il aurait dû répondre non. Peut-être que ce sang-là ne vient pas des batailles. Peut-être un sang de marche lente, d’exil discret. Peut-être que le rêve de Norvège n’était qu’une sortie de secours.
Les murs du fort sont toujours là, pierres froides, épaisses. Aucun lieutenant, aucun plan de fuite. Le périphérique gronde au loin. Dans mon carnet, je dessine des têtes de mort minuscules, serrées comme des insectes.
outils et surmoi
(2025-08-02 10:31:02|affdate|oui)Pauvreté et peur du ridicule. Ce qui renforce la sensation de pauvreté, c’est cette peur du ridicule. C’est l’intégration du mépris de classe prodigué durant des décennies, des siècles. Une espèce de surmoi. Freud envoie valdinguer Jung exactement à cause de cela. « Tu ne veux pas accepter ma trouvaille », lui dit-il en brandissant la Torah. Jung le considère. C’est-à-dire lui, le chandelier à sept branches, les trente-six chandelles. Et il lui répond : non. Tout simplement non. Sans trop en faire, sans théâtre. Puis il sort de la pièce sombre qui pue le tabac froid. Un dernier regard vers le cendrier de cristal sur lequel est posé un vieux cigare tordu que rallumera Lacan. Bon, là-dessus, Jung passe aux archétypes, aux symboles. Pourquoi pas. C’est-à-dire que c’est bêtement un changement d’outils, comme un changement de point de vue. Rien d’autre.
Ce que je veux dire, c’est qu’il faut, avant d’écrire, s’intéresser aux outils d’écriture dont tu disposes, me dit T.C. Il est assez véhément sur le sujet. Presque en colère. Il ne comprend pas qu’on ne s’intéresse pas à l’essentiel. Je crois que c’est ce qu’il veut dire. Je me sens honteux, parce que j’ai l’impression qu’il me parle. Il me parle d’une façon indirecte, ce qui fait son petit effet immanquablement. Je le prends pile dans le foie, le coup. Puis la douleur monte peu à peu au cerveau. L’outil devient une espèce de surmoi. Je vois des pinces Monseigneur me regarder de haut, et des pieds-de-biche trépigner. Je me sens minuscule.
02 août 2025
(2025-08-02 09:55:14|affdate|oui)La prison était parfaite, on n’en voyait pas les murs.
Cependant, le mot prison revenait : quelqu’un ou quelque chose étouffait à l’intérieur de murs invisibles. Ce manque d’air, cette oppression, cet accablement n’étaient-ils pas les meilleurs indices d’un enfermement que l’on découvrait peu à peu ?
En apparence, tout semblait en ordre. Les rideaux de fer s’ouvraient à l’aube et se refermaient le soir. La pluie, qui tombait drue, donnait une véritable sensation d’être mouillée.
Le soleil, en revanche, dispensait une lumière plus froide. Bien qu’on parvienne à l’étouffement lors des nombreuses canicules qui se succédaient, la chaleur contenait quelque chose d’impitoyablement glacé.
Trouve ta prison. Plisse les yeux. Patience.
F. dit que j’expérimente. Il parle de technique. On se rejoint sur la technique. Sur les outils.
Ensuite, ce que chacun écrit avec ces outils a-t-il de l’importance ? Je veux parler du contenu.
F. a sans doute viré l’idée de contenu depuis longtemps.
De mon côté, impression d’être sur une paroi rocheuse. Je grimpe à mains nues.
Je sais qu’en haut il n’y aura plus vraiment d’intérêt pour le contenu.
J’aurai certainement une vision d’ensemble.
Je verrai, en un seul regard, tous les outils se déployer comme des chaînes de montagnes, avec leurs vallées intermédiaires, leurs plaines, leurs fleuves.
Ce que j’écris contient encore trop de contenu. La prison est probablement l’idée de contenu. Ce qui est contenu ne doit plus l’être. Il faut que je demande à S de me donner une claque dans le dos pour changer mon point d’assemblage avec l’idée de contenu.
Hors contenu qui a t-il. N’est-il pas erroné de se poser la question alors qu’on est enfermé dans la prison du contenu. Hors contenu y a t’il des questions. La question existe-t-elle en dehors de tout contenu.
J’ai écrit hors lieu. Je sentais qu’il fallait un espace différent. J’avais cette intuition qu’il y avait une possibilité d’extérieur. Cependant encore une fois le divertissement l’aveuglait sur l’essentiel. Je cherchais vaguement un extérieur, ce qui me dispensait de songer à l’intérieur.
Est-ce que Sei Shônagon n’aurait pas un rapport avec ce que j’écris ce jour ?
Est-ce que Notes de chevet serait le lien ?
Est-ce que l’on peut encore croire au hasard — que la proposition 11 = 2, comme dialogue, évoque exactement ce genre de mouvement interne ?
Est-ce que le temps existe vraiment, tant qu’on reste dans l’illusion du contenu ?
Et si l’on sortait du contenu… sortirait-on du temps ?
Tant que je me pose ces questions, je sais que je suis encore en prison.
Lectures : Signal/Bruit de P.C, reçu par mail.
Écho à un autre email de T.C concernant le cancer. Voir aussi D.C, et M., qui va se faire opérer le 6 d’une tumeur à l’amygdale.
Pourquoi est-ce que je relève ces détails, que je les rumine parfois durant des jours.
Pourquoi je ne m’intéresse pas à des choses plus “joyeuses” ?
Trouvé un livre dans la boîte à livres de Molly Sabata : Hymne de Lydie Salvayre.
Lu la première page.
L’utilisation de “on dit que” m’a sauté aux yeux — c’est probablement la raison pour laquelle je l’ai emporté.
écrire est l’outil même
seize
(2025-08-01 23:57:15|affdate|oui)
Codicille
Pourquoi 162 ?
Certains diront que c’est un hasard ancien, la longueur d’un rouleau, la patience d’un copiste ou l’inspiration d’une nuit.
Mais moi je pense qu’il fallait bien finir quelque part. Et que finir, c’est toujours recommencer.
162, c’est 1 + 6 + 2 = 9. Et après 9 ? On recommence : 0.
C’est une boucle. Un retour. Le moment exact où ce qu’on a nommé disparaît de nouveau.
C’est pour cela que je n’en propose que 16.
Parce que 1 + 6 = 7.
Et que 7, c’est le nombre de mondes, de cieux, de nains, de notes, de jours.
C’est le juste excès. Le seuil du visible.
À quoi bon pousser au-delà si l’infini est déjà là, dans le nombre impair qui rassemble ?
Chaque phrase ici est une poignée de sable — mais si on les jette ensemble, elles dessinent peut-être un passage.
Un verso. Ou un silence.
Verso
- Le souvenir est éreintant mais pas son parfum
- Si la jeunesse pense à mourir, c’est qu’elle n’a pas encore trop vécu
- La vieillesse peut être très triste si on n’a pas de petite joie pour compagnie
- On dit que Jimmy Hendrix était un garçon timide et on dit aussi que John est resté à contempler sa dent carriée un bon moment
- On dit que on dit qu’il ou elle
- Trouver le vivant dans le mort et son contraire
- Pourquoi s’arrêter à 162 sinon parce qu’après 9 tout repart à 0
- Sans un plan qui tombe à l’eau, on ne sait rien de la dureté des sols
- L’inconscient sait d’avance ce que tu n’as pas encore imaginé
- Si j’avais le temps j’aimerais bien m’arrêter un peu pour le voir passer
- Que laisse-t-on derrière soi de précieux, se demande-t-il en plein été sur la route
- Si l’on sort du spectacle, on ne trouve que des vêtements au sol
- Pourquoi un extraterrestre voudrait s’intéresser à toi
- Il faudra être mort pour se déplacer plus vite que la lumière
- Si je n’existe plus, je ne suis plus seul
- Tout parle, mais peu écoute
Recto
Soie. Doux, odorant, s’échappe. Cruauté aussi. Mais une cruauté qui ne fait pas mal à autrui. Une déchirure de l’air. Est-ce cruel pour soi, pour l’air, difficile de le dire. Et d’ailleurs pourquoi faudrait-il le dire.
Un bol intact, dans une lumière du matin. Un sourire qui n’a pas besoin de public. Le fait de ne pas répondre immédiatement, et de n’en éprouver aucune culpabilité. Une fenêtre entrouverte sur un champ qui n’appartient à personne, mais qu’on regarde comme s’il nous reconnaissait. Être à l’abri d’un désir qui ne nous concerne pas, entendre quelqu’un parler, et rien vouloir ajouter. Se tenir là, dans le retrait, et pourtant sentir que l’on pèse dans le réel.
Un ballon rouge s’envole. Il y a un grand ciel et un point rouge. Il y a des toits en dessous, mais ce ne sont pas les mêmes toits au départ et à l’arrivée. C’est dans un film. C’est drôle parce que c’est paradoxal. Des images en noir et blanc sauf ce rouge. Cette espoir dans un ballon rouge qui flotte dans le ciel, pour rien. C’est un espoir sans but, c’est pour ça qu’il est beau, qu’il me plaît.
Luxembourg. Le mot lumière ici c’est bassin. Au milieu du bassin le jet d’eau. L’eau en retombant sur l’eau crée un mouvement. Il est remarquable si l’on prend le temps de l’étudier que les déchets se regroupent par affinité. Ainsi les bâtonnets plats se rangent à côté des bâtonnets plats, les emballages de chupa chups font une ronde, les balles de ping-pong jouent à s’entrechoquer ensemble. Chaque jeu n’inclut que les membres appartenant au jeu et ignore tout des autres jeux.
paupière tombante
(2025-07-28 17:25:56|affdate|oui)|
Voir la honte au moment même où elle vous prend, c’est voir par en-dessous. Par défaut. À rebours. Ce n’est plus une image, c’est un voile. La honte n’arrive pas de l’extérieur. Elle monte. Elle boursoufle la vue. Elle se glisse entre le monde et soi comme un écran bistre, opaque, figé. Honte d’être là. Nu, immobile. Pris dans une impudeur si totale qu’elle semble presque tranquille. Et pourtant personne ne voit. |
la honte au centre du paysage n’arrondit pas les angles. Elle tient le milieu comme un pion figé. Autour, les allées blanches dessinent une spirale hésitante, |
Tension silencieuse
(2025-07-25 16:36:57|affdate|oui)recto
Le bleu de travail. Le plus souvent café, selon ce que dit Talleyrand. Fort. Enfer. Les yeux pochés, jamais de bacon. Raide comme la justice derrière le genou, ce qui n’aide pas à plier.
Le pain. Il remplit un trou, temporairement. Un goût de sueur, évidemment. Pas de croix au dos avec un couteau, pas de bénédicité. Le pain nous mène à la baguette.
La cuisine. Petit coin étroit, confortable. Il faut rentrer son ventre pour s’asseoir en bout de table. Un peu de dignité : se laver les mains des propos diffusés par le poste. Apercevoir des pigeons, frères et sœurs, à la fenêtre.
verso
La Clark. Rebelle, elle baille aux corneilles. Démarche souple, un peu trop. Comme une danse auguste, une clownerie résistante. Elle lutte, sans pancarte, contre le cirage de pompes généralisé. L’odeur devient suffocante, sur le tard.
La soupe au lait. Elle indique le soir mieux que la pendule. Sa forme dépend de l’humeur, du fond du placard. À boire et à manger. Un tout-en-un qui s’avale chaud, tiède, rarement froid.
L’appentis. Il sent la peau de poisson séché, la vieille ficelle, le caoutchouc des bottes. Bardé de bois à nœuds, bon marché. Couvert de tôle ondulée. Une accumulation de choses, qui semble du désordre, mais qui ne l’est pas.
Amer Caïn
(2025-07-25 08:26:43|affdate|oui)recto
Il m’est soudain devenu difficile d’écrire comme de parler. Impression que tout ce que je peux dire ou écrire sera de toute façon faux, inintéressant, ridicule. J’ai l’impression d’être revenu des années en arrière. Peut-être 79 ou 80. C’est si loin. Je ne me souviens que de cette difficulté à dire que j’avais retrouvée dans l’envie d’écrire. La difficulté de dire, en y réfléchissant, remonte à bien plus loin. Elle est associée à l’enfance. C’est qu’on ne prenait pas la parole si facilement. Ou peut-être que la parole des enfants était du pipi de chat. Tiens. C’est venu comme ça. Du pipi de chat. C’est-à-dire rien, ou presque. C’est difficile de ne pas inventer. De dire les choses telles qu’elles sont. Ce que l’on appelle « dire la vérité ». Comme ils disent. Une fois j’ai voulu tuer tout le monde à cause de ça. Quelle vérité. C’est au même moment que je cesse de parler de toi. Je crois qu’il y a un lien avec cette histoire de vérité. De toute façon, on ne me croit pas. On dit que j’invente, quand on ne dit pas que je mens. Je me vois entrer dans une librairie près de la gare de l’Est, acheter ce premier carnet de la marque Clairefontaine, couverture verte à motif écossais, petits carreaux. Et un feutre le plus fin possible, le plus fin cela devait être du 0,5. Et cette envie d’écrire, d’où vient-elle sinon de cette impossibilité de dire qui remonte. Une acidité. Et je crois que tu es associé à tout cela. Je ne m’en rends pas compte encore. Pour l’instant j’ouvre le carnet, est-ce que je dois écrire tout de suite sur la première page ? Ou bien peut-être laisser une page libre, écrire sur celle d’après. C’est une question. C’est un prétexte. Il faut que je mette la date pour ne pas oublier. Quoi. Je n’en sais rien. C’est sans doute une habitude qui revient avec la difficulté. Qui l’accompagne. Inscrire la date du jour, en marge sur un cahier. Je te vois ricaner. Tu te moques de mes velléités d’application. Tu essaies de me dire quelque chose que je ne désire pas entendre. Que je repousse. L’exact contraire de ce que tout le monde autour me dit. Applique-toi et… tu obtiendras, tu auras, tu pourras. Cette fois tu ris franchement. Je le retrouve, ce rire. Non, je ne dis pas que tu ris de bon cœur. Ce ne serait pas la bonne expression. Tu ris tristement. C’est une chose que je n’avais encore jamais relevée. Et maintenant je peux accoler ces deux mots, rire et tristement. Et c’est toi. C’est tellement toi. Cela je ne peux pas l’exprimer la première fois. J’éprouve une peur inouïe en entendant ce rire. Il y a quelque chose qui ne va pas. C’est évident. Cela saute aux yeux — ou à l’oreille plutôt. Cette fausseté apparente qui vient briser l’idée de justesse apprise.
verso
Tu m’as laissé tomber l’été 1967, pour être précis. Ça s’est passé en fin de journée, vers 18 heures, je m’en souviens comme si c’était hier. Tu étais en train de tailler des flèches en vue de tuer le plus de monde possible. J’arrangeais les plumes des empennages, nous étions là tous les deux juchés sur la tonnelle, concentrés sur notre colère. Cette colère qui, le croyais-je, nous soudait. Et puis tu as détourné le regard, il y a eu ce bruit dans l’escalier de l’autre côté du grillage, chez Muguette, la voisine. Des gens arrivent. Ce sont des étrangers. Des Américains. Tu te souviens de ce mot. Américains. Je n’arrive toujours pas à comprendre l’effet que ce mot a pu avoir sur toi. Est-ce que c’est parce qu’il contient âme, ce mot. Amer. Caïn. Est-ce que c’est parce qu’on vient d’enterrer l’arrière-grand-père. L’œil dans la tombe. L’Hypnose de vouloir croire en quelque chose. Ces choses étranges que tu apprends au catéchisme. Je te rappelle les choses telles que je les ai vues et entendues. Rien de moins, rien de plus. D’ailleurs, Jennifer, si tu veux le savoir, je nie faire est beaucoup moins fort qu’Amer Caïn J’espère que tu t’en rends compte toi aussi à présent. Mon pauvre vieux, tu es tombé dans tous les panneaux. Heureusement que j’étais là, sinon je n’aurais pas donné cher de tes os. Il fallait que j’en aie, de la patience. Pourquoi ai-je eu tant de patience. Tu pourrais trouver ça suspect un jour. Une patience suspecte, c’est aussi bizarre qu’un rire triste, tu ne trouves pas.
No Outside
(2025-07-19 16:55:04|affdate|oui)The fact that it’s Saturday, again Saturday, always Saturday, that it comes back without anything changing, that I get up without wanting to, without momentum, without even proper tiredness, the fact that I haven’t done anything I should have done, that I didn’t open the file, didn’t read yesterday’s text, didn’t fix anything, that everything slips away from the moment I wake up, that everything weighs on me without weight, that the Dibbouk is there, waiting, that I pretend to wait for it, that I hope it’ll speak for me, the fact that I cross out, that I go back, that I freeze, that I repeat, that every word slips through my hands, that everything is lukewarm, blurry, slow, and that I want it to move, to leave, to blow up, to tear itself away, that I type faster, that I drown the silence in lines, that I get lost in loops, in titles, in file names, in endless tags, the fact that I want to shake something in me, to get it out, to make it burst, but that nothing comes, that it stays there, stuck deep down, the fact that I try to write to escape what I’m writing, that I reread myself and everything puts me to sleep, that everything falls asleep with me, the fact that I think of other texts, of older ones, of the ones that changed nothing, that I search for a tone I’ve already worn out, that I repeat myself, that I pin myself inside my own sentences, that I go in circles, that I circle, that I circle again, that I feel this slowness like a threat, like a well, and that I run not to fall into it, the fact that it’s pointless, that it catches up with me, that I’m already in the well, in the hollow stomach of Saturday, in the short breath of everything I don’t do, that I struggle in sand, that I talk too much, that I think too much, that I think nothing, that I don’t think anymore, that I exhaust myself looking for an exit, a phrase, an image that might hold, the fact that nothing holds, that everything slips, that everything repeats, that Monday is approaching, that I’m already in Monday, in the soft dread of Monday, in the worn-out bottom of all my delays, that I’m still here, planted in this chair, that I’d like to get out of myself but that I’m me, that I’m here, again, again, again, that I’m alone in this inside without windows, that I’m trapped in everything I didn’t do, that I turn and I turn and I always fall back in the same spot, that I’m surrounded, surrounded from all sides, surrounded by myself, by everything I avoid, that I’m the echo of myself and that it doesn’t stop, that I don’t stop, that I don’t know how to stop myself anymore.
The fact that I stayed there, that I didn’t move, that I stayed in the same room, on the same chair, in the same sentence, that everything tightened around me, that I no longer knew how to get free, that the light didn’t change, that the screen stayed on without saying anything, that words kept spinning in circles in my mouth, that my throat tightened, that the inside became the only place, that I searched for air and found none, that every thought brought me straight to the next, that I couldn’t get out of myself, that nothing helped me escape, that I was caught in a soft net, in a lukewarm mass, in a float without beginning or end, that I stayed there waiting for a storm or a shock or a scream or a nothing, the fact that I emptied myself trying to run, that I wore myself out struggling against a weight without a name, that I collapsed without even falling, just sank a little deeper inside, that it quieted like that, not with peace but with extinction, and that little by little, breath returned, lower, longer, wider, that my hands came back, resting on the table, that my body remembered itself, that my legs felt their weight again, that sounds returned slowly, first the fridge, then a scrape against the window, then nothing, but a nothing that had presence, the fact that the ground rebuilt itself under my feet, not here but elsewhere, older, the fact that a field came back to me, a field of nothing, a field of always, with thick hedges, dogwood, brambles, nettles swollen with water, bright green, nearly shining, the fact that I could smell them without seeing them, that I walked through clover, that I was young, or old, or ageless, that I was there and nothing happened, that the sky was white, that it was hot, heavy, without drama, that cows lay at the far end, motionless, that flies flew low, slow, without aim, that the leaves didn’t move, that the wind had stopped looking, that I stood there for no reason, in wet grass, that the sounds were far off, muted, that the light had no direction, that I knew it would rain, but that it didn’t matter, the fact that the clouds swelled, that the sky stretched tight, that the day didn’t move, the fact that the rain finally came, wide, thick, without anger, that it fell on me like on everything else, that it washed me without insistence, that it cooled what it could, that the field began to breathe again, that the animals didn’t flinch, that everything simply stayed, just like that, exactly there, that I was inside it, that it had come back, the field, the calm, the grass, the water, the taste of sorrel, the weight of my arms, the silence after, and that it was exactly enough.
Sans dehors
(2025-07-19 16:54:30|affdate|oui)Le fait que c’est samedi, encore samedi, toujours samedi, que ça revient sans rien changer, que je me lève sans envie, sans élan, sans même une vraie fatigue, le fait que je n’ai rien fait de ce que j’aurais dû faire, que je n’ai pas ouvert le fichier, que je n’ai pas lu le texte d’hier, que je n’ai rien corrigé, que tout m’échappe dès le matin, que tout me pèse sans poids, que le Dibbouk est là, à l’attendre, que je fais semblant de l’attendre, que j’espère qu’il parle à ma place, le fait que je rature, que je reviens, que je bloque, que je répète, que chaque mot me glisse entre les mains, que tout est tiède, flou, lent, et que je veux que ça bouge, que ça parte, que ça explose, que ça s’arrache, que je tape plus vite, que je noie le silence dans les lignes, que je me perds dans les boucles, dans les titres, dans les noms de fichiers, dans les balises sans fin, le fait que je veuille secouer quelque chose en moi, faire sortir, faire jaillir, mais que rien ne vient, que ça reste là, collé au fond, le fait que j’essaie d’écrire pour échapper à ce que j’écris, que je me relis et que tout m’endort, que tout s’endort avec moi, le fait que je pense à d’autres textes, à des anciens, à ceux qui n’ont rien changé, que je cherche un ton que j’ai déjà usé, que je me répète, que je m’épingle dans mes propres phrases, que je tourne en rond, que je tourne, que je tourne encore, que je ressens cette lenteur comme une menace, comme un puits, et que je cours pour ne pas y tomber, le fait que ça ne sert à rien, que ça me rattrape, que je suis déjà dans le puits, dans le ventre vide du samedi, dans le souffle court de tout ce que je ne fais pas, que je me débats dans du sable, que je parle trop, que je pense trop, que je pense rien, que je ne pense plus, que je m’épuise à chercher une issue, une phrase, une image qui tiendrait, le fait que rien ne tienne, que tout glisse, que tout se répète, que lundi approche, que je suis déjà dans lundi, dans la peur molle de lundi, dans le fond usé de tous mes retards, que je suis encore là, planté dans cette chaise, que je voudrais sortir de moi mais que je suis moi, que je suis là, encore, encore, encore, que je suis seul dans ce dedans sans fenêtres, que je suis à l’intérieur de tout ce que je n’ai pas fait, que je tourne et que je tourne et que je tombe toujours au même endroit, que je suis cerné, cerné de partout, cerné par moi, par tout ce que j’évite, que je suis l’écho de moi-même et que ça ne s’arrête pas, que je ne m’arrête pas, que je ne sais plus comment faire pour m’arrêter.
Le fait que je sois resté là, que je n’aie pas bougé, que je sois resté dans la même pièce, sur la même chaise, dans la même phrase, que tout se soit resserré autour de moi, que je n’aie plus su comment m’en défaire, que la lumière ne changeait pas, que l’écran restait allumé sans rien dire, que les mots tournaient en rond dans ma bouche, que la gorge se serre, que l’intérieur devienne l’unique endroit, que je cherche l’air et que je n’en trouve pas, que chaque chose pensée ramène à la suivante, que je ne sorte pas de moi, que rien ne m’aide à sortir, que je sois pris dans un filet mou, dans une masse tiède, dans un flottement sans début, sans fin, que je sois resté là à attendre un orage ou un choc ou un cri ou un rien, le fait que je me sois vidé à force de vouloir fuir, que je me sois épuisé à lutter contre un poids sans nom, que je me sois effondré sans même tomber, juste tassé un peu plus dans le dedans, que ça se soit calmé comme ça, non par paix mais par extinction, et que peu à peu, le souffle revienne, plus bas, plus long, plus large, que les mains soient revenues, posées sur la table, que le corps se rappelle à moi, que les jambes reprennent leur poids, que les sons reviennent lentement, d’abord le frigo, puis un frottement contre la vitre, puis plus rien, mais un plus rien habité, le fait que le sol se refasse sous mes pieds, pas ici mais ailleurs, plus ancien, le fait qu’un champ me revienne, un champ de rien, un champ de toujours, avec des haies épaisses, du cornouiller, des ronciers, des orties grasses pleines d’eau, vertes, presque brillantes, le fait que je sente leur odeur sans les voir, que je marche dans le trèfle, que je sois jeune, ou vieux, ou sans âge, que je sois là et qu’il ne se passe rien, que le ciel soit blanc, qu’il fasse chaud, lourd, sans drame, que les vaches soient couchées dans le fond, immobiles, que les mouches volent bas, lentes, sans intention, que les feuilles ne bougent plus, que le vent ait cessé de chercher, que je sois debout sans raison, dans l’herbe humide, que les sons soient lointains, éteints, que la lumière n’ait pas de direction, que je sache qu’il va pleuvoir, mais que cela ne change rien, le fait que les nuages gonflent, que le ciel se tende, que le jour ne bouge pas, le fait que la pluie vienne enfin, large, épaisse, sans colère, qu’elle tombe sur moi comme sur le reste, qu’elle me lave sans insister, qu’elle rafraîchisse ce qu’elle peut, que le champ respire à nouveau, que les bêtes ne bronchent pas, que tout reste, simplement, là, exactement là, que je sois dedans, que ce soit revenu, le champ, le calme, l’herbe, l’eau, le goût d’oseille, le poids de mes bras, le silence après, et que ce soit exactement assez.
indexeur d’ombres
(2025-07-16 18:57:52|affdate|oui)Je commence par vider le bac. Papier thermique, fin, parfois encore tiède. Ils tombent en vrac, les uns sur les autres. Pliés, déchirés, effacés. Il faut les lisser, les aplatir, les aligner à la lumière. J’en attrape un, puis un autre, j’enchaîne. Les chiffres sautent aux yeux. Douze virgule trente-quatre, code manquant, remise oubliée. Ça ne prend pas longtemps quand on a le geste. Ce n’est pas que je réfléchis, c’est que je vois où ça cloche. Je stabilote parfois. Je coche. Je classe.
Je travaille dans une pièce sans fenêtres, sous un néon blafard. Au bout du couloir, il y a la machine à café. L’odeur y stagne. Lino usé, meubles de récup, murs beige sale. On entend les bips des caisses au loin, les bruits de porte automatique. Personne ne parle beaucoup ici. On arrive, on se connecte, on scanne, on valide. Il y a deux écrans, un clavier, un logiciel un peu vieillot. On nous a dit de ne pas chercher à comprendre, juste à corriger. On appelle ça "régulariser".
J’arrive chaque matin en RER. Deux lignes à prendre, et dix minutes à pied à travers la zone commerciale. Le trajet, c’est là que je pense. J’observe les autres, les sacs, les gestes. C’est aussi une façon de m’échauffer. Ce que je fais ensuite au bureau, c’est pareil, en plus abstrait. Je rassemble, je classe, je répare. Les lignes s’alignent, les erreurs se gomment. Parfois un ticket bloque : total incohérent, client inconnu, retour non soldé. Alors je remonte, ligne par ligne, j’ajuste.
On ne voit jamais les gens. Rien que les traces. Des courses, des promotions, des habitudes. Des dates. Des achats groupés ou dérisoires. On s’y habitue. Il ne faut pas lire trop dans les tickets. Mais ça revient. Des listes de goûters d’enfants, des packs de bière, du lait, des croquettes, des vêtements à dix euros. On recompose sans vouloir. Une sorte de silhouette floue. Pas de nom, pas de visage. Juste des flux. Des marques de passage. Des mini-biographies. Éphémères.
Personne ne parle de ce qu’on fait ici. Ce n’est pas un métier qu’on raconte. Même le titre n’existe pas vraiment. Sur le contrat, il est écrit : "opérateur de validation post-caisse". Mais entre nous, on dit juste "le back", ou "l’indexation". Moi je dis rien. Je fais mes heures. Je classe les tickets.
— -
Elles sont là, tout le temps. Pas devant moi. Pas en vrai. Mais dans ma tête. Une présence latente, continue, comme un bruit de fond qu’on oublie un moment puis qui revient — quand on s’y attend le moins. Elles apparaissent souvent dans le RER. À l’heure calme du matin, ou quand la rame ralentit à quai. Elles sont debout, les bras croisés, concentrées sur leur téléphone, ou assises près de la vitre, les paupières mi-closes. Je ne leur parle pas. Je ne saurais pas comment. Mais elles m’accompagnent.
Au travail, elles reviennent par fragments. Un prénom sur un ticket, une trace de rouge à lèvres sur un bord, une écriture ronde griffonnée au dos. Parfois une carte de fidélité oubliée, un ticket double avec deux paiements distincts, comme un couple qui fait ses comptes à part. Parfois un parfum, infime, resté sur le bord de la machine. Il me vient des histoires. Je ne les écris pas, je ne les dis pas, mais elles naissent à l’intérieur. Des femmes qui viennent faire leurs courses le soir, seules ou avec des enfants, pressées ou ralenties. Des femmes qu’on devine fortes, ou fatiguées, ou drôles. Je ne fais que les croiser sans qu’elles sachent.
Il y a des jours où ça me fatigue d’être à ce point traversé. Ce n’est pas du désir, pas seulement. C’est autre chose. Une forme de tension permanente. Une attente, peut-être. Comme si je passais ma vie à les entrevoir, sans jamais pouvoir m’inscrire dans leur monde. Même quand elles me regardent — ce qui est rare — je détourne les yeux. Je souris, mais trop tard. Ou pas du tout.
Il y en a eu une, une fois. On a pris le même train pendant trois semaines. Elle montait à la même station que moi, s’asseyait toujours côté fenêtre. On s’est parlé deux fois. Je ne me souviens pas exactement des mots. Mais je me souviens de la voix. Basse, nette. Elle m’a demandé l’heure. Puis un jour, elle n’est plus montée. Et j’ai mis du temps à comprendre qu’elle ne reviendrait pas.
Depuis, je fais comme si. Je fais mes heures. Je scanne mes tickets. Je laisse passer les silhouettes dans les wagons, dans les rayons, dans les rêves. Elles forment une sorte de cortège silencieux, un ballet flou, jamais tout à fait là, jamais complètement ailleurs. Et moi, je reste au milieu. Indexeur d’ombres. Agent de passage.
Public Transport and the Station Hall
(2025-07-16 18:14:17|affdate|oui)I just took out a small consumer loan. I’d had it with the three-hour public transport routine. Lyon to Saint-Laurent-de-Mûre isn’t far — maybe twenty kilometers — but by train or bus it’s at least an hour and a half each way. One day at a time, it’s fine. But six months like that wears you down. I know what I’m talking about.
This morning I passed the Chronopost warehouse. Still in shadow. The trucks were half-asleep, engines off, lights dead. That’s when it hit me : I finally have a car. Not new, nothing fancy, but it starts, it moves, it gets me there and back. That’s all I want from it. I thought again about the loan, the woman on the phone. “Do you have a permanent contract ?” she asked. And I said yes. That felt good. But when I told her what I do, there was this little silence. Nothing big. Just a pause. Then she started asking about the rates. She had questions. I guess they’re not monitored over there. I’m not either. Nobody’s watching me on the job. Not filming me, anyway. Not that I know of.
I park behind the building, on the edge of the slab. The concrete is still wet in places. There’s dew on the skinny grass by the curb. I get out. The ground crackles underfoot like I’m walking on bones.
The building’s a plain concrete block, square, nameless. One long window strip runs across the front, but you can’t see through it. First time I came, I thought I had the wrong place. Inside, it’s clean, cold, functional. Smooth floor, bare walls. Everything echoes halfway. The machines are black, massive, silent. Cremation furnaces. The one I use most often is called Rouge-Gorge. It says so on the plate. First time I saw it, I smiled. I haven’t smiled since.
There are yellow pipes, cables, control panels, green and red buttons, a polished metal lever. Every morning, I change, check the lights, roll the cart, open the door. I place the body. I’m careful with the paws. Always. It’s a habit.
Some days are quiet. Some are full. Small ones, big ones. Mostly dogs. Some cats. Once in a while, something else. I don’t read the names. I mean, I do. But not out loud.
At the end, we seal the urn, label it, slide the sheet inside the box. And we add the small white envelope. Inside, a card. Three seeds. “Plant these in memory of your companion.” I can’t stand that word anymore — companion. Too common. Too sad. Too much.
One time, I opened the envelope. Just curious. The seeds were black. Tiny. I almost kept them. But I closed it up.
I wonder if people actually plant them. If they scatter the ashes under a cherry tree, if they sow and water and wait. If they walk past that little patch of earth every day thinking, This is where Ramsès lies. Or Chiffon. Or Lola.
It gets to me. Not enough to cry. But something stays. On the edge. Like the tufts of grass that grow in the cracks of the slab. You tear them out. They come back.
This morning, pushing the cart, I felt it come again. One of those thoughts you don’t call for, but they show up anyway. For me to exist, to open the door to this furnace — how many generations did it take to get here ?
Then I thought about my father. He’s been with me most days since I started this job. Back when I still took the train, the bus, he used to sit next to me. Not for long. Pretty soon someone would come and sit right down on top of his memory. Driving is better. No doubt.
My mother’s there too, most days. She prefers the viewing rooms. She’ll tap me gently on the shoulder. "That’s good, son. I’m so glad you’re being useful. I’ll sit for a while, don’t mind me." She likes the quieter room, the one with the grey chairs and soft light.
There’s cousin Karl, the twin nieces Astrid and Liliane. Death hasn’t changed them. Still teasing each other, shouting, laughing, running off down invisible halls.
Sometimes I’m just there, in front of the damn furnace, and it’s all of them around me. And more. And more again. A whole train station some days. People dressed in old clothes — some with lace collars, others in rags, others still in animal skins, wooden shoes, old leather coats. They drift. They stand. They look around.
And then there’s the animals, of course. Swarming, restless. Darting through the room like it’s all a game. Pretending to bark, meow, screech, flutter. But they can’t. Not really. Not like the human dead. They don’t speak in your head. They don’t leave words behind. They’re here. But they pass through.
transports en commun et hall de gare
(2025-07-16 18:09:22|affdate|oui)Recto
Je viens de faire un petit crédit à la consommation. Marre de me taper trois heures de transports en commun. Lyon – Saint-Laurent-de-Mûre, ce n’est pas que ce soit loin, une vingtaine de kilomètres à peine, mais en train ou en bus, c’est minimum une heure et demie le matin, et autant le soir. Sur une journée, ça va. Sur six mois, ça devient une forme de punition. Je sais de quoi je parle. Ce matin encore, en voiture, j’ai longé l’entrepôt Chronopost. Il était encore dans l’ombre, les camions dormaient debout, moteurs froids, phares éteints. C’est à ce moment-là que je me suis dit : j’ai enfin une bagnole. Pas neuve, pas brillante, mais elle démarre, elle roule, elle me ramène. C’est tout ce que je lui demande. J’ai repensé au crédit, à la femme au téléphone, celle de la société de financement. Elle m’avait demandé : « Vous avez un CDI ? » Et j’ai pu dire oui. Quel pied. Mais quand j’ai précisé mon métier, il y a eu un blanc. Rien de bien méchant, une seconde suspendue, mais je l’ai bien senti. La conversation a dérivé sur les tarifs. Elle avait pas mal de questions. Ils doivent pas être écoutés dans leurs bureaux. Moi non plus je ne suis pas écouté pendant le boulot. Je ne suis pas filmé non plus. Enfin… pas à ma connaissance.
Je me gare au bord de la dalle, derrière le bâtiment. Le béton est encore mouillé par endroits. Il y a de la rosée sur les touffes d’herbe maigres qui poussent le long des bordures. Je descends de la voiture, et ça craque sous mes pieds comme si je marchais sur des os. Le bâtiment lui-même est un bloc de béton rectangulaire, nu, gris, sans nom. Une longue bande vitrée court le long de la façade, mais on voit rien à travers, à peine quelques reflets. On dirait un centre de tri désaffecté, ou une piscine municipale fermée pour travaux. Quand je suis venu la première fois, je croyais m’être trompé d’adresse.
Dedans, c’est propre, froid, fonctionnel. Tout est béton, sol lisse, murs nus, éclairage neutre. Les machines sont noires, massives, silencieuses. Des fours. Le mien s’appelle Rouge-Gorge. C’est écrit dessus. Ça fait sourire la première fois. Après, non. Il y a des tuyaux jaunes, des câbles, des écrans de contrôle, des boutons rouges, des boutons verts, un manche en métal poli. Chaque matin, je mets ma tenue, je vérifie les voyants, je fais rouler le chariot, j’ouvre la porte. Je place le corps, je fais attention aux pattes. Toujours. C’est une habitude.
Les jours pleins, ça s’enchaîne. Des petits, des gros, surtout des chiens. Quelques chats. Parfois autre chose. Je lis pas les noms. Enfin si, mais pas à voix haute. À la fin, je referme l’urne, je colle l’étiquette, je glisse la fiche dans la boîte. Et je joins la petite enveloppe blanche. Dedans, une carte. Trois graines. « À planter en mémoire de votre compagnon. » Je supporte plus ce mot. Compagnon. Trop utilisé, trop triste, trop faux aussi. Une fois, j’ai ouvert l’enveloppe, juste pour voir. Des graines noires, minuscules. J’ai failli les garder. Puis je l’ai refermée.
Je me demande si les gens les plantent vraiment. Est-ce qu’ils versent les cendres sous un cerisier ? Est-ce qu’ils sèment, arrosent, attendent ? Est-ce qu’ils passent tous les jours devant le petit coin de terre en se disant : ici repose Ramsès. Ou Chiffon. Ou Lola. Moi, ça me touche un peu. Pas au point de pleurer. Mais ça reste là, en bordure. Comme les touffes d’herbe dans les joints de la dalle. On les arrache. Elles reviennent.
Verso
Je l’ai senti venir ce matin, pendant que je poussais le chariot. Une de ces pensées que j’ai pas appelées, mais qui débarquent quand même, entêtées. Pour que moi j’existe, que j’ouvre la porte de ce four, il a fallu combien de générations avant moi pour qu’on en arrive là ? Je sais pas d’où elle vient, cette phrase, mais elle revient. Toujours. Elle flotte un moment, se cale dans la nuque, reste là.
J’ai pensé à mon père. Il m’accompagne presque tous les jours depuis que j’ai pris ce boulot. Avant, il s’asseyait à côté de moi dans le train ou dans le bus. Mais ça durait jamais longtemps. Très vite, quelqu’un s’asseyait sur son souvenir. En voiture, on est mieux. Je le sens là, tranquille, silencieux. Ma mère aussi est souvent présente. Elle préfère les salons de recueillement. Elle me met une petite tape sur l’épaule, penchée un peu, les cheveux relevés comme à l’époque : « C’est bien, fils. Je suis tellement contente que tu te rendes utile. Je te laisse un moment, je vais m’asseoir au salon. » Elle aime bien le salon d’à côté, celui avec les fauteuils gris et la lumière indirecte.
Il y a aussi le cousin Karl, les deux nièces jumelles, Astrid et Liliane. La mort ne les a pas changées. Toujours en train de se chamailler, de rire, de courir d’une pièce à l’autre. Et parfois, quand je suis là, devant ce putain de four, c’est tout ce monde-là qui m’accompagne. Et puis il y en a d’autres. Des morts inconnus. Des morts lointains. Un véritable hall de gare certains jours, avec leurs costumes d’époque, leurs allures de travers. Certains avec des fraises autour du cou, d’autres en haillons, d’autres encore avec des peaux de bête, des sabots, des valises en cuir. Ça murmure, ça passe, ça stationne, ça observe.
Sans oublier la foule des bestioles, bien sûr. Elles courent partout, elles jouent les vivantes, elles font semblant de japper, de miauler, de caqueter, de piailler. Mais en vrai, on voit bien qu’elles ne peuvent pas. Elles ne sont pas comme les morts humains. Elles n’ont pas cette voix qui reste dans la tête. Elles sont là, pourtant, on les devine, minuscules ou massives, mais elles ne parlent pas. Elles ne hantent pas. Elles passent.
A House Like Any Other
(2025-07-13 12:18:35|affdate|oui)Recto
It was a simple house. One storey, plus an attic. Like most of the houses along Charles Vénuat Road, in the La Grave district of Vallon-en-Sully. Nothing special from the outside, unless you knew.
In the cellar, crates of potatoes laid on old sheets of La Montagne, the local paper. Shelves, uneven and makeshift, lined the walls — jars of green beans, peas, cherries soaked in liquor, syrupy prunes. It smelled faintly of damp earth and vinegar. It wasn’t used often, but everyone knew what was there.
Upstairs, the attic held what no one dared to throw away. A trunk of letters with no names. A biscuit tin filled with faces no one could place. The dust had settled over generations. There were hats in round boxes, gloves in pairs or alone, scarves too thin to be useful. It was all left as it was. Maybe another time.
Charles Brunet lived on the ground floor. Eighty-five. Retired schoolteacher. Former town clerk. He said things like that, as if they mattered. He walked to the village each morning to buy his paper, no matter the weather. Back home, he did his crossword. He said it gave structure to the day.
Above him lived a family. The father sold asphalt for a roofing company. The mother sewed from home. Two children — seven and four — had picked up the local accent. “It’s better that way,” she’d said once, “they fit in better.”
Nothing changed much. That was part of its comfort.
verso
We were coming back from Saint-Bonnet. Lunch in Hérisson, cheap, nothing special. I pointed to the house as we drove past.
“Stop,” my wife said. I hadn’t meant to. I slowed down, but I hadn’t meant to stop. I pulled over.
From the outside, it was the same house. But something had gone. The ivy was gone from the bricks. The row of apple trees behind — gone. Even the old cherry tree had been cut down. Everything looked new. Clean. Too clean.
I crossed the road alone. I didn’t want to stay. “Wait,” my wife said.
A woman arrived by bicycle. She looked at us. Not rude. Just cautious. She opened the gate.
My wife spoke. “Are you the owner ?” “Yes,” the woman said. Her voice was sharper now.
“My husband grew up in this house.”
That made it worse.
She spoke of the purchase. “Your father was an unpleasant man,” she said.
I wanted to leave. I didn’t want to know why. I already knew, I suppose. Or feared I did. I felt ashamed. Of him, and then, quickly, of myself.
“Let’s go,” I said.
Another man appeared. Moped. Blue. The kind we used to call les bleues. The woman’s voice hardened. “We have nothing to say to you.”
We left. I haven’t been back since.
une maison parmi d’autres
(2025-07-13 12:18:00|affdate|oui)recto
C’est une maison simple. Elle ressemble à tant d’autres, le long de la rue Charles Vénuat, quartier de La Grave, à Vallon-en-Sully. Un rez-de-chaussée, un étage. Une cave, un grenier.
Au rez-de-chaussée vit Charles Brunet. 85 ans. Ancien instituteur et secrétaire de mairie. Il dit que sa vie est réglée comme du papier à musique. Chaque matin, il trempe le pain de la veille dans un bol de café noir, sans sucre. Il se lave le visage dans l’évier de la cuisine, s’habille lentement, et part, à pied, jusqu’au village, à quelques kilomètres. Qu’il pleuve ou qu’il gèle, il va chercher son journal. Ensuite, il fait ses mots croisés. Le reste de la journée.
À l’étage vit une famille. Le père est voyageur de commerce pour une société de revêtements bitumineux. Il part tôt, revient tard. La mère est couturière à domicile. Elle reçoit dans la salle à manger, les volets souvent à demi clos. Les enfants ont sept et quatre ans. Ils parlent avec l’accent du coin, pour ne pas qu’on les traite de Parisiens. C’est mieux, disent-ils, pour avoir des copains.
Dans la cave, les pommes de terre sont rangées dans des cagettes tapissées de feuilles de La Montagne. Sur des étagères bricolées : haricots verts, petits pois en bocaux. Cerises à l’eau-de-vie, prunes au sirop. La cave est une réserve. On n’y va pas tous les jours, mais on sait ce qu’il y a.
Le grenier est en désordre. On y monte par un escalier large. En dessous, une penderie : parkas, manteaux, costumes de laine. Au-dessus, des boîtes en carton et en métal : chapeaux passés de mode, chaussures, foulards, gants. Dans le grenier lui-même : des lettres sans signature, des photos sans noms. On imagine des visages, des noms oubliés. Puis on referme la malle.
verso
J’ai garé la voiture devant la maison. Nous revenions de Saint-Bonnet, nous avions déjeuné à Hérisson, au pied du château. Un petit établissement, repas à moins de 15 euros. -- Arrête-toi donc, m’a dit mon épouse quand je lui ai montré la maison. J’allais passer sans m’arrêter. J’avais ralenti pourtant. Mais je me suis arrêté.
C’était la même maison en apparence, mais comme vidée de quelque chose. Quelque chose d’indéfinissable.
Le lierre avait été arraché de la façade. La rangée de pommiers, celle qui séparait la cour du jardin potager, avait disparu. Même le vieux cerisier n’était plus là. Tout était propre, net. Trop.
Je regardais ça de l’autre côté de la route. J’avais envie de repartir. -- Attends, a dit mon épouse.
C’est là qu’une femme est arrivée, à vélo. Elle nous a regardés, méfiante. Elle a ouvert le portail, a fait entrer son vélo.
C’est mon épouse qui a parlé. Moi, je ne pouvais pas. -- Vous êtes la propriétaire ? -- Oui, a répondu la femme, mais son visage s’est encore durci. Elle ne comprenait pas ce qu’on faisait là. -- Mon mari a vécu dans cette maison, enfant, a dit mon épouse.
Alors c’est devenu pire. La femme a parlé de l’achat de la maison. -- Votre père était un type infect, elle a dit.
Je voulais repartir. Ça n’avait plus aucun sens. Je ne voulais pas savoir. Je savais déjà, ou je me doutais. Honte de lui. Et, tout de suite, honte de moi. Honte de tout.
-- Viens, j’ai dit. On s’en va. Ça ne sert à rien.
Un autre type est arrivé. À mobylette. Une bleue. Comme on disait autrefois. -- On n’a rien à faire avec vous, a dit la femme, quand elle l’a vu. On est repartis. Je ne suis jamais repassé devant la maison depuis.
Je peux vous appeler Malone ?
(2025-07-10 18:06:53|affdate|oui)Recto
Je me souviens. Poupées russes. Un malentendu, certainement. Des silhouettes dans une rue. Bonjour. Une question inattendue.
-- Tu les connais, ces gens ? — Non. Je croyais qu’il fallait dire bonjour à tous les gens qu’on croise dans la rue.
C’était pas grave, en apparence. Mais il y avait ceux à qui l’ on pouvait, et tous les autres à qui on ne pouvait pas. C’était déjà assez compliqué comme ça pour faire face aux masques. Il fallait d’urgence s’en composer un nouveau, celui de l’indifférence. On ne pouvait pas encore savoir s’il était bien commode. Si on était vraiment à l’abri derrière ce masque. Ça rendait assez maladroit, surtout si on oubliait qu’on se baladait avec.
Comme toujours, on exigeait de soi un choix, une décision : l’indifférence, ou pas.
Verso
Je me retournai et il était assis sur ma propre chaise. J’avais été comme éjecté de celle-ci par une force centripète. Aplati contre un mur de la pièce, je reprenais mon souffle. Le choc, comme toujours, avait été violent. Il me fallait un peu de temps. Quand je me suis senti enfin prêt, je me suis donc retourné, et j’ai vu le malentendu dans le blanc des yeux, si je peux dire.
Il n’avait rien d’extraordinaire. C’était un de ces pauvres types comme on en croise à chaque coin de rue. Il était d’une banalité à pleurer. Cependant, comme nous étions seuls à présent, et que je ne savais plus où j’avais foutu mon masque d’indifférence pour me protéger, je me sentais nu, et je vis que le malentendu était nu lui aussi. Nous étions face à face et complètement nus. La situation, elle, n’était tout de même pas banale. Peut-être que ça rattraperait un peu les choses, m’étais-je dit. Et aussitôt, j’éprouve l’envie irrépréssible de le dire à voix haute : « Vous avez remarqué que nous sommes face à face et totalement nus ? »
J’hésitais sur la façon de le nommer. « Monsieur le Malentendu » paraissait un peu pompeux, voire obséquieux. « Malentendu » tout court , trop familier. Même si on se connaissait depuis belle lurette, ce n’était pas une raison pour se ruer dans la trivialité. Du coup, comme le malentendu de nommer le malentendu se faisait pressant, j’exposai ma difficulté : -- Comment dois-je vous appeler ? -- J’étais en train de me poser la même question, c’est cocasse, me répondit-il. Peut-être que l’on pourrait rester chacun dans un état innommable, si cela vous va, continua-t-il.
Je pensais à Sam et à Monsieur Hackett, puis je me mis à penser à un banc public. Je me souvins tout à coup que ce genre d’objet m’appartenait et que je pouvais en user à ma guise puisqu’il s’agissait d’un bien public. Ce qui n’était pas la même chose que d’être ici, dans cette pièce, où chacun des meubles qui la meublent est une propriété personnelle, certes, mais sur lesquels le malentendu peut s’asseoir quand ça lui chante.
Je ne suis pas enceinte, me dit Malone. Vous pouvez m’appeler Malone, me dit-il. Je vous ferai grâce des dîners au caneton. Puis il jeta un coup d’œil à sa montre et il me regarda sans rien dire. Un moment, un avion passa. -- Vous vouliez me demander quelque chose de précis ? reprit-il.
C’était tellement abrupt après cette courte période de silence et de léger malaise que je ne sus quoi dire immédiatement. Ce qui ouvrit soudain la porte, légèrement, à peine un entrebâillement, à tout un univers derrière celle-ci que je reconnus aussitôt à l’odeur. Une odeur de poussière déposée depuis belle lurette sur des meubles que l’on n’a pas utilisés depuis des lustres.
Il y avait là aussi un certain nombre de sensations paradoxales. Des draps rêches en lin invitant à se glisser dedans comme dans une armure en fer mais au final tout à fait confortables par temps chaud. Une peluche borgne aimée mais qui paraissait tellement abandonnée qu’un sentiment de culpabilité vous prenait aussitôt à la gorge. Un rai de lumière avec des milliers de grains de poussière traversant l’espace pénombreux d’une chambre à coucher d’enfant.
Il me fallut très peu de temps pour me rendre compte que tous ces objets, ces lieux, m’avaient un jour appartenu. Autant qu’un objet ou un lieu peut appartenir à qui que ce soit, d’ailleurs. Je les regardais et je me rendais compte qu’ils ne m’appartenaient plus. Ils m’avaient appartenu comme s’ils m’avaient laissé ma chance et que je ne l’eusse pas saisie au bon moment pour pouvoir les conserver.
Malone toussa et je compris que ça voulait dire que je m’étais égaré dans le souvenir et que ça ne l’intéressait pas du tout. -- Vous m’avez convoqué pour autre chose que la réminiscence de ces fadaises, dit-il sur un ton pointu de Parisien.
Ce qui évidemment me poussa immédiatement hors de ma rêverie. Et je l’en remerciais. -- Merci, mille fois merci. Sans vous, cher Malone, ça aurait pu durer des heures, voire des jours et des nuits.
Allons droit au fait ajouta-t-il en se détendant un peu, passant une jambe sur l’autre et renversant son buste en arrière pour bien la caler sur le dossier de la chaise.
C’est mon problème, lui avouai-je. Aller droit vers un but. J’adorerais pouvoir le faire, croyez-moi, mais aussitôt que je mets un pied devant l’autre il se passe quelque chose de fort étrange, la ligne devient courbe et je finis par tourner en rond.
Il rit. Vous êtes un drôle de zigoto, vous… À un moment je cru qu’il allait me nommer Watt mais il se retint. Ce qui me procura une légère sensation de plaisir. -- Vous alliez m’appeler Watt ? l’interrogeai-je. -- Vous êtes en train d’esquiver, me répondit-il.
Je n’esquive rien, je suis même dans le centre du problème je crois. Il faut que je vous le dise : je sens les choses, Malone, mais je m’exprime mal. Je devrais plutôt dire « je sens des choses » car je ne suis pas certain que ces choses existent vraiment, et que je puisse en parler.
-- Quelles choses, bon dieu, parlez ! hurle-t-il.
Et là je me souviens qu’il faut me recroqueviller jusqu’à réduire mon corps tout entier pour n’occuper qu’un minuscule point dans l’espace. -- Où êtes-vous donc passé ? me demande Malone. -- Je suis là, baissez les yeux, regardez là entre deux fentes du parquet, ce point noir. -- Et ça vous amuse ? (il rit) -- Je ne crois pas. C’est une sorte de réflexe : dès que ça hurle, je me transforme en point. -- Tant que ce n’est pas un point final…
-- Allez-y, moquez-vous, j’ai l’habitude, vous savez. -- Ah, voici enfin un sujet intéressant, (Malone décroise les jambes et se penche en avant au-dessus du point que j’essaie de maintenir en invoquant toutes mes ressources d’« à quoi bon puisque personne ne me comprend, puisque personne ne m’aime, puisque personne ne voit que j’existe »)
-- Que faites-vous vraiment pour exister ? reprend Malone. -- Je me dis que j’écris. -- Et vous le faites ? -- Oui, tous les matins j’écris entre 1000 et 1500 mots. -- Et ça vous sert à quoi ? -- À rien. Faut-il donc que les choses servent toujours à quelque chose ? J’existe ainsi « pour rien » si vous préférez. -- Si vous écrivez, c’est pour être lu, n’est-ce pas ? reprend Malone. -- Non. C’est ce que j’ai cru durant des années, mais ça aussi, ça m’est passé.
Le malentendu fit une drôle de moue puis il sifflota. -- À quelle heure est la bouffe dans cette baraque ?
-- Vous esquivez quelque chose, Malone. Ce coup-ci, c’est votre tour, je le vois bien. -- Non, je n’esquive rien du tout. Quand je m’ennuie, j’ai faim. -- Moi aussi, tiens, répondis-je.
-- Ça nous fait au moins un point commun. Vous auriez du caneton ?
Et de nous tenir les côtes, et de rire, et de pleurer soudain à chaudes larmes.
I Could Call You Malone.
(2025-07-10 18:06:20|affdate|oui)Recto
I remember. Russian dolls. A misunderstanding, certainly. Shapes on a street. Hello. An unexpected question.
-- Do you know those people ? -- No. I thought you had to say hello to everyone you passed in the street.
It didn’t seem like a big deal. But there were those you could greet, and all the others you couldn’t. It was already hard enough dealing with masks. You had to urgently construct a new one—one of indifference. No one knew yet if it fit. Or if it really protected you. It made you clumsy, especially if you forgot you were wearing it.
As always, you were expected to choose : indifference, or not.
Verso
I turned. He was sitting in my chair. I had been ejected, it seemed, by some inward force. Pinned against a wall, catching my breath. The shock—always strong—needed time.
When I was ready, I turned again and looked him in the eye. The misunderstanding.
He looked ordinary. A nobody. Someone you’d pass without noticing. But we were alone now. And I had misplaced my mask of indifference. I felt exposed. So did he. We were both naked. That wasn’t ordinary. That redeemed the moment a little. I almost said it aloud : “You notice we’re both completely naked ?”
What to call him ? “Mr. Misunderstanding” felt pompous. Just “Misunderstanding” was too familiar. I voiced the dilemma : -- What should I call you ? -- I was wondering the same. Strange, isn’t it ? Maybe we could remain unnamed.
I thought of Sam. Of Mr. Hackett. Of a park bench. Those belonged to me. Public things. Unlike the chair. This chair was mine. But the misunderstanding could sit in it whenever he liked.
“I’m not pregnant,” he said. “Call me Malone. I’ll spare you the duck dinners.”
He glanced at his watch. Looked at me in silence. A plane passed.
-- Was there something in particular you wanted ? he asked.
His question hit hard after that silence. I had no reply. And the silence cracked the door open to a world behind it. A dusty smell. Furniture untouched for ages.
Rough linen sheets, like iron armor, strangely pleasant in the heat. A one-eyed stuffed animal. Loved once. Now so neglected it made me feel guilty. A shaft of light with dust specks floating in it. A child’s bedroom.
These things had once been mine. As much as anything can be. I saw them now and knew they weren’t. They had given me a chance. I had not taken it.
Malone coughed. A sign I was drifting. He wasn’t interested.
-- You didn’t call me here for nostalgia, he said sharply.
I snapped out of it. Thanked him. -- Thank you, truly. Without you, I’d have stayed in it for hours. Days.
Let’s get to the point, he said. Relaxed. Crossed a leg. Leaned back.
That’s my problem, I said. Getting to the point. I try. I take one step, then things curve. I end up circling.
He laughed. You’re a strange one. For a second, I thought you were Watt. He didn’t say it. That pleased me.
-- You were going to call me Watt ? -- You’re dodging, he said.
Not dodging. At the center, I think. I sense things, Malone. But I say them badly. Maybe they’re not even real. Maybe I shouldn’t speak of them.
-- What things ? Speak !
That’s when I remembered : I had to shrink. Fold inward. Become a point in space.
-- Where’d you go ? he asked. -- Here. Between the floorboards. That black dot.
-- Does it amuse you ? (he laughed) -- I don’t think so. It’s reflex. When someone shouts, I turn into a dot.
-- As long as it’s not a period.
-- Go ahead, laugh. I’m used to it.
-- Now that’s interesting, he said. (He leaned in. Looked closer at the dot I was holding together with all my “no one sees me, no one loves me” strength.)
-- What do you actually do to exist ? he asked. -- I tell myself I write. -- Do you ? -- Yes. Every morning. A thousand to fifteen hundred words. -- What’s it for ? -- Nothing. Must everything have a use ?
-- If you write, it’s to be read. Right ? -- That’s what I thought, once. Not anymore.
The misunderstanding made a face. Then whistled.
-- When do we eat in this place ?
-- Now you’re dodging, Malone. Your turn. -- I’m not dodging. I’m bored. When I’m bored, I’m hungry. -- Me too. -- That makes one thing we share. Got any duck ?
And we held our sides. And we laughed. And then cried. A lot.
Lettre à une amie de Toronto
(2025-07-08 09:11:15|affdate|oui)Lettre à une amie (FR)
Chère amie,
Je t’écris pour te faire part d’un petit travail d’écriture auquel je me suis livré ces derniers jours. Il est né d’un mot ancien — chemin — que j’ai voulu suivre, étymologiquement, poétiquement, comme on suit une piste. Puis ce mot a bifurqué : il m’a mené vers gambe, vers gamin.
Ces trois textes courts sont venus d’eux-mêmes, comme une séquence, comme un fil.
Je les ai écrits en français — mais très vite, j’ai senti que quelque chose pouvait s’ouvrir dans leur traduction : non pas une traduction littérale, mais une forme d’écho, de réponse en creux.
Alors j’ai pensé à toi, à ta manière d’écrire, à ton anglais si sensuel et sobre à la fois. Je t’ai imaginée recevant ces textes et y répondant dans ta langue, dans ton rythme. Voilà tout.
Tu es libre d’écrire ce que tu veux, comme tu veux.
Tendrement, P.
NB : J’ai essayé maladroitement de m’y mettre moi-même, mais la difficulté vient des étymologies parfois fort différentes entre nos deux langues, nos deux manières de penser. Peut-être cela t’indiquera-t-il mieux la béance à enjamber…
Letter to a friend (EN)
Dear friend,
I’m writing to share a little writing experiment I’ve been working on. It started with an old word — chemin — and I followed it, etymologically, poetically, like a trail. Then the word forked : it led me to gambe, and then to gamin.
These three short texts came on their own, like a sequence, like a thread.
I wrote them in French — but soon I felt something could open up through translation. Not literal translation, but a kind of echo, a response in reverse.
That’s when I thought of you, your way of writing, your English that’s both sensual and spare. I imagined you reading these pieces and responding in your own language, in your own rhythm. That’s all.
Write whatever you feel like.
Warmly, P.
PS : I clumsily tried myself at it — but the difficulty lies, perhaps, in how different our two languages are, how they carry thought. Maybe this will show you more clearly the gap to be crossed.
CAMINUS
Caminus est le passage, la voie que le feu trace, ou celle que l’on suit vers la maison, vers la lumière.
Le feu devient métaphore du chemin.
La parole aussi cherche une voie plus simple. Elle impose à la langue de chercher un son qui se plie, glisse, se palatise.
Le latin fixe le mot dans la pierre. Le roman le libère dans la bouche. Le français en fait un souffle intime.
GAMBE
Gambe vient de la courbure. Ce n’est plus la flamme, c’est le corps. Ce n’est plus la trace du feu, c’est la flexion du vivant.
La jambe marche, la langue suit. Les sons aussi veulent des articulations simples.
La gambe, c’est déjà une danse. C’est l’organe du déplacement, le rythme battu du mot.
GAMIN
Puis vient le gamin. Celui qui n’a pas de chemin tout tracé. Celui qui va.
Il marche en traînant, trotte sans passé, bricole son lexique dans la rue.
Il ne dit pas chez moi, il dit où on va ?. Il vit dans le bord du mot.
Hearth
(caminus → cheminée → hearth / fire)
Le foyer, lieu du feu, mais aussi lieu du mot : ce qu’on rallume pour se souvenir, ce qu’on entretient pour vivre.
The hearth was never just a place to burn wood. It was a place to burn silence. A place where words, too, caught fire. A mouth in the wall. A wound, a witness.
Limb
(gambe → leg / limb / gait)
Le membre, la marche, la trace du corps qui avance : entre pas et phrase, il y a un balancement, une articulation.
The limb bends before the step. Movement is memory. The body writes before the pen. Rhythm before sentence. The knee knows what the mouth forgets.
Waif
(gamin → waif / urchin / ragamuffin)
L’enfant sans lieu, sans repère fixe, sans voix assignée — et pourtant porteur d’une langue vivante, dérivée, vivace.
The waif has no address. Just corners, thresholds, puddles and echo. Language clings to him like wet cloth. No house, no name — but all the grammar of survival.
Réponse de mon amie (FR)
Cher P.,
J’ai lu tes textes comme on suit un sentier dans le brouillard. Chaque mot levait un peu la brume. Ce n’était pas une réponse que j’ai voulue formuler, plutôt un accompagnement, une manière de marcher à côté. Tes mots appellent les miens, mais différemment : en se dédoublant, en changeant d’eau, en changeant de langue.
Je t’envoie trois petits fragments, comme des pas en écho. Ils sont nés des tiens.
Avec chaleur, A.
My friend’s reply (EN)
Dear P.,
I read your texts like walking a path in the fog. Each word cleared a little of the mist. What I’ve written isn’t a reply, exactly — more a way of walking alongside. Your words called mine, but they came out altered : in another water, in another tongue.
So I’m sending you three short fragments, like steps in return. They were born from yours.
Warmly, A.
Caminus
fragment on fire and etymology
The Romans said caminus — furnace, hearth, the place where fire makes things soft.
I say chemin.
The fire doesn’t stay in one place. It leaves a trace. That’s the path. That’s the mouth learning to choose ease over fracture.
The stone says keep still. The tongue says let me go.
Gambe
fragment on limbs and names
You don’t walk with a word, but you carry it in your bones.
Gambe — a leg, a line, a curve.
Greek said kampe, meaning bend, meaning grief at the back of the knee.
The leg becomes a note. The note becomes a line. The line forgets where it started.
Walking is thinking. Thinking is folding the body toward a direction it doesn’t yet trust.
Gamin
fragment on boys, streets, and speech
The boy with no garden.
The boy who walks like language — always half-erased, with dust on his vowels.
They called him gamin, from gambin, from gambe.
His name was an accident of legs.
He walked. That was all.
He walked with his mouth open, and the street wrote itself into his breath.
Illustration / Visual
En souvenir de ces vacances que nous avions passées à Galway, 1982 — P. In memory of that summer we spent in Galway, 1982 — P.
8 juillet 2025
(2025-07-08 07:41:25|affdate|oui)Chez
Chez moi,
c’est difficile de dire chez moi.
Est-ce que je pense souvent à le dire ?
Non. Jamais.
Ce que je dis à la place de chez moi,
je dis dans la ville, dans la maison,
dans la chambre —
ça ne m’appartient pas.
Plus maintenant.
Je disais ma maison lorsque j’étais enfant.
Je disais aussi notre chambre,
puisque nous dormions là ensemble,
mon frère et moi.
Rarement mon jardin, mon école, mon village.
C’était plus loin,
même si c’était géographiquement proche.
C’était plus loin mentalement, enfant,
que mes parents, mon frère, ma maison.
Et si je traduis ce premier texte en anglais, c’est pour que son sens me revienne autrement surtout, en écho. par le son bien plus que par la pensée par le rythme par l’entremise d’une autre temporalité hachures et zébrures consonnes et voyelles chamboulement.
Home
Hard to say home.
Do I even think it, often ?
No. Never.
What I say instead of home
is the city the house, the room.
It’s never really mine.
Not anymore.
As a child I used to say my house.
I’d also say our room,
since my brother and I slept there, together.
Rarely my garden, my school, my village.
Though geographically close,
they felt further away than my brother,
my parents, my house.
If I translate this first text into English,
it’s not to understand it.
It’s so its meaning might return to me —
differently.
Through echo.
Through sound, more than thought.
Through rhythm.
Through another kind of time.
Scars and streaks.
Consonants and vowels.
Upheaval.
Pour que le home remplace ainsi le chez et que l’on parle soudain d’âme que d’un bien , d’un avoir . Car home c’est hâm c’est heim n’est-ce pas. le village natal je me demande ce qui me fait le plus d’effet vraiment. Est-ce le mot village ou le mot natal, est-ce les deux mis ensemble, difficile de le dire, difficile à haute voix.
For home to stand in for chez,
and for us to speak of soul
instead of asset, or possession.
Because home is hām,
is heim, isn’t it ?
The natal village.
I wonder what hits harder.
Is it village ?
Or natal ?
Or the two — stitched together ?
Hard to tell.
Harder still to say aloud.
Chez, dans l’espace,
c’est le lieu non vide — en apparence —
qui se distingue du vide omniprésent.
Chez Bertrand,
ce n’est pas comme chez Philippe,
ni comme chez Anne-Marie.
C’était toujours mieux que chez moi, enfant.
Je me souviens.
Je détestais dire on va chez moi.
Entraîner l’autre dans la détresse du chez moi.
In space, home is what pretends not to be void —
but only in contrast to all that is.
Bertrand’s place
was nothing like Philippe’s,
or Anne-Marie’s.
All of them were better than mine.
As a child, I remember that clearly.
I hated saying let’s go to my place.
As if I were leading someone
into the quiet wreck of it.
## L’entre-deux
Chez eux.
Je reviens à ça.
À chez moi, si l’on veut —
ce vide.
C’est à partir de là que,
après m’être élancé,
et m’être toujours heurté contre le même mur,
j’ai fait ce pas de côté.
J’ai découvert cet interstice.
Pas de chez eux.
Pas de chez moi.
L’entre-deux.
The In-Between
Their place.
That’s where I return.
To my place, maybe —
to the void.
From there,
after throwing myself forward
and hitting the same wall over and over,
I took a step aside.
And found an opening.
Not their place.
Not mine.
Just the in-between.
Chez nous
Chez nous était un songe.
On tendait la main pour toucher une limite,
mais il n’y en avait pas.
Chez nous était cette fiction,
nous servant de vérité temporaire.
Et nous tenions ainsi,
bon an mal an,
jour de soleil ou jour de pluie,
un temps de bon grain,
un temps d’ivraie.
Our place
Our place was a dream.
We reached out to touch a border —
but there was none.
Our place was a fiction
we used as a makeshift truth.
And we held on like that,
for better or worse,
in sun or in rain,
in the time of wheat,
in the time of weeds.
Chez soi
Oh, la tranquillité rêvée d’un chez soi
qui prend l’eau de toute part,
mais qu’on ne veut pas voir.
On dit comme on est bien chez soi.
On s’accroche tellement à ce comme on est bien
que c’en est louche —
mais on ne veut pas entendre.
On s’attend, dans le fond,
à quelque chose de terrible.
Quelque chose qu’on ne doit pas dire.
Qu’on ne doit jamais dire.
At Home
Oh, the dream of peace at home —
even as the walls leak from every seam,
and we refuse to see it.
We say there’s no place like home.
We cling so tightly to that no place like
it starts to feel suspicious —
but we shut our ears.
Deep down,
we’re expecting something awful.
Something that must not be said.
Something never to be spoken.
Chez l’hirondelle
Chez l’hirondelle,
ce mélange de terre et de paille
collé par la salive
me faisait quelque chose, enfant.
Je suis vieux maintenant.
Je sais que je parle d’un autre temps.
Les hirondelles sont devenues rares.
Elles ont peu à peu disparu avec le temps.
Chez l’hirondelle,
la salive est le ciment —
vous savez,
c’est quelque chose
comme une parole
qui se fait nid
sous les toits.
The Swallow’s Home
The swallow’s nest —
a mix of mud and straw
held together with spit —
used to stir something in me as a child.
Now I’m old.
I know I’m speaking of another time.
Swallows have grown rare.
They’ve faded, little by little, with the years.
In the swallow’s home,
saliva is the cement —
you know,
something like a voice
turning itself
into a nest
beneath the eaves.
a Profane Litany
(2025-07-07 19:26:44|affdate|oui)There Is
There is the crack, the fissure, the egg, the lime, the shell,
the split, the opening —
and what’s left behind, no longer of any use.
There is the surge, the rising sun, the song,
the bird, the weight of sky, the blue.
There is the breath, the pull of air,
lungs filled,
the wild cry,
the horse.
There is air.
There is the nothing,
the empty,
the space —
and the intent.
There is the moment —
the hand opening
with no thought
of love
or of killing.
There is life,
blood running its loops in vein and artery,
the heart beating.
There is the dance.
There is what one thinks,
what one thinks one thinks,
what one would rather not think
but thinks still.
There is fatigue.
There is the struggle.
There is ignorance, the unknown, the unknowable, the edge.
There is the shrinking ring of I-know,
growing smaller year by year.
There is the slip, the grip that tightens
on nothing —
fear.
And the act of letting go.
There is the fall —
a vertiginous plunge into a bottomless well
whose end we’ll never know.
There is time to get used to the fall.
That is its gift.
There is waking to the taste of ash,
the mud, the earth silencing the mouth.
There is silence.
There is waking to the crash of silence.
There is death.
There is night.
There is forgetting.
Absence.
The end of hoping.
The end of despair.
There is the nothing —
and its secret gift.
There is a rooster that cries.
A bell that rings.
There is the memory of swallows
and their nests of straw and dirt.
There is a second chance.
There is a spring.
And a line of chicks
crossing the mud
in the farmyard.
Yes
Yes — all of it is true, and none of it is.
It’s beyond judgment.
Yet judgment is what we’re left with.
Yes.
Yes — hatred comes easier to some,
and maybe it’s more honest
than the flattened “I love you”
we’re fed like milk gone sour.
Yes — people kill each other every day.
People save each other too.
And no one holds the scales
to say :
this is justice,
this is not.
Yes — beauty is not the most evenly shared thing in this world.
But it’s not the fault of ophthalmologists,
nor opticians,
nor pupils,
nor eyes.
Yes — the elements don’t care if you are kind,
or if you’ve tried to stay kind
for the last eight days.
Yes — what is just always seems closer
than what is not.
And yet, all of it is just —
when you think neither of yourself
nor of others.
Yes — we all die as we were born :
without reason,
without memory,
without any desire we can truly call our own.
Nothing ever belongs to us
but what we give
without meaning to.
Litanie profane
(2025-07-07 19:25:42|affdate|oui)Il y a
Il y a la fente, le craquement, l’œuf, le calcaire, la coquille, l’éclosion, l’ouverture
et il y a ce qui reste là qui n’est plus important.
Il y a l’élan, le lever du soleil, le chant, l’oiseau, la profondeur des cieux, le bleu.
Il y a le souffle, l’aspiration, l’air qui remplit les poumons, le hennissement, le cheval.
Il y a l’air, le rien, le vide, l’espace et l’intention.
Il y a le moment, la main qui s’ouvre sans pensée, pour aimer ou pour tuer.
Il y a la vie, le sang qui coule dans les veines, dans les artères, le cœur qui bat,
il y a la danse.
Il y a ce que l’on pense, ce que l’on croit penser,
que l’on imagine penser, ce que l’on ne voudrait pas penser
mais que l’on pense quand même.
Il y a la fatigue.
Il y a la lutte.
Il y a l’ignorance, l’inconnu, l’inconnaissable, la limite.
Il y a la petitesse du cercle des je sais qui s’amenuise au fil des ans.
Il y a ce glissement que l’on sent au bout des doigts,
ce crispement qui voudrait s’accrocher à quoi on l’ignore,
la peur.
Et il y a l’événement de l’abandon.
Il y a la chute vertigineuse dans un puits sans fond
dont on ne sait combien de temps elle durera.
Il y a le temps pour s’adapter à la chute,
et toute sa valeur enfin.
Il y a l’éveil au goût de cendre,
la boue et la terre qui terrasse,
la langue qui emplit la bouche.
Il y a le silence.
Il y a l’éveil au fracas du silence.
Il y a la mort, la nuit, l’oubli, l’absence
et la fin des espérances,
la fin des désespérances.
Il y a le rien qui contient son don.
Il y a un coq qui chante,
il y a une cloche qui sonne,
il y a le souvenir des hirondelles
et de leurs nids de terre et de paille.
Il y a une nouvelle chance.
Il y a un printemps
et toute une file de poussins
qui traverse la boue dans la cour de la ferme.
oui
Oui, tout cela est vrai et tout cela est faux.
C’est au-delà du simple jugement, et en même temps, il faut bien des jugements. Oui.
Oui, la haine est un réflexe pour certain(es), et sans doute plus honnête que la complaisance des je t’aime qu’on nous assène.
Oui, des gens s’entretuent tous les jours.
Mais des gens aussi s’entraident,
et nul ne tient le fléau pour dire : ceci est juste, ceci ne l’est pas.
Oui, la beauté n’est pas la chose la mieux partagée du monde,
et ce n’est pas la faute des ophtalmologues, des oculistes,
ni même celle de la pupille, ni de l’œil.
Oui, les éléments se moquent de savoir si tu es aimable,
comme des efforts renouvelés que tu as faits depuis huit jours pour le rester.
Oui, ce qui est juste nous paraît toujours plus accessible que ce qui ne l’est pas,
et pourtant tout l’est, quand on ne pense ni à soi ni aux autres.
Oui, nous mourrons tous comme nous sommes nés :
sans raison, sans mémoire, sans désir qui nous appartienne,
car rien ne peut jamais nous appartenir que ce que nous donnons sans y penser.
July 04 2025
(2025-07-05 07:13:13|affdate|oui)RECTO
May 1968
At this stage of the night, I’m not sleeping. I’m thirsty, I get up to drink some water. The house is quiet, like the countryside all around, just the subtle rustling of the wind in the big prunus trees in the yard. It’s May and several windows are open to the night, letting in the scent of cut hay. You can hear crickets, the usual symphony of approaching summer. I’m in the kitchen now and I hear the television, a dull murmur that cuts through the usual silence. There are strange noises, distant shouts, like startled birds. A commentator, in a hurried voice, says it’s a “real revolution.” I don’t know if it’s a film or the news. These urban images are so far from the farm and the cows. I approach the room’s entrance, the floorboards creak a little under my bare feet. I see my father stretched out on the living room sofa, a hand on his forehead. My mother is sitting in an armchair, her sewing lamp casting a yellow halo on her fingers as they go back and forth over a piece of fabric. “What are you doing up at this hour ?” she asks, without looking up from her work. “I’m thirsty and I can’t sleep,” I reply. I glance at the screen. I see a city, I think it’s Paris, a strange night there. I see policemen, they’re wearing helmets and carrying weapons that gleam under the streetlights. There are piles of cobblestones at the side of a boulevard, like piles of rocks Papa picks up in the fields. The camera moves, adding to the sense of disorder, everything is blurry and fast. “You need to go back to bed now,” my father says, his voice a little tense. He looks worried ; I haven’t seen him like that since Grandpa had the flu. His parents, who are also my grandparents, live in Paris. I ask if it’s a film or if it’s real, I want it to be a film. Mama wants to reassure me : “It’s a film, darling, don’t worry.” Her thread got tangled. I go back towards the kitchen, a small cool breeze enters the room. It comes from the hills whose silhouettes you can just make out in the distance despite the darkness, soft, sleeping shapes. I wonder if the noises from Paris reach here, carried by this wind.
October 1973
At this stage of the night, I open my eyes and see the harsh light of a streetlamp penetrating through the curtain’s gap, illuminating the wall. Someone, before us, drew a cruel woman in India ink on it, with black hair and pointed teeth. I think her name is Vampirella, a comic book heroine my brother read. We’ve only lived in this house for a short while, here in the Parisian suburbs, a housing development house with a tiny, ridiculous garden. I finally have my own room. My brother has the one on the same landing, upstairs. We have the whole floor to ourselves, even if the stairs creak with every step. My father’s business is doing well, at least, it was doing well until these last few days. He works for a firm that sells bituminous or asphalt roofing. But the 1973 oil crisis is shaking us all at different levels. The adults talk about “crisis,” about “shortage,” words that sound dry and cold. My father has to go sign on at the unemployment office, that’s what he said, his voice is deeper. He doesn’t have a diploma, he often repeats that. He has to meet psychologists to take tests, people who ask strange questions, he doesn’t like that at all. His silhouette is less straight in the evening when he comes home. My mother abandoned her sewing business ; her machines stayed in the countryside when we came to settle here. She started painting a year or two ago, melancholic colors, landscapes that don’t resemble the ones here. In front of our house flows the Oise, which is a rather dirty river ; I’ve seen things floating in it. On its banks, there’s a lot of trash, crumpled papers, old bottles, and mixed with oil slicks that shimmer in rainbows when the sun hits them. Barges pass in front of our windows, heavy and slow ; it’s a ceaseless spectacle ; it makes the windowpanes vibrate. Nothing here pleases me. I miss my old life, the endless fields, the profound silence of the night, the smell of earth after rain. Here, even the crickets sound wrong.
November 1989
At this stage of the night, P. is sleeping. Her breathing is regular, a slight breath against my shoulder. I’ve taken refuge in the alcove, curled up, listening to the news. The radio, an old Philips set on the wobbly stool, broadcasts hour by hour what’s happening in Germany, an uninterrupted flow of excited voices and breathless reports. And now, it’s happening : the journalist’s voice trembles, you can almost hear him crying. East Berliners have just forced their way through different checkpoints of the Wall, alerted by West German media that permissions for passage from the GDR to the FRG, doled out sparingly for decades, have been lifted. The destruction of the Wall begins this very night. It’s unbelievable. It’s an event I never thought I’d live to see. I wonder if I should wake P. to tell her, to share this moment that marks the end of an era, of a world. At the same time, witnessing this historic event here, in this Bastille apartment where our silences have grown so heavy, shortly before our definitive breakup, awakens in me a selfish desire to keep it to myself until morning. To savor it alone, this secret of a world tilting. Not to break the silence before the end, before the tilt of our own wall. The voices on the radio are those of regained freedom, but in the room, I hear only the beating of my own heart and P.’s breath, still unaware that the world has changed.
July 1994
At this stage of the night, I open my eyes and hear the rain. It’s pouring, a resonant sheet of sound enveloping the old house in Montfort l’Amaury. Raindrops, fine and cold, penetrate the kitchen through the ill-fitting window, and the cat, crouched on the sill, meows, a plaintive, sharp sound. I look at the alarm clock, its green digits in the dark : it’s 4 in the morning. Too early to get up, too late to go back to sleep. I make myself a coffee, the bitter smell fills the room. I turn on the computer I just bought secondhand when I moved into this old house. It’s a strange light-grey piece of furniture, with a screen that takes time to light up. The modem is sluggish, its plaintive fax-like hiss distorts the air, but after a while, after crackling and beeping, the connection is made. I go to AOL, this window onto the world that opens, line by line. In bold headlines, I read the words, black and heavy : genocide, Tutsi, Noroît, Rwandan Patriotic Front. Hard to wake up to that. It’s as if the coffee is turning to ice in my cup. I check my messages, looking for a distraction, a breath of air. The cat comes to join me, climbing onto my lap, her soft claws in my pajama pants. We look at the screen for a good while longer, the scrolling letters, the headlines of newspapers talking about a distant, broken world. Then I put her down and go look out the bedroom window. The rain has stopped, silence has returned, almost deafening. I open the window. A rooster crows in the distance, its hoarse voice tears through the dawn. A motorcycle sputters in an adjacent street, the sound bounces off the walls of the sleeping houses. First bird songs, timid at first, then more confident. The cat clacks her teeth ; she might see a sparrow on the branch. It will soon be 7 AM, time to go to work. This world waking up around me knows nothing of what the screen told me tonight.
September 2001
At this stage of the night, the images replay in a loop. They spin and spin in my head, like a scratched record. At first, when I saw them for the first time, I thought it was a film, one of those American blockbusters. I was coming back from my job in Lausanne, I’d driven on the highway to Yverdon-les-Bains. At the town entrance, I’d been pulled over because I hadn’t yet changed my French license plates, an administrative formality that seemed huge at the time. M.A. was in front of the television, sitting on the sofa, she had a strange look on her face, pale, with wide eyes. “Look,” she said, in a barely audible voice, showing me the images on television. I didn’t understand immediately. We saw an airliner approaching very tall towers, certainly in the United States, no doubt Manhattan. It was seeing M.A.’s face that I knew it wasn’t a film, not fiction. The plane entered the first tower, slowly, as if time had stretched out. There was no sound, I remember that, a deafening silence that made the scene even more unreal. Then, another plane appeared, very shortly after, to penetrate the second tower. And there, we saw the two towers collapse, majestically, as if they were just a flimsy house of cards that had been flicked over. It was so unreal, so absurd. I didn’t immediately grasp the scale of what I was seeing. It’s now, as I think back on it, eyes wide open in the silent night, that everything makes sense. Abnormal things are happening, that’s for sure. Completely out of sync with our quiet life here in Europe, in Switzerland, that’s what I tell myself. The world is changing. It’s even possible that this event marks a total change of era or epoch, a fracture in time. As I couldn’t sleep anymore, tormented by these images, I got up and went to the living room. The event had happened the day before, and since then, all the television channels worldwide had been replaying the images in a loop, tirelessly, as if to forever engrave the catastrophe in our memories.
Summer 2003
At this stage of the night, I brood over my life. I have the impression that time is slipping away, that every second is a drop of water escaping, and that I can’t hold onto anything. I’ve just arrived from Switzerland, a step backward, a kind of defeat. Back in Lyon, Rue Henri Pensier, a 50 sq. m. apartment, 700 euros a month, a rent that seems exorbitant for the space. My job is a 5-minute walk away ; I manage a network of international investigators for the Americans in Sans-souci. It’s not without worry, quite the opposite. The proof is, I can no longer sleep. The heat doesn’t help ; the heatwave has been going on for several days already, a blanket of lead over the city ; even at night the air is heavy and still. I spend a lot of time on the internet, my refuge. I chat with women on a messaging service, Caramail, a name that sounds soft for such a harsh world. I divorced a few months ago, a page turned, but which one ? I’m forty-three years old, I own nothing, I haven’t really done anything with my life. That’s my obsession. A recurring adolescent crisis, an endless loop. I feel like talking to women will elucidate something I haven’t understood, a key, an explanation. Talking to men, not for me. Besides, I’m bad at sports, and something unnameable prevents me. Let’s call it the discomfort I feel listening to unspoken words, egos, competitions. Women are more interesting, more direct. They don’t hesitate to talk about intimate things, to reveal fragments of themselves. Sometimes, I feel like a kind of vampire. I don’t drink blood. I drink the words these women are willing to share with me, their stories, their sorrows, their joys. With the internet, it’s very easy ; anonymity, we still believe in it. So you can easily talk to American, Canadian, Scandinavian women ; it’s actually a kind of sociological experiment bordering on mystical experience. What one could conclude as a man is that women generally have much more guts than us. I got up to wet a sheet in the kitchen sink, the cool water on my burning hands. Then I hung it in the window frame, a flimsy rampart against the heat. I turned on the fan hoping to cool the room, a constant hum stirring the hot air. Then I headed to the desk, the dark screen waiting. I pressed enter to wake it from sleep and joined the live chat. That’s where I met S., who wasn’t sleeping either at this stage of the night.
Autumn 2008
At this stage of the night, I can’t sleep. Sleep won’t come ; thoughts spin like wind turbine blades. So as not to disturb S., her calm breathing beside me, I’ve set up a corner in the attic, among the boxes and old furniture. We moved from Lyon to Oullins a few months ago. Rents in the city had become too expensive, I think, or rather we told ourselves that for the same price, we could swap our duplex for a house with a small garden, a space to breathe a little. I had bought a new computer for the occasion, and we had fiber optic internet. The download speed was prodigious ; entire films passed in a blink of an eye ; it was modernity entering our home. It was around that time that I resigned from my job as operations director at that IT consulting firm in Bron. I was fed up, felt like I was treading water. I found another job almost immediately, near Neuville-sur-Saône, a warehouse worker in a depot. I wasn’t earning much, but it was fine. We managed to get by, to make ends meet without too much difficulty. The company I worked for did destocking, buying unsold goods. It was doing incredibly well because people were starting to feel the backlash of the crash, the subprime crisis. People were buying more and more second-hand items. Faucets, electronic wiring, all sorts of goods that my young boss negotiated with large retailers who could no longer afford to keep too much inventory. It was the flip side of the crisis, a kind of parallel economy that was growing. From time to time, I’d take a trip to Paris to see my father. I’d bought a used Mégane, not many kilometers, a diesel, which was good too because fuel prices were soaring, another consequence of all this global disorder. It took me between an hour and an hour and a half to get to work each morning and evening, an eternity spent in Lyon’s traffic jams. I’d listen to the radio in traffic, the news programs, the analyses. I think I pretty much grasped the full extent of that crisis at the time, from listening and reading. A gigantic scam organized to bring down European banks, in the end, when you put the puzzle together. People were being evicted from their homes all over the United States ; unbearable reports were on the news. We saw reports about it, entire families on the streets. We focused on a local crisis, so to speak, a crisis affecting individuals. We couldn’t yet imagine the repercussions on the global economy, the tidal wave that would affect everyone. Here, in the silence of the attic, the rustle of the wind in the tiles brings me back to that time when everything seemed to be on the verge of collapse.
March 2020
At this stage of the night, I wonder how we’re going to get through this. Insomnia follows insomnia, one white night after another, staring at the ceiling. There’s the fact that, suddenly, I can no longer receive students ; my music lessons have stopped ; silence has fallen in the room usually full of notes. And then there’s the fact that expenses keep running ; they don’t go into lockdown. The fact that this situation is as extraordinary as it is absurd, a bubble in time. The fact too that we know nothing, in fact, about this disease, nor its cure, an unknown hanging, heavy and invisible. The fact that, since I can no longer sleep, I am like a zombie, my eyes red, my head foggy. The fact that suddenly, reality has dissipated, like a thick fog that never ends. The fact that we are living in a science fiction book, with masks, social distancing, exit permits. The fact that we no longer know where the truth lies when we witness this parade of experts of all kinds, each with their opinion, their figures, their certainties, and their doubts. The fact that this government inspires no confidence ; its messages are murky, contradictory. The fact that, in the background, one senses enormous financial interests, invisible but powerful cogs, particularly for pharmaceutical laboratories. The fact that, suddenly, we have gone from an apparent democracy to a feudal regime, where decisions fall from above, without discussion. The fact that obscurantism now reigns, that you have to choose your side, your belief. The fact that if you are not for the vaccine, you are necessarily against it, and vice versa ; there are no more nuances, no more grey. The fact that the binary nature of opinions and judgments, accelerated by the use of social networks, doesn’t help anything ; it digs ditches. The fact that I would really like to sleep, and I can’t, that this night is mine, and the whole world’s.
July 2025
At this stage of the night, I pinched myself to see if I was still alive. Today’s world is no longer the world I once knew ; memories stretch, fade. The heat is suffocating ; even in the middle of the night, it clings to the skin. I sleep in a separate room in the house, so as not to warm S. with my breathing machine. I removed the mask connected to the respiratory machine, a slight feeling of coolness on my face. I took the opportunity to get up and go down to the kitchen, my feet on the cold tiles, to make myself a coffee. The cat is there, behind the kitchen door, a black shadow. She meows when she sees me, her familiar whine. “It’s not time to eat yet,” I tell her, in a hoarse voice. “Go back to sleep.” I went back upstairs to open the computer and landed on this page in VS Code, a redesign of my website’s homepage. Lately, I’ve been spending a lot of time coding, lines of text piling up, loops, functions. I think I’m managing to batten down the hatches, to retreat into solving pure logical problems. All the more so since absurdity increasingly reigns outside. Just yesterday, it comes back to me, that woman telling me not to listen to everything that’s said about the far right. That the real problem is the immigrants. That as long as we don’t fix that, things won’t get better. She’s Italian, a Calabrian. “I’m also of immigrant stock,” I say, without aggression. “Yes, but it’s not the same thing,” she retorts. “When our parents arrived, they wanted to integrate.” I don’t know, I no longer know. “That kind of talk tires me out,” I say, cutting her short. “Let’s get back to this painting.” Her boat is far too big ; it takes up all the space on the canvas, crushing the landscape. Moreover, it’s right in the center ; you see only it, a dead weight. I take a piece of charcoal and show her on her sketch. “At this stage of the painting, things can still be modified quite easily,” I say. “Leave a little more air around it, and besides, there’s no one in your boat. It’s a ghost ship. A ghost ship sailing on a ghost ocean in a ghost world.” The heat weighs down.
VERSO
At this stage of the night, my wanderings in the city always bring me back, at one point or another, to Rue Saint-André des Arts. Like an invisible magnet. And more specifically to that art-house cinema, whose discreet facade promises distant journeys. That day, it was a Tarkovsky film, perhaps one of his early works. It had rained all day, a fine, persistent rain, and the street’s cobblestones were slippery ; the black asphalt gleamed under the neon lights of the bookstores. I took refuge in that cinema because of the bad weather, I think, but also out of that thirst for elsewhere that only the big screen can offer. The room was almost empty ; an smell of old velvet and cold dust hung in the air. I chose a seat in the third row, just close enough for the image to envelop me without overwhelming me. The screening began, and the darkness swallowed me. It was the first film by this director I had seen, and I particularly remember that scene where a man chops down trees, axe stroke after axe stroke, with an almost superhuman determination. It seems to me it was twilight, that uncertain hour when day mingles with night, a pale light filtering through the forest canopy. He was clearing the way to climb a hill, not towards an earthly peak, but as if to reach a star, a distant ideal. The image is still very strong in my memory, that repeated gesture, the sweat, the cracking wood. And it must also resonate, I think, with my Slavic blood, something ancestral that understands this quest, this strength. The film ended in a heavy silence. I stepped out into the Parisian night, my mind still numb from the images. The rain had stopped, but the streets were still damp, reflecting the yellow halos of the streetlights. The outside world seemed strangely unreal to me after the intensity of the film. I walked without a specific destination, the cobblestones echoing under my steps. The cinema experience had left an imprint, a silent certainty that some paths can only be opened by sheer will, even when the star seems unreachable. Perhaps, as in that film, I was also still driven at that time by a kind of impossible dream, but I no longer remember which one. A hazy, elusive dream that pushed me without me knowing its destination. Afterwards, I made the rounds of the bistros, as I often did at that time. I felt so lonely that it was the only place where I could gorge myself on a little human warmth, blend into the hum of conversations, the smell of stale tobacco and spilled coffee. Each counter was a temporary refuge, a stopover before returning to the silence of my own apartment. Loneliness, at this stage of the night, was a beast that followed me everywhere, and the lights of the cafés were the only ones that could keep it at bay for a moment.
4 juillet 2025
(2025-07-04 19:25:53|affdate|oui)RECTO
Mai 1968
à ce stade de la nuit, je ne dors pas. J’ai soif, je me lève pour aller boire de l’eau. La maison est calme, comme la campagne tout autour, juste le frottement discret du vent dans les grands prunus de la cour Nous sommes en mai et plusieurs fenêtres sont ouvertes sur la nuit, laissant entrer le parfum des foins coupés. On peut entendre des grillons, la symphonie habituelle de l’été qui approche. Je suis maintenant dans la cuisine et j’entends la télévision, une rumeur sourde qui tranche avec le silence habituel. Il y a des bruits étranges, des cris lointains, comme des oiseaux affolés. Un commentateur, d’une voix pressée, dit que c’est une "véritable révolution". Je ne sais pas si c’est un film ou les informations, ces images urbaines sont tellement loin de la ferme et des vaches. Je m’approche de l’entrée de la pièce, le plancher craque un peu sous mes pieds nus. Je vois mon père allongé sur le canapé du salon, une main posée sur son front. Ma mère est assise sur un fauteuil, sa lampe de couture projetant une auréole jaune sur ses doigts qui vont et viennent sur un morceau de tissu. « Que fais-tu debout à cette heure-là ? » elle demande, sans lever les yeux de son ouvrage. « J’ai soif et je n’arrive pas à dormir », je réponds. Je jette un regard sur l’écran. On voit une ville, je pense qu’il s’agit de Paris, une drôle de nuit là-bas. On voit des policiers, ils portent des casques et des armes qui brillent sous les lampadaires. Il y a des pavés en tas sur le bord d’un boulevard, comme des tas de cailloux que Papa ramasse dans les champs. La caméra bouge, ce qui ajoute à l’effet de désordre, tout est flou et rapide. « Il faut retourner te coucher maintenant », dit mon père, sa voix est un peu tendue. Il a l’air inquiet, je ne l’ai pas vu comme ça depuis la grippe de Papy. Ses parents qui sont aussi mes grands-parents habitent à Paris. Je demande si c’est un film ou si c’est pour de vrai, j’ai envie que ce soit un film. Maman veut me rassurer : « C’est un film, ma chérie, ne t’inquiète pas. » Son fil s’est emmêlé. Je repars vers la cuisine, un petit vent frais pénètre dans la pièce. Il provient des collines dont on devine les silhouettes au loin malgré l’obscurité, des formes douces et endormies. Je me demande si les bruits de Paris arrivent jusqu’ici, portés par ce vent.
octobre 1973
à ce stade de la nuit, j’ouvre les yeux et je vois la lumière crue d’un lampadaire qui pénètre par l’interstice du rideau et vient éclairer le mur. Quelqu’un, avant nous, a dessiné une femme cruelle à l’encre de Chine sur celui-ci, avec des cheveux noirs et des dents pointues. Je pense qu’elle se nomme Vampirella, une héroïne de bande dessinée que mon frère a lue. Nous habitons cette maison depuis peu, ici en banlieue parisienne, une maison de lotissement avec un petit jardin ridicule. J’ai désormais ma chambre à moi. Mon frère celle sur le même palier, à l’étage. Nous avons tout l’étage pour nous deux, même si l’escalier craque à chaque pas. Les affaires de mon père marchent bien, du moins, elles marchaient bien jusqu’à ces derniers jours. Il travaille dans une firme qui vend des toitures bitumineuses ou asphaltées. Mais le choc pétrolier de 1973 nous ébranle tous à différents niveaux. Les adultes parlent de "crise", de "pénurie", des mots qui sonnent secs et froids. Mon père doit aller pointer au chômage, c’est ce qu’il a dit, sa voix est plus grave. Il n’a pas de diplôme, ça, il le répète souvent. Il doit rencontrer des psychologues pour passer des tests, des gens qui posent des questions bizarres, il n’aime pas cela du tout. Sa silhouette est moins droite le soir quand il rentre. Ma mère a abandonné son entreprise de couture, ses machines sont restées à la campagne lorsque nous sommes venus nous installer ici. Elle a commencé à peindre depuis une année ou deux, des couleurs mélancoliques, des paysages qui ne ressemblent pas à ceux d’ici. Devant chez nous passe l’Oise, qui est un fleuve assez sale, j’ai vu des choses flotter. Sur ses berges, il y a beaucoup de déchets, des papiers gras, des vieilles bouteilles, et mêlées à des nappes de mazout qui brillent en arc-en-ciel quand le soleil tape. Des péniches passent devant nos fenêtres, lourdes et lentes, c’est un spectacle incessant, ça fait vibrer les vitres. Rien ne me plaît ici. Je regrette ma vie d’avant, les champs à perte de vue, le silence profond de la nuit, l’odeur de la terre après la pluie. Ici, même les grillons sonnent faux.
novembre 1989
à ce stade de la nuit, P. dort. Sa respiration est régulière, un léger souffle contre mon épaule. Je me suis réfugiée dans l’alcôve, recroquevillée sur moi-même, pour écouter les informations. La radio, une vieille Philips posée sur le tabouret bancal, diffuse heure par heure ce qu’il se passe en Allemagne, un flot ininterrompu de voix excitées et de reportages haletants. Et maintenant, ça y est : la voix du journaliste tremble, on l’entend presque pleurer. Des Berlinois de l’Est viennent de forcer le passage à différents check-points du Mur, avertis par les médias Ouest-Allemands que les autorisations de passage de la RDA vers la RFA, soumises au compte-gouttes depuis des décennies, sont levées. La destruction du Mur commence cette nuit même. C’est inouï. C’est un événement que je ne pensais jamais vivre. Je me demande s’il faut réveiller P. pour la prévenir, partager ce moment qui marque la fin d’une époque, d’un monde. En même temps, assister à cet événement historique ici, dans cet appartement de la Bastille où nos silences sont devenus si lourds, peu avant notre rupture définitive, réveille en moi un désir égoïste de le garder pour moi jusqu’au matin. De le savourer seule, ce secret du monde qui bascule. De ne pas briser ce silence d’avant la fin, avant la bascule de notre propre mur. Les voix à la radio sont celles de la liberté retrouvée, mais dans la pièce, je n’entends que le battement de mon propre cœur et le souffle de P., ignorant encore que le monde vient de changer
juillet 1994
à ce stade de la nuit, j’ouvre les yeux et j’entends la pluie. Elle tombe dru, une nappe sonore qui enveloppe la vieille maison de Montfort l’Amaury. Des gouttes de pluie, fines et froides, pénètrent dans la cuisine par la fenêtre mal ajustée, et la chatte, accroupie sur le rebord, miaule, un son plaintif et aigu. Je regarde le réveil, ses chiffres verts dans le noir : il est 4 heures du matin. Trop tôt pour se lever, trop tard pour se rendormir. Je me fais un café, l’odeur amère remplit la pièce. J’allume l’ordinateur que je viens d’acheter d’occasion en même temps que j’ai emménagé dans cette vieille maison. C’est un drôle de meuble gris clair, avec un écran qui prend du temps à s’éclairer. Le modem est poussif, son sifflement plaintif de fax déforme l’air, mais au bout d’un moment, après des grésillements et des bips, la connexion se fait. Je me rends sur AOL, cette fenêtre sur le monde qui s’ouvre, ligne par ligne. En gros titre, je lis les mots, noirs et lourds : génocide, Tutsi, Noroît, Front Patriotique Rwandais. Dur de se réveiller avec ça. C’est comme si le café se glaçait dans ma tasse. Je vais faire un tour sur ma messagerie, chercher une distraction, une bulle d’air. La chatte vient me rejoindre, elle grimpe sur mes genoux, ses griffes douces dans mon pantalon de pyjama. Nous regardons l’écran encore un bon moment, les lettres qui défilent, les titres des journaux qui parlent d’un monde lointain et brisé. Puis je la dépose et je vais regarder à la fenêtre de la chambre. La pluie s’est arrêtée, le silence est de retour, presque assourdissant. J’ouvre la fenêtre. Un coq chante au loin, sa voix rauque déchire l’aube . Une moto pétarade dans une rue adjacente, le son rebondit sur les murs des maisons endormies. Premiers chants d’oiseaux, timides d’abord, puis plus assurés. La chatte claque des dents, elle voit peut-être un moineau sur la branche. Il va bientôt être 7h, l’heure d’aller bosser. Ce monde qui s’éveille autour de moi ne sait rien de ce que l’écran m’a raconté cette nuit.
septembre 2001
à ce stade de la nuit, les images reviennent en boucle. Elles tournent et tournent dans ma tête, comme un disque rayé. Au début, quand je les ai vues pour la première fois, je crus qu’il s’agissait d’un film, un de ces blockbusters américains. Je revenais de mon boulot à Lausanne, j’étais rentré par l’autoroute jusqu’à Yverdon-les-Bains. À l’entrée de la ville, j’avais été contrôlé parce que je n’avais pas encore changé mes plaques françaises, une formalité administrative qui me paraissait énorme à l’époque. M.A était devant la télévision, assise sur le canapé, elle faisait une drôle de tête, le visage livide, les yeux ronds. « Regarde, » elle me dit, d’une voix à peine audible, en me montrant les images à la télévision. Je n’ai pas compris tout de suite. On voyait un avion de ligne s’approcher de très hautes tours, certainement aux États-Unis, sans doute Manhattan. C’est en voyant la tête de M.A que j’ai su qu’il ne s’agissait pas d’un film, pas une fiction. L’avion est entré dans la première tour, lentement, comme si le temps s’était étiré. Il n’y avait pas de son, je me souviens de ça, un silence assourdissant qui rendait la scène encore plus irréelle. Puis, un autre avion est apparu, très peu de temps après, pour pénétrer dans la seconde tour. Et là, on a vu les deux tours s’effondrer, majestueusement, comme s’il s’agissait d’un vulgaire château de cartes que l’on aurait renversé d’une pichenette. C’était tellement irréel, tellement absurde. Je n’ai pas réalisé tout de suite l’ampleur de ce que je voyais. C’est maintenant, que j’y repense, les yeux grands ouverts dans la nuit silencieuse, que tout prend sens. Il se passe des choses anormales, c’est certain. Totalement en décalage avec notre vie ici, bien au calme en Europe, en Suisse, c’est ce que je me dis. Le monde est en train de changer. Il se peut même que cet événement marque un changement total d’ère ou d’époque, une fracture dans le temps. Comme je n’arrivais plus à dormir, rongé par ces images, je me suis levé pour me rendre au salon. L’événement s’était produit la veille dans la journée, et depuis, toutes les chaînes de télévision du monde entier repassaient les images en boucle, inlassablement, comme pour graver à jamais la catastrophe dans nos mémoires.
été 2003
à ce stade de la nuit, je ressasse ma vie. J’ai l’impression que le temps file, que chaque seconde est une goutte d’eau qui s’échappe, et que je ne peux rien retenir. Je viens d’arriver de Suisse, un retour en arrière, une sorte de défaite. Retour à Lyon, rue Henri Pensier, un 50 m², 700 euros par mois, un loyer qui me semble démesuré pour l’espace. Mon boulot est à 5 minutes à pied, je m’occupe d’un réseau d’enquêteurs internationaux pour les Américains à Sans-souci. Ce n’est pas sans souci, bien au contraire. La preuve, je n’arrive plus à dormir. La chaleur n’arrange rien, la canicule dure depuis plusieurs jours déjà, une chape de plomb sur la ville, même la nuit l’air est lourd et immobile. Je passe beaucoup de temps sur internet, mon refuge. Je chatte avec des femmes sur une messagerie, Caramail, un nom qui sonne doux pour un monde si brut. J’ai divorcé il y a de ça quelques mois, une page tournée, mais laquelle ? J’ai quarante-trois ans, je ne possède rien, je n’ai rien fait de ma vie vraiment. C’est mon obsession. Une crise d’adolescence à répétition, une boucle infernale. J’ai l’impression que discuter avec des femmes va élucider quelque chose que je n’ai pas compris, une clé, une explication. Discuter avec des hommes, très peu pour moi. D’ailleurs, je suis nul en sport, et puis quelque chose d’indicible m’en empêche. Appelons ça le malaise que j’éprouve à écouter les non-dits, les égos, les compétitions. Les femmes sont plus intéressantes, plus directes. Elles n’hésitent pas à parler de choses intimes, à livrer des fragments d’elles-mêmes. Parfois, j’ai l’impression d’être une sorte de vampire. Je ne bois pas de sang. Je bois les propos que veulent bien me livrer toutes ces femmes, leurs histoires, leurs peines, leurs joies. Avec internet, c’est très facile, l’anonymat, nous y croyons encore. Alors on peut très bien parler avec des Américaines, des Canadiennes, des Scandinaves, c’est d’ailleurs une sorte d’expérience sociologique qui frôle l’expérience mystique. Ce que l’on pourrait en conclure en tant qu’homme, c’est que les femmes ont en général bien plus de cran que nous. Je me suis levé pour aller mouiller un drap dans l’évier de la cuisine, l’eau fraîche sur mes mains brûlantes. Puis je l’ai accroché dans l’encadrement de la fenêtre, un rempart dérisoire contre la chaleur. J’ai allumé le ventilateur dans l’espoir de rafraîchir la pièce, un ronronnement constant qui brasse l’air chaud. Puis je me suis dirigé vers le bureau, l’écran noir attendait. J’ai appuyé sur la touche enter pour sortir de la veille et j’ai rejoint la messagerie en direct. C’est là que j’ai rencontré S., qui ne dormait pas non plus à ce stade de la nuit.
automne 2008
à ce stade de la nuit, je n’arrive pas à dormir. Le sommeil ne vient pas, les pensées tournent comme des pales d’éolienne. Pour ne pas déranger S., sa respiration calme à côté, je me suis aménagé un coin au grenier, entre les cartons et les vieux meubles. Nous avons déménagé de Lyon à Oullins quelques mois auparavant. Les loyers en ville étaient devenus trop chers, je crois, ou plutôt nous nous étions dit que pour le même prix, on pouvait échanger notre duplex contre une maison avec un petit jardin, un espace pour respirer un peu. J’avais acheté un nouvel ordinateur pour l’occasion et nous avions la fibre. La vitesse de téléchargement était prodigieuse, des films entiers passaient en un clin d’œil, c’était la modernité qui entrait chez nous. C’est à peu près vers ces eaux-là que j’ai démissionné de mon job de directeur des opérations dans cette SSII de Bron. Un ras-le-bol, l’impression de faire du surplace. J’ai trouvé un autre job presque dans la foulée, vers Neuville-sur-Saône, magasinier dans un entrepôt. Je ne gagnais pas lourd, mais ça allait. On parvenait à se débrouiller, à boucler les fins de mois sans trop de mal. La boîte pour laquelle je bossais faisait du déstockage, rachetait des invendus. Ça marchait du feu de dieu parce que les gens commençaient à éprouver le contrecoup du krach, de la crise des subprimes. On achetait de plus en plus d’occasion. De la robinetterie, du câblage électronique, tout un tas de denrées que mon jeune patron négociait auprès de grandes enseignes qui ne pouvaient plus se permettre de conserver trop de stocks. C’était le revers de la médaille de la crise, une sorte d’économie parallèle qui prenait de l’ampleur. De temps en temps, je faisais un saut à Paris pour voir mon père. J’avais acheté une Mégane d’occasion, pas beaucoup de kilométrage, un diesel, ce qui était bien aussi parce que le prix des carburants flambait, une autre conséquence de tout ce désordre mondial. Il me fallait entre une heure et une heure et demie de trajet matin et soir pour me rendre à ce boulot, une éternité passée dans les bouchons de l’agglomération lyonnaise. J’écoutais la radio dans les bouchons, les émissions d’information, les analyses. Je crois que j’ai à peu près fait le tour de cette crise à l’époque, à force d’écouter et de lire. Une gigantesque arnaque organisée pour faire couler les banques européennes, au bout du compte, quand on remontait le puzzle. Les gens étaient expulsés de leurs maisons un peu partout aux États-Unis, des images insoutenables passaient aux actualités. On voyait des reportages là-dessus, des familles entières à la rue. On se focalisait ainsi sur une crise au niveau local, si je peux dire, une crise des particuliers. On n’arrivait pas encore à imaginer les répercussions sur l’économie mondiale, la déferlante qui allait toucher tout le monde. Ici, dans le silence du grenier, le souffle du vent dans les tuiles me ramène à cette époque où tout semblait basculer.
Mars 2020
à ce stade de la nuit, je me demande comment on va s’en sortir. Les insomnies se suivent, une après l’autre, des nuits blanches à regarder le plafond. Il y a ce fait que, soudain, je ne peux plus recevoir d’élèves, mes cours de musique sont à l’arrêt, le silence s’est fait dans la pièce habituellement pleine de notes. Et puis il y a le fait que les charges continuent de courir, elles ne se confinent pas, elles. Le fait que cette situation soit tout aussi extraordinaire qu’absurde, une bulle dans le temps. Le fait aussi qu’on ne sache rien, en fait, concernant cette maladie, ni son remède, une inconnue qui plane, lourde et invisible. Le fait que, comme je ne dors plus, je suis comme un zombie, les yeux rougis, la tête cotonneuse. Le fait que soudain, la réalité se soit dissipée, comme un brouillard épais qui n’en finit pas de tomber. Le fait qu’on vive dans un livre de science-fiction, avec des masques, des gestes barrières, des attestations de sortie. Le fait qu’on ne sache plus où se situe la vérité lorsqu’on assiste à tout ce défilé d’experts en tout genre, chacun avec son avis, ses chiffres, ses certitudes et ses doutes. Le fait que ce gouvernement n’inspire aucune confiance, ses messages sont troubles, contradictoires. Le fait qu’en tâche de fond, on devine des intérêts financiers énormes, des rouages invisibles mais puissants, notamment pour les laboratoires pharmaceutiques. Le fait que, soudain, nous sommes passés d’une apparente démocratie à un régime féodal, où les décisions tombent d’en haut, sans discussion. Le fait que l’obscurantisme règne désormais, qu’il faut choisir son camp, sa croyance. Le fait que si tu n’es pas pour le vaccin, tu es forcément contre, et vice versa, il n’y a plus de nuance, plus de gris. Le fait que la binarité des opinions et des jugements, accélérée par la fréquentation des réseaux sociaux, n’arrange rien, elle creuse des fossés. Le fait que j’aimerais bien pouvoir dormir et que je n’y arrive pas, que cette nuit est la mienne, et celle du monde entier.
juillet 2025
à ce stade de la nuit, je me suis pincé pour savoir si j’étais encore en vie. Le monde d’aujourd’hui n’est plus le monde que j’ai connu jadis, les souvenirs s’étirent, pâlissent. La chaleur est suffocante, même au cœur de la nuit, elle colle à la peau. Je dors dans une chambre à part dans la maison, pour ne pas réchauffer S. avec ma machine. J’ai retiré le masque relié à la machine respiratoire, une impression légère de fraîcheur sur mon visage. J’en ai profité pour me lever et descendre à la cuisine, les pieds sur le carrelage froid, me faire un café. La chatte est là, derrière la porte de la cuisine, une ombre noire. Elle miaule en me voyant, sa plainte familière. « Ce n’est pas encore l’heure de bouffer, » je lui dis, d’une voix rauque. « Va te recoucher. » Je suis remonté à l’étage pour ouvrir l’ordi et je suis tombé sur cette page dans VS Code, une refonte de la page d’accueil de mon site web. En ce moment, je passe beaucoup de temps à coder, des lignes de texte qui s’empilent, des boucles, des fonctions. Je crois que je parviens à fermer les écoutilles, à me renfermer sur de purs problèmes logiques à résoudre. Et ce d’autant que l’absurdité règne de plus en plus à l’extérieur. Hier encore, ça me revient, cette femme qui me dit qu’il ne faut pas écouter tout ce que l’on dit sur l’extrême droite. Que le véritable problème, ce sont les émigrés. Que tant qu’on n’aura pas réglé ça, ça n’ira pas. C’est une Italienne, une Calabraise, ses yeux sont vifs. « Moi aussi je suis de souche émigrée, » je dis, sans agressivité. « Oui, mais ce n’est pas la même chose, » elle rétorque. « Quand nos parents sont arrivés, ils voulaient s’intégrer. » Je ne sais pas, je ne sais plus. « Ça me fatigue ce genre de propos, » je dis, en coupant court. « Revenons-en à cette peinture. » Son bateau est beaucoup trop gros, il prend toute la place sur la toile, écrase le paysage. De plus, il est en plein centre, on ne voit que lui, un poids mort. Je prends un morceau de fusain et je lui montre sur son croquis. « À ce stade du tableau, on peut encore modifier assez facilement les choses, » je dis. « Laisser un peu plus d’air autour, et puis, il n’y a personne dans ton bateau. C’est un bateau fantôme. Un bateau fantôme qui vogue sur un océan fantôme dans un monde fantôme. » La chaleur pèse.
VERSO
à ce stade de la nuit, mes errances dans la ville me ramènent toujours, à un moment ou à un autre, à la rue Saint-André des Arts. Comme un aimant invisible. Et plus spécifiquement à ce cinéma d’art et d’essai, dont la devanture discrète promet des voyages lointains. Ce jour-là, c’était un film de Tarkovski, une de ses premières œuvres peut-être. Il avait plu toute la journée, une pluie fine et persistante, et les pavés de la rue étaient glissants, le bitume noir luisait sous les néons des librairies. Je me suis réfugié dans ce cinéma à cause du mauvais temps, je crois, mais aussi par cette soif d’un ailleurs que seul le grand écran peut offrir. La salle était presque vide, une odeur de vieux velours et de poussière froide flottait dans l’air. J’ai choisi une place au troisième rang, juste assez près pour que l’image m’enveloppe sans me submerger. La projection a commencé, et le noir m’a happé. C’est le premier film de ce réalisateur que j’ai vu, et je me souviens particulièrement de cette scène où un homme abat des arbres, bûche après bûche, avec une détermination presque surhumaine. Il me semble que c’est entre chien et loup, cette heure incertaine où le jour se mêle à la nuit, une lumière pâle filtrant à travers le couvert forestier. Il dégageait le chemin pour gravir une colline, non pas pour un sommet terrestre, mais comme pour rejoindre une étoile, un idéal lointain. L’image est encore très forte dans ma mémoire, ce geste répété, la sueur, le bois qui craque. Et ça doit aussi résonner, je pense, avec mon sang slave, quelque chose d’ancestral qui comprend cette quête, cette force. Le film s’est terminé dans un silence pesant. Je suis sorti dans la nuit parisienne, l’esprit encore engourdi par les images. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore humides, reflétant les halos jaunes des lampadaires. Le monde extérieur me semblait étrangement irréel après l’intensité du film. J’ai marché sans but précis, les pavés résonnant sous mes pas. L’expérience du cinéma avait laissé une empreinte, une certitude silencieuse que certains chemins ne peuvent être ouverts qu’à la force de la volonté, même quand l’étoile semble inatteignable. Peut-être, comme dans ce film, étais-je aussi encore mué à cette époque par une sorte de rêve impossible, mais je ne me souviens plus duquel. Un rêve flou, insaisissable, qui me poussait sans que j’en connaisse la destination. Ensuite, j’ai fait la tournée des bistrots, comme je le faisais souvent à cette époque. Je me sentais si seul que c’était le seul lieu où je pouvais me goinfrer d’un peu de chaleur humaine, me fondre dans le brouhaha des conversations, l’odeur du tabac froid et du café renversé. Chaque comptoir était un refuge temporaire, une escale avant de retrouver le silence de mon propre appartement. La solitude, à ce stade de la nuit, était une bête qui me suivait partout, et les lumières des cafés étaient les seules à pouvoir l’éloigner un instant.
01 juillet 2025
(2025-07-01 08:27:14|affdate|oui)Consignes d’écriture
F. nous invite à examiner les sept derniers jours afin de rédiger des descriptions de lieux, si possible dans la ville. Il prend comme modèle le livre d’A. E., Journal du dehors. La proposition est la suivante : le recto sera une suite de trois textes descriptifs. Le verso sera un bloc de texte contenant une scène avec personnage(s), si possible avec des paroles insérées à la façon des paperoles de Proust.
Réflexions sur les "paperoles" et le dialogue
Les "paperoles de Proust" désignent des bandes de papier que Marcel Proust ajoutait et collait à ses manuscrits pour insérer des additions et des modifications à son œuvre, notamment à À la recherche du temps perdu.
Proust était un écrivain obsédé par la réécriture et le perfectionnisme. Au fur et à mesure qu’il avançait dans la composition de son roman fleuve, il lui venait de nouvelles idées, des développements, des précisions ou des digressions qu’il voulait absolument intégrer. Plutôt que de recopier des pages entières, il utilisait ces "paperoles" – des bouts de papier de toutes tailles, parfois très longs (certaines atteignant près de deux mètres) – qu’il collait et repliait en accordéon sur les marges ou entre les lignes de ses cahiers et placards.
Ces paperoles sont devenues emblématiques de son processus d’écriture et témoignent de la manière dont son œuvre s’est construite et enrichie au fil du temps, dans un véritable chantier permanent où la colle et les ciseaux jouaient un rôle essentiel. Elles sont d’ailleurs exposées dans les musées et les expositions dédiées à Proust, comme celle de la BnF "Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre", car elles sont une source précieuse pour comprendre la genèse de La Recherche.
Je ne vois pas vraiment le rapport entre le fait de ne pas "fabriquer des dialogues" avec des tirets et les paperoles proustiennes. Ce qui est très bien. Le fait que les choses n’aient pas de rapport nous oblige souvent à en inventer un.
L’exercice du carnet et la quête du réel
Cet exercice, le recto notamment, me rappelle les carnets : de longues promenades en ville. Parfois s’asseoir dans un parc, dans un café, noter. Noter ce que je vois, ce que j’entends, ce que je pense au même moment. Une relation obstinée au réel, ou à ce que j’imagine être le réel. Ma réalité. Bien que dans son avant-propos, A.E. inscrive son désir de s’absenter de ces descriptions, comment ne pas la voir ? Ce qui me rappelle que je ne voyais que moi à la relecture de ces petits textes. Et le dégoût de ces relectures. Une sorte de pathologie liée à la relecture.
Retour en 1985 : souvenirs d’Aubervilliers
J’ai créé un nouveau dossier intitulé "recto_verso". Dans ce dossier, un autre, "01_jour_1". J’ai placé les deux textes d’appui issus du Journal du Dehors. Puis, j’ai cherché le livre numérique et l’ai ajouté. En l’ouvrant avec Foliate, la table des matières sur la gauche indique des dates : 1985, 1986, 1987 jusqu’à 1992.
Ce qui me fait réfléchir à ce que je pouvais faire ces mêmes années. On payait encore avec des francs. La baguette valait, je crois, un franc, mais combien pour un paquet de cigarettes ? Peut-être quatre ou cinq francs. Le café au comptoir valait le même prix qu’une baguette. Tout est bien sûr relatif. Relatif au revenu. Je me rends compte que j’ai du mal à me souvenir de mes salaires en francs. En 1985, j’habite à Aubervilliers, en face du centre commercial. Je travaille comme magasinier le jour chez CII à Bobigny, la nuit chez IBM Vendôme où j’endosse l’uniforme de gardien de nuit.
Cet exercice recto-verso me paraît fastidieux dans le cadre des sept derniers jours de cet été 2025. Serais-je capable de revenir en 1985, de me retrouver dans les rues d’Aubervilliers, près du canal, ou encore à déambuler dans les rues alentour, souvent près de bâtiments industriels, d’usines ? Il me semble me souvenir de si peu de choses. En tout cas, pas plus qu’au cours de ces sept derniers jours. J’ai récemment retrouvé des photographies en noir et blanc de cette époque justement. Vague souvenir des visages, des collègues de travail, des locaux. Dans une remise, je me souviens d’un gros rouleau de papier bulle sur lequel je m’allongeais à la pause déjeuner pour récupérer un peu dans la journée. Je me souviens aussi d’avoir obtenu le numéro d’Alice Sapritch par l’un des magasiniers qui la connaissait. Je me souviens lui avoir téléphoné, assis sur ce rouleau de papier bulle ; il y avait sans doute un téléphone fixe dans ce local car les téléphones mobiles n’existaient pas, ou si oui, je n’en possédais pas. Elle avait décroché. J’ai été tellement surpris qu’elle décroche. J’ai balbutié que je voulais faire des photos d’elle. Elle m’a ri au nez puis elle a raccroché.
Est-ce à la même époque que j’ai rencontré Francis Huster dans un café près de l’Opéra, à deux pas de mon travail ? Peut-être peu avant de me rendre à mon travail. Il m’arrivait de boire un café à une terrasse avant de me laisser avaler par ce boulot. Francis Huster était à la table juste à côté de la mienne. Je lui avais demandé s’il accepterait que je fasse des photographies de lui. Il n’avait pas dit non. Il m’avait même donné rendez-vous dans un théâtre près de République, je crois. Il tournait un film avec Zulawski, La Femme publique avec Valérie Kaprisky. Je m’étais rendu au rendez-vous quelques semaines après. J’avais réussi à me faufiler dans les coulisses de ce théâtre, je ne sais comment. Zulawski engueulait Huster copieusement. Ça n’allait pas arranger les choses. Il n’allait peut-être pas être de bonne humeur pour faire des photos.
En fait, il ne se souvenait plus du tout de moi. À la fin du tournage, il m’a toisé avec un air absent et m’a dit : « Vous devez vous tromper. »
Flâneries et projets photographiques
En 1985, je marche le long du canal avec M. Elle m’a demandé de lui faire des portraits parce qu’elle veut présenter un book ; elle en a besoin pour se présenter à des castings. Nous sommes en automne. Sur la rive opposée, une ligne de peupliers semble disparaître ou apparaître, incertaine. Il y a souvent de la brume, un décor idéal pour prendre des photographies en noir et blanc.
Réflexion sur l’organisation et le "recto_verso" personnel
Avec ce début de mois et ce nouvel atelier, il faut en profiter pour créer une nouvelle rubrique ou un nouveau groupe de mots-clés. Je n’ai pas encore eu le temps d’y réfléchir, mais "recto_verso" me paraît intéressant. Cet aspect "double" de ma vie en 1985, celle d’un tâcheron d’un côté accumulant les boulots pour rembourser ses dettes, puis se constituer un capital pour partir en Asie, et de l’autre, ces aspects plus "artistiques" de ma personnalité, la photographie noir et blanc et l’écriture. Encore que, si je me souviens bien, je ne me vois pas écrire en 1985 vraiment, juste quelques notes sur des carnets péniblement réunies. En général, une date et quelques mots, guère plus. Ce qui me motivait pour ces deux activités n’était pas l’art à proprement parler. L’art était un prétexte. Ce qui me motivait devait être ce qui motivait le petit Poucet à semer des miettes dans la forêt, puis des petits cailloux en s’apercevant que les miettes étaient mangées par les oiseaux.
Souvenirs de Bonn et de la photographie musicale
Parmi les photographies retrouvées de cette époque, je me souviens de ce voyage à Bonn pour le 11e sommet du G7. J’avais pris un train de nuit. C’était au mois de mai. Avais-je demandé une accréditation à l’agence Sipa ? Je ne sais plus. Est-ce que je travaillais encore avec l’agence de photographie pour l’Afrique ? Aucune idée. Est-ce aussi à cette période que j’allais au Feel One à la Défense faire des photographies de musiciens africains comme Fela ou Touré Kunda, Mory Kanté ? Ou que j’avais photographié cette actrice black, Félicité Wouassi ? Je ne sais plus.
Plus tard dans la soirée.
RECTO Parking souterrain, niveau -1. Bornes de recharge électrique. Barrières métalliques, lignes blanches au sol, tracées « en épis » pour garer les véhicules. Au plafond, des panneaux lumineux indiquent la sortie piéton. Numérotation au sol. Un petit hall offre la possibilité de prendre un escalier ou de visiter une expo photo installée là. Deux caisses automatiques attendent le paiement : on insère le billet, et si l’on veut payer par carte sans fil, une lumière bleue s’allume. Personne derrière les vitres de la cabine, juste une affiche avec un flash code : « Venez voir nos services. » Les ascenseurs sont silencieux, un bouton lumineux. Sur la paroi, une bite dessinée avec « J. est une p. » et un numéro de téléphone. Niveau 0 : la sortie. Une chaleur écrasante.
Chercher sur l’interphone « cabinet médical », puis sonner. Un mécanisme à peine bruyant signale que l’on peut pousser la porte. Le cabinet est au rez-de-chaussée. Des affiches sur la porte : « Médecins en colère ». Une petite affichette invite : « Sonnez et entrez. » La secrétaire salue avec bonhomie, au téléphone, et fait signe de rejoindre la salle d’attente, juste là. Une personne dit bonjour. Une femme entre deux âges, une habituée, car de sa place elle interpelle la secrétaire. « C’est bien un homme, 95 % des opérations se passent sans problème », dit-elle. Puis une mère entre avec ses deux enfants. Ils ne disent pas bonjour. La mère les reprend. Les enfants marmonnent un « bonjour » du bout des lèvres, puis attrapent les magazines en papier glacé sur une étagère en fer. Ils changent de place, ils ont chaud. Un petit grésillement discret indique que la climatisation fonctionne. Il faut lever la tête pour voir l’appareil : un coude en plastique où se trouvent fils et câbles, l’ensemble montant vers un faux plafond ponctué de spots allumés. Au-dessus d’un mur, quelques fenêtres horizontales ont été percées, laissant apercevoir la colline de Fourvière.
Le Monoprix se dresse comme un temple à l’angle de la rue Grenette et de la rue de la République. Il semble qu’ils vont rendre la rue Grenette piétonnière, comme la rue de la République. Pour le moment, seuls les bus ont le droit de circuler. C’est incessant. Il y a tout de même un feu rouge qui permet aux piétons de s’élancer d’un trottoir à l’autre. Quand le petit homme est vert, c’est un mouvement de foule d’un bord à l’autre. Parfois, quelqu’un s’en fiche et ne se préoccupe pas du bonhomme vert. Un vigile se tient dans l’ombre de l’entrée. Il est en uniforme, boutonné jusqu’au cou. C’est un homme noir, un balèze. Il ne sue pas. Il ne bouge pas. Il est là, inamovible dans l’ombre de l’entrée. Impossible de le rater. Mais personne ne dit bonjour. Ni lui, ni les clients. Ça rentre et ça sort. À côté, un magasin H&M, l’enseigne rouge vermillon. Un peu plus loin, une rue perpendiculaire mène, au choix, à un parking ou à une église.
VERSO Elle avait sorti tous les desserts et les avait posés sur la table en formica. « Lequel vas-tu choisir, lis ce que c’est si tu le peux à voix haute », dit-elle. Une chaleur insupportable régnait dans la cuisine. « Il faudrait lui mettre au moins un rideau, elle dit au téléphone, en attendant que le store soit réparé un rideau tu sais ce que c’est n’est-ce pas, avec une tringle toute bête et des anneaux ». La voix de la vieille dame avait commencé sa litanie, elle lisait les étiquettes des desserts. « Va ni lle chocolat lié geois, yahourt à la poire, yahourt à la pèche, gateau de riz au cara mel ». Juste avant, elle s’était enfilé une tranche de melon qu’elle avait mis un temps infini à avaler. « Je le coupe en petits dés c’est rigolo, mais c’est trop vous savez je ne mange presque plus rien —un blanc— si vous saviez à quel point j’aimerais retourner à Marengo . Elle raccrocha et dit « Alors maman tu as choisi ton dessert ». « Elle a l’embarras du choix, dit l’homme », mais elle l’interrompt : « Tais-toi, laisse-la choisir son dessert ! » Puis elle enchaîne : « Il n’y a qu’à tout mettre dans l’évier, elle fera la vaisselle. Elle aime faire la vaisselle ». Et elle poursuit, disant à l’homme : « Tu peux aller faire ta sieste si tu veux. Mais avant, il faut qu’elle rebranche les fils de la télé. Aller maman, rebranche les fils de la télé. Oui c’est ça, ça y est on voit la lumière rouge. » Il faisait chaud dans le salon aussi. « Pourquoi tu ne mets pas en route le ventilateur ? » « Je ne sais pas, dit la maman, quelqu’un a dû l’éteindre, et quelqu’un a retiré les fils de la télévision aussi. » « Non, laisse-la faire, il faut qu’elle remette les fils toute seule. La lumière rouge apparaît, tu as réussi ! Aller je vais te faire tes ongles. » La vieille dame regarde ses ongles de pouces, elle a un ongle très long qu’elle montre à l’homme, assis maintenant à côté d’elle. Mais il réplique quelque chose d’idiot, du genre « Ah oui, il est plus long que l’autre ». « Va donc faire ta sieste ! » dit la fille à l’homme qui, au bout d’un temps, se lève et va dans une autre pièce. Il s’agit d’un appartement HLM : une cuisine, un salon salle à manger, une chambre à coucher et une autre pièce qui sert de fourre-tout depuis des années.