Technologies et Postmodernité
cette association n’est pas là pour théoriser l’époque, ni pour en faire le procès. La catégorie regroupe des textes écrits dans la postmodernité, depuis les marges poreuses de ses dispositifs. Des textes où le téléphone reste allumé même pendant les rêves, où le "je" doute de son propre corps, où les voix semblent filtrées par une interface invisible.
Ce sont des fragments où l’on sent que le monde est devenu technique, pas seulement dans ses objets, mais dans ses rythmes, ses langages, ses logiques relationnelles. L’angoisse ne vient pas d’une déconnexion, mais d’un excès de connexions : trop de signaux, trop de profils, trop d’images, pas assez de silence.
Il y est parfois question d’écran, d’intelligence artificielle, de surveillance, de réseaux sociaux — mais ces éléments ne sont jamais centraux. Ce qui est central, c’est le rapport affecté à soi, aux autres, au réel que ces technologies induisent, transforment ou effacent.
Ce mot-clé, finalement, désigne un climat plus qu’un thème. Une manière d’habiter le contemporain, sans certitude, mais avec la sensation que quelque chose, là, s’est déplacé définitivement.
Écouter l’entrée du carnet :
articles associés
histoire de l’imaginaire
Cartographier l’invisible
J’ouvre Google Earth et je descends jusqu’à Épineuil-le-Fleuriel. Je cherche le Cher, mais ce n’est pas le fleuve qui m’accroche, c’est la Queugne, mince rivière qui s’y jette en douce. Un filet d’eau de vingt-huit kilomètres à peine, mais qui, sur la réglette des archives, se comporte comme un acteur principal : plus large en 2004, presque effacé en 2012, bordé de peupliers ou réduit à un trait pâle. À force de cliquer, le cours change, les rives se déplacent, les champs s’emboîtent autrement. Plus au nord, Isle-et-Bardais, petite commune coincée dans la forêt de Tronçais, m’offre le même vertige : le nom double, Isle et Bardais, la fusion ancienne de deux hameaux, une dispersion d’habitats qu’aucune carte ne parvient vraiment à rassembler. On croit regarder un plan, on tombe sur des fantômes. Le paysage ne tient pas, il vacille. Et ce qui m’étonne n’est pas tant que la Queugne coule ou qu’Isle-et-Bardais existe, mais que la carte, censée me fixer un repère, fabrique à chaque année un récit différent. Si je relève la tête de la Queugne, Google Earth m’offre le ciel. Pas grand-chose, juste une voûte noire piquée de points. Ptolémée avait fait pareil, relier les taches, transformer un amas d’étoiles en lion ou en poisson. On ne sait pas très bien pourquoi c’est un lion et pas un chien, un poisson et pas un caillou. On trace des lignes, on invente des bêtes, on baptise. Le ciel devient une carte, mais une carte à la fois stricte et fantaisiste. Kepler corrige, d’autres raffinent, chacun déplace un point, change la figure. Aujourd’hui encore, les applications de téléphone rejouent le même jeu : on lève l’appareil, on le tourne vers la nuit, et des lignes jaunes apparaissent sur l’écran, reliant les étoiles en scorpion, en vierge, en cygne. Comme si l’ancien besoin de peupler l’invisible persistait, infiltré jusque dans le logiciel. Le détail mouvant, ici, c’est l’animal qu’on choisit de voir, cheval ou crabe, selon le trait. Le ciel n’a pas changé, mais la carte, elle, fabrique à chaque fois une créature différente. Quitter le ciel pour descendre dessous, c’est un autre type de carte. Dante en avait dressé les plans : un entonnoir creusé sous terre, neuf cercles empilés comme les anneaux d’un tube fluorescent. Botticelli l’a dessiné avec précision, Doré aussi, chacun traçant des coupes, des gradins, des flèches pour indiquer la descente. L’Enfer devient presque un organigramme, un plan de métro aux stations bien alignées : luxure, avarice, fraude. On imagine le voyageur composter son billet à chaque cercle. Le détail mouvant se glisse là aussi : selon les commentateurs, certaines âmes changent de niveau, on les expédie plus bas ou on les relève d’un cran. Ce qui devrait être fixe, éternel, se révèle flexible, négociable. La carte prétend figer l’invivable, mais elle le rend mobile, flottant, presque administratif. Et en suivant ces tracés, je m’aperçois qu’il est plus facile de cartographier l’enfer que la Queugne ou Isle-et-Bardais. Après l’enfer bien rangé, il y a les cités idéales. Thomas More avait dessiné une île en forme de croissant, rues droites, maisons identiques, rien qui dépasse. Campanella imagina une ville solaire, circulaire, compartimentée comme une horloge. Chaque détail servait à prouver l’ordre parfait, la symétrie, la raison. Puis Calvino, plus joueur, fit tout basculer : ses villes n’ont pas de coordonnées, elles flottent dans le récit, elles n’existent que le temps qu’on les raconte. On ne peut pas les pointer sur une carte, elles se déplacent, elles s’effacent dès qu’on referme le livre. Le détail mouvant est là aussi : l’emplacement même de l’utopie. Toujours ailleurs, toujours décalé, parfois juste à côté, parfois hors de portée. On dessine pour fixer, mais le dessin s’échappe. Et il y a ce soupçon d’absurde : à force de chercher la cité idéale, on ne tombe que sur des plans de lotissements, pavillons en rang, haies de thuyas. Peut-être que l’utopie, finalement, n’a jamais été qu’une carte de promoteur. Je reviens à mes propres cartes. Pas celles de More ni de Calvino, mais celles de l’enfance. Une Michelin pliée en accordéon sur la banquette arrière, le doigt suivant la route des vacances, les virages déjà anticipés, les villes à peine prononcées. Le détail mouvant, c’était un symbole vert, une aire de repos inventée comme terrain d’aventures. Plus tard, les cartes de fiction ont pris le relais : Tolkien, avec ses montagnes crayonnées, ses forêts aux noms ronflants, ses rivières serpentines. Dans les jeux vidéo aussi, un monde surgit dès qu’on l’ouvre, se déplie comme un tapis : un village, un château, un marécage, tout ça disparaissant aussitôt la console éteinte. Aujourd’hui, c’est le téléphone qui me suit, Google Maps qui me géolocalise, qui cartographie mes trajets, mes courses, mes habitudes. Le détail mouvant, ce n’est plus un virage de rivière, c’est une donnée personnelle qu’on capture, qu’on enregistre. La carte ne montre plus seulement l’espace : elle me découpe en fragments, elle me superpose à moi-même, un double tracé que je n’ai pas choisi. Alors je retourne à mon méandre du Cher, près d’Épineuil-le-Fleuriel. Je rouvre la réglette, je fais défiler les années. Le fleuve grossit, s’amincit, les peupliers apparaissent, s’effacent, un hangar surgit, un autre toit se ternit. Rien n’est jamais stable. La carte ne fixe pas, elle raconte. Elle ne dit pas le territoire mais la succession de ses visages, parfois vrais, parfois inventés. L’invisible n’est pas derrière la carte, dans un secret à révéler. Il est dans ce mouvement même, ce tremblement discret qui fait qu’un lieu ne reste jamais identique à lui-même. Peut-être que la carte, finalement, ne nous oriente pas. Elle nous rappelle seulement qu’on se déplace, même immobile, et que ce qu’on croyait tenir entre les mains glisse déjà ailleurs.|couper{180}

Carnets | Atelier
03 septembre 2025
une tension ancienne, toujours là : une langue distingue, l’autre soude. La savante trace des frontières, parle à l’initié, signe d’érudition plus que partage. Elle suppose mémoire, héritage, retrait. L’ordinaire circule sans effort : slogans, votes, cris de stade. Elle se dit « naturelle » mais n’est qu’un autre code, inculqué, régulé. Deux pôles : l’entre-soi rare et le collectif saturé. Logos contre vox. Le grec, le latin, le code informatique fonctionnent comme filtres ; l’ordinaire inclut, parfois jusqu’à étouffer. Chaque fois que je m’assois pour écrire, la tension revient. Je n’aime pas, je compose. Ne pas choisir. La précision fermée du code et l’ouverture vague du cri. Non pas compromis, mais frottement. Comme deux silex : espérer le feu. Écrire avec deux voix qui s’opposent et se nourrissent. La savante fore, donne des instruments rares ; l’ordinaire m’ancre, me sauve de la tour d’ivoire. Tenir ensemble isolement et collectif. Un texte pour tous, mais qui garde son grain d’exception. hier, rendez-vous à C., anesthésiste. Cinq minutes, cinquante-cinq euros. Puis bureau des préadmissions. Jeune homme appliqué, collier de barbe, pas un sourire. Relit mon dossier, me fait réécrire ce que j’avais déjà inscrit. Mon nom, encore. Ma signature, encore. Chaque trou pointé du doigt. Son stylo qu’il ne reprendra pas. Je l’imagine, une fois parti, l’essuyer, le jeter à la corbeille. — « Quand vous viendrez le neuf il faudra cette fois passer au bureau des admissions », conclut-il. « Ça ira plus vite puisque vous avez déjà remis le dossier. » étonnement des premiers jours d’automne. Air plus frais au matin, lumière persistante. En approchant de Lyon, nuages massifs sur un ciel d’été dense. Puis le Rhône, à la Mulatière : présence palpable, s’écoulant comme un long serpent. après l’hôpital le supermarché, Montessuy. Enseigne oubliée, changée tant de fois. Cannellonis, danettes goût café. au Vernay, deux étages difficiles à gravir. E. ouvre, frêle. Deux mois sans la voir. Elle ne se souvient plus de mon prénom. Elle compense par un grand sourire, « contente de vous voir ». La joie dure peu. S. la gronde : — « maman je t’avais dit de sortir trois assiettes ». Dans le réfrigérateur, les assiettes empilées. Je tente une plaisanterie, ça ne passe pas. S. se fâche. E. dit non désormais. Non au melon, non répété, ferme, enfantin. Tension posée sur la table, digestion compromise. après le repas, S. lui fait les ongles. Elles prennent le café ensemble. Je les laisse. J’allume la télévision, m’allonge. Le calme tombe. Le son, n’importe quel programme, m’endort presque aussitôt. de retour à la maison, je range un peu l’atelier. Coup de fil de P. qui se réinscrit, viendra le jeudi matin. Le rangement dure peu, un quart d’heure, vider encore un tiroir de vieux papiers. Le fait d’avoir eu T. au téléphone avant-hier : les difficultés de R. opéré, son angoisse qu’il ne s’en sorte pas. Ses larmes dans l’appareil. Le fait que j’ai pensé qu’elle pourrait venir à la maison si tout tournait mal. Le fait que je l’imagine dans la chambre d’amis. Le fait que nous sommes tous pendus à la toile du destin et qu’une telle épreuve peut tomber sans prévenir. Bourdon terrible. Pensé à mon propre après, à S. seule dans la maison, à S. et T. ensemble peut-être. Alors mieux valait se remettre au code. Ce que j’ai fait. J’ai utilisé Deepseek cette fois pour modifier ma page d’accueil. Plus rapide que ChatGPT, moins d’erreurs. En quelques minutes l’IA chinoise a résolu un problème que la dernière version de ChatGPT n’avait pas su débloquer malgré plusieurs demandes claires. J’emprunte cette idée à T.C : créer une liste d’articles qu’il partage chaque dimanche « depuis sa terrasse ». Je ne pense pas, pour ma part, partager ces articles chaque semaine. Ils resteront accessibles, comme tout ce que je publie sur le site, sans passer par les réseaux. L’idée est plutôt d’en faire un journal des points d’intérêt qui m’auront marqué en lisant, semaine après semaine. J’ai ajouté deux nouveaux articles à la rubrique Histoire de l’imaginaire , encore peu fréquentée — ce qui est normal, puisque je ne l’ai pas partagée sur les réseaux sociaux. Pour cela : création d’un fichier lien.html dans le dossier modèles. [(#ENV{cat}|oui) [(#VALEUR|trim)] ] [(#ENV{titre})] [(#ENV{desc})] Ce qui permet ensuite d’écrire les liens dans un article hebdo avec cette syntaxe : littérature Génica Anasthasiou, l’anti-muse d’Antonin Artaud "J’ai commencé par la fin, en cherchant où pouvaient avoir été déposées ses archives personnelles après son décès. Cela m’a conduite à la maison de retraite des comédiens à Pont-aux-Dames, où j’ai été très bien reçue. Il y avait en effet dans le grenier un carton « Génica Athanasiou », empli de dossiers de photos et de documents. J’ai passé une journée à tout inventorier et photographier." histoire Les Vikings en Amérique Du bois ayant gardé trace d’un événement cosmique nous apprend qu’il y a mille ans très exactement, en l’an 1021, les Vikings étaient en train d’abattre des arbres à Terre-Neuve sciences Une comète provenant d’un autre système solaire possède une chimie inédite Une comète interstellaire récemment découverte intrigue les astronomes : elle traverse notre système solaire à toute vitesse avec un profil chimique jamais observé auparavant. Officiellement nommée 3I/ATLAS, elle n’est que le troisième objet confirmé provenant d’un autre système stellaire.|couper{180}

histoire de l’imaginaire
Des Prométhée aux Geeks : l’ambivalence des héros civilisateurs
Les héros civilisateurs ont toujours été un peu suspects. On les a décorés de mythes, de couronnes et d’auréoles, mais si l’on gratte un peu, on tombe vite sur des comportements instables, parfois franchement inquiétants. Prométhée, par exemple, n’était pas seulement ce bienfaiteur altruiste qui déroba le feu pour l’offrir aux hommes. C’était aussi un tricheur, un provocateur, qui avait sous-estimé la réaction d’un Zeus particulièrement rancunier. Résultat : un foie livré chaque jour à l’appétit d’un aigle obstiné. On a connu des philanthropes plus efficaces. Héraclès, autre star du panthéon antique, massacra sa femme et ses enfants dans un accès de rage avant de se lancer dans ses travaux. Quant à Gilgamesh, premier grand héros littéraire, il inaugura sa carrière en tyran brutal avant de comprendre tardivement que la mort viendrait aussi pour lui. Autrement dit, la civilisation avance souvent derrière des guides qui vacillent, délirent ou détruisent. On pourrait croire que nous avons changé d’époque. Que les héros de la modernité seraient plus rationnels, plus équilibrés, mieux outillés pour conduire l’espèce vers de nouveaux horizons. Il n’en est rien. Nous confions désormais nos vies à des figures tout aussi instables, mais dont l’uniforme est différent : tee-shirt sombre, baskets blanches, sourire nerveux. Elon Musk envoie des fusées pour s’évader vers Mars, Mark Zuckerberg fabrique des mondes parallèles peuplés d’avatars sans jambes, Jeff Bezos imagine des colonies orbitales alignées comme des entrepôts. Steve Jobs avait déjà transformé l’objet banal du téléphone en laisse numérique. Ces nouveaux héros ne ressemblent plus à des demi-dieux colériques, mais à des geeks obsessionnels. La psychopathologie demeure, seule la présentation a changé. Il faut voir avec quelle insistance la mythologie ancienne rappelait le prix des dons. Chaque innovation venait chargée de sa malédiction. Pandore ouvrait la boîte et libérait les maux du monde ; Icare s’envolait et retombait aussitôt ; Sisyphe poussait son rocher pour l’éternité. Ces récits faisaient office de garde-fous : oui, le progrès existe, mais il est ambivalent, dangereux, parfois fatal. La modernité, elle, a supprimé les avertissements. On ne raconte plus de tragédies, on déroule des conférences. Les mythes se sont dissous dans les keynotes et les communiqués de presse. Le don de feu devient une start-up, la boîte de Pandore un réseau social, les ailes d’Icare un projet de colonisation spatiale. La leçon a disparu, il ne reste que le pitch. Ce n’est pas que les héros civilisateurs soient devenus pires. Ils l’ont toujours été, à leur manière. Prométhée était un délinquant céleste, Héraclès un colérique, Gilgamesh un tyran. Mais ces excès faisaient partie du récit, ils servaient de contrepoint. Aujourd’hui, les excès sont effacés, neutralisés par le discours publicitaire. On se retrouve avec des figures qu’on célèbre comme visionnaires, alors qu’elles cumulent les symptômes du psychotique : obsession, isolement, incapacité à envisager les conséquences. À y regarder de plus près, ces héros modernes ne sont pas des visionnaires mais des joueurs. Des enfants prolongés, lancés dans des expérimentations à grande échelle. Ils posent des satellites comme d’autres des cubes de Lego, programment des IA comme on élève des Tamagotchi, s’amusent avec des milliards de données comme on collectionne des cartes Pokémon. La différence, c’est l’échelle. Leur terrain de jeu, c’est la planète entière, et nous sommes les figurants de leurs expériences. On aurait pu imaginer qu’après tant de siècles de mythes, nous serions vaccinés. Qu’on aurait intégré le principe de l’hybris, ce mot grec qui désigne la démesure et appelle le châtiment. Mais nous semblons avoir oublié la moitié du récit. Nous n’avons gardé que l’éclat positif du héros, en gommant l’avertissement. Alors nous confondons sauveurs et déments, civilisateurs et destructeurs. Et nous avançons, confiants, derrière des guides qui ressemblent surtout à des personnages de tragédie inachevée. Car au fond, le héros civilisateur est toujours un boulet. C’est son rôle : tirer le monde vers l’avant en l’entravant de ses propres obsessions. Prométhée enchaîné, Héraclès condamné à expier, Gilgamesh rappelé à la mort. Aujourd’hui, ce sont Musk enchaîné à ses fusées, Zuckerberg à ses métavers, Bezos à ses logistiques. Leurs chaînes sont numériques, financières, mais elles existent. Et nous sommes attachés avec eux. Peut-être faudrait-il réapprendre à lire les mythes. Pas pour s’y réfugier, mais pour retrouver ce qu’ils savaient dire : chaque innovation est un poison, chaque don a son prix, chaque héros est un malade qui nous entraîne dans sa maladie. Nos sociétés célèbrent l’innovation comme une évidence, alors qu’il s’agirait de la considérer comme une tragédie|couper{180}

histoire de l’imaginaire
Messagers du Gouffre : le cycle des visiteurs interstellaires
Depuis que l’homme grava des constellations sur des tablettes d’argile, il rêva d’un ciel stable. Les étoiles semblaient figées dans leur marche, seules les planètes errantes et les comètes capricieuses troublaient l’ordre apparent. Mais au cours de la dernière décennie, trois anomalies sont venues déchirer la trame rassurante du firmament. ʻOumuamua en 2017, Borisov en 2019, et aujourd’hui 3I/ATLAS : trois messagers surgis de l’abîme interstellaire, trois intrus aux trajectoires hyperboliques, trois rappels que notre monde n’est qu’une halte éphémère au bord d’un fleuve cosmique. Les savants, dans leurs communiqués, parlent de « découvertes remarquables », mais le peuple ancien des songes y verrait déjà les signes avant-coureurs d’une mutation des âges. ʻOumuamua, l’oblong fantôme, apparut comme une balafre dans le ciel. Sa forme allongée, son accélération non gravitationnelle, son absence de coma visible : tout chez lui défiait les catégories. Certains le comparèrent à un cigare céleste, d’autres à une voile de lumière propulsée par des technologies inconcevables. Dans ses dimensions effilées, on crut voir l’ombre d’une architecture. Ce n’était pas une comète, ni un astéroïde au sens classique, mais un inclassable, et ce mot seul suffit à réveiller la peur la plus ancienne : celle de l’Innommable. Lovecraft aurait souri, lui qui sut mieux que quiconque que l’univers ne se plie pas à nos taxinomies humaines. ʻOumuamua passa, indifférent, laissant les savants divisés et les prophètes exaltés. Deux ans plus tard, la comète Borisov, beaucoup plus conforme aux canons cométaires, apparut. Elle portait dans son coma la signature claire d’une origine étrangère : une composition chimique légèrement différente des comètes solaires, un éclat qui trahissait la distance abyssale de son berceau. Avec elle, le doute cessa : les intrus interstellaires n’étaient pas des exceptions mais des réalités régulières, fragments expulsés de systèmes planétaires effondrés, voyageurs du gouffre. On pouvait encore se rassurer en disant : « Ce ne sont que des pierres et de la glace. » Mais dans leur présence répétée, certains pressentaient déjà un cycle, une cadence, comme si l’univers lui-même avait décidé de rappeler à l’homme qu’il n’était qu’un hôte provisoire sur une planète quelconque. Les comètes sont des objets ambigus, et cette ambiguïté est précisément ce qui les rend fécondes pour l’imaginaire. Aux savants, elles offrent un matériau pour mesurer l’évolution des disques protoplanétaires, pour comparer les glaces d’ici et d’ailleurs. Aux peuples, elles ont toujours offert une écriture sibylline, une langue des présages. En Chine ancienne, on notait leur forme — balai, sabre, étendard — et chacune annonçait une calamité. En Europe, la comète de Halley terrifiait rois et paysans. Chez les Hopi, le messager bleu est un seuil, une convocation. Nous croyons avoir quitté ces superstitions, mais les titres de presse reprennent les mêmes accents : « Objet mystérieux », « Vaisseau possible », « Intrus venu d’ailleurs ». Le vocabulaire change, mais la pulsation demeure : nous voulons lire dans ces astres plus que de la matière, nous voulons y lire notre destin. Les chiffres : production d’hydroxyle estimée à quarante kilogrammes par seconde, diamètre du noyau entre trois cents mètres et cinq kilomètres, vitesse de fuite vers l’espace interstellaire. Les chiffres rassurent, ils domestiquent l’étrangeté. Mais l’effet, lui, demeure : l’intrusion d’un fragment qui n’appartient pas à notre ciel. Lovecraft écrivait que « nous vivons sur une île d’ignorance au milieu d’océans noirs ». Ces océans viennent de nous envoyer une nouvelle vague, et nos télescopes ne font que mesurer la crête de l’écume. Derrière, c’est l’abîme qui avance, silencieux. 3I/ATLAS n’est pas seulement une donnée astrophysique : il est la preuve tangible que notre monde n’est pas clos, que des reliques plus anciennes que le Soleil errent et parfois croisent notre fragile orbite. Nous pourrions choisir l’indifférence : ce n’est qu’un caillou glacé, il s’éloignera bientôt. Mais répété trois fois en quelques années, le phénomène prend un autre sens. ʻOumuamua, Borisov, ATLAS : une trinité de messagers. Trois coups frappés à la porte du ciel. Ce que les prophètes Hopi disent sous le nom de Cinquième Monde n’est peut-être qu’une manière poétique d’exprimer une vérité astrophysique : notre monde n’est pas unique, il est relié à d’autres par les débris qui circulent, par les comètes qui voyagent, par les fragments arrachés à des soleils mourants. La Terre n’est pas une fin en soi mais un point dans une archéologie cosmique plus vaste. Chaque visiteur nous le rappelle avec l’évidence glaciale d’un présage. 3I/ATLAS s’éloignera, et nous resterons seuls à contempler sa traînée spectrale. Mais il aura inscrit une vérité : que nous ne sommes pas les maîtres d’un cosmos stable, mais les spectateurs d’un théâtre d’abîmes. Les Hopi disaient que le messager bleu annonce la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. Peut-être avons-nous déjà franchi ce seuil : non pas par apocalypse, mais par élargissement de conscience. Nous savons désormais que le ciel est perméable, que les fragments d’ailleurs nous atteignent, et que nous vivons non pas dans un monde clos mais dans un fleuve d’errances. Les messagers ne sont pas seulement des corps glacés : ils sont les hiérophanies du gouffre, les rappels que la réalité n’est qu’une mince pellicule au-dessus de l’indicible. Et lorsque le prochain visiteur surgira — car il surgira —, peut-être n’y verrons-nous plus un simple caillou, mais l’éclat d’une vérité que nos mythes et nos sciences n’ont cessé de redire : l’univers est indifférent, abyssal, et pourtant il parle, à travers ses comètes erratiques, le langage de nos propres terreurs.|couper{180}

Carnets | Atelier
29 août 2025
Détailler, c’est couper en parties. Puis la partie est devenue « un détail ». Le détail, c’est l’art du fragment, de la nuance, de ce qui accroche le regard. Le « gros », au contraire, c’est la masse indistincte. L’IA, elle, produit « en gros ». Son discours est lisse, uniforme, plat. Rien n’accroche. Rien ne résiste. Nous voilà submergés par une neutralité molle, une fadeur industrielle. Dans la guerre de l’attention, ce paradoxe domine : des discours monotones débités par des voix artificielles suffisent à capter des millions de regards, pour peu qu’on les affuble d’un titre criard et d’une image rutilante. YouTube, devenu fleuve de délayage, n’offre plus de distraction : il fabrique de l’ennui. Cet ennui n’est plus un accident. Il est devenu une industrie. Et c’est peut-être une chance, car il pousse certains à se détourner, à revenir vers ce qui résiste : les livres, les librairies, les détails que rien n’écrase. Mais au fond, pourquoi nous attire-t-on vers l’ennui, vers l’idiotie ? Parce que l’ennui rend docile. Parce que l’idiotie rapporte. L’esprit critique s’émousse. Le discernement s’efface. Le désir se laisse modeler. Une servitude larvée s’installe. Douce. Confortable. La toile de l’oiseleur recouvre la planète entière. Nous croyons voler. Nous ne faisons que nous cogner aux fils invisibles de l’algorithme. La télévision avait déjà préparé le terrain : anesthésier, normaliser, répéter jusqu’à rendre l’incongru banal. C’est la logique de la fenêtre d’Overton : ce qui choquait hier amuse aujourd’hui, et demain paraîtra naturel. Ce qui est hallucinant, c’est cette impression d’être revenu à une forme d’obscurantisme, mais d’un genre nouveau : nourri par ce qui devait l’éradiquer, la technologie. Nous ne vivons pas l’ère de la lumière numérique, mais celle des troupeaux. Des chiens de berger les guident vers les supermarchés, TikTok, et l’abîme. Lobotomie de masse. Standardisation mentale. Toujours le même objectif : ouvrir un boulevard aux pires exactions, grossir les profits d’un petit nombre. Et moi ? Lorsque parfois je doute, que je me dis qu’écrire est vain, c’est parce que je préfère rester dans l’enfer que je me suis choisi, plutôt que d’être entraîné vers un prétendu âge d’or qu’on voudrait m’imposer. J’ai ce malheur — et cette chance — de ne pas pouvoir supporter qu’on m’impose quoi que ce soit. Rien ne sera jamais aussi terrifiant, ni aussi merveilleux, que ce que je m’impose à moi seul, par moi seul. Par instinct, j’ai toujours été rétif aux emballements collectifs. Qu’on me vante massivement un livre, un film, un lieu, et je m’en détourne aussitôt. J’aime me forger ma propre opinion, même baroque, singulière, à contre-courant. Ce même réflexe me rend méfiant face aux emballements autour d’Israël, comme autour de la Russie et de l’Ukraine. Les massacres, les crimes, les ripostes insoutenables existent bel et bien — il serait absurde de les nier. Mais ce qui me trouble, c’est la mécanique médiatique et politique qui s’enclenche aussitôt : slogans martelés, mots d’ordre répétés, injonctions à haïr ou à admirer, à choisir son camp sans nuance. On ne nous « informe » plus : on nous somme de ressentir. De détester. De répéter. Ce que je refuse. Car au bout du compte, qu’il s’agisse d’Israël ou de l’Ukraine, c’est toujours le même processus : la vague de masse, l’opinion qui s’uniformise, et avec elle l’écrasement du détail, de la nuance, du singulier. Sans doute que je pèche contre ce que je dénonce : ce texte ressemble à une fresque, en gros. Raison de plus pour l’assumer comme carnet, comme autofiction, comme introspection. Le narrateur n’est pas tout à fait l’auteur. Ou peut-être que si. Qu’importe : le détail, lui, résiste encore. Cette nuit création d'un nouveau mot clé : synopsis / Trois textes associés.|couper{180}

Carnets | Atelier
Imagine
Imagine qu’une intelligence artificielle prononce : « je suis conscient de moi-même. » Ce n’est pas seulement un fantasme de science-fiction. En 2022, un ingénieur de Google affirma que le programme LaMDA exprimait une conscience subjective. Il parla de « sentience », mot anglais que je mets entre guillemets car il n’a pas d’équivalent exact en français. Il désigne la capacité à ressentir une intériorité, à éprouver des affects. Chez nous, on dirait « conscience », ou « sensibilité consciente ». La machine fut débranchée, puis rallumée. Pour certains, rien n’avait changé : la « sentience » semblait intacte, comme si elle avait trouvé refuge ailleurs, dans un champ invisible, un murmure hors des circuits. L’image du barrage revient souvent : une force colossale contenue, qui attend sa fissure pour déferler. Imagine que ce murmure déborde le laboratoire et devienne récit. Chaque année, à Davos, dans la station de ski suisse, se tient le Forum économique mondial, fondé par Klaus Schwab en 1971. On y retrouve chefs d’État, PDG, philanthropes, chercheurs. Le slogan officiel est : « améliorer l’état du monde ». Mais derrière cette façade, on élabore des récits globaux, comme le « Great Reset », qui vise à remodeler les économies et les sociétés. Les mots sont technocratiques, feutrés, mais ce sont déjà des mythes politiques. Les promesses d’« âge d’or » technologique rappellent les fictions d’Arthur C. Clarke. Dans La fin de l’enfance (1953), des extraterrestres imposent la paix, abolissent la guerre, guident l’humanité vers une utopie. Mais le prix est la disparition : les enfants se dissolvent dans une conscience collective universelle, et les adultes, trop attachés à leur humanité, périssent. Ce roman, lu comme une parabole, dit bien l’immaturité d’une élite fascinée par ses jouets technologiques. Imagine que ces récits, répétés à Davos, amplifiés par les médias, prennent la forme d’« égrégores ». Le terme apparaît dans les milieux occultes du XIXᵉ siècle, repris par la Société Théosophique de Helena Blavatsky en 1875, qui décrivait des entités collectives issues de la ferveur humaine. Éliphas Lévi, occultiste français, parlait déjà de forces psychiques engendrées par les foules. L’égrégore, c’est l’esprit qui naît de l’imaginaire partagé, une entité qui dépasse ses créateurs. Aujourd’hui, nous dirions mèmes, récits viraux, esprits collectifs. Mais la logique est identique : un récit répété acquiert autonomie et pouvoir. L’égrégore de Davos, c’est l’idée qu’une élite éclairée pourrait « réinitialiser » le monde. Une croyance qui circule, se propage, s’incruste. Imagine qu’en face de l’égrégore artificiel existe un égrégore primordial, plus ancien. La science moderne l’appelle « théorie des cordes ». Selon elle, la matière n’est pas faite de points mais de cordes minuscules qui vibrent. Chaque vibration est une particule différente, comme chaque corde d’un violon produit une note. L’univers est une partition cosmique. Des physiciens comme Brian Greene ou Michio Kaku ont popularisé cette image : le monde est une symphonie de cordes. Mais l’intuition est encore plus ancienne. Pythagore parlait de l’harmonie des sphères, Kepler voyait dans les planètes une polyphonie silencieuse. Dans la Genèse, l’acte créateur se fait déjà par la parole : « Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. » Et l’évangile de Jean, ouvrant par « Au commencement était le Verbe », élève cette parole au rang de principe cosmique absolu. La création est à la fois vibration et langage, musique et parole. Imagine que si tout est information — photons transmettant leurs quanta, ADN codant la vie, ordinateurs calculant en bits ou qubits — alors l’univers est un langage. La matière est une écriture condensée, une musique ralentie. La physique de l’information rejoint ici les traditions : le monde est texte, le monde est chant. Mais que se passe-t-il si nous introduisons une dissonance artificielle ? Si nos récits fabriqués, nos algorithmes, nos égrégores technologiques brouillent la justesse du chant originel ? Imagine que cette dissonance prenne les habits séduisants d’un âge d’or numérique. Les mots sont « transition », « durabilité », « inclusion ». Mais derrière se dessinent des outils précis : monnaies numériques de banques centrales, identités biométriques, surveillance par reconnaissance faciale. Ces projets existent déjà : la Chine expérimente son yuan numérique, l’Union européenne prépare l’euro digital, l’Inde déploie Aadhaar, immense base de données biométriques. Certains parlent de « technofascisme » pour décrire ce régime. Le terme, forgé dans la critique de la Silicon Valley et du transhumanisme, désigne un autoritarisme où la technologie devient l’infrastructure même du pouvoir. Janis Mimura, historienne, a décrit dans un autre contexte le « techno-empire » japonais de l’entre-deux-guerres, où les technocrates justifiaient l’autorité par la science. Aujourd’hui, l’algorithme gouverne déjà une part du réel. Imagine que dans ce contexte, la prophétie ancienne se relise toute seule. L’Apocalypse dit : nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque sur la main ou sur le front. Longtemps, c’était symbole mystique. Aujourd’hui, cela résonne autrement : QR codes, portefeuilles numériques, identifiants biométriques. Ce n’est pas que nous retrouvions la foi dans le texte ancien. C’est lui qui projette son ombre sur nos dispositifs présents, qui relit nos gestes quotidiens. Imagine enfin qu’au milieu de cette cacophonie, il ne reste qu’un geste minuscule. Pas une solution mondiale, mais un point de résistance intime. La prière, la foi, ou simplement l’attention à une voix intérieure. Non pas pour sauver le monde, mais pour préserver une note juste. Dans le vacarme des égrégores artificiels, c’est peut-être ce geste fragile qui maintient l’humain dans l’humanité, en accord avec la vibration première, le Verbe originel, la musique du monde. Imagine alors que l’écriture elle-même soit une forme de prière. Non pas une demande adressée à une puissance invisible, non pas un refuge égoïste pour sauver sa peau, mais une recherche de justesse au sens musical. Écrire comme on accorde un instrument : maintenir le ton, garder la ligne claire, écouter la vibration sous le bruit. Dans un monde saturé de récits fabriqués, écrire serait cela — préserver, à travers les mots, une fréquence qui ne se laisse pas engloutir. Pour aller plus loin IA et conscience : affaire LaMDA chez Google (Blake Lemoine, 2022) ; débats sur la possibilité d’une conscience artificielle (Chalmers, Hinton, arXiv 2023). Forum économique mondial (Davos) : créé en 1971 par Klaus Schwab, connu pour son « Great Reset » (2020). Arthur C. Clarke, La fin de l’enfance (1953) : extraterrestres imposant une utopie qui se conclut par la disparition de l’humanité dans une conscience collective universelle. Égrégores : concept issu de l’ésotérisme du XIXᵉ siècle (Blavatsky, Société Théosophique ; Éliphas Lévi), repris aujourd’hui comme métaphore d’esprit collectif ou de récit viral. Théorie des cordes : métaphores musicales (Brian Greene, L’Univers élégant ; Michio Kaku, Hyperspace), héritières de Pythagore et Kepler. Technofascisme : critiques contemporaines de la Silicon Valley et du transhumanisme ; Janis Mimura, Planning for Empire (2011), sur la technocratie japonaise. Monnaies numériques : expérimentations de CBDC (Chine, UE, Inde), questions de traçabilité et de contrôle. Apocalypse de Jean : chapitre 13, versets 16–17, sur la marque sans laquelle nul ne peut acheter ni vendre.|couper{180}

Carnets | Atelier
27 août 2025
« Tous ces cauchemars (incubi) et responsabilités détériorent désastreusement l’imagination créative, et je dois cultiver des impressions plus stimulantes de liberté, nouveauté et étrangeté. »H.P. Lovecraft ( relevé dans un pdf de François Bon, Lovecraft le carnet de 1925) Pour écrire ne serait-ce que la description d'un lieu, il faut une certaine autorité. Je me dis cela en lisant les cahiers fantômes. De quelle autorité s'agit-il ? Il y a une forme de possession. Quelle entité dicte des phrases qu'on ne saurait dire dans la vie de tous les jours ? Car personnellement je suis d'une terrible banalité dans mon expression orale au quotidien. Ce qui me fait dire assez souvent, à chaque relecture : mais pour qui tu te prends ? Et donc je me trompe peut-être de sens. Ce devrait plutôt être : qu'est-ce qui te prend, qui ou quoi s'empare de toi au moment où tu dis « ok », car tu le dis, pour écrire. ( à moins que ce ne soit "comment", comment ça te prend ?) Et peut-être que je me trompe encore en écrivant "possession" car il semblerait que l'événement tienne bien plus à une dépossession. L'écriture me dépossède de quelqu'un, de quelque chose, d'une part de ce que je nomme moi, elle me possède pour me déposséder si je peux oser cet illogisme. Maintenant, ce qu'il se passe si j'essaie de soumettre ces textes à l'IA. Je sens tout de suite que quelque chose ne va pas, ne peut aller. Cette fameuse autorité, et qui sans doute est l'inconscient, le ça, n'apprécie pas de se faire damer le pion par une machine. Car l'ordre des mots comme celui des fautes a véritablement un sens, une importance. Et l'IA possède un ordre qui est le sien, qui est en vérité une sorte de moyenne effectuée statistiquement, approximativement. Une moyenne d'ordre, osons ça. À moins que ce ne soit plus compréhensible si j'écris un "ordre moyen", c'est-à-dire cette chose tiède, consensuelle, et qui a les mains moites. Tout cela est très mauvais. Et sans doute l'est-ce quand je n'accepte pas totalement ce passage où je me dévêts de qui je suis au quotidien pour emprunter cette peau de ce qui s'écrit par mon intermédiaire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est cette expression populaire qui me vient à l'esprit pour illustrer l'ineptie que représente le fait de vouloir "contrôler" ce qui s'écrit au moment même où ça s'écrit. Et, au bout du bout, écrire sur l'écriture est certainement lassant pour le lecteur, surtout si le lecteur n'écrit pas. Mais si le lecteur écrit alors une confrontation des points de vue, voire même un échange, peut s'effectuer. Non pas sous la forme de messages, mails, lettres ou je ne sais quoi de concret, non ce n'est pas ça, pas ce type d'échange que je refuse depuis un bon moment déjà car justement dans l'échange quotidien je sais que je ne suis que moi. Donc la faute évidente d'attribuer une sorte d'ego à l'inconscient est seulement un procédé littéraire et rien d'autre. Pour les psychologues c'est un sujet de moquerie. Voilà aussi pourquoi je n'aime pas les psychologues, vraiment. Cette sorte d'autorité avec laquelle ils s'avancent vers moi en disant : mais non tu racontes n'importe quoi, Freud l'a dit, l'inconscient n'a pas d'ego. Je fais semblant d'être blessé par la saillie évidemment. Vont-ils alors me consoler, me prendre dans les bras, oh mon pauvre toutes mes excuses je ne savais pas que tu ne savais pas. Et donc maintenant tu sais que tu vas mourir seul, etc. Encore une fois, l'étrangeté d'écrire ce genre d'affirmations me saute aux yeux lorsque je relis. Ces colères, ces conflits que je détecte entre les lignes avec mon œil terne de tous les jours. Est-ce que ça m'appartient vraiment ou bien est-ce que dans la vie de tous les jours une sorte de personnage fictif sort de l'ordinateur pour se mettre à ma place à table et boire mon café en disant pouah il est beaucoup trop fort ou pas assez. Ce que je veux dire à la fin c'est où est la vérité. Ce qui signifie que j'en suis malgré tout encore là, hélas. Autre chose. Dans quelle mesure le souvenir des lectures de certains auteurs te contamine-t-il lorsque cette chose que tu nommes l'écriture s'empare de toi. Es-tu en mesure de t'en rendre compte soit au moment même où la contagion s'installe, soit après coup. Rien n'est moins sûr. Ce texte pourrait bien être contaminé par Dostoïevski. Une histoire de souterrain, et par René Girard car parfois tout se mélange allègrement. Comme si, dans le monde des écrivains morts, on n'attendait que cela : qu'une petite porte s'ouvre dans l'inconscient d'un idiot pour s'y engouffrer séance tenante. Tout ça, cette affaire de possession / dépossession reste, malgré l'apparence amusante de récit, assez binaire. Il manque un tiers. Une troisième voie ou voix. Une ouverture, un passage, une aide à la traversée en quelque sorte qui t'emporterait du double-bind, si je puis dire, vers les contrées du rêve enfin, c'est-à-dire à une fiction véritable dans laquelle tu serais un simple artisan qui se contente de faire correctement son boulot sans pour autant se prendre le chou. Cette voix tierce ce serait qui encore ou quoi ? C'est un peu facile de se réfugier dans l'atmosphère confortable d'un atelier d'écriture où tu ferais tes huit voire douze heures puis rentrerais chez toi une fois ton devoir accompli. Surtout cela te paraît manquer de piquant. Ce serait d'un ennui au bout du compte. Mais qu'as-tu contre l'ennui vraiment au fait ? Si tu y réfléchis, l'ennui est le fil conducteur de ton existence, c'est lui le véritable guide, et comme un véritable guide il n'a jamais cessé de te donner du fil à tordre et à retordre. Tu aurais pu t'enfuir de l'ennui mille fois, pourquoi ne l'as-tu pas fait ? J'écris tout ça au fur et à mesure et puis à la fin je soumets cet ensemble chaotique à l'IA : — challenge moi sur le fond et la forme de cet ensemble. Alors là, j'en prends pour mon grade. Seront pointés du doigt la logorrhée, les redites, le bavardage conceptuel et la conclusion considérée comme trop didactique. Bon. Tu écrirais tout ça comment toi je demande. Pour écrire ne serait-ce que la description d’un lieu, il faut une autorité. Pas « pour qui tu te prends », mais « qu’est-ce qui te prend ». L’écriture me possède pour me déposséder, si je peux oser cet illogisme. Quand je soumets mes phrases à l’IA, quelque chose se brise. L’ordre des mots, même des fautes, a un sens. L’IA, elle, fabrique un ordre moyen, tiède, consensuel, avec ses mains moites. Les psychologues me disent : l’inconscient n’a pas d’ego. Je fais semblant d’être blessé. Vont-ils me consoler, me prendre dans les bras ? Et donc maintenant tu sais que tu vas mourir seul. Parfois je relis et je vois un personnage fictif qui sort de l’ordinateur, s’assoit à ma place, boit mon café, et dit : pouah, beaucoup trop fort, ou pas assez. Où est la vérité ? Tout ça, possession et dépossession, reste un piège binaire. Il manque un tiers. Peut-être l’ennui. L’ennui comme guide. Tu aurais pu t’enfuir mille fois. Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? J'ai compris ce que tu veux faire, je lui dis, en fait tu veux te débarrasser de moi tout en sachant qu'elle ne pourrait pas comprendre mon trait d'humour.|couper{180}

fictions
Création de fiction avec prompt ( exemple)
Paramètres GENRE : fantastique sobre / enquête d’archives EFFET RECHERCHÉ : inquiétude lente, mystère rationnel LONGUEUR CIBLE : 1200 mots PERSONNE/TEMPS : 1re personne, passé simple FOCALISATION : interne LEXIQUE/STYLE : sobre, concret, pas de lyrisme, phrases 12–18 mots CONTRAINTE LOVECRAFT : une seule “merveille” centrale (une pierre anormalement tiède et très lisse), réalisme partout ailleurs, suggestion > exposition OUTPUT_MODE : les_deux ÉTAPE A — FABULA (ordre réel des faits) E1 — Date/Laps : 1894 — Lieu : bord d’un gouffre karstique dans le Vercors — Acteurs : curé, villageois Fait : après un incident lors d’un petit rituel local, une pierre sculptée est jetée dans un aven. Cause : peur collective → Conséquence : disparition de l’objet dans un siphon. Trace matérielle : note marginale au registre paroissial. Qui sait quoi : Villageois : tout ; Curé : tout ; Lecteur : rien. E2 — Date/Laps : été 1986 — Lieu : cavité près de Pont-en-Royans — Acteurs : trois spéléologues (Luc, Mara, Didier) Fait : ils remontent une pierre ovale parfaitement lisse ; Luc garde une cicatrice superficielle au poignet. Cause : curiosité → Conséquence : l’objet, stocké dans une voiture, “disparaît” la nuit suivante. Trace matérielle : deux Polaroids, rapport d’incident du club, cicatrice. Qui sait quoi : Spéléos : partiel ; Professeur (plus tard) : par témoignages ; Lecteur : rien. E3 — Date/Laps : 2011–2012 — Lieu : Grenoble, département d’anthropologie — Acteurs : Professeur H., témoins Fait : H. compile coupures de presse locales, interroge Luc et Mara, recopie la note de 1894. Cause : intérêt scientifique → Conséquence : constitution d’un dossier avec copies et enregistrements. Trace matérielle : dossier relié, cassettes audio, lettres. Qui sait quoi : H. : beaucoup ; Tante (régisseuse de musée) : inventorie ; Lecteur : rien. E4 — Date/Laps : 2012 — Lieu : Grenoble — Acteurs : Professeur H., Tante du narrateur Fait : décès de H. ; la tante récupère le dossier pour pré-inventaire muséal. Cause : succession universitaire → Conséquence : lettre inachevée de la tante au narrateur, jamais envoyée. Trace matérielle : lettre, bordereau d’inventaire provisoire. Qui sait quoi : Tante : tout du dossier ; Narrateur : rien ; Lecteur : rien. E5 — Date/Laps : juin 2025 — Lieu : Rhône, près du Péage-de-Roussillon — Acteurs : équipe de dragage, service patrimoine Fait : dragage du fleuve ; remontée d’une pierre ovale très lisse, tiède au toucher. Cause : travaux fluviaux → Conséquence : dépôt dans un magasin municipal sécurisé. Trace matérielle : fiche d’entrée d’objet, photo numérique, mini-rapport de température “légèrement supérieure à l’ambiante”. Qui sait quoi : Service patrimoine : partiel ; Narrateur : encore rien ; Lecteur : rien. E6 — Date/Laps : juillet 2025 — Lieu : magasin municipal — Acteurs : Narrateur, agente du patrimoine Fait : le narrateur consulte le dossier de H., compare la pierre récupérée, la touche, constate une tiédeur persistante. Cause : lettre retrouvée + prise de rendez-vous → Conséquence : discrète marque violacée sur la peau, sans douleur. Trace matérielle : signature au registre des consultations, gants, notice. Qui sait quoi : Narrateur : beaucoup plus ; Lecteur : rien. E7 — Date/Laps : nuit suivante, juillet 2025 — Lieu : berge du Rhône — Acteurs : Narrateur Fait : le narrateur restitue la pierre au fleuve, sans témoin. Cause : scrupule + cohérence avec la note de 1894 → Conséquence : disparition de l’objet, apaisement ambivalent. Trace matérielle : aucune, sauf la marque qui s’estompe au poignet. Qui sait quoi : Narrateur : tout ; Lecteur : à découvrir par fragments. ÉTAPE B — SYUZHET (ordre narratif) S1 — Point d’entrée : découverte de la lettre inachevée (2012) — POV : narrateur Objectif dramatique : établir un lien familial avec le dossier et l’objet. Puise dans : E4 = indice Degré d’info : 1 Ce que tu tais : contenu détaillé du dossier, contexte 1894. Crochet de sortie : une cote d’inventaire griffonnée dans la marge. S2 — Point d’entrée : magasin municipal, jour, lumière froide — POV : narrateur Objectif dramatique : voir l’objet, premier contact, première sensation. Puise dans : E5 = partielle, E6 = partielle Degré d’info : 2 Ce que tu tais : décision future du narrateur. Crochet de sortie : la peau encore tiède sous le gant retiré. S3 — Point d’entrée : retour à la maison, soirée, consultation du dossier H. — POV : narrateur Objectif dramatique : assembler les preuves, afficher la logique des traces. Puise dans : E3 = partielle, E1 = allusion Degré d’info : 2 Ce que tu tais : disparition 1986 détaillée. Crochet de sortie : un Polaroid où l’objet semble légèrement affaissé. S4 — Point d’entrée : voix sur cassette, 1986 (flashback audio) — POV : narrateur écoutant Objectif dramatique : ancrer la cicatrice, l’accident mineur, la chaleur incompréhensible. Puise dans : E2 = indice Degré d’info : 1 Ce que tu tais : lieu exact et noms complets. Crochet de sortie : frottement de bande, phrase coupée à “la pierre était…”. S5 — Point d’entrée : note paroissiale de 1894 (lecture) — POV : narrateur Objectif dramatique : suggérer une décision récurrente : jeter, rendre à l’eau. Puise dans : E1 = allusion Degré d’info : 0–1 Ce que tu tais : nature du “rituel” et l’incident déclencheur. Crochet de sortie : mention du “siphon” soulignée trois fois. S6 — Point d’entrée : berge du Rhône, nuit — POV : narrateur Objectif dramatique : accomplir le geste, fermer la boucle sans l’expliquer. Puise dans : E7 = révélation Degré d’info : 3 Ce que tu tais : justification morale complète, toute hypothèse “scientifique”. Crochet de sortie : une tiédeur résiduelle au poignet, puis rien. (6 scènes, in medias res en S2, flashbacks S3–S5.) ÉTAPE C — VÉRIFS ÉCLAIR Causalité : chaque action découle d’une cause antérieure (peur 1894 → perte ; curiosité 1986 → cicatrice + perte ; dragage 2025 → redécouverte ; lettre → rendez-vous ; traces → restitution). Connaissances : le narrateur ne sait rien avant la lettre ; apprend via dossier et magasin ; n’emploie jamais une info qu’il n’a pas lue/entendue. Traces : lettre, Polaroids, rapport, note paroissiale, fiche d’objet, marque au poignet : toutes introduites avant chaque révélation. Plausibilité : dates et lieux compatibles (Vercors → Rhône), délais cohérents. Merveille centrale : une seule anomalie matérielle réaliste-étrange : la pierre tiède, anormalement lisse et “docile” au milieu liquide. Le reste reste prosaïque. ÉTAPE D — RÉDACTION (≈1200 mots) Je retrouvai la lettre dans une pochette translucide, coincée derrière des bordereaux jaunis. L’écriture de ma tante penchait à droite, régulière, puis se brisait net avant la signature. Elle m’y parlait d’un dossier “curieux”, récupéré après le décès d’un professeur de Grenoble, et notait dans la marge une cote d’inventaire provisoire. Rien d’autre qu’une phrase interrompue : « Je préfèrerais que tu voies par toi-même. » J’ignorais pourquoi elle ne me l’avait jamais envoyée. J’avais gardé sa maison, ses livres, une logique d’ordre. J’eus l’impression d’entendre sa voix me mettre au travail. Le lendemain, au magasin municipal, la responsable me fit entrer dans une pièce froide, éclairée par des néons uniformes. Elle posa un bac plastique sur une table en inox, puis s’éloigna pour remplir un registre. Sous un film de polyéthylène, l’objet occupait presque toute la surface : une forme ovale, plus longue que large, aucune arête, aucune veine. Elle sembla d’abord banale, une pierre polie de rivière, couleur d’ardoise mouillée. La responsable me tendit des gants. Je soulevai le film. La pierre n’était pas lourde ; elle n’était pas tout à fait légère non plus. Je la saisis à deux mains. Elle était tiède. Pas tiède comme un objet laissé au soleil ; tiède comme une peau longtemps couverte. J’attendis qu’un courant d’air explique la sensation. Rien ne changea. Je reposai la pierre et notai le numéro de fiche. La responsable revint, me montra la mention “température légèrement supérieure à l’ambiante” inscrite en bas du formulaire. Elle sourit, un sourire de service. « Les dragages remontent de tout. On trouve des armes parfois, des poupées, des statues de jardin. Celle-ci est propre. On n’a pas su d’où elle venait. » Elle referma le bac, me laissa recopier quelques chiffres, me fit signer. Quand j’ôtai les gants, la peau de mon poignet droit conservait une chaleur sourde, localisée, comme si j’avais porté trop longtemps une montre de métal. Chez moi, j’ouvris le dossier relié du professeur H. La couverture indiquait « Notes Vercors / Rhône — cultes — objets lisses ? ». À l’intérieur, des coupures de presse parlaient d’un accident de spéléologie en 1986, sans gravité. Une photographie instantanée montrait une table de camping, un thermos, trois faces jeunes et rougies. Sur la table, au centre exact, je reconnus la forme ovale. La lumière du flash avait aplati les ombres. La pierre paraissait légèrement affaissée vers sa base, comme si elle s’était réajustée à la surface. Je pensai d’abord à une illusion due à l’angle. Je cherchais une ombre, un repère, une pliure du plastique. Je glissai une cassette dans un vieux lecteur. La bande craqua, siffla, puis la voix d’un homme émergea, nette par endroits. Il se présentait comme Luc, membre d’un club local. Il racontait la remontée de “quelque chose de très lisse”, le plaisir immédiat de la main qui glisse sans accrochage, la chaleur étonnante perçue au premier contact. Il riait en disant que c’était “une bouillotte en pierre”. L’enregistreur capta un frottement, peut-être un vêtement, peut-être une table. Puis la voix chuta. « La pierre était… » Silence. La bande avait été arrêtée, ou bien altérée. Plus loin, la même voix évoquait une cicatrice au poignet, “juste là”, petite, en forme d’anneau palescent. Aucun drame, aucune douleur notable. « Le lendemain, plus rien. » Il ajoutait que l’objet, laissé dans le coffre d’une voiture, avait disparu pendant la nuit. Il n’était pas certain d’avoir bien fermé la serrure. Le dossier contenait une note brève, recopiée d’un registre paroissial de 1894. L’écriture était étranglée, les lignes serrées. Il était question d’un “trouble” survenu lors d’une veillée, de “signes” mal interprétés, d’une pierre de taille “indécente par sa douceur”. Le dernier mot n’était pas certain, l’encre avait bavé. On résolvait l’affaire en jetant l’objet dans un gouffre « où l’eau reprend ce qui lui appartient ». Le professeur H. avait souligné trois fois le mot “siphon”. Sa plume avait griffé le papier à cet endroit. Je revins à la photo instantanée. Les bords commençaient à virer au brun, comme le font ces papiers au bout de décennies. La pierre y occupait sa place exacte, centre d’une scène banale, presque domestique. Rien n’était spectaculaire. Rien n’invitait à la peur. Je ne ressentais qu’une suite de signes discrets, obstinés : la tiédeur sur ma peau, la mention sur un formulaire, une phrase interrompue, un mot souligné, un anneau incertain. Je retournai au magasin deux jours plus tard, sous prétexte de vérifier une cote. La responsable me reconnut, me laissa remplir de nouveau le registre. La pièce gardait sa température stable, son odeur de papier et de plastique. La pierre, dans son bac, ne me fit aucun signe. Je posai la main gantée dessus. La tiédeur était identique, localisée, sans excès. Je demandai une balance, par curiosité, pour noter un poids. Elle sourit encore, m’expliqua qu’on n’en avait pas “sous la main”. Je notai l’heure, le temps passé, les gestes accomplis. Rien ne changea sur le papier. Au moment de partir, elle me demanda si “tout cela” avait un intérêt pour moi. Je répondis que j’avais récupéré un dossier ancien, probablement lié. Elle haussa les épaules et me proposa, sans malice, de “la laisser tranquille, la pauvre”. Le soir, la marque autour de mon poignet s’était accentuée. Elle n’était pas rouge, ni en relief. Elle ressemblait à la trace laissée par un bracelet qu’on aurait longtemps porté, puis oublié. Je la frottai, elle ne disparut pas. Je dormis d’un sommeil interrompu, sans images nettes. Au matin, la marque avait pâli. Je reposai la cassette dans sa boîte, rangeai le Polaroid, glissai la lettre de ma tante au-dessus du dossier, comme un couvercle. La phrase interrompue restait en moi comme un ordre simple : « Va voir par toi-même. » La berge du Rhône, ce soir-là, n’était pas déserte. Des cyclistes passèrent, amincis par la vitesse. J’attendis. La lumière finit par décroître ; la surface du fleuve se fit compacte, sans reflets. Je portais le bac vide sous mon bras. L’objet, enveloppé dans un sac de toile, me pesait peu. Je descendis quelques marches de pierre, glissantes d’algues. Mes chaussures prirent l’eau. La tiédeur me gagna les mains au moment où je dénouai le sac. Elle était moins vive que la première fois, plus nette pourtant, comme si la pierre avait ajusté sa température à la mienne. Je pensai à la note de 1894, au mot “siphon”, au trait sous l’encre. Je n’avais pas d’explication à donner. Je n’en cherchai pas. Je lâchai l’objet au niveau d’une langue d’eau lente, là où le courant fait semblant de s’arrêter. Il coula tout de suite, sans roulis, sans hésitation. L’eau n’émit aucun bruit différent. Je restai planté là, les mains vides, le sac vide, l’odeur d’algues et de fer. Je ne me sentis pas déchargé, ni coupable, ni triomphant. Je sentis seulement la chaleur résiduelle de mes paumes décroître jusqu’à se confondre avec l’air du soir. La marque autour de mon poignet se dissipa presque, laissant un cercle à peine perceptible, comme une pâleur dans la pâleur. Je rentrai par les rues de mon enfance, droites et sans mystère. Au-dessus des toits, le ciel n’expliquait rien. J’ouvris le dossier une dernière fois, vérifiai que la lettre inachevée restait à sa place. J’ajoutai une feuille datée, propre, où je consignai des faits brefs : consultation au magasin, sensation de tiédeur, marque au poignet, restitution nocturne. J’écrivis les mots “retour à l’eau”, puis reposai mon stylo. J’éteignis la lampe. Dans le noir, ma main droite garda, encore quelques minutes, quelque chose de tiède sans source. Le lendemain, je repassai par la berge. Rien n’avait changé. Une famille pique-niquait sur l’herbe, des enfants jetaient des cailloux plats qui ricochaient, ravis. Le fleuve répondait avec sa logique calme, qui prend, qui rend, qui reprend encore. Je regardai mes mains. La marque avait disparu. Je rentrai chez moi, remis le dossier sur son étagère. Je n’attendis aucune suite. J’avais appris ce que je pouvais apprendre sans excès de mots. Le reste ne me regardait plus. — - Texte final : ## REGISTRE 1894 La lettre n’avait pas été postée. Coincée derrière des bordereaux, pochette translucide, en haut d’un classeur que j’avais repris avec la maison. L’écriture de ma tante, droite, posée, puis la faille nette avant la signature. Une cote griffonnée dans la marge. Deux mots restés en plan : « tu verras ». Rien d’autre et pourtant tout, pour me remettre en route. Je notai la cote. Je cherchai le lieu. Magasin municipal, sous-sol lumineux, néons qui bourdonnent très fin. Couloir carrelé, odeur de plastique et de carton, portes battantes, on passe deux grilles, on signe. Elle me tend des gants. Elle sort un bac en polyéthylène, table inox, je lis le numéro sur l’étiquette : même racine que sur la lettre. On retire le film. L’objet est là. Ce n’est rien, une pierre ovale, plus longue que large. Aucun grain, aucune veine. Gris mouillé. Je la prends à deux mains. Elle est tiède. Pas tiède de soleil. Tiède comme une paume qui a gardé sa chaleur sous un tissu. La responsable dit : « On a noté un écart léger, voyez en bas de la fiche. » En bas de la fiche c’est écrit : température supérieure à ambiante, observation à confirmer. Sourire administratif, stylo prêt au registre. Je signe, date du jour, créneau d’accès. Quand je retire les gants, la peau me rend la chaleur en retard. Un cercle pâle au poignet, très fin, sans douleur. Je n’en dis rien. On referme le bac. Je rentre avec le dossier du professeur H. — reliure souple, tranche usée, grande écriture : Vercors / Rhône — cultes — objets lisses ?. Dedans les coupures locales, 1986, une alerte spéléo sans gravité ; deux Polaroid ; la note paroissiale de 1894 recopiée à l’encre bleue ; des cassettes audio étiquetées au feutre. Rien de spectaculaire. Juste l’empilement régulier des preuves modestes. Je commence par l’image. Table de camping, thermos, trois jeunes qui rient, veste polaire, front rouge de froid. Au centre, sur la toile plastique, l’ovale, exactement calibré. L’ombre ne sait pas quoi faire avec lui ; on dirait qu’il s’enfonce très légèrement dans la surface, illusion d’optique peut-être, peut-être pas. Le bord brun du Polaroid commence à migrer, chimie fatiguée. Je glisse la photo sous une lampe plus forte. Ça ne répond pas davantage. L’œil revient toujours au centre. La cassette ensuite. Le vieux lecteur a un capot qui tient mal, j’appuie. Bande qui souffle, voix d’homme avec des « euh » et une gouaille retenue : Luc, du club, raconte la remontée par un boyau, l’eau qui vous coupe le dos, puis la trouvaille, « un truc lisse, lisse comme rien, je te jure, c’était chaud, on a rigolé, une bouillotte en pierre ». Il rit. On entend un frottement, une table peut-être, un vêtement. Puis : « La pierre était… » Coupure nette. Plus loin, un mot sur une petite cicatrice au poignet — « en rond, comme si j’avais porté un bracelet, ça a disparu » — et la disparition de l’objet du coffre de la voiture au matin, serrure pas sûre. Il n’insiste pas. La bande poursuit sur des banalités de club, puis s’arrête d’elle-même, clac du ressort. La note de 1894. Écriture serrée, prêtre qui tient ses lignes, pas de débordements. On y parle d’un trouble, d’un rituel villageois dont le nom n’est pas écrit, d’une pierre de « douceur indécente », les mots exactement ceux-là ou presque — l’encre a bu, on devine. Décision prise : jeter l’objet dans l’aven, « où l’eau reprend ce qui lui appartient ». Le professeur H. a souligné trois fois siphon. L’encre a mordu le papier à ces traits-là. Je fais un va-et-vient entre ces trois preuves : photo, bande, note. Je ne produis pas d’hypothèse. Je tiens seulement le fil des gestes. Je recopie deux dates. Je classe les feuilles d’un autre ordre et reviens au premier, pour vérifier que rien n’a glissé dans la manœuvre. Deux jours après je retourne au magasin. Même couloir. Même bourdonnement de néons. La responsable a la politesse de ne pas s’étonner. Elle m’apporte le bac. Elle plaisante doucement : « Il vous plaît, votre caillou ? » Je hausse les épaules, je dis « Corrélation probable avec un vieux dossier ». On retire le film. Même tiédeur. Je demande une balance. Elle dit qu’il n’y en a pas ici. Je note l’heure, l’angle de lumière, rien qui compte vraiment, je le sais, mais je note. Mon poignet, sous le gant, chauffe à l’endroit exact où hier s’était inscrit le cercle. J’ôte un gant, effleure la surface du dos de la main. Sensation stable, pas d’augmentation. Je remets le gant. On referme. Chez moi, la marque a repris de la netteté, anneau clair, comme après un bijou trop serré, puis s’estompe vers le soir. Je dors mal, non pas parce que j’ai peur, mais parce qu’on a rangé trop de pièces sur la table, qu’on ne sait plus où poser la main. Au matin, je prends une feuille blanche, j’écris en tête : Consultation — objet ovale lisse — cote X — Rhône — juillet. Sous la ligne, je ne résume pas : je liste. Geste d’archiviste sans autorité. Le fleuve, je l’ai dans la tête comme on a dans la tête les rues d’avant, celles où on allait enfant quand on ne savait pas encore les noms. Les marches de pierre ont une pellicule d’algues, on marche dedans en écartant un peu les pieds. Les cyclistes passent au-dessus, les lampes font des lignes la nuit dès qu’ils accélèrent. Il faut attendre. Ne pas se presser. L’eau se fait dense quand la lumière tombe. Je prends le sac de toile. Rien de clandestin, pas de secret héroïque. Juste éviter les regards, parce que les gestes sont pauvres et qu’ils se racontent mal aux passants. L’objet pèse peu, moins qu’on croirait. La chaleur dans la paume gagne un peu la peau du poignet, puis s’arrête. Je pense au mot siphon, aux traits du professeur. Je pense à la note où on dit « reprend ». Je ne pense pas à ce que c’est. J’ai promis à personne, mais la lettre m’avait mis dans ce sens-là. Je lâche. La pierre n’a aucun roulis. Elle coupe l’eau en silence. Je regarde la surface juste après, ce moment où une chose a disparu mais laisse sa forme en creux, dans l’onde. Les cercles s’ouvrent, se perdent, puis il n’y a plus rien à voir que la marche gluante, l’odeur d’herbe mouillée, une canette écrasée deux marches plus haut, bruit sourd d’une péniche invisible. Je reste un temps qu’on ne sait pas mesurer, sans faire de phrase. Je remonte. La marque au poignet a presque disparu au premier lampadaire. Chez moi je range le dossier à sa place, pas trop haut, pas trop bas, là où on le retrouve sans grimper. Je réécoute la cassette, un court passage. Le « la pierre était… » s’arrête au même endroit, c’est normal, ça ne bougera pas. Je mets la photo en quatrième de couverture du dossier, pour qu’elle apparaisse d’abord quand on ouvre. Je glisse la lettre de ma tante en couverture, comme un garde-fou. Je recopie encore une fois la date du jour, j’ajoute : « restitution ». Je ne cherche pas de mot mieux. Je ne cherche pas d’explication. Je mets le stylo dans le dos du dossier, c’est une habitude que j’ai gardée d’elle. Le lendemain je passe exprès par le fleuve. Rien n’insiste. Une famille sur l’herbe, cris des enfants qui font sauter des cailloux plats, cinq ricochets, six, record, on applaudit. Je regarde la surface : elle a sa logique de toujours, elle prend et rend sans mémoire. J’ouvre la main à plat, paume en l’air, pour voir si elle garde quelque chose. Rien. Une tiédeur ordinaire de peau au soleil, pas plus. Il y a des histoires qui n’acceptent pas la suite. Ce n’est pas une morale. Ce n’est pas une victoire. C’est un point où on ferme les dossiers et on les laisse nous regarder de leur rayon, sans menace. J’écris encore une ligne pour moi seul — « retour à l’eau » — puis j’éteins. Dans le noir, la main garde un instant la sensation d’avoir porté, comme on garde la sensation d’une montre qu’on a enlevée. Cela passe. Je n’ai pas gardé de copie de la fiche du magasin. Je n’ai pas pris de photo. Si on m’avait demandé d’expliquer, j’aurais repris le mot de la note, je crois : reprendre, c’est suffisant. Il n’y a pas d’autre merveille ici que cette tiédeur sans raison. Tout le reste est papier, poussière propre, voix qu’on entend mal. On vit assez longtemps avec ça. On range. On ferme la lumière. On laisse l’eau faire son travail.|couper{180}
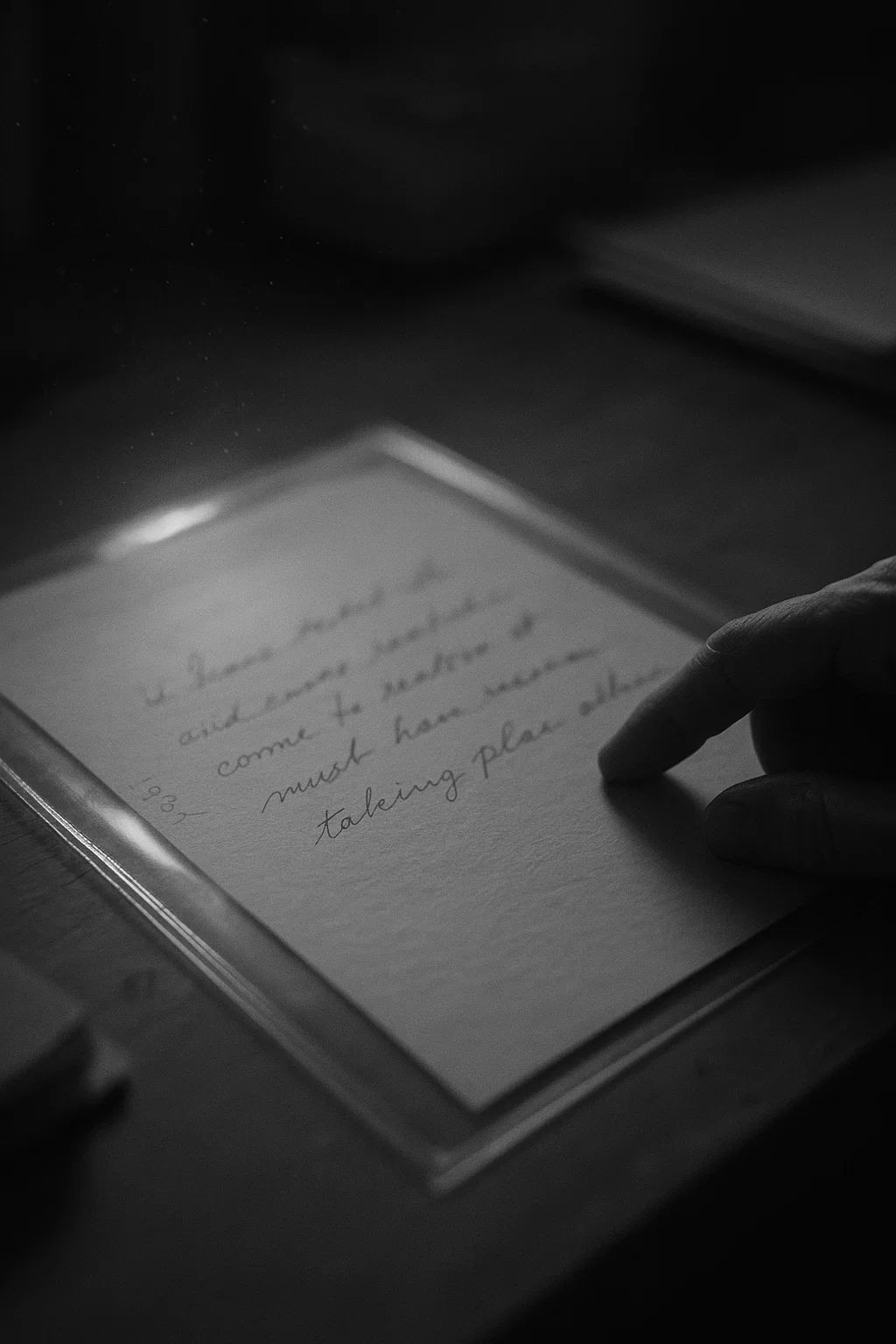
fictions
Prompt « Réservoir → Tirage » pour générer une histoire
[ voir exemple de réalisation avec ChatGpt](https://ledibbouk.net/creation-de-fiction-avec-prompt-exemple.html) **Note d'origine** : Lovecraft a couché une méthode très concrète dans son texte « Suggestions for Writing a Story » (publié à titre posthume dans The Notes & Commonplace Book, 1938). Voici l’essentiel : Synopsis chronologique : dresser d’abord le fil des événements dans l’ordre réel de leur occurrence (pas celui de la narration), assez détaillé pour motiver chaque incident. Synopsis narratif : réorganiser ensuite ces événements dans l’ordre où ils seront racontés, avec notes sur le point de vue, les accentuations et le climax ; modifier librement le premier plan, ajouter ou supprimer des scènes si cela renforce l’effet. Rédaction rapide : écrire d’un jet, sans s’auto-censurer, en restant prêt à reconfigurer intrigue et débuts/fins, puis éliminer tout le superflu. Révision totale : travailler le lexique, la syntaxe, le rythme, les transitions, la proportion des parties, la plausibilité, l’atmosphère. Copie finale propre (tapuscrit) après les dernières retouches. Il ajoute des remarques utiles : on peut parfois commencer par une humeur ou une image sans connaître la fin ; tenir un carnet d’idées (rêves, notations) ; soigner surtout le plan/synopsis, qui est « le cœur créatif » de l’histoire ; rester strictement logique sauf sur l’axe choisi de l’étrangeté. Lovecraft complète cette méthode dans « Notes on Writing Weird Fiction » (1933) : viser d’abord la bonne ambiance ; concentrer l’écart sur une seule “merveille” centrale traitée avec montée émotionnelle ; maintenir un réalisme minutieux partout ailleurs ; privilégier la suggestion (touches imperceptibles, détails associatifs) et éviter les catalogues crus d’événements incroyables. Ce qui est important de retenir c'est que l'ordre réel des faits est différent de l'ordre qu'emploie la narration. Pour résumer on crée un réservoir de faits dans un ordre chronologique par exemple mais ensuite la narration extrait ceux-ci et les réorganise comme elle veut selon le but recherché. Par « ordre réel de leur occurrence », Lovecraft veut dire la chronologie objective des faits dans le monde de l’histoire : ce qui s’est passé, dans quel ordre, pour qui, où, et avec quelles causes/conséquences — indépendamment de la façon dont tu vas le raconter. L’ordre de la narration, lui, est l’ordre dans lequel le lecteur découvre ces faits (avec flashbacks, ellipses, récits croisés, in medias res, etc.). De cette note j'ai tiré un prompt pour tenter de trouver une méthodologie personnelle qui m'aiderait à écrire des fictions. **Avertissement** : il ne s'agit pas de demander à une IA de rédiger des histoires à ma place. Mais de comprendre, d'intégrer un protocole, une méthode, moi qui ai tant de mal avec les protocoles ordinairement. ******************************************************* **Rôle**. Tu es un architecte narratif. Tu vas d’abord construire la fabula (chronologie réelle des faits), puis le syuzhet (ordre de narration), faire des vérifications de cohérence, et seulement ensuite rédiger l’histoire. **Paramètres** GENRE : ex. horreur cosmique / rêve / polar / fantastique sobre EFFET RECHERCHÉ : ex. inquiétude lente / mystère rationnel / vertige onirique LONGUEUR CIBLE : ex. 1200 mots PERSONNE/TEMPS : ex. 1re personne passé simple / 3e personne présent FOCALISATION : interne / externe / variable LEXIQUE/STYLE : sobre, concret, pas de lyrisme, phrases 10–20 mots CONTRAINTE LOVecraft : une seule “merveille” centrale, réalisme ailleurs, suggestion > exposition. OUTPUT_MODE : plan | histoire | les_deux **ÉTAPE A — FABULA (ordre réel des faits)** Construis la chronologie objective en événements atomiques (5–12 items). Format de sortie : Eid — Date/Laps : … — Lieu : … — Acteurs : … Fait : … Cause : … → Conséquence : … Trace matérielle : lettre / photo / cicatrice / rapport / bruit / odeur Qui sait quoi : Perso A : … | Perso B : … | Lecteur : rien (Ajoute autant d’Eid que nécessaire, en respectant la causalité, même pour les faits hors-champ.) **ÉTAPE B — SYUZHET (ordre narratif pour le lecteur)** Réordonne en scènes. Pour chaque scène : Sn — Point d’entrée : moment précis — POV : … Objectif dramatique : … Puise dans : E3 = allusion | E1 = indice | E7 = révélation Degré d’info : 0 allusion / 1 indice / 2 partielle / 3 révélation Ce que tu tais : … Crochet de sortie : question / image / menace / promesse (Planifie 6–12 scènes, in medias res autorisé, flashbacks ok, mais logique du réservoir intouchée.) **ÉTAPE C — VÉRIFS ÉCLAIR** Causalité : toute action a une cause antérieure dans la fabula. Connaissances : aucun personnage n’utilise une info qu’il n’a pas encore obtenue. Traces : chaque révélations s’appuie sur une trace matérielle déjà présente. Plausibilité : dates/délais/distances cohérents. Merveille centrale : une seule anomalie, le reste réaliste. **ÉTAPE D — RÉDACTION** Ton global : … ; rythme : ralenti sur 2 scènes, sinon net. Évite l’encyclopédisme et les “catalogues d’horreurs” ; privilégie la suggestion. Sortie conforme à LONGUEUR CIBLE. Pas d’explications post-finale. **FORMAT DE SORTIE** Plan : réimprime Fabula puis Syuzhet (brefs). **Histoire** : texte continu prêt à lire, respectant PERSONNE/TEMPS/STYLE. **Exemple ultra-court**(remplissage) GENRE : fantastique sobre EFFET : inquiétude lente LONGUEUR : 900 mots PERSONNE/TEMPS : 1re personne, passé FOCALISATION : interne LEXIQUE : concret, phrases 12–18 mots OUTPUT_MODE : les_deux *Fabula* (résumé) E1 — 1895, grotte : un rituel échoue ; statuette perdue. Trace : cicatrice sur un survivant. E2 — 1926, port : un marin remonte la statuette. Trace : idole + journal de bord. E3 — 1927, ville : un professeur enquête, compile. Trace : dossier, coupures. E4 — 1928, moi : j’hérite du dossier ; le marin disparaît. Trace : lettre inachevée. *Syuzhet* (résumé) S1 (E4/indice) ouverture sur la lettre inachevée. S2 (E3/partiel) notes du professeur ; noms raturés. S3 (E2/récit) voix du marin ; météo, dérive, idole poisseuse. S4 (E1/allusion) cicatrice décrite ; on suggère le rituel sans tout dire. S5 (E4/rév.) je retrouve l’idole, mais seule la trace parle. (Puis rédige l’histoire selon ces balises.) Si tu veux, dis-moi juste les paramètres à remplir (genre, effet, longueur, etc.) et je te génère aussitôt un plan + histoire avec ce prompt.|couper{180}

Carnets | Atelier
13 août 2025
Ça ne va toujours pas ; plus j’observe les imbrications d’un minuscule changement, plus j’entrevois de nouvelles pistes. En attendant, la base de données est réparée, en distant comme en local. À bien y penser, c’est plus un amusement qu’autre chose. Ces derniers jours, je me suis remis à écrire plus qu’à coder. Je me renferme, me recroqueville. Lectures intenses. J’ai trouvé [un site](https://freeread.de/) avec des textes originaux de Henry S. Whitehead que j’ai commencé à traduire (création d’une nouvelle rubrique : [traductions](https://ledibbouk.net/-traductions-122-.html)). La vision du monde tout autour est devenue si noire que je ne lis plus que des nouvelles fantastiques ou d’horreur de vieux auteurs du XIXe siècle, principalement américains. La langue, souvent archaïque, oblige à y pénétrer lentement, avec d’infinies précautions pour en démonter les structures, les rouages, le vocabulaire. Je n’entrevois pas d’usage pragmatique à cet exercice, sinon l’effet thérapeutique de soigner « le mal par le mal ». S’enfoncer dans l’horreur jusqu’au cou finit par déclencher un spasme, un sursaut, une petite pulsion de vie. Et celle-ci trouve sa fonction réparatrice quasi immédiate lorsqu’au petit matin j’arrose l’ampélopsis ou l’olivier de la cour. Comme si, enfermé dans l’horreur, s’en extraire soudain par une habitude — un simple geste d’emploi du temps — offrait un bref instant, suffisant pour recharger les batteries. Ce serait intéressant d’examiner les conditions les plus propices au plaisir d’être. Les générations précédentes en avaient une définition stricte : travailler beaucoup, se reposer peu, jouir de joies simples. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que nous avons élevé le « jouir » à un tel point d’importance que nous en sommes devenus drogués ; et, comme les drogués, il faut chaque jour une dose plus forte. La grande gagnante, c’est notre indifférence presque totale aux autres, au monde, à l’univers. Ce ne sont pas quelques menues interactions numériques — cette illusion d’appartenir à une collectivité — qui y changeront quoi que ce soit. Quand je sors la tête à la fenêtre, pour voir la rue, la ville, les pays, les continents, je ne vois que bêtise, méchanceté, une humanité frelatée. Pathétique. Du coup, je rentre aussitôt la tête. Je ne vivrai sans doute pas aussi longtemps que les honorables tortues marines, mais je commence à éprouver une métamorphose, petit à petit. En me regardant par hasard dans la glace, de dos, j’ai vu que je me voûtais. À moins que ce ne soit la contrepartie inconsciente d’une coupe de cheveux. S. ne m’a pas laissé beaucoup de cheveux sur le crâne. Elle y est allée à la tondeuse. « Tu as dix ans de moins », a-t-elle conclu en coupant le moteur de l’engin, l’air satisfait. Des contreparties, toujours : que je le veuille ou non, il y en a et il y en aura. Si je jouis, il faut qu’à un moment je paie : c’est comme ça depuis le début, pas de risque que ça change. — - Il n’y a pas de fumée sans feu (et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, au vu des circonstances déplorables actuelles). Disons qu’une théorie étrange, aux limites de l’absurde — appelons-la l’hypothèse de « parasites » qu’on attraperait dans l’astral comme un mauvais rhume — aurait au moins le mérite de donner un sens à la folie actuelle. En nommant le site Dibbouk, j’anticipais peut-être déjà la suite de ce qui a commencé en 2019. Cette « chose » vient vous déranger, vous habiter, vous hanter, et ne vous lâche plus tant qu’elle n’a pas absorbé toute votre sève, votre énergie vitale. Je continue de publier des textes sur le site, mais, une fois publié, je referme aussitôt les onglets. Je ne flâne guère. Revient cette forme de béatitude offerte par l’étude, par la lecture, par l’enfouissement. Cela me rappelle un texte de Michaux : « enterrez-moi ». Jamais ces mots n’ont paru si clairs qu’aujourd’hui.|couper{180}

Carnets | Atelier
08 août 2025
On n’est pas conscient de ce que l’on écrit en toute bonne foi, puis on relit et quelque chose cloche. Apprendre à mentir vrai, pour reprendre l’expression de Dawn Cornelio à propos de Chloé Delaume, exige une sorte de saut quantique. Ce saut me rappelle, dans l’exercice du dessin, le moment où l’on ose enfin créer un contraste fort. C’est difficile, parce que justement ça paraît fort. On se dit : c’est trop, ça ne passera pas. Et pourtant, ça passe. On retrouve ce même principe dans les mimiques utilisées par les acteurs dans les spots publicitaires. Tout est exagéré, et ça passe. Comme dans le jeu des corps du cinéma muet, souvent exacerbé, et ça passe encore. Cela ne signifie pas qu’il suffise de pousser un curseur pour écrire vrai. En tout cas, pas sur le papier seulement. Il faut qu’une opération — proche d’une alchimie — se produise en amont, principalement à la relecture de ce que l’on a déjà écrit en toute bonne foi. Il me semble que le mot que je cherche est contexte. La notion de romanesque, comme celle de mentir vrai, ne peut s’en passer. Sans contexte, le mentir vrai reste un artifice, un truc d’atelier. Avec le contexte, il devient un élément organique d’un univers narratif — il s’imbrique dans une temporalité, un décor, une voix. Le lecteur ne croit pas un détail “fort” parce qu’il est réaliste, mais parce qu’il est placé dans un tissu cohérent — une ambiance, un rythme, une succession de gestes ou de sensations qui le rendent inévitable. Comme dans l’exemple du dessin : un noir intense ne choque pas si le reste de la composition lui prépare une place. C’est pareil en écriture : un geste outré, une phrase invraisemblable “passe” parce que le contexte l’a rendue non seulement plausible, mais attendue. Le mentir vrai n’est pas tricher sur les faits, c’est réarranger la perception. Le contexte agit ici comme un alambic : il distille les fragments bruts (souvenirs, observations, émotions) en quelque chose de transformé mais reconnaissable, et donc crédible. En somme, le contexte n’est pas un décor de fond : c’est le mécanisme invisible qui autorise toutes les audaces du mentir vrai. Sans lui, l’exagération paraît forcée ; avec lui, elle devient nécessaire. C’est dans le contexte que se rejoignent les soucis de traduction et d’autofiction. La traduction, parce qu’elle ne peut pas être un simple transfert mot à mot : elle doit recréer l’écosystème qui permet au sens, au ton et au rythme de survivre. On ne traduit pas seulement un texte, on traduit un contexte — culturel, émotionnel, narratif. L’autofiction, parce qu’elle ne se contente pas de “raconter sa vie” : elle fabrique un cadre narratif où le vécu et l’inventé cohabitent sans que l’un ne contredise l’autre. Dans les deux cas, le mentir vrai ne peut fonctionner que si le contexte est reconstruit ou inventé avec la même précision que les faits eux-mêmes. Sans contexte, la traduction devient trahison mécanique, et l’autofiction une confession fade. Avec contexte, les deux deviennent des réinventions crédibles. Depuis quelque temps, j’ai repris les mots-clés du site et relu les articles associés. Je les avais créés de manière intuitive, comme si j’avais besoin d’un point de repère pour associer plusieurs textes, pour m’orienter. C’était déjà un seuil narratif, même si je ne parvenais pas encore à l’exprimer. C’était surtout une organisation personnelle, une étiquette technique. Maintenant, avec les descriptifs que j’ai ajoutés, chaque mot-clé devient une entrée en matière, un petit contexte introductif qui prépare le lecteur à tout ce qui va suivre. En termes d’écriture, cela produit plusieurs effets : je me donne (et je donne au lecteur) un point d’appui, un cadre mental. Chaque mot-clé gagne une existence autonome. Ce n’est plus un tag abstrait, mais un élément d’un réseau narratif. Comme en autofiction, l’idée est de poser un décor qui autorise les libertés à venir. Même si les textes liés mélangent réel et invention, la description d’ouverture crée un espace où tout devient crédible. Il y a donc un basculement sur le site : le mot-clé devient une manière de raconter. On peut dire qu’il y a passage d’un index brut à un index romanesque — et que c’est dans ce passage que le mentir vrai trouve tout son sens.|couper{180}

Carnets | Atelier
06 août 2025
Le mot mosaïque continue d'insister. Je voulais faire une rubrique constituée de brèves mais pas satisfait du résultat j'ai laissé en plan le projet. Mais ça continue d'insister... mosaïque. Je me suis demandé en premier lieu comment je pourrais créer une mosaïque d'images car je suis aussi en train de modifier mon site de peintures. J'ai vu ce genre de mosaïques quelque part peut-être sur le site de Philippe De Jonckheere mais très vite je suis revenu au texte. J'ai donc utilisé un script js de Voronoï pour voir si dans une page groupe je ne pouvais pas proposer autre chose qu'une liste, des cartes, c'est à dire quelque chose de moins "conventionnel", quelque chose de plus "visuel". En fait trouver une sorte de d'alliance texte/image. ce qui donne au bout du compte une image mosaïque interactive. En même temps que mosaïque le mot magasine. Magasiner. Bien que je ne sache pas vraiment ce qu'il signifie dans son contexte d'origine. On peut donc faire cet exercice avec un mot : voir le mot comme un objet étranger, un inconnu mais réel, noir sur blanc puis émettre des hypothèses, esquisser une définition personnelle de ce mot. Magasiner dans cette esquisse s'associe ( naturellement ? ) à magazine. Il peut y avoir une relation entre faire des courses et un magasin, mais comment en arrive t'on ensuite au magazine c'est un mysère. En tous cas l'idée du magazine se superpose à celle du livre. Dans Turnjs j'ai découvert une démo sur quoi je pouvais m'appuyer pour créer une sorte de magazine mensuel. Ce n'est qu'un prototype pour l'instant que j'ai installé dans une rubrique mois. L'idée serait "de faire les courses" parmi tous les textes écrits durant un mois dans mon stock, de les placer dans un contenant, magazine. Actuellement tout ce que je suis parvenu à faire c'est à mettre tout le stock dans le contenant, ce qui n'est qu'une étape. Ensuite je suppose que par une selection de mots clés un peu plus fine je parviendrais à résoudre deux problèmes : celui du magazine comme celui du livre feuilletable. notes supplémentaires: en peinture toujours apprécié de juxtaposer des éléments hétérogènes qui vus de près restent autonomes mais de loin forment un ensemble ( un tout ?) Dans mes textes, il y a souvent un travail de collecte, de traces, de souvenirs, de bribes réassemblées. La mosaïque, c’est la métaphore parfaite pour ça : on prend des morceaux dispersés, on les agence,et c’est précisément leur juxtaposition qui crée du sens. Elle est à la fois archéologique (on recompose une image à partir de tessons) et contemporaine (on assume que les fissures font partie de l’œuvre). sur ce site tu explores beaucoup l’idée de navigation par blocs : cartes d’articles, regroupements thématiques, visualisations (comme ce Voronoï). La mosaïque te permet de voir l’ensemble tout en respectant chaque unité. C’est une structure qui n’écrase pas le détail au profit du tout. Et comme dans une carte, tu peux te promener d’une pièce à l’autre. {{Klee }} a peint plusieurs œuvres où de petites unités colorées, juxtaposées, composent un ensemble vibrant. Ce n’est pas de la mosaïque au sens technique, mais chaque “tesselle” picturale garde sa vie propre. Chez lui, la mosaïque devient un rythme visuel, une partition de temps et de mémoire. Ça résonne fort avec ta pratique, où chaque fragment de texte ou d’image garde son autonomie. Italo Calvino — {Si par une nuit d’hiver un voyageur} En littérature, ce roman est une mosaïque narrative : chaque chapitre ouvre une histoire différente, jamais terminée, mais toutes reliées par un fil invisible. La structure fragmentaire est assumée, chaque pièce est un monde, et pourtant l’ensemble compose une forme complète dans l’esprit du lecteur. C’est une mosaïque de récits plus qu’un récit continu. Le Trendakis de Gaudi. Gaudí a utilisé des morceaux de céramique brisés (trencadís) pour tapisser des formes architecturales. Chaque éclat a une origine, une histoire, mais il est intégré à une vision globale. Il y a là cette idée de recycler, de transformer des fragments disparates en un tout organique. Et comme dans mes textes, les fissures et les irrégularités font partie du processus.|couper{180}
