traductions
Rubrique de traductions françaises dédiées au fantastique et à la weird fiction : poèmes et nouvelles de Clark Ashton Smith (The Star-Treader, Chant to Sirius, Nero), textes d’Ambrose Bierce, Fernando Pessoa (A Hora do Diabo), et récits pulp parus dans Weird Tales (Henry S. Whitehead : La Bête Noire, Tancrède le Noir, Noire Terreur). Chaque publication est accompagnée de repères éditoriaux, variantes, documentation et notes sur les choix de traduction (rythme, phrasé, étrangeté lovecraftienne). Objectif : rendre accessibles des textes rares en français tout en respectant la voix d’origine. Mots-clés : traductions littéraires, fantastique, weird, Lovecraft, Clark Ashton Smith, Bierce, Pessoa, Whitehead.
traductions
The Challenge From Beyond -L’épreuve des confins
En 1935, le rédacteur en chef de Fantasy Magazine convia cinq figures majeures de la science-fiction et cinq plumes tout aussi illustres de la fantasy à composer deux récits collectifs, écrits en relais, tous deux baptisés The Challenge From Beyond. Pour la version « fantastique », on trouve C.L. Moore, A. Merritt, H.P. Lovecraft, Robert E. Howard et Frank Belknap Long. La déclinaison « science-fiction » réunit Stanley G. Weinbaum, Donald Wandrei, Edward E. (alias « Doc ») Smith, Harl Vincent et Murray Leinster. Dans le texte qui suit, le nom de l’auteur figure entre parenthèses à l’entame de chaque section. texte original (traduction personnelle) L'épreuve des confins [C. L. MOORE] George Campbell entrouvrit, dans le noir, des yeux noyés de sommeil. Il resta là, immobile, à guetter par l’ouverture de toile la pâleur d’août, jusqu’à ce que monte, lentement, la seule question : qu’est-ce qui l’avait tiré de sa nuit ? Dans l’air vif, tranchant, des bois canadiens flottait un narcotique plus sûr que toutes les drogues. Campbell s’abandonna, sans bouger, se laissant couler vers la lisière du sommeil, goûtant cette fatigue exquise, cette lourdeur neuve de muscles tendus puis relâchés, fondus dans un bien-être parfait. Après tout, n’était-ce pas là le vrai luxe des vacances ? Le repos, enfin, après l’effort — dans la nuit limpide, saturée de résine et de silence. Luxueusement, alors que son esprit glissait vers l’oubli, il se le répétait : trois mois de liberté. Trois mois sans villes, sans routine, sans l’université ni ses étudiants au front muré, trois mois sans la géologie assénée comme du plomb dans leurs oreilles fermées. Trois mois de— La torpeur se rompit d’un coup. Dehors, un crissement brutal — fer-blanc contre fer-blanc — éventra le silence. George bondit, saisit sa lampe, éclata de rire et la reposa. Dans le clair-obscur, il distingua, parmi ses boîtes culbutées, la silhouette furtive d’une petite bête nocturne. Il allongea le bras, tâtonna vers l’entrée, ses doigts se refermèrent sur une pierre — il arma le geste. Mais le geste se figea. Ce n’était pas une pierre. C’était autre chose. Carré, lisse comme du cristal, manifestement façonné, les arêtes émoussées jusqu’à la rondeur. L’étrangeté sous ses doigts le glaça ; il reprit la lampe, projeta le faisceau. La somnolence s’évapora. Dans sa main, un cube clair comme du cristal de roche. Du quartz, oui — mais pas la forme hexagonale. On l’avait tiré, par un procédé inconnu, en cube parfait, quatre pouces de côté, chaque face usée jusqu’à l’arrondi. Le cristal, si dur, poli à force de siècles, approchait la sphère. Des ères d’usure avaient coulé sur cet objet transparent. Et, plus troublant encore : au cœur, enfoui dans la masse, un disque minuscule, de matière pâle, innommée, gravée de signes profonds. Des coins, des entailles, ombre de cunéiforme. Campbell fronça les sourcils, se pencha. Comment une telle chose avait-elle pu s’incruster dans du cristal pur ? Un souvenir le traversa : les légendes qui disaient le quartz glace figée à jamais. Glace — et cunéiforme — oui, écriture née chez les Sumériens, venus du nord s’installer aux origines dans la vallée mésopotamienne… Puis le bon sens revint et il rit. Le quartz datait des premiers âges, quand la Terre n’était que feu et roche. La glace n’apparaîtrait que des millions d’années plus tard. Et pourtant — ces signes. D’homme, sans doute, quoique étrangers, sinon par ce vague air cunéiforme. À moins… qu’au Paléozoïque des êtres n’aient déjà possédé l’écriture ? Qu’ils aient gravé ces coins cryptés sur ce disque scellé ? Ou bien… cette chose était-elle tombée du ciel, météore incrusté dans une Terre en fusion ? Il s’arrêta net, les oreilles en feu devant la démesure de son imagination. Silence, solitude, et ce cube étrange conjuraient contre son bon sens. Il haussa les épaules, posa l’objet au bord de la paillasse, éteignit la lampe. Le matin, à tête claire, trancherait peut-être. Mais le sommeil refusa de revenir. Quand il coupa la lumière, il lui sembla que le cube brillait encore, d’une clarté qui résistait, une lueur obstinée avant de céder. Ses yeux abusés ? Peut-être. Comme si la lumière s’attardait, à regret, au fond énigmatique de la chose, un éclat persistant, à contre-cœur. Il resta longtemps ainsi, mal à l’aise. Les questions tournaient, repassaient, se cognaient dans son crâne. Ce cube, ce cristal jailli d’un passé sans âge — peut-être de l’aube même de l’histoire — pesait sur lui comme un défi. Un défi lancé à son sommeil, à sa raison, à la nuit canadienne. [A. MERRITT] Il resta étendu — des heures, lui sembla-t-il. C’était cette lumière tenace, cette lueur qui refusait de mourir, qui retenait son esprit. Comme si, au cœur du cube, quelque chose s’était éveillé, agité dans sa torpeur, soudain dressé — et braqué sur lui. Fantaisie pure. Il bougea, impatient, braqua sa lampe sur la montre : près d’une heure. Trois encore avant l’aube. Le faisceau tomba sur le cube tiède, s’y accrocha. Longues minutes. Puis il l’éteignit net, observa. Plus de doute. À mesure que ses yeux s’accoutumaient à la nuit, le cristal étrange luisait de minuscules éclairs fugitifs, comme des fils d’éclairs saphir, au plus profond. Ils vibraient au centre, jaillis du disque pâle aux marques inquiétantes. Et le disque lui-même paraissait enfler… les marques bouger, se tordre… le cube grandir… illusion des éclairs minuscules ? Un son vibra. Le fantôme même d’un son — comme les cordes d’une harpe pincées par des doigts fantomatiques. Il se pencha. Ça venait du cube… Un grincement, soudain, dans les broussailles. Une touffe de corps qui s’éparpillent. Un cri étranglé, aigu, comme d’un enfant en proie à la mort, vite étouffé. Tragédie furtive du sous-bois : chasseur, proie. Il s’approcha, ne vit rien. Éteignit de nouveau. Vers sa tente — à terre, un scintillement bleu pâle. Le cube. Il se baissa pour le ramasser, puis, obéissant à un avertissement obscur, retira la main. Et la lueur se mit à mourir. Les éclairs saphir, irréguliers, regagnaient le disque. Plus un son. Il resta assis, guettant la lumière : s’allumer, s’éteindre, faiblir, toujours. Il comprit alors : deux éléments déclenchaient le phénomène. Le rayon électrique. Et son attention fixée. Son esprit devait voyager avec le faisceau, se clouer au cœur du cube, si le battement devait croître, jusqu’à… quoi ? Un froid le traversa, comme au contact d’une étrangeté absolue. C’en était une, il le savait. Rien de terrestre. Rien de la vie terrestre. Il surmonta sa réticence, reprit le cube, l’emporta sous la toile. Ni chaud, ni froid ; sans son poids, il n’aurait pas su qu’il le tenait. Il le posa sur la table, détourna la lampe, referma le rabat. Puis il revint, tira la chaise, braqua le faisceau droit sur le cube, au cœur. Il y envoya sa volonté, sa concentration, toute, comme on pousse un courant. Regard et pensée rivés au disque. Comme à l’ordre, les éclairs saphir jaillirent. Ils fusèrent du disque dans le cristal, refluèrent, baignèrent disque et marques. Celles-ci se mirent à changer, à se déplacer, avancer, reculer dans l’azur battant. Ce n’était plus du cunéiforme. C’étaient des choses. Des objets. Il entendit la musique — harpe pincée. Le son montait, plus fort, plus fort, jusqu’à faire vibrer le cube entier. Les parois fondaient, devenaient brume — brouillard de diamants. Et le disque croissait, ses formes glissaient, se divisaient, se multipliaient, comme si une porte s’ouvrait et qu’une foule de fantômes s’y engouffrait. La pulsation bleue enflait. Un sursaut de panique. Il voulut rompre, retirer son regard, sa volonté — laissa choir le faisceau. Le cube n’avait plus besoin du rayon. Et lui ne pouvait plus se retirer… ne pouvait plus ? C’était lui, à présent, qu’on aspirait — happé dans ce disque devenu globe, au dedans duquel des formes innommables dansaient sur une musique qui baignait tout d’un éclat constant. Il n’y avait plus de tente. Seulement un rideau immense de brume étincelante derrière lequel brillait le globe. Il se sentit happé à travers cette brume, aspiré comme par un vent colossal, droit vers le globe. [H. P. LOVECRAFT] À mesure que la clarté brouillée des soleils saphir s’intensifiait, les contours du globe ondulaient, se dissolvaient dans un chaos mouvant. Sa pâleur, sa musique, son mouvement se mêlaient à la brume qui l’avalait, la blanchissant d’un acier spectral, la faisant battre comme une marée. Les soleils saphir, eux aussi, se perdaient, se fondaient dans l’infini gris d’une pulsation sans forme. Et la vitesse — en avant, vers l’ailleurs — atteignait des sommets insoutenables, cosmiques. Toute échelle humaine pulvérisée. Campbell savait : un tel vol, dans la chair, eût été mort instantané. Mais ici, dans ce cauchemar hypnotique, l’impression visuelle d’une accélération météorique paralysait sa pensée. Sans repères dans le vide gris, il avait pourtant la certitude de dépasser la lumière. Sa conscience céda — un noir miséricordieux engloutit tout. Et soudain, au milieu d’une opacité sans couture, les pensées revinrent. Impossible de dire : instants, années, éternités. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il reposait, sans douleur. L’absence de sensation physique dominait tout, rendait même le noir plus fluide. Il n’était plus un corps privé de sens : il était intelligence nue, désincarnée. Il pensait avec une rapidité, une acuité presque inhumaines — sans rien comprendre à l’endroit où il se trouvait. Un instinct le traversa : il n’était pas dans sa tente. Pas de lit, pas de mains pour palper couvertures, toile, lampe. Pas de froid. Pas de fente de toile laissant filtrer la pâle nuit. Quelque chose clochait — atrocement. Il recula mentalement, revit le cube fluorescent, l’engrenage qui avait suivi. Il avait su qu’il basculait trop loin, incapable de se reprendre. À la fin, une peur panique avait surgi — plus profonde que l’effroi du vol démoniaque. Elle venait d’un éclair, d’une mémoire lointaine. Comme si des cellules enfouies avaient reconnu dans le cube une familiarité — mais une familiarité trempée de terreur. Peu à peu, cela remonta. Autrefois, dans ses lectures de géologie, il avait croisé les Eltdown Shards, fragments d’argile douteux, exhumés du sud de l’Angleterre, trente ans plus tôt, dans des strates précarbonifères. Formes et marques si étranges que certains avaient osé l’hypothèse artificielle, brodant extravagances sur leur origine. Ce qui était sûr : ils venaient d’un temps où l’homme n’existait pas. Et leurs figures déconcertaient jusqu’à l’horreur. Et ce n’était pas dans un traité scientifique qu’il avait vu mention d’un globe de cristal enfermant un disque. Mais dans un opuscule occulte, délirant, publié en 1912 par un ecclésiastique du Sussex, Arthur Brooke Winters-Hall. Celui-ci prétendait reconnaître dans les Shards certains « hiéroglyphes préhumains » transmis ésotériquement par des cercles mystiques. À ses frais, il avait publié une « traduction » des inscriptions. Et dans cette traduction figurait un récit supposé préhumain, contenant l’épouvantable référence : le cube. Ce récit disait qu’un ordre puissant d’êtres vermiformes avait peuplé un monde, puis d’innombrables mondes, dans une galaxie étrangère. Leur science, leur maîtrise des forces dépassait toute imagination terrestre. Très tôt, ils avaient conquis l’art du voyage interstellaire, colonisé toutes les planètes viables, exterminé les races croisées. Mais au-delà de leur galaxie — qui n’était pas la nôtre — ils ne pouvaient pas voyager en personne. Dans leur quête de savoir total, ils avaient trouvé comment franchir les gouffres transgalactiques par l’esprit. Ils avaient forgé des objets : cubes d’un cristal inconnu, chargés d’énergie, renfermant des talismans hypnotiques, clos dans des enveloppes sphériques résistantes au vide. Ces enveloppes pouvaient être projetées hors de leur univers, attirées seulement par la matière froide. Les frictions atmosphériques brûlaient la gaine, laissant le cube nu, prêt à être découvert. Par nature, il attirait. Joint à la lumière, il s’activait. L’esprit qui le fixait était happé par le disque, filé le long d’un courant obscur jusqu’à la planète d’origine des vers. Là, une machine recevait l’esprit, le suspendait, sans corps, sans sens, jusqu’à examen par un membre de la race. Alors se produisait l’échange : l’esprit vidé, remplacé par celui de l’interrogateur. Et ce dernier, via le cube, traversait l’espace pour animer le corps étranger du captif, l’explorer de l’intérieur. Quand l’exploration se terminait, l’aventurier reprenait le cube pour rentrer. Parfois, l’esprit prisonnier retrouvait son monde. Parfois, non. Car les vers n’étaient pas toujours cléments. Une espèce prometteuse détectée — et l’on capturait par milliers, détruisant, éradiquant les civilisations. D’autres fois encore, des cohortes s’installaient à demeure sur la planète étrangère, détruisant tout, habitant des corps nouveaux. Mais sans jamais recréer leur civilisation-mère : il manquait toujours quelque élément. Les cubes, par exemple, ne pouvaient être forgés que chez eux. Sur l’infinité des cubes lancés, seuls quelques-uns touchaient un monde habité. Trois seulement, disait le récit, étaient tombés dans notre univers. L’un, il y a deux mille milliards d’années, sur une planète proche du bord galactique. Un autre, il y a trois milliards d’années, près du centre. Le troisième — le seul à atteindre notre système — avait frappé la Terre il y a cent cinquante millions d’années. Et c’est sur ce dernier que la traduction de Winters-Hall insistait. À cette époque, régnait sur Terre une immense espèce conique, plus avancée que tout ce qui avait précédé ou suivi. Ces êtres, si développés, envoyaient déjà leurs esprits explorer espace et temps. Quand le cube tomba, certains individus en furent altérés, mentalement déplacés. Les dirigeants comprirent qu’ils hébergeaient des intrus et les détruisirent. Ils avaient déjà connu pires translations. Par exploration mentale, ils reconnurent la nature du cube, le dissimulèrent, le gardèrent comme menace et relique. Ils ne voulaient pas détruire un objet si riche en promesses. De temps à autre, un téméraire y goûtait — mais chaque cas était traqué, réglé. Effet collatéral : la race des vers, par ses exilés, apprit le sort de ses explorateurs, conçut pour la Terre une haine brûlante. Elle eût voulu la dépeupler. Elle lança d’autres cubes à l’aveugle, espérant en frapper des zones non gardées. En vain. Les êtres coniques gardèrent le cube unique dans un sanctuaire, relique et base d’expériences. Jusqu’à ce que la guerre, la chute de leur grande cité polaire, le perde dans le chaos. Et quand, cinquante millions d’années plus tard, ils envoyèrent leurs esprits dans un futur infini pour fuir un péril sans nom, nul ne savait ce qu’était devenu le cube. Voilà ce que racontaient les Shards d’Eltdown. Et voilà ce qui glaçait Campbell : la précision de la description. Dimensions, consistance, disque hélioglyphe, effets hypnotiques — tout y était. À ruminer dans le noir, il en vint à se demander si son aventure, et lui-même, n’étaient pas le produit d’un vieux cauchemar, remonté de sa mémoire après lecture de cet opuscule charlatanesque. Et si c’était un cauchemar, il persistait — car son état, sans corps, n’avait rien de normal. Il ne savait pas combien de temps dura ce ressassement. Ici, durée et mesure n’avaient plus sens. Cela lui sembla l’éternité, quand survint l’interruption. Une sensation, mentale plutôt que physique. Ses pensées balayées, aspirées hors de lui, tumulte et chaos. Tout déborda. Ses souvenirs, son passé, ses traditions, ses rêves, ses idées, ses intuitions, jaillirent d’un coup, à une vitesse, une profusion vertigineuses. La parade devint cataracte, vortex. Aussi horrible que le vol sous le cube. Et il sombra, de nouveau, dans l’oubli. Un autre vide. Puis, lentement, des sensations : lumière saphir, grondement lointain. Pression d’un sol sous lui — posture déconcertante. Impossible de concilier la sensation avec un corps humain. Il tenta de bouger les bras — échec : seulement de petites saccades nerveuses. Il voulut ouvrir les yeux — aucun mécanisme ne répondit. La lumière saphir, diffuse, sans foyer. Puis, peu à peu, des images — curieuses, hésitantes. Pas les limites habituelles de la vue, mais une perception nouvelle. Campbell pensa : cauchemar, encore. Il se trouvait dans une salle vaste. Hauteur moyenne, surface énorme. Quatre côtés visibles à la fois. Hautes fentes, portes et fenêtres à la fois. Des piédestaux bas, aucun meuble « normal ». Par les fentes, des coulées de lumière saphir ; au-dehors, des bâtiments cubiques, groupés. Sur les parois, entre les fentes, des marques étranges. Il comprit soudain pourquoi elles l’angoissaient : elles répétaient les hiéroglyphes du disque. Mais le vrai cauchemar, c’était la créature. Rien d’humain, rien de terrestre. Un ver gigantesque, mille-pattes gris pâle, haut comme un homme, deux fois plus long. Tête en disque, frangée de cils autour d’un orifice violet. Corps dressé sur les pattes arrière, les deux paires de devant servant de bras. Un peigne violet courait le long de l’échine. Une queue membraneuse en éventail clôturait l’ensemble. Autour du cou, un collier de pointes rouges cliquetait à chaque torsion. Vision délirante, cauchemar suprême. Et pourtant ce n’était pas elle qui l’écrasa dans l’inconscience. Mais un dernier contact, insoutenable : dans la boîte lustrée que portait le ver, Campbell aperçut, miroitant, ce qui aurait dû être son corps. Ce ne l’était pas. C’était la masse gris pâle d’un des mille-pattes. [ROBERT E. HOWARD & FRANK BELKNAP LONG] De ce dernier tourbillon, il émergea lucide. Il comprit. Sa conscience était enfermée dans le corps d’un natif monstrueux d’une planète étrangère — et, là-bas, quelque part à l’autre bout de l’univers, son propre corps abritait l’esprit du ver. Il repoussa l’horreur. Qu’était-ce, au fond ? D’un point de vue cosmique, quelle importance ? La vie, la conscience seules comptent. La forme — rien. Son corps n’était hideux que selon les critères terrestres. La peur, le dégoût — noyés sous l’excitation d’une aventure titanesque. Son ancien corps ? Une enveloppe. Un manteau qu’on jette à la mort. Sa vie d’avant ? Labeur, pauvreté, frustration, couvercle de règles et d’entraves. Qu’avait-il à regretter ? Ici, rien de moins. Peut-être plus. Son intuition le lui criait : bien plus. Il reconnut — avec cette lucidité qu’on n’atteint que quand tout a brûlé — qu’il n’avait aimé, dans son ancienne vie, que les plaisirs du corps. Et ceux-là, il les avait épuisés. Plus rien de neuf sur Terre. Mais ce corps étranger, lui, promettait des jouissances inédites, exotiques, effrayantes. Une exaltation sauvage enfla en lui. Il était un homme sans monde, libéré des conventions, des inhibitions de la Terre ou de cette planète. Hors de tout carcan. Un dieu. Il songea, ricanant, à son corps, là-bas, vaquant aux affaires de la société humaine — mais un monstre regardant par ses yeux, un ver pilotant la machine. Et nul ne s’en doutant. Qu’il ravage, qu’il tue, qu’il détruise. La Terre, ses races, ne signifiaient plus rien pour George Campbell. Il avait été l’un de ces milliards de zéros, ficelé par les lois, les usages, condamné à vivre et à mourir dans sa niche. D’un saut aveugle, il avait franchi la barrière. Ce n’était pas la mort. C’était une naissance. Une mentalité neuve, adulte, affranchie. La captivité sur Yekub ? Un détail. Yekub. Le nom surgit. Comme il sut le nom du corps qu’il habitait : Tothe. La mémoire de Tothe remuait dans son cerveau — ombre de savoir, instincts enfouis. Campbell, par sa conscience humaine, les happa, les traduisit : chemin vers la sécurité, la liberté, le pouvoir. Il ne vivrait pas Yekub en esclave. En roi. Comme les barbares, autrefois, s’asseyaient sur les trônes des empires. Alors seulement il regarda autour. Toujours étendu sur une sorte de divan, dans cette salle fantastique. Devant lui, un mille-pattes dressé, tenant un objet de métal poli, faisant cliqueter les pointes rouges de son cou. Campbell sut qu’il parlait — et, grâce aux processus imprimés par Tothe, il comprit, par bribes. C’était Yukth, maître suprême de la science. Mais Campbell n’écoutait pas. Il avait son plan. Désespéré, étranger à toute méthode de Yekub. Hors de portée de Yukth, qui ne se doutait de rien. Sur une table, un éclat de métal. Pour Yukth, un outil. Pour Campbell, une arme. L’esprit terrestre fournit l’idée — et lança le corps de Tothe dans un geste inconnu ici. Il saisit l’éclat, frappa, d’un coup de bas en haut. Yukth se cabra, se renversa, ses entrailles répandues au sol. Campbell bondit vers la porte. Sa vitesse — grisante. Première preuve des promesses physiques de ce corps. Il courut. Couloir torsadé, escalier vrillé, porte sculptée. Ses réflexes, guidés par les souvenirs de Tothe, le menaient. Jusqu’à une salle circulaire, sous un dôme inondé d’une lumière bleue livide. Au centre, une structure à étages, chacun d’une couleur vive. Au sommet, un cône violet. De son faîte s’élevait une brume bleue, qui rejoignait une sphère suspendue — luisante comme de l’ivoire translucide. Le dieu de Yekub. C’est ce que lui soufflaient les profondeurs de Tothe. Mais les raisons de cette vénération s’étaient perdues depuis un million d’années. Un prêtre-ver vermiforme se dressa, figé d’horreur. Campbell n’hésita pas : l’éclat trancha la vie. Sur ses pattes segmentées, il gravit l’autel en gradins. La sphère changeait déjà, la brume bleue s’épaississait. Mais Campbell n’avait plus peur. Il était ivre de puissance. Plus de superstition, ni d’ici ni de la Terre. Avec ce globe, il serait roi. Roi de Yekub. Il tendit la main. La sphère, d’ivoire, virait rouge. Rouge sang. [FRANK BELKNAP LONG] Le corps de George Campbell quitta la tente dans la pâleur d’août. Il avançait d’une démarche lente, hésitante, entre les troncs géants, sur le tapis d’aiguilles odorantes. L’air était vif, coupant. Le ciel, cuvette d’argent givré piquée d’étoiles, et, loin au nord, des gerbes d’aurore éventraient la nuit. La tête ballottait hideusement, d’un côté, de l’autre. De la bouche molle s’échappaient des filets d’écume ambrée que la brise dispersait. D’abord il marcha droit, presque homme. Puis, à mesure que la tente disparaissait derrière lui, la posture se déforma. Le torse se pencha, les membres se racourcirent. Là-bas, sur Yekub, la créature mille-pattes qu’il était devenu serrait un dieu rougeoyant et courait, frémissements d’insecte, à travers une salle irisée, franchissant les portails massifs vers l’éclat de soleils étrangers. Ici, sur Terre, dans l’ombre des arbres, le corps de Campbell suivait un destin de bête. De longs doigts griffus arrachaient des feuilles, tandis qu’il s’avançait vers une nappe d’eau scintillante. Là-bas, sur Yekub, il rampait entre des blocs cyclopéens, le long d’avenues de fougères, brandissant le dieu rond et rouge. Ici, dans les sous-bois, un cri rauque éclata. Des dents humaines s’enfoncèrent dans la fourrure souple d’une proie, déchirèrent la chair sombre. Un renard argent s’arc-bouta, planta ses crocs dans un poignet velu, le sang jaillit. Lentement, Campbell se redressa, la bouche maculée de rouge. Les bras pendants, balancés, il gagna l’eau. Là-bas, sur Yekub, la créature variforme ondulait dans la poussière scintillante, devant des milliers de vers prosternés. Une force sacrée rayonnait de son corps tressé. Il avançait vers un trône — empire d’esprit au-delà de toute souveraineté humaine. Ici, sur Terre, un trappeur fourbu, égaré toute la nuit, atteignit la rive au petit matin. Sur l’eau, quelque chose flottait. Il s’agenouilla, tira lentement la masse vers la boue. Là-bas, très loin, la créature brandissait le dieu rouge sous une voûte d’hypersoleils, trône flamboyant comme Cassiopée. Le dieu ardent consumait les scories animales, brûlait le corps de ver d’un feu blanc spirituel. Ici, sur Terre, le trappeur contempla — et l’horreur l’anéantit. Le visage noirci, velu, du noyé : bestial, simiesque. De sa bouche tordue s’écoulait un ichor noir. Alors la voix du dieu rouge parla : « Celui qui a cherché ton corps dans les abîmes du Temps habitera un logis sans réponse. Aucun rejeton de Yekub ne gouvernera jamais un corps humain. Sur toute la Terre, les vivants se déchirent, festoient de cruautés indicibles. Aucun esprit de ver ne dompte un corps d’homme quand ce corps aspire à l’oiseau, au corbeau. Seuls des esprits humains, forgés par dix mille générations, tiennent leurs instincts en laisse. Ton corps se détruira sur Terre, cherchant le sang de ses frères, l’eau où s’affaisser. Il finira par se nier lui-même. Car l’instinct de mort l’emporte, et il retournera à la boue d’où il vient. » Ainsi parla le dieu rond et rouge de Yekub, dans ce segment lointain du continuum, à George Campbell — tandis que lui, dépouillé de tout désir humain, s’asseyait sur un trône, gouvernait un empire de vers avec une sagesse, une bonté, une bienveillance qu’aucun homme, jamais, n’avait données à un empire d’hommes. FIN|couper{180}

traductions
A HORA DO DIABO / L’HEURE DU DIABLE
Quelques repères A Hora do Diabo est une nouvelle dialoguée écrite vers 1917–1918, retrouvée dans la fameuse « arca » (la malle de Pessoa qui contenait des milliers de feuillets inédits).Elle a été publiée bien plus tard, en 1988, puis reprise dans différents volumes au Portugal. Le texte met en scène un narrateur qui croise le Diable sous les traits d’un voyageur élégant, cultivé, qui discourt sur Dieu, la liberté et la condition humaine. C’est un texte où Pessoa mélange fantaisie narrative, spéculation métaphysique et ironie subtile, très proche de ses fragments philosophiques. Dans les éditions « e outros contos », le récit est accompagné d’autres textes courts, souvent apocryphes ou attribués à des hétéronymes. L’HEURE DU DIABLE Ils sortirent de la gare et, en arrivant dans la rue, elle eut la stupeur de reconnaître qu’elle se trouvait déjà dans sa propre rue, à quelques pas de sa maison. Elle s’arrêta net. Puis se retourna, pour partager sa surprise avec son compagnon ; mais derrière elle ne venait plus personne. La rue était là, lunaire et déserte, et il n’y avait nul bâtiment qui pût être ou paraître une gare. Étourdie, somnolente, mais intérieurement éveillée et inquiète, elle alla jusqu’à chez elle. Elle entra, monta l’escalier ; au premier étage, elle trouva son mari encore debout. Il lisait dans le bureau, et lorsqu’elle entra, il posa son livre. -- Alors ? demanda-t-il. -- Tout s’est très bien passé. Le bal était très intéressant. — Et elle ajouta, avant qu’il n’interroge — Des gens qui étaient là m’ont ramenée en automobile jusqu’au début de la rue. Je n’ai pas voulu qu’ils me déposent à la porte. Je suis descendue là, j’ai insisté. Ah, comme je suis fatiguée ! Et, dans un geste de grand épuisement, oubliant même le baiser, elle alla se coucher. Ses rêves prirent une tournure étrange, ponctués de choses inexplicables par aucune expérience connue. En elle flotta le désir de grandeurs immenses, comme si, dans une vie antérieure, elle avait été séparée un jour, par-delà toutes les âges de la terre. Et elle se vit avancer sur un pont vertigineux, d’où l’on embrassait le monde entier. En bas, à une distance plus qu’impossible, brillaient, comme des astres dispersés, de grandes taches de lumière : des villes, sans doute, de la terre. Une silhouette vêtue de rouge lui apparut et les lui désigna : -- Ce sont les grandes villes du monde. Voici Londres — et il montra, plus bas, une lueur dans la distance. Voici Berlin — et il en désigna une autre. Et celle-là, là-bas, c’est Paris. Des taches de lumière dans la nuit, et nous, sur ce pont, nous passons au-dessus, incrédules devant le mystère et le savoir. -- Quelle chose à la fois terrible et magnifique ! Mais qu’est-ce donc, tout cela, là en bas ? -- Ceci, madame, c’est le monde. C’est d’ici que, sur l’ordre de Dieu, j’ai tenté son Fils, Jésus. Mais cela n’a pas marché, comme je m’y attendais : le Fils était plus initié que le Père, et il était en contact direct avec les Supérieurs Inconnus de l’Ordre. Ce fut une épreuve, comme on dit en langage initiatique, et le Candidat s’en sortit admirablement. -- Je ne comprends pas. C’est bien d’ici, vraiment, que vous avez tenté le Christ ? -- Oui. Bien sûr : là où s’étend aujourd’hui une vallée immense, se dressait alors une montagne. Les abîmes ont aussi leur géologie. Ici même, où nous sommes, c’était le sommet. Comme je m’en souviens ! Le Fils de l’Homme me repoussa d’au-delà de Dieu. J’ai suivi, car c’était mon devoir, le conseil et l’ordre de Dieu : je l’ai tenté avec tout ce qui existait. Si j’avais suivi mon propre conseil, je l’aurais tenté avec ce qui n’existe pas. Peut-être l’histoire du monde en général, et celle de la religion chrétienne en particulier, auraient-elles été différentes. Mais que peuvent-elles contre la force du Destin, suprême architecte de tous les mondes — le Dieu qui a créé celui-ci, et moi qui, parce que je le nie, le soutiens ? -- Mais comment peut-on soutenir une chose en la niant ? -- C’est la loi de la vie, madame. Le corps vit parce qu’il se désintègre, mais sans se désintégrer tout à fait. S’il ne se désagrégeait pas, seconde après seconde, il serait un minéral. L’âme vit parce qu’elle est perpétuellement tentée, même si elle résiste. Tout vit parce que tout s’oppose à quelque chose. Moi, je suis ce à quoi tout s’oppose. Mais si je n’existais pas, rien n’existerait, car il n’y aurait rien à quoi s’opposer — comme la colombe de mon disciple Kant qui, volant dans l’air léger, croit qu’elle volerait mieux dans le vide. « La musique, la clarté lunaire et les rêves sont mes armes magiques. Mais par musique, il ne faut pas entendre seulement celle qu’on joue : aussi celle qui demeure à jamais inentendue. Quant au clair de lune, il ne faut pas croire qu’il s’agit seulement de celui qui vient de l’astre et projette aux arbres leurs grands profils ; il est un autre clair de lune, que même le soleil n’exclut pas, et qui, en plein jour, obscurcit ce que les choses prétendent être. Seuls les rêves sont toujours ce qu’ils sont. C’est le côté de nous où nous naissons, et où nous demeurons toujours naturels et nous-mêmes. -- Mais, si le monde est action, comment le rêve peut-il faire partie du monde ? -- Parce que le rêve, madame, est une action devenue idée ; et c’est pourquoi il conserve la force du monde tout en rejetant sa matière, qui est d’être dans l’espace. N’est-il pas vrai que nous sommes libres en rêve ? -- Oui, mais le réveil est si triste... -- Le bon rêveur ne s’éveille pas. Moi, je ne me suis jamais éveillé. Dieu lui-même doute que je dorme — il me l’a dit un jour... Elle le regarda avec un sursaut et, soudain, ressentit de la peur : une expression surgie du fond de son âme qu’elle n’avait jamais éprouvée. -- Mais enfin, qui êtes-vous ? Pourquoi ce masque ? -- Je réponds, en une seule réponse, à vos deux questions : je ne suis pas masqué. -- Comment ? -- Madame, je suis le Diable. Oui, je suis le Diable. Mais ne me craignez pas, ne vous effrayez pas. Et dans un éclair de terreur extrême, où flottait un plaisir nouveau, elle reconnut soudain que c’était vrai. -- Je suis en effet le Diable. Ne vous alarmez pas, car je suis réellement le Diable, et c’est pourquoi je ne fais pas de mal. Certains de mes imitateurs, sur la terre ou au-dessus, sont dangereux, comme tous les plagiaires, car ils ignorent le secret de ma manière d’être. Shakespeare, que j’ai souvent inspiré, m’a rendu justice : il a dit que j’étais un gentleman. Aussi pouvez-vous être tranquille. En ma compagnie, vous êtes bien. Je suis incapable d’un mot, d’un geste, qui puisse offenser une dame. Quand cela ne serait pas ma nature, Shakespeare m’y contraindrait. Mais, en vérité, il n’y avait nul besoin. « Je remonte au commencement du monde, et depuis lors j’ai toujours été un ironiste. Or, comme vous le savez, les ironistes sont inoffensifs, sauf quand ils prétendent utiliser l’ironie pour insinuer quelque vérité. Moi, je n’ai jamais voulu dire la vérité à personne : d’une part parce que cela ne sert à rien, d’autre part parce que je ne la connais pas. Mon frère aîné, Dieu tout-puissant, je crois bien qu’il ne la connaît pas non plus. Mais ce sont là affaires de famille. « Peut-être ne savez-vous pas pourquoi je vous ai menée ici, dans ce voyage sans terme réel ni but utile. Ce n’était pas, comme vous pouviez le croire, pour vous séduire ou vous violenter. Ces choses-là arrivent sur terre, parmi les animaux — et l’homme en fait partie — et il paraît qu’elles donnent du plaisir, à ce qu’on me dit de là-bas, même aux victimes. « D’ailleurs, je n’aurais pu. Ces choses appartiennent à la terre, parce que les hommes sont des animaux. À ma place, dans l’ordre social de l’univers, elles sont impossibles : non parce que la morale y serait meilleure, mais parce que nous, les anges, n’avons pas de sexe — et c’est là, du moins en ce cas, la garantie suprême. Vous pouvez donc être rassurée : je ne vous manquerai pas de respect. Je sais bien qu’il existe des irrespects accessoires et vains, comme ceux des romanciers modernes ou ceux de la vieillesse ; mais même ceux-là me sont interdits, car mon absence de sexe date du commencement des choses et je n’ai jamais eu à y penser. On dit que bien des sorcières ont passé des pactes avec moi : c’est faux ; ou alors, c’est que le pacte fut conclu avec l’imagination elle-même — qui, en un sens, c’est moi. « Soyez donc tranquille. Je corromps, c’est vrai, parce que je fais imaginer. Mais Dieu est pire que moi, au moins sur un point : il a créé le corps corruptible, bien moins esthétique. Les rêves, eux, ne pourrissent pas. Ils passent. Et c’est mieux ainsi, n’est-ce pas ? » « C’est ce que signifie l’Arcane XVIII. J’avoue ne pas bien connaître le Tarot, car je n’ai jamais réussi à en apprendre les secrets, malgré tant de gens qui prétendent le comprendre parfaitement. » -- Dix-huit ? Mon mari détient le dix-huitième degré de la franc-maçonnerie. -- Pas de la franc-maçonnerie, non : d’un rite de la franc-maçonnerie. Mais, malgré ce qu’on en dit, je n’ai rien à voir avec la franc-maçonnerie, et encore moins avec ce degré. Je parlais de l’Arcane XVIII du Tarot, c’est-à-dire de la clé de tout l’univers — dont, d’ailleurs, ma compréhension est imparfaite, comme elle l’est de la Kabbale, que les docteurs de la Doctrine Secrète connaissent mieux que moi. « Mais laissons cela, qui n’est que journalisme. Souvenons-nous que je suis le Diable. Soyons donc diaboliques. Combien de fois avez-vous rêvé de moi ? » -- Que je sache, jamais, répondit Maria en souriant, les yeux grands ouverts fixés sur lui. -- Jamais vous n’avez pensé au Prince Charmant, à l’Homme Parfait, à l’amant infini ? Jamais vous n’avez senti, en rêve, près de vous, celui qui caresse comme nul autre ne caresse, qui vous est vôtre comme s’il vous incluait en lui, qui est à la fois le père, l’époux et le fils, dans une triple sensation qui n’en fait qu’une ? -- Bien que je ne comprenne pas tout à fait, oui, je crois avoir pensé ainsi et ressenti cela. Il est un peu difficile de l’avouer, vous savez ? -- C’était moi, toujours moi, la Serpent, le rôle qui m’a été donné depuis le commencement du monde. Je dois sans cesse tenter, mais — qu’on s’entende — dans un sens figuré, frustrant, car il n’y a aucun intérêt à tenter utilement. « Ce furent les Grecs qui, en interposant la Balance, firent onze les dix signes primitifs du Zodiaque. Ce fut la Serpent qui, par l’interposition de la critique, fit véritablement douze la décennie primitive. -- En vérité, je n’y comprends rien. -- Vous ne comprenez pas : écoutez. D’autres comprendront. Mes meilleures créations sont le clair de lune et l’ironie. -- Ce ne sont pas des choses très semblables... -- Non, car je ne me ressemble pas à moi-même. Ce vice est ma vertu. Voilà pourquoi je suis le Diable. -- Et comment vous sentez-vous ? -- Fatigué, surtout fatigué. Fatigué des astres et des lois, et avec un peu l’envie de rester hors de l’univers et de me recréer sérieusement avec rien. À présent il n’y a ni vide ni absence de raison ; et moi je me souviens de choses anciennes — oui, très anciennes — des royaumes d’Adam, avant Israël. De ceux-là j’étais destiné à être roi, et aujourd’hui je suis en exil de ce que je n’ai pas eu. « Je n’ai jamais eu d’enfance, ni d’adolescence, ni par conséquent d’âge viril auquel parvenir. Je suis le négatif absolu, l’incarnation du néant. Ce qu’on désire et qu’on ne peut obtenir, ce qu’on rêve parce que cela ne peut exister — c’est là mon royaume vide et c’est là qu’est assis le trône qui ne m’a pas été donné. Ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû exister, ce que la Loi ou la Fortune n’ont pas accordé, je l’ai jeté à pleines mains dans l’âme de l’homme, et elle s’est troublée de sentir la vie vive de ce qui n’existe pas. Je suis l’oubli de tous les devoirs, l’hésitation de toutes les intentions. Les tristes et les fatigués de la vie, quand l’illusion est tombée, lèvent les yeux vers moi, car moi aussi, à ma manière, je suis l’Étoile Brillante du Matin. Et il y a si longtemps que je le suis ! « L’humanité est païenne. Jamais aucune religion ne l’a pénétrée. Dans l’âme de l’homme ordinaire n’existe pas le pouvoir de croire à la survie de cette âme elle-même. L’homme est un animal qui s’éveille sans savoir où ni pourquoi. Quand il adore les Dieux, il les adore comme des sortilèges. » Votre religion est une sorcellerie. Ainsi fut-elle, ainsi est-elle, et ainsi sera-t-elle. Les religions ne sont rien d’autre que ce qui déborde des mystères dans la profanité — et que celle-ci ne peut comprendre, car, par nature, elle n’en a pas le pouvoir. « Les religions sont des symboles, et les hommes prennent les symboles, non comme des vies (ce qu’ils sont), mais comme des choses (ce qu’ils ne peuvent être). Ils sacrifient à Jupiter comme s’il existait, jamais comme s’il vivait. Quand on renverse du sel, on en jette une pincée, de la main droite, par-dessus l’épaule gauche. Quand on offense Dieu, on récite quelques Pater Noster. L’âme demeure païenne, et Dieu reste à exhumer. Seuls les rares ont posé sur son tombeau l’acacia — la plante immortelle — pour qu’il s’en relève le moment venu. Mais ceux-là, parce qu’ils ont bien cherché, furent élus pour le trouver. « L’homme ne diffère de l’animal qu’en sachant qu’il ne l’est pas. C’est la première lumière, qui n’est rien d’autre qu’une ténèbre visible. C’est le commencement, car voir la ténèbre, c’est en posséder la lumière. C’est la fin, car c’est savoir, par la vue, qu’on est né aveugle. Ainsi l’animal devient homme par l’ignorance qui naît en lui. « Ce sont des ères sur des ères, des temps derrière des temps, et il n’y a jamais que ce cercle dont la vérité réside au point du centre. « Le principe de la science, c’est de savoir que nous ignorons. Le Monde — c’est là où nous sommes ; la Chair — c’est ce que nous sommes ; le Diable — c’est ce que nous désirons. Ces trois, à l’Heure Haute, ont tué le Maître que nous aurions pu devenir. Et le secret qu’il détenait, pour que nous nous convertissions en lui, ce secret fut perdu. » « Moi aussi, madame, je suis l’Étoile Brillante du Matin. Je l’étais avant que Jean ne parle, car il existe des atomes avant les atomes, et des mystères antérieurs à tous les mystères. Je souris lorsqu’on croit (et que je crois moi-même) que je suis Vénus dans un autre système de symboles. Mais qu’importe ? Tout cet univers, avec son Dieu et son Diable, avec les hommes et les choses qu’ils voient, est un hiéroglyphe éternellement à déchiffrer. Je suis, par office, Maître de Magie : et pourtant je ne sais pas ce qu’elle est. « La plus haute initiation s’achève par la question incarnée de savoir s’il existe quoi que ce soit. Le plus haut amour est un grand sommeil, comme celui dans lequel nous nous aimons en dormant. Moi-même, qui devrais être un haut initié, je demande parfois à ce qu’il y a en moi d’au-delà de Dieu si tous ces dieux et tous ces astres ne sont pas autre chose que des sommeils d’eux-mêmes, d’immenses oublis de l’abîme. « Ne soyez pas surprise que je parle ainsi. Je suis naturellement poète, car je suis la vérité parlant par erreur ; et toute ma vie, en fin de compte, est un système particulier de morale, voilé en allégorie et illustré par des symboles. -- Non, dit-elle en riant, il doit bien exister une religion véritable… Oui — ajouta-t-elle en riant davantage — ou bien elles sont toutes fausses. -- Madame, toutes les religions sont vraies, si opposées qu’elles paraissent. Elles sont des symboles différents de la même réalité, comme une même phrase dite dans plusieurs langues ; si bien que ceux qui prononcent la même chose de façon différente ne se comprennent pas entre eux. Quand un païen dit Jupiter et qu’un chrétien dit Dieu, ils mettent la même émotion en des termes différents de l’intelligence : ils pensent différemment une même intuition. « Le repos d’un chat au soleil est la même chose que la lecture d’un livre. Un sauvage contemple l’orage comme un Juif regarde Jéhovah ; un sauvage regarde le soleil comme un chrétien contemple le Christ. Et pourquoi, madame ? Parce que “tonnerre” et “Jéhovah”, “soleil” et “chrétien”, sont des symboles divers d’une même chose. « Nous vivons dans ce monde de symboles, dans le même temple clair et obscure ténèbre visible, pour ainsi dire ; et chaque symbole est une vérité qui se substitue à la vérité, jusqu’à ce que le temps et les circonstances restituent la véritable » « Je corromps, mais j’éclaire. Je suis l’Étoile Brillante du matin — expression, soit dit en passant, qui fut déjà appliquée deux fois, non sans raison ni discernement, à un autre que moi. » -- Mon mari m’a dit un jour que le Christ était le symbole du soleil... -- Oui, madame. Et pourquoi ne serait-il pas tout aussi vrai de dire que le soleil est le symbole du Christ ? -- Mais vous renversez tout... -- C’est mon devoir, madame. Ne suis-je pas, comme l’a dit Goethe, non pas l’esprit qui nie, mais l’esprit qui contredit ? -- Contredire est vilain... -- Contredire les actes, oui... Contredire les idées, non. -- Pourquoi donc ? -- Parce que contredire les actes, si mauvais qu’ils soient, c’est gêner la rotation du monde, qui est action. Mais contredire les idées, c’est les laisser nous quitter, et nous faire tomber dans le désenchantement, puis dans le rêve, et par là appartenir au monde. « Il existe, madame, à propos de ce qui se passe dans ce monde, trois théories distinctes : que tout est l’œuvre du Hasard ; que tout est l’œuvre de Dieu ; et que tout est l’œuvre de plusieurs causes, combinées ou entremêlées. Nous pensons, en général, selon notre sensibilité, et pour cela tout se transforme pour nous en un problème de bien et de mal. Depuis longtemps, je subis de grandes calomnies à cause de cette interprétation. Il ne semble être venu à l’esprit de personne que les relations entre les choses — supposant qu’il y ait choses et relations — sont trop complexes pour qu’aucun dieu ni aucun diable ne les explique, ni même les deux ensemble. « Je suis le maître lunaire de tous les rêves, le musicien solennel de tous les silences. Vous souvenez-vous de ce que vous avez pensé, seule, devant un grand paysage de forêts baignées de clair de lune ? Vous ne vous en souvenez pas, car vous pensiez à moi — et je dois vous le dire : je n’existe pas vraiment. Si quelque chose existe, je ne le sais pas. « Les aspirations vagues, les désirs futiles, les lassitudes du commun, même quand on aime, les ennuis de ce qui n’ennuie pas — tout cela est mon œuvre, née lorsque, allongé sur les rives des grands fleuves de l’abîme, je me dis que je ne sais rien, moi non plus. Alors ma pensée descend, effluve vague, dans l’âme des hommes, et ils se sentent différents d’eux-mêmes. « Je suis l’Éternel Différent, l’Éternel Ajourné, le Superflu de l’Abîme. Je suis resté hors de la Création. Je suis le Dieu des mondes qui existaient avant le Monde, les rois d’Adam qui régnèrent mal avant Israël. Ma présence dans cet univers est celle d’un convive non invité. J’apporte avec moi la mémoire des choses qui n’ont pas été, mais qui auraient pu être. (Alors face ne voyait pas face, et il n’y avait pas d’équilibre.) « La vérité, cependant, c’est que je n’existe pas — ni moi, ni rien d’autre. Tout cet univers, et tous les autres univers, avec leurs divers créateurs et leurs divers Satans plus ou moins parfaits et aguerris, sont des vides dans le vide, des riens qui tournent, satellites, dans l’orbite inutile du néant. « Tout cela, je ne le dis pas pour vous, mais pour votre fils... -- Je n’ai pas d’enfant... Enfin, je dois en avoir un dans six mois, si Dieu le veut... -- C’est à lui que je parle... Dans six mois ? Six mois de quoi ? -- De quoi ?! Six mois... -- Six mois solaires ? Ah, oui. Mais la grossesse se compte en mois lunaires, et moi je ne peux compter qu’en mois de Lune, car elle est ma fille — c’est-à-dire mon visage reflété dans les eaux du chaos. Avec la grossesse et toutes les saletés de la terre je n’ai rien à voir, et je ne sais par quelle fantaisie on a choisi de mesurer ces choses selon les lois de la lune que j’ai fournies. Pourquoi n’ont-ils pas trouvé une autre mesure ? À quoi bon l’Omnipotent avait-il besoin de mon travail ? » « Depuis le commencement du monde on m’insulte et l’on me calomnie. Même les poètes — mes amis naturels — qui m’ont défendu ne l’ont pas bien fait. Un Anglais nommé Milton m’a fait perdre, avec quelques compagnons, une bataille indéfinie qui n’eut jamais lieu. L’autre, l’Allemand Goethe, m’a donné le rôle d’un entremetteur dans une tragédie de village. Mais je ne suis pas ce qu’on pense. Les Églises m’abominent. Les croyants tremblent à mon nom. Pourtant, que cela leur plaise ou non, j’ai un rôle dans le monde. Je ne suis ni le révolté contre Dieu, ni l’esprit qui nie. Je suis le Dieu de l’Imagination, perdu parce que je ne crée pas. C’est par moi que, dans ton enfance, tu rêvais ces rêves qui sont des jouets ; c’est par moi que, devenue femme, tu as senti la nuit t’enlacer des princes et des dominateurs cachés au fond des songes. Je suis l’Esprit qui crée sans créer, dont la voix est une fumée et l’âme une erreur. Dieu m’a fait pour que je l’imite la nuit. Il est le Soleil, je suis la Lune. Ma lumière plane sur tout ce qui est futile ou défait : feux-follets, berges de rivières, marécages et ombres. « Quelle main d’homme s’est posée sur tes seins, qui fût la mienne ? Quel baiser t’a été donné qui fût égal au mien ? Quand, dans les grandes après-midis brûlantes, tu rêvais à tel point que tu rêvais de rêver, n’as-tu pas vu passer, au fond de tes songes, une figure voilée, rapide, qui t’aurait donnée toute la félicité, qui t’aurait embrassée indéfiniment ? C’était moi. C’est moi. Je suis celui que tu as toujours cherché et que tu ne pourras jamais trouver. Peut-être, au fond de l’abîme, Dieu lui-même me cherche-t-il pour que je le complète. Mais la malédiction du Dieu plus ancien — le Saturne de Jéhovah — plane sur lui et sur moi, nous sépare alors qu’elle aurait dû nous unir, afin que la vie et ce que nous en désirons ne fussent qu’une seule et même chose. « L’anneau que tu portes et chéris, la joie d’une pensée vague, ce sentiment d’être belle dans le miroir où tu te regardes — ne t’y trompe pas : ce n’est pas toi, c’est moi. C’est moi qui noue à merveille tous les liens dont les choses se parent, qui dispose avec justesse les couleurs dont elles s’ornent. De tout ce qui ne vaut pas la peine d’être, je fais mon domaine et mon empire — seigneur absolu de l’interstice et de l’entre-deux, de ce qui, dans la vie, n’est pas la vie. Comme la nuit est mon royaume, le rêve est mon domaine. Ce qui n’a ni poids ni mesure m’appartient. » « Les problèmes qui tourmentent les hommes sont les mêmes que ceux qui tourmentent les dieux. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, dit Hermès trois fois à Maxime, qui, comme tous les fondateurs de religions, se souvint de tout, sauf d’exister. Combien de fois Dieu m’a-t-il dit, citant Antero de Quental : “Hélas ! Et qui suis-je ?” « Tout est symbole et retardement, et nous, qui sommes dieux, nous n’avons qu’un degré de plus dans un Ordre dont nous ne connaissons pas les Supérieurs Inconnus. Dieu est le second dans l’Ordre manifeste, et il ne me dit pas qui est le Chef de l’Ordre, le seul à connaître — s’il les connaît — les Chefs Secrets. Combien de fois Dieu m’a-t-il dit : “Mon frère, je ne sais pas qui je suis.” « Vous avez l’avantage d’être humains, et parfois, du fond de ma lassitude de tous les abîmes, je crois qu’il vaut mieux la paix d’une soirée de famille au coin du feu que toute cette métaphysique des mystères à laquelle nous, dieux et anges, sommes condamnés par substance. Quand je me penche sur le monde, j’aperçois au loin, partant du port ou y revenant, les voiles des barques de pêcheurs, et mon cœur a des nostalgies imaginaires de la terre où je ne suis jamais allé. Heureux ceux qui dorment, dans leur vie animale, un système d’âme voilé en poésie et illustré par des mots. » -- Cette conversation a été des plus intéressantes... -- Cette conversation, madame ? Mais cette conversation, bien qu’elle soit peut-être le fait le plus important de votre vie, n’a jamais eu lieu en vérité. D’abord, vous le savez : je n’existe pas. Ensuite, comme s’accordent à le dire les théologiens qui m’appellent Diable et les libres penseurs qui m’appellent Réaction, aucune de mes paroles ne peut avoir d’intérêt. Je suis un pauvre mythe, madame, et, ce qui est pire, un mythe inoffensif. Il me console seulement que l’univers — oui, cet amas de formes et de vies — soit lui aussi un mythe. « On me dit que toutes ces choses peuvent être éclaircies à la lumière de la Kabbale et de la philosophie, mais ce sont là matières dont je ne sais rien. Et Dieu, à qui j’en parlai un jour, m’avoua qu’il ne les comprenait pas bien non plus, car elles appartiennent exclusivement, dans leurs arcanes, aux grands initiés de la Terre — lesquels, à en croire les livres et les journaux, abondent et ont toujours abondé. « Ici, dans ces sphères supérieures d’où fut créé et transformé le monde, nous, pour vous dire la vérité, nous ne comprenons rien. Je me penche parfois sur la vaste terre, couché sur le rebord de mon plateau — ce plateau de la Montagne d’Héredom, comme je l’ai entendu nommer — et chaque fois je vois naître de nouvelles religions, de nouvelles grandes initiations, de nouvelles formes, toutes contradictoires, de la vérité éternelle, que Dieu lui-même ignore. « Je vous avoue que je suis las de l’Univers. Dieu autant que moi aimerions dormir d’un sommeil qui nous libérât des charges transcendantes où, sans savoir comment, nous avons été investis. Tout est infiniment plus mystérieux qu’on ne le croit, et tout cela — Dieu, l’univers et moi — n’est qu’un recoin mensonger de la vérité inaccessible. » -- Vous n’imaginez pas combien j’ai apprécié votre conversation. Je n’ai jamais entendu personne parler ainsi. Ils étaient sortis dans la rue, pleine de clair de lune, qu’elle n’avait pas remarquée. Elle se tut un instant. -- Mais savez-vous ce que je ressens, au fond, réellement, à la fin de tout ? -- Quoi donc ? demanda le Diable. Elle leva vers lui les yeux soudain pleins de larmes. -- Une grande pitié pour vous !... Une expression d’angoisse, qu’on n’aurait jamais cru possible, passa sur le visage et dans les yeux de l’homme rouge. Il laissa retomber brusquement le bras qui entourait le sien. Il s’arrêta. Elle fit quelques pas, gênée. Puis elle se retourna, pour dire quelque chose — elle ne savait quoi — afin de s’excuser de la peine qu’elle voyait lui avoir causée. Elle demeura stupéfaite. Elle était seule. Oui, c’était sa rue, le haut de sa rue, mais au-delà d’elle il n’y avait plus personne. Le clair de lune frappait, éclatant, non pas sur la sortie du funiculaire, mais sur les deux portes fermées de la serrurerie habituelle. Non, au-delà d’elle, il n’y avait personne. C’était la rue du jour, vue de nuit. Au lieu du soleil, le clair de lune — rien d’autre ; un clair de lune normal, très lumineux, qui laissait les maisons et les rues dans leur naturel. Le clair de lune de toujours. Elle avança vers sa maison. -- Je suis venue avec des gens que je connaissais. Comme ils allaient dans la même direction... -- Et comment es-tu rentrée ? À pied ?! -- Non. Je suis venue en automobile. -- Ah bon ! Je n’ai rien entendu. -- Pas jusqu’à la porte — dit-elle sans hésiter. — Ils se sont arrêtés au coin de la rue, et j’ai demandé qu’ils ne me conduisent pas jusque-là, parce que je voulais marcher ce bout de rue sous ce clair de lune si beau. Et il est beau... Je vais me coucher. Bonne nuit... Et ce fut en souriant, mais sans lui donner le baiser habituel — que nul, en le donnant, ne sait si c’est coutume ou si c’est baiser. Aucun des deux ne remarqua qu’ils ne s’étaient pas embrassés. L’enfant, un garçon, qui naquit six mois plus tard, se révéla, avec le temps, fort intelligent : un talent, peut-être un génie, ce qui était peut-être vrai, bien que quelques critiques seulement l’affirmassent. Un astrologue, qui fit son horoscope, déclara qu’il avait le Cancer à l’Ascendant, et Saturne comme signe. -- Dis-moi, mère... On dit que certaines mémoires maternelles peuvent se transmettre aux enfants. Il y a une chose qui m’apparaît constamment en rêve, et que je ne peux relier à rien de ce qui m’est arrivé. C’est le souvenir d’un étrange voyage, où surgit un homme vêtu de rouge qui parle beaucoup. D’abord une automobile, puis un train, et dans ce voyage en train on passe sur un pont très haut, qui semble dominer toute la terre. Ensuite, il y a un abîme, et une voix qui dit beaucoup de choses — que si je les comprenais, peut-être me diraient-elles la vérité. Puis on sort à la lumière, c’est-à-dire au clair de lune, comme si l’on sortait d’un souterrain — et c’est exactement ici, au bout de la rue... Ah, et au commencement de tout, il y a une sorte de bal, ou de fête, où cet homme en rouge apparaît... Maria posa sa couture sur ses genoux. Et, se tournant vers son amie Antónia, dit : -- Quelle histoire curieuse. Bien sûr, tout cela des automobiles, des trains et le reste, c’est du rêve ; mais il y a pourtant une part de vérité... C’était ce bal au Clube Azul, au Carnaval, il y a bien des années — oui, cinq ou six mois avant qu’il ne naisse. Tu te souviens ? J’ai dansé avec un garçon déguisé en Méphistophélès, et ensuite vous m’avez ramenée en voiture, et je me suis arrêtée au bout de la rue... là même où il dit être sorti de l’abîme. -- Oh, ma chère, je m’en souviens parfaitement... Nous voulions t’accompagner jusqu’à ta porte, mais tu n’as pas voulu. Tu disais que tu aimais marcher un peu sous la lune. -- C’est cela même... Mais c’est étrange, mon fils, que tu sois tombé juste sur des détails que je suis certaine de ne jamais t’avoir racontés. Bien sûr, cela n’a aucune importance... Comme les rêves sont étranges ! Comment peuvent-ils arranger une histoire où se mêlent des choses vraies — que la personne elle-même ne pouvait deviner — et tant d’absurdités, comme ce train et ce pont ? Ingrate humanité ! Voilà comment elle remercia le Diable. illustration :Quais de la ville au clair de lune-> City Docks by Moonlight, John Atkinson Grimshaw (1836-1893)|couper{180}

traductions
The Star-Treader
LE MARCHEUR D'ÉTOILE Poème de Clark Ashton Smith 1912 faisant partie de son premier recueil publié à 19ans. I Une voix m’a crié dans une aube de songes : « Hâte-toi : les toiles de la mort et de la naissance sont balayées, et tous les fils de la terre s’usent jusqu’à la rupture ; vers l’espace resplendit ton antique chemin des soleils, dont la flamme fait partie de toi ; et des abîmes s’étendent, immuables, dont l’immensité se déploie à travers tout le mystère de ton esprit. Va, et foule sans crainte l’embrasement des étoiles où tu passas jadis ; perce sans effroi chaque immensité dont la vastitude ne t’écrasa point autrefois. Une main brise les chaînes du Temps, une main repousse la porte des années ; maintenant tombent les liens terrestres de la joie et des larmes, et le rêve resserré s’ouvre sur l’espace sublime. » II Qui chevauche un rêve — quelle main l’arrêtera ? Quel œil pourra noter, ou mesurer, sa course vouée à son but, le fil et le tissage de sa voie ? Il m’arracha au monde qui me serrait, et m’entraîna par-delà le seuil du Sens. Mon âme fut projetée, suspendue, emportée en tournoiement, telle une planète enchaînée et lancée par la foudre solaire, tendue et farouche. Rapide comme les rayons propagés qui jaillissent de soleils disjoints dans une nuit où nul astre n’éclaire, le rêve ailé accomplit sa trajectoire. A travers des années renversées puis rallumées, je suivis cette chaîne infinie où les soleils sont des maillons de lumière ; je retraçai, à travers des sphères linéaires et ordonnées, l’entrelacs des fils du temps en une trame de midi et de nuit. A travers étoiles et abîmes je vis le rêve se dérouler, ces plis qui composent le vêtement de l’âme. III Aurores enflammées de mémoire, chaque soleil avait l’éclat pour rallumer une chambre close, délaissée et obscurcie dans l’immensité de l’âme. Leurs signes étrangers brillèrent et s’illuminèrent ; je compris ce que chacun avait inscrit sur le parchemin de mon esprit. De nouveau je revêtis mes vies anciennes, et reconnus la liberté et les entraves qui avaient formé et marqué mon âme. IV Je plongeai dans chaque esprit oublié, les unités qui m’avaient bâti, dont les profondeurs étaient jadis aveugles et informes comme l’infini — retrouvant chacun de mes mondes anciens, de planète en planète emporté à travers les gouffres qui séparent puissamment, semblables à un sommeil entre deux vies. J’en trouvai un, où les âmes demeurent comme des souffles reposant sur une rose ; elles y rampent pour délier tout fardeau de vieux chagrins. Et j’en connus un, où la trame de douleur se tisse dans l’habit de l’âme ; et un autre encore, où d’une beauté nouvelle se renforce la chaîne ancienne de la Beauté — douce comme un son, aiguë comme le feu — dans une lumière qu’aucune obscurité ne peut abattre. V Là où nul rêve terrestre n’avait jamais foulé, ma vision entra sans crainte, et la Vie déploya devant moi ses royaumes cachés, comme à un dieu curieux. Là où des soleils colorés de systèmes triples offraient aux planètes une étrange, ineffable lumière verte, les enserrant comme une mer extérieure, et où de vastes midis d’aurore alternaient avec des ciels semblables à des couchants éternels, le toucher de la Vie renouvelait incompréhensiblement les accords de la joie et l’enchantement harmonieux du chagrin. Des passions mortes, telles des étoiles rallumées, brillaient dans l’ombre des voies oubliées. Là où des dieux sans couronne siègent dans les ténèbres, le jour flambait sur des autels ardents. J’entendis — redevenu une part de cela — la musique centrale des Pléiades, et vers Alcyone mon âme s’inclina avec les étoiles soumises à son chant. Sans obstacle, joyeux, je foulai, revenant, des mondes édéniques depuis longtemps perdus ; ou bien j’arpentai des sphères qui leur chantent réponse, par-delà un espace que nulle lumière n’a traversé, diverses comme la folle antiphone de l’Enfer s’opposant au chant angélique du Ciel. VI Quels immensités le rêve partit-il chercher ! Je me crus au-delà du rappel du monde, dans des gouffres où l’obscurité est un mur assez épais pour aveugler l’éclat d’Antarès. Dans des sphères insoupçonnées, je trouvai la suite du cycle de mon être : quelque vie où la première offrande du Chant, étrange feuille impérissable, fut posée sur des fronts que le Deuil étoilé avait couronnés, et que la Douleur avait longuement oints ; quelque avatar où l’Amour chantait tel le dernier grand astre du matin avant que la Mort ne remplisse tout son ciel ; quelque vie dans des années plus fraîches, encore neuves, sur un monde dont la Paix était comme un manteau semblable aux calmes qui reposent sur des bassins embrasés des lueurs du printemps tardif. Là, la surface limpide de la Vie reflétait l’image de toutes choses, et ne trembla que sous la caresse de l’aile assombrissante de la Mort. Quelque éveil plus ancien, aux années primitives, quand la lutte géante des forces tourbillonnantes forgea pour la première fois ce qu’on nomme la Vie — chauffée aux fournaises des soleils, sur l’enclume d’un monde. VII Ainsi je connus ces existences antérieures dont les vies s’étaient fondues dans la mienne ; jusqu’à ce que, soudain, mon rêve — qui contenait une nuit d’où Rigel n’envoyait aucun signe de puissance — se vidât des étoiles foulées, et se réduisît à la mesure du soleil : les barreaux familiers de la prison du cerveau, et le vêtement de la peine et de la joie tissé par les navettes complexes de la terre.|couper{180}

traductions
Chant to Sirius
CHANT À SIRIUS Quelles nuits te retardent, ô Sirius ! Ta lumière est une lance, et tu les transperces comme le guerrier qui frappe son ennemi jusqu’au centre même de sa vie. Tes rayons s’étendent au-delà des gouffres ; ils ouvrent un pont au-dessus, qui durera jusqu’à ce que les maillons de l’univers soient défaits, se séparent, et que tous les gouffres ne fassent plus qu’un, sans soleils pour les diviser. Que tu es fort dans ta place ! Tu marches ton orbite, et l’obscurité tremble sous toi comme une route battue par une armée. Tu es un dieu, dans ton temple évidé de lumière au cœur de la nuit infinie, dont le sol est le vide d’en bas ; tes mondes y sont prêtres et ministres. Tu laboures l’espace, tel un paysan, et tu l’ensemences de semences étrangères. Elles portent des fruits étrangers — et ceux-ci sont ton témoignage, comme les moissons des champs sont le témoignage du paysan.|couper{180}

traductions
Nero
Clark Ashton Smith compose Nero au début des années 1920, dans la période qui suit la parution de ses grands recueils poétiques (The Star-Treader and Other Poems (1912) → Le Marcheur d'Étoile et autres poèmes en 1912, Ebony and Crystal (1922) → Ébène et Cristal). C’est encore l’époque où il se voit d’abord comme un poète, héritier du romantisme décadent et symboliste, nourri de Swinburne, Baudelaire, et des visions cosmiques de Poe. Sa carrière de nouvelliste fantastique, qui l’associera plus tard à Lovecraft et à Weird Tales, n’a pas encore vraiment pris son essor. Dans Nero, il donne voix à l’empereur romain comme incarnation de l’ivresse destructrice. C’est moins un portrait historique qu’une projection poétique : Smith met en scène l’imaginaire du pouvoir absolu, fasciné par la ruine et la beauté qui naît de la destruction. On y retrouve sa vision cosmique, où la grandeur humaine n’est qu’un prélude à l’embrasement des mondes, et où l’esthétique passe par l’apocalypse. Déjà, on y perçoit le glissement de son lyrisme vers un univers plus noir, plus fantastique, qui sera celui de ses contes ultérieurs. Ainsi, Nero peut se lire comme un texte-charnière : il appartient à la veine poétique et oratoire de Smith, mais annonce déjà son goût pour les figures de souverains déchus, de civilisations détruites, et pour l’imaginaire cataclysmique qui deviendra central dans ses récits de Zothique ou d’Hyperborée NÉRON Cette Rome, l’œuvre de tant d’hommes, l’aboutissement de tant d’années de labeur — couronnement rêvé par les morts, projection du désir sans bornes des rois — n’est plus que l’éclat fiévreux de mon rêve obscur, combustible de vision, brève incarnation d’une volonté errante, gaspillée dans l’extase farouche d’une heure immense, quand des siècles entassés devinrent flamme pour tous les siècles éteints et ceux encore à naître. Un simple couchant eût suffi à dire autant — sauf pour la musique qu’arrachent des mains de feu aux silences durs et étroits qui bâillonnent la matière muette : une musique traversée de la voix tendue de la Vie, prompte à crier son agonie — et sauf pour ma certitude que l’éclat en était plus rouge du sang des hommes. La destruction précipite et exalte le processus qui engendre la Beauté, révèle des formes encore jamais vues, donne mouvement, couleur et voix là où l’informe n’était qu’inexpressif silence. Créer, c’est peiner : des années et des jours s’acharnent vers une fin souvent moindre que le désir — après la lente consommation de toutes les forces, et l’épuisement des facultés qu’ailleurs l’on eût offertes à la jouissance. Et lorsqu’enfin l’œuvre est là, il ne reste plus ni capacité, ni pouvoir d’en tirer le moindre plaisir. Mais la destruction, elle, réclame peu de temps ou de talent : tout y est voué à une seule fin, pure, sans entrave — l’ivresse des sens, la jubilation du regard. Et dans la mort, dans la ruine, on puise une vie plus haute, plus totale, qui étend et justifie l’être. Si j’étais dieu, avec l’éventail infini des attributs qui forment l’essence même de la divinité et sa puissance visible… Mais je ne suis qu’empereur, n’ayant que pour un temps le pouvoir d’accélérer la marche de la Mort chez autrui, d’arrêter la Vie épuisée qui se traîne… Et pour moi-même je ne puis retarder l’une, ni hâter l’autre. Des rois, il en fut bien d’autres, et tous sont morts, sans autre puissance dans la mort que celle que le vent accorde à leur poussière dispersée, pour irriter les yeux de la postérité. Mais dieu, je serais suzerain de ces rois innombrables, je guiderais le souffle de leur destin. Dieu, délivré de la mortalité qui aveugle et alourdit la volonté, quelle extase ce serait — rien qu’à contempler la Destruction accroupie derrière le Temps, les destins muets qui guettent les soleils voyageurs, le Silence vampire au sein des mondes, le feu sans lumière qui ronge la base des choses, et la marée du Léthé qui monte et pourrit la pierre des sphères fondamentales… Cela suffirait — jusqu’au moment où les ailes éblouies de ma volonté s’élèveraient avec l’avènement d’une puissance trop soudaine pour se laisser saisir. Alors je lancerais dans leur lutte les forces ennemies, Chaos et Création, ces puissances immémoriales, avec leurs étoiles et leurs gouffres asservis — dynastes du Temps et anarches des ténèbres — en une guerre irrévocable. J’instillerais au cœur de l’univers une discorde nouvelle, un principe de Samson pour l’abattre dans une magnificence de ruine. Oui : le monstre Chaos serait mon molosse déchaîné, et ma puissance, le bras même de la Destruction. Je m’exalterais à voir les étoiles fumantes rallumer, sous mon souffle, leur antique feu, se consumer elles-mêmes jusqu’au néant. La lente pesanteur des soleils, entraînant myriades de mondes, je la changerais à mon gré en une fulgurante cataracte de lumière rugissante — et dans ce tumulte, on entendrait la voix de la Vie, et le chant des morts immémoriaux dont la poussière s’élève en ailes vaporeuses parmi le fracas ascendant des systèmes ruinés. Et las de cet éclat, j’arracherais les yeux mêmes de la lumière, me dressant au-dessus d’un chaos de soleils éteints qui s’amoncellent, grincent et se fracassent en tonnerres, prêtant mouvement et clameur aux gouffres aveugles, mais nulle lueur. Ainsi je donnerais à ma divinité espace et voix pour s’affirmer, ainsi je la comblerais — hâtant les pas du Temps en jetant des mondes comme des cailloux négligents, ou des soleils brisés pour éclairer l’éternité d’une flamboyance nouvelle.|couper{180}

traductions
L’homme-arbre
Voici un récit de Whitehead encore publié la toute première fois dans le Weird Tales de février-mars 1931. Par curiosité je suis parvenu à me procurer le sommaire du magazine en question : he Eyrie (La volière – rubrique courrier des lecteurs / éditoriale) / Robert E. Howard — Le chant d’un ménestrel fou (poème) / J.-J. des Ormeaux — Siva le Destructeur (nouvelle) / Ben Belitt — Les rossignols de Tzo-Lin (nouvelle) / H. P. Lovecraft — Le Phare ancien (poème) / H. P. Lovecraft — Mirage (poème) / Seabury Quinn — Le Spectre secourable (nouvelle) / Edmond Hamilton — La Cité de l’horreur (nouvelle) / Jane Scales — La Chose dans le bush (nouvelle) / Francis Flagg — L’Image (nouvelle, 1931) / Henry S. Whitehead — L’Homme-arbre (nouvelle) / Frank Belknap Long — L’Horreur venue des collines (roman court) / Guy de Maupassant — Sur l’eau (réédition) / En lisant l'homme-arbre de whitehead j'ai eu l'idée de le faire traduire par HP Lovecraft comme s'il écrivait ce récit à l'une de ses tantes D'ailleurs, dans le Weird Tales d'août 1938, on peut lire une nouvelle de HPL intitulé "l'arbre" qui me paraît reprendre un peu l'idée de l'homme-arbre, déplacée évidemment dans un tout autre décor et bien sûr dotée de son ouverture "cosmique" L'homme-arbre ( d'après un récit de Henry S. Whitehead et en empruntant au style lovecraftien ) Ma chère tante, si je prends la plume, c’est avec la propre appréhension de celui qui a trop longtemps différé l’aveu d’une chose vue, entrevue plutôt, dont l’énormité ne devrait point se hisser dans la sphère humaine ; je vous écris donc depuis la rive grise de Providence pour déposer entre vos mains un récit qui n’est ni confession ni chronique, mais la trace encore tiède d’une hantise : il m’advint, lors d’un séjour aux Antilles nouvellement passées de la férule danoise au pavillon étoilé, d’approcher un usage si antique qu’il ne tient plus de l’homme, et d’y percevoir, derrière l’écorce et la sève, une intention d’outre-monde ; je débarquai au couchant, dans le petit port de Frederiksted, où la bourgade, ourlée d’un croissant de sable sidérant de blancheur, exhalait ces odeurs de sel, de canne broyée et de goémon qui font comme une vapeur sucrée au ras des quais ; la multitude bigarrée bruissait, chariots grinçants, voix profondes, et, de cette cohue, se détacha un personnage théâtral — le Directeur Despard, en blanc immaculé, cuivre étincelant — dont l’inclinaison eût convenu à Versailles, et qui, par égard non à ma personne mais au spectre honoré de mon grand-oncle, le capitaine McMillin, planta sur ma venue un lustre déplacé ; je n’étais que le porteur d’un nom, et déjà la jetée s’ouvrait comme un parvis ; cependant, ce qui suivit tient à la géographie secrète du plateau dit Grande Fontaine, où je gagnai, quelques jours plus tard, dans une Ford percluse, avec Hans Grumbach pour guide : trois heures d’ascensions, de ravins, de sentes en épingle, manguiers lourds, bananeraies à demi sauvages, puis la vaste table des collines du centre-nord, et là, la ruine — bastides éventrées, murets croulants, champs étouffés par la brousse, et, comme un vestige blême, l’eau même de la fontaine : une lame claire tombant d’un roc, frisson infaillible sur une île par ailleurs sèche ; c’est en ce lieu que je vis Silvio Fabricius, qu’ils nommaient, avec une simplicité glaciale, l’homme-arbre ; il se tenait contre un palmier auguste, tronc poli de vieil ivoire végétal, et l’étreignait, visage appuyé à l’écorce lisse, prunelles grandes ouvertes mais tournées, me sembla-t-il, non vers la prairie des hommes, plutôt vers une profondeur qui ne tolérait pas nos sens ; je demandai, et Grumbach — dont le teint se fit cireux — lâcha ce seul mot : « il écoute », puis hâta la marche, comme si ce spectacle avait effleuré quelque corde interdite ; je crus d’abord à l’ethnographie : une survivance dahoméenne, un voeu ancien, un médiateur qui recueille des augures — pluie, sécheresse, mouches voraces — et les rapporte au patriarche du hameau ; mais, à force de retours sur ce plateau, de station muette à quelques toises du colosse sylvestre, de nuits où l’alizé allumait dans les frondes un chuchotement continu, je commençai d’entendre — non de mes oreilles, mais d’une faculté plus basse et sinueuse — que l’écoute de Silvio n’était pas l’écoute d’un mortel : elle passait par les fibres du tronc comme par les câbles d’un orgue abîmal, descendait aux moelles du sol, et de là remontait, à travers le réseau inextricable des racines entremêlées aux racines de l’île entière, vers des bouches sans langue qui n’ont jamais goûté la lumière ; l’homme, pensé-je alors avec un frisson que je crus d’abord ridicule, n’était que l’organe d’un organisme, non pas le palmier seul, mais une trame végétale dont les antiques continents furent jadis la peau, et qui, patiente, impassible, a conservé mémoire de cycles précédant nos chronologies ; durant ces mois, notre ami Carrington — esprit industrieux — obtint bail du domaine pour y planter l’ananas ; on releva les masures, on colmata les chemins, et j’eus la faiblesse d’y engager quelques deniers et un reste d’orgueil familial ; je recommandai, par habitude plus que par discernement, le même Grumbach comme régisseur, et c’est sa bile contre ce qu’il appelait « superstitions » qui scella le désastre ; un après-midi de chaleur stagnante, tandis que Silvio avait quitté son poste pour porter message au bourg, Grumbach conduisit deux bûcherons rétifs au pied du colosse et, voyant leur hésitation, arracha la hache et frappa — une fois, deux fois — entailles nettes à hauteur d’homme ; je reviens alors de la source avec Carrington, et ce que je dois vous dire me reste à la gorge : j’aperçus Silvio, soudain, sur la crête du champ, silhouette filiforme contre l’azur surexposé ; il fit, de ce couteau de canne qu’il portait à la ceinture, un geste bref, impérieux, comme on abaisse une verge de chef d’orchestre ; à cet instant précis, sans délai ni ambiguïté, une noix énorme se détacha de la cime, chuta dans un sifflement de plomb et vint briser le crâne du régisseur avec une précision si souveraine que l’hypothèse du hasard se dissout encore en moi quand j’y songe ; les deux ouvriers hurlèrent, l’air vibra d’un voile, et Grumbach, que nous relevâmes, n’était plus qu’une pulpe ; Silvio passa près de nous comme un somnambule d’ébène, ne jeta ni œillade ni parole, et, parvenu au tronc blessé, posa ses longs doigts sur les entailles, non en homme qui ausculte une plaie, mais en créature qui reconnaît, par un toucher d’initié, l’atteinte portée à sa propre chair ; le lendemain, je retournai seul au palmier et, cédant à une impulsion que je ne me pardonne guère, lui confiai — à lui, à l’homme, à l’arbre, je ne sais — que j’avais vu le geste, et que mon silence, fût-il coupable, serait entier ; il me regarda — et ce regard, ma tante, n’était point humain ; c’était une attention verticale, qui passait à travers moi comme passe la nappe d’eau à travers la roche poreuse — puis il parla, une seule fois, avec cette voix qui semblait vous venir non de la poitrine mais du sol : jeune maître, mon frère pense à vous ; soyez serein ; vous avez tout à gagner ; et il replaqua son visage contre l’écorce, et ses bras ceignirent le tronc dans une immobilité d’idole ; ce ne fut pourtant que le prélude à l’augure le plus noir : à la fin de l’été 1928, quand la tourmente se mit en branle sur les grandes latitudes océanes, Silvio, les yeux clos, transmit au patriarche des signes d’une exactitude blasphématoire — quatre jours avant la foudre officielle du télégraphe ; et lorsque l’ouragan, en convulsion céleste, vint labourer l’île, l’on retrouva au matin l’homme et l’arbre confondus dans le même trépas — le colosse déraciné étendu comme un dieu vaincu, Silvio sous lui, visage lisse, presque serein, tel un officiant retourné dans la bouche même de son culte ; durant des jours, une poudre de terre demeura sur les fronts des villageois, traînées d’une communion muette avec ce qui venait de choir ; depuis lors — et voici la part que je n’ose dire qu’à vous — chaque bruissement de palmes, même dans nos climats sans palmier, réveille en moi la certitude hideuse que nous ne sommes pas les premiers à penser sur cette planète, ni même les mieux doués ; il existe, dans la profonde coulée des choses vertes, une mémoire sans visage, une volonté lente, indifférente et vaste, qui s’agrège par rhizomes et filaments, qui a, d’âge en âge, pris langue avec des médiateurs de chair, et dont Silvio n’était que l’agent local, le doigt posé sur la membrane vivante d’un ordre plus grand ; l’arbre n’était pas un arbre, mais l’antenne d’une conscience immémoriale ; ce que Grumbach a frappé, ce n’était pas du bois : c’était une oreille ; ce qui lui a répondu, par la chute d’un fruit, n’était pas vengeance, mais réflexe ; je ne sors plus à la nuit sans craindre les rameaux, je détourne mon pas des parcs, j’évite l’ombre même des érables de Benefit Street, car j’entends — oui, j’entends — sous le vacarme urbain, la rumeur basse et obstinée d’un monde qui pense autrement, qui calcule à l’échelle des ères, et qui, parfois, choisit, d’une prunelle verte et sans paupière, un homme pour lui prêter oreille ; si cette lettre vous paraissait outrée, brûlez-la ; mais si, un soir, un souffle passe dans un bouquet immobile, souvenez-vous que le vent n’est peut-être que l’alibi commode d’un autre souffle, plus ancien, et qu’il est des portentes qu’il vaut mieux saluer de loin, tête nue, sans lever la hache.|couper{180}
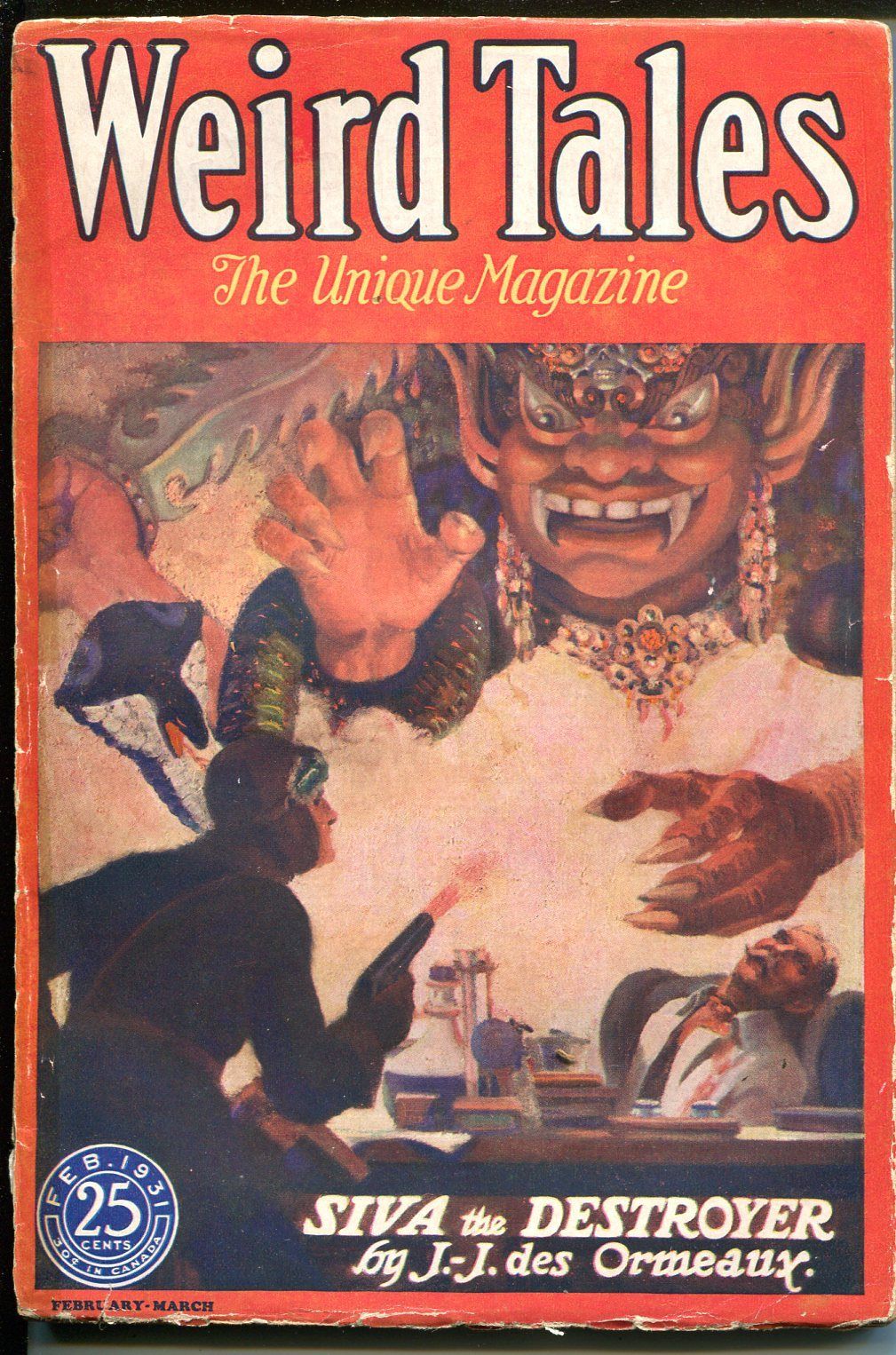
traductions
Noire Terreur
Une histoire de vodu — sur l’île antillaise de Sainte-Croix, des croyances peuvent tuer par la seule terreur. Une traduction inspirée de Black Terror De Henry S. Whytehard paru dans Weird Tales en octobre 1931 Noire Terreur Je me réveille dans le grand lit de mahogany de ma maison à Christiansted avec la sensation aiguë que quelque chose cloche, atrocement, comme une déchirure dans la tête. Je me rassemble, secoue la nuque pour chasser le sommeil, écarte la mousseline du moustiquaire. Ça va mieux. L’étrange horreur qui m’avait poursuivi hors du sommeil décroît. Je tâtonne, retourne vers le rêve, ou quoi que c’était — pas un rêve, non, autre chose. Je peux maintenant, d’une façon obscure, le localiser. Je m’aperçois que j’écoute, douloureusement, une note tenue, lancinante, comme un orgue à vapeur cloué sur un seul son haut, strident, rauque. Je sais que ce n’est pas un orgue à vapeur. On n’a pas ça à Sainte-Croix depuis que Colomb a vu l’île à son deuxième voyage, 1493. Je me lève, enfile mes mules, ma robe de bain en mousseline, toujours rien compris. Net, la note s’interrompt, coupée comme quand les tambours cessent d’un coup quand les Noirs font une rata derrière la ville, dans les collines. C’est là seulement que je comprends. C’était une femme. Elle hurlait. Je sors sur la galerie semi-fermée qui court le long de la façade sur Compagnie Gade, la rue de terre battue en dessous, et je me penche. Un groupe de Noirs levés tôt, habits de n’importe où, s’assemble là, et ça grossit chaque seconde. Hommes, femmes, gamins noirs, serrés en nœud qui se resserre juste sous mes fenêtres, leurs grognements gutturaux faisant un fond à la voix seule de ce cri tenu — car la femme, au centre, a repris, souffle neuf, sa plainte à vous glacer, à vous vriller les nerfs, une stridence à faire grimacer qui écoute. Aucun de ce monde ne la touche. J’écoute leur créole, guttural, pour attraper un mot qui me dirait. Des bribes du large patois, rien à quoi raccrocher l’esprit. Et puis ça vient, du plus mince filet de voix, un timbre d’enfant : le mot net, Jumbee. D’accord. Je tiens le fil. La femme qui crie croit — et le cercle autour d’elle croit — que quelque sorcellerie est en marche. Un ennemi a payé les services du papaloi, le sorcier, et quelque chose d’affreux, malédiction ou charme, a été « posé » sur elle, ou sur les siens. Tout ça, c’est ce que raconte le mot Jumbee. Je reste à guetter la suite. Je me demande aussi pourquoi un policier ne vient pas disperser. Bien sûr le policier, Noir lui aussi, sera pris comme les autres, mais il fera son devoir. « Mets un Noir à conduire un Noir ! » Le vieux dicton reste vrai, comme aux temps d’esclavage. La femme, prise de convulsions, se berce d’avant en arrière, on dirait possédée. Ses hurlements ont maintenant une basse, une cadence pure d’horreur. C’est atroce. Un policier, enfin. Deux, même. L’un, le vieux Kraft, autrefois top-sergent danois de troupes de garnison. Kraft est quasi blanc, mais malgré sa nuance africaine, il ne tolère pas les simagrées. Il avance, fait tournoyer sa matraque en menace, grogne des reproches rauques, ordres de circuler. Le groupe commence à couler vers le marché du dimanche, poussé par l’agent brun foncé du sergent Kraft. Ne restent plus, face à face, que le vieux Kraft et la Noire qui a crié, là, dans la rue. Je vois la figure du vieux changer : du masque dur, professionnel, à quelque chose d’humain. Il lui parle bas. Elle répond en marmonnant, pas hostile, seulement pour que nul n’entende. Je parle depuis la galerie. — Qu’y a-t-il, Herr Kraft ? Je peux aider ? Le vieux Kraft lève les yeux, me reconnaît, touche sa casquette. — Stoopide-ness ! dit-il, explose pour expliquer. La fame… elle a eu — Il s’interrompt, fait un geste sec, dramatique, me lance un regard signifiant. Ses yeux disent : « Je pourrais tout vous dire, mais pas de là. » — Une chaise, sur la galerie, pour la pauvre femme ? proposé-je en hochant. — Come ! dit-il à la femme. Elle suit, docile, par l’escalier extérieur, tandis que je vais décrocher la porte au bout de la galerie. On installe la femme — elle semble hébétée, tient la tête d’une main — dans un de mes fauteuils, où elle se balance lentement en chuchotant. Kraft et moi, dedans, jusqu’à la salle à manger. Au dressoir, je sers comme il se doit mon ami, le sergent Kraft de la police de Christiansted. — Ses hurlements m’ont réveillé, une bonne demi-heure trop tôt, dis-je, pour lancer. — Yah, yah, fait Kraft, la vieille tête avisée qui hoche. Elle me dit de Obiman l’a fixée pour de bon, cette fois ! Ça promet. J’attends la suite. — Mais ce que c’est au juste, je ne saurais dire du tout, poursuit Kraft, décevant, comme s’il jouait au secret professionnel. — Un autre, Herr Kraft ? dis-je. Il ne se fait pas prier, « skoal » final à l’œil dans l’œil, comme on fait à la danoise. Cette libation — ce que j’espérais — dénoue sa langue. Épargnez-vous son accent qu’on coupe au couteau. Il m’apprend que cette femme, Elizabeth Aagaard, vit dans une case de l’habitation, près de la Central Factory, à quelques miles de Christiansted. Elle a un fils, Cornelis McBean. Garçon du pays comme on dit « oiseau de potence » : joueur, voleur, mauvais sujet. Déjà passé au tribunal pour broutilles, déjà enfermé plus d’une fois au Christiansfort. Mais, dit Kraft, « c’est pas le vole qui fait la difficulté présente ». Non. Le jeune McBean a eu l’outrecuidance d’aimer Estrella Collins, la fille d’un riche boutiquier noir, rue latérale de Christiansted. Vieux Collins n’en veut pas, ses mots n’ont rien fait à la tête dure du garçon. Alors il a — bref — embauché un papaloi pour l’écarter. — Mais, protesté-je, je connais le vieux Collins. Je comprends qu’il refuse un vaurien pareil, mais — un commerçant, un homme riche à l’échelle du pays, faire appel à un papaloi — ça… — Him Black ! dit le sergent, petit geste qui explique tout. — Et quel genre d’ouanga Collins lui a-t-il fait « poser » ? dis-je après un temps. Le vieux me jette un regard vif au mot. Un mot lourd. En Haïti, courant. C’est talisman comme amulette : attire ou repousse, protège. Mais ici, à Sainte-Croix, la magie des Noirs n’est ni aussi nette ni (comme on l’imagine) aussi mortelle que les tours des papalois, des hougans dans les mornes haïtiens infestés, leurs milliers d’autels à Ougoun Badagaris, à Damballa, au Serpent venu des lointains, terribles Guinées. Je ne peux pas m’attarder au détail des ouangas. On ne peut tout dire. Les détails — — Je crois que c’est un « sweat-ouanga », souffle Kraft, qui pâlit d’un ton sous son ivoire brûlé de soleil. — La femme allègue, continue-t-il, que le garçon va tomber malade et mourir à midi — aujourd’hui. Pour ça qu’elle marche en ville dès l’aube, parce qu’il n’y a pas d’aide. Elle veut se lamenter, comme, ce malheur sur sa tête. Kraft m’a donné tout ce qu’il a. Il mérite sa récompense. Je revisite le dressoir. — Excusez encore, sergent. C’est un peu tôt pour moi. Mais « on ne marche pas sur une seule jambe ». Le sergent grince un sourire au proverbe santa-crucien — un dernier pour la route est toujours justifié — et répond : — Il doit bien marcher — sur trois ! Il ajuste le troisième verre, « skoal », puis redevient le policier. — Je l’emmène, la femme ? demande-t-il sur la galerie où Elizabeth Aagaard se berce toujours, gémit, chuchote sa peine. — Laissez-la ici, dis-je. Esmerelda lui trouvera à manger. Le sergent salue, s’en va. — Gahd bénisse vous, sar, murmure la pauvre. Je la laisse, vais dire deux mots à ma vieille cuisinière, puis vers ma douche en retard. Bientôt sept heures. Après le petit-déjeuner, je demande des nouvelles d’Elizabeth. Elle a mangé, a tout déversé à Esmerelda et aux autres domestiques. Le récit d’Esmerelda fixe l’idée : McBean a été marqué pour la mort par un des plus vieux, des plus meurtriers procédés de barbarie primitive — dont tous les Blancs qui savent vous diront qu’il n’agit que par la psychologie de la peur, cette peur de l’occulte qui engourdit l’esprit africain depuis des millénaires de guerre contre la brousse, et l’emprise de ses féticheurs, prêtres du vodu. On sait — tous ceux qui étudient la « magie » africaine — que des fragments du corps humain — cheveux, ongles, ou même un vêtement longtemps porté — entretiennent un lien magique avec le corps, et une influence correspondante. Un morceau de chemise, porté contre la peau, gorgé de sueur, vaut beaucoup pour fabriquer un charme qui protège — et son contraire, enfoui contre quelqu’un pour lui nuire. Le sang, etc., entre dans ce catalogue. Pour McBean, voilà ce qui a été fait. Le papaloi a mis la main sur une de ses chemises. Il a habillé avec le corps récemment enterré d’un vieil homme noir mort de vieillesse. Trois jours, trois nuits, la chemise au cercueil. Puis on a su la remettre, subrepticement, à portée de McBean. Elle « avait été égarée ». Le garçon la retrouve dans la case de sa mère, la remet. Et, comme si ça ne suffisait pas — la terreur seule, quand il l’apprend, peut tuer — voilà qu’ils apprennent, mère et fils, par la vigne à ragots, la Grapevine, qu’un petit ouanga, composé de ses rognures d’ongles, des poils ras de sa barbe d’une semaine récupérés dans l’écume du rasage, divers bouts de sa personne extérieure, a été « fixé » par le papaloi de Christiansted, puis « enterré contre lui ». Ça veut dire : à moins de retrouver l’ouanga, le déterrer, le brûler, il meurt à midi. Comme il n’a su l’« enterrement » que la veille au soir, et que l’île de Sainte-Croix fait plus de quatre-vingts miles carrés, il a — mettons — une chance sur cent mille milliards de le trouver, le sortir, l’annuler au feu. Songez qu’aux antiques, aux lointaines ascendances, ses ancêtres ont cru, fixé, donné force à ce meurtre par la tête — ça ressemble bien à la condamnation de Cornelis McBean, mauvais Noir de la place, amoureux ambitieux d’une jeune négresse un peu au-dessus de sa caste selon l’ordre africain des Antilles — il passera à midi pile. C’est, noyé de détails, la substance du récit d’Elizabeth Aagaard. Je la regarde, apaisée maintenant, humble, plus la furie hurlante de l’aube. Et à la voir, pauvre âme, le muet poids de mère dans ses yeux ternes d’où les larmes glissent sur la face charbon, je me dis que je veux aider. Que c’est intolérable. Que cette chose est plus vicieuse que les vices ordinaires. Je ne veux pas me croiser les bras et laisser un McBean inconnu disparaître sur ordre d’un papaloi à gages, parce que le lisse Collins a choisi ce moyen — quinze dollars, peut-être — des rognures, un trou dans l’île — pour l’écarter. Je l’imagine, le jeune Noir, livide de peur sans nom — une grappe de frayeurs antiques, héritées, déraisonnables — tremblant, recroquevillé, âme nauséeuse à ce qui vient, trois heures encore quand sonnera midi au vieux beffroi de Christiansfort. Impuissant, pris dans sa tête, devant la condamnation qu’il s’est attirée pour avoir aimé la brune Estrella Collins — père brun lisse qui porte le plateau de quête chaque dimanche dans son église. Il y a du grotesque, à m’asseoir là, devant la mère McBean. Elle a lâché prise, on dirait, résignée au sort de son fils unique. « Him Black », a dit le vieux Kraft. Ce souvenir du plateau entre les mains grasses du boutiquier me ramène une idée. — Votre église, Elizabeth ? — Moi Église anglaise, sar — le garçon aussi. Lui faire grand shandramadan, sar, lui jouer et peut-être un tief, mais lui ancien communicant, sar. L’inspiration vient. Peut-être qu’un des prêtres de l’« English Church » peut aider. Au fond, c’est affaire de croyance. Qu’un ouanga « enterré contre » moi n’aurait pas le moindre effet — pure absurdité de Polynésiens qui tuent au charme en vous faisant regarder votre image dans une calebasse d’eau et secouent l’eau pour détruire l’image ! — peut-être que si Elizabeth et son fils font leur part… Je parle longuement, sérieusement à Elizabeth. Je martèle : la puissance de Dieu l’emporte sur celle des fétiches, même le serpent. À la fin, une espérance chez elle, me semble, elle s’en va. Je saute en voiture, grimpe au presbytère de l’English Church. Le père Richardson, pasteur, lui aussi natif des Antilles, est là. Je lui expose l’affaire. Il me répond : — Je vous suis obligé, Mr Canevin. S’ils prenaient conscience — disons — de ce que vous venez d’énoncer : la puissance de Dieu, infinie, au-dessus de leurs croyances ! Je vous accompagne, tout de suite. C’est peut-être la délivrance d’une âme humaine. Et ils viennent vers nous, curés, pour le vol de deux noix de coco ! Il disparaît deux minutes, revient avec un sac noir, et nous filons vers le village d’Elizabeth, le long de la belle route qui borde la Caraïbe lisse et bleue. Le village d’habitation est étonnamment calme. Le prêtre descend devant la case d’Elizabeth, je range la voiture dans l’herbe de Guinée. Je vois la haute silhouette du père Richardson, austère, longue soutane noire, entrer d’un pas vif. Je le suis, juste à temps pour une scène étrange. Le garçon noir, livide, réduit par la peur, ramassé sous une mince couverture sur un petit lit de fer. Au-dessus de lui, le prêtre. Il se penche, coupe d’un petit couteau quelque chose au cou du garçon, et le jette avec dédain sur le sol battu. L’objet atterrit à mes pieds. Je le regarde. Un petit sac noir, tissu de coton, avec une houppe de plumes de coq noir en haut, serrée de multiples tours de fil rouge vif. L’ensemble gros comme un œuf. Je reconnais l’amulette de protection. Dents qui claquent, froid de mort sur lui, le garçon proteste en créole. Le prêtre répond gravement. — Pas de demi-mesures, Cornelis. Quand on demande l’aide de Dieu, on se défait de tout le reste. — Murmure d’assentiment de la femme, qui arrange une petite table avec une chandelle, dans l’angle. Le père Richardson tire de son sac une petite bouteille à gicleur et fait pleuvoir des gouttes sur l’ouanga au sol. Puis il asperge la case entière d’eau bénite, finit par la femme, moi, et le garçon. Quand l’eau touche sa joue, il tressaille, frissonne. Et soudain cette évidence me frappe : affaire de croyance encore. Passer de la supposée protection du grigri que le prêtre vient de lui trancher et lancer, à la méthode de l’Église, doit — d’une façon obscure — agir très fort sur ce jeune. La bouteille retourne au sac. Le prêtre parle : — Dieu intervient pour toi, mon enfant — et la puissance de Dieu surpasse toutes choses, visibles et invisibles. Il tient tout dans le creux de sa main. Il va ôter ta peur, enlever ce poids de ton âme, et tu vivras. À toi de faire ta part, si tu veux être fortifié par le Sacrement. D’abord la pénitence. Puis — Le garçon, déjà plus calme, acquiesce, le prêtre nous fait signe de sortir, la mère et moi. Je ouvre, sors. Je laisse Elizabeth à vingt pas de la case, mains tordues, lèvres en prière. Je m’assois dans la voiture. Dix minutes. La porte s’ouvre. Signe d’entrer. Le garçon est calme, le père Richardson referme son sac. Il se tourne vers moi : — Adieu, et merci. C’est très bien à vous de m’avoir mené. — Vous ne venez pas ? — Non, fait-il, réfléchit. Non, je reste jusqu’au bout. — Regarde sa montre. — Vous avez dit midi… — Alors je reste, dis-je, et vais me mettre dans un coin de la petite case. Le prêtre reste près du lit, regard sur le garçon, dos tourné vers moi. La femme, en prière silencieuse dans l’autre coin, se tient hors du chemin. Le prêtre se penche, prend la main inerte, le poignet dans ses grandes mains blanches fermes, compte le pouls, jette un œil à sa montre. Puis vient s’asseoir près de moi. — Une demi-heure, murmure-t-il. La femme, rigide, à genoux sur la terre, prie sans un son. Nous restons, sans parler, vingt longues minutes. La tension de l’air devient visible. Brusque chute de la mâchoire du garçon. Le prêtre bondit, saisit, frictionne les mains noir-mate. La tête roule sur l’oreiller, les dents se referment, les paupières battent. Un spasme léger, sous la couverture. Il prend deux, trois grandes inspirations, retombe dans un quasi coma. Le prêtre reste auprès. Je compte à ma montre les minutes jusqu’à midi. Neuf — huit — sept — puis, trois minutes avant midi. À ce point, j’entends la voix basse du prêtre qui récite, monotone. J’écoute, attrape ses mots. Il tient la main du garçon, et les phrases sortent, graves : — … pour résister et surmonter toute attaque de ton adversaire… te donner force contre l’esprit… et qu’il ne prévale en rien contre toi. — Puis, baissant d’un ton, surprise, sa voix d’anglican se met à déclamer dans l’ancienne langue liturgique : — … et effugiat atque discedat omnis phantasia et nequitia… vel versutia diabolicae fraudis omnisque spiritus immundus adjuratis… Les mots grossissent, prennent puissance à mesure qu’il insiste. Nous sommes au bord exact de midi. Je relève la tête de la montre vers le lit : convulsion sur convulsion traverse ce corps mince. Alors la case se met à trembler — un coup de vent tombé de nulle part. Les palmes sèches claquent dehors, la bise siffle sous la porte mal posée. Le rideau de mousseline gonfle d’un coup, voile. Et la voix rauque du garçon : — Damballa ! dit-il net, puis gémit. Damballa : l’un des Grands Mystères du vodu. Je frissonne malgré moi. Plus haut, plus ferme, la voix du père Richardson, posée, maintenant en intonation — grandes phrases de pouvoir, formules interposées, et lui, dressé, comme un mur entre le chétif garçon noir et les Puissances mauvaises qui viennent le prendre pour leurs fins. Il étend une sorte de manteau de protection au-dessus de ce corps rampant. La mère est prostrée, bras en croix sur la terre — dernier geste de supplication possible à l’humain. Mon regard tombe au coin extrême de la pièce — un objet, forme bizarre, dépasse d’un tas d’habits. Midi exact. Je vérifie la montre, le coup lointain de l’Angelus roule depuis la lourde cloche de St John. Le père Richardson cesse son récitatif, repose la main du garçon sur la couverture, entonne l’Angelus. Je me lève, à la fin je lui tire la manche. Le vent — curieusement — a totalement cessé. Seul le soleil de midi tape sur la tôle du toit, étouffant. Il m’interroge. Je pointe le coin, sous les vêtements. Il va, se penche, tire un grossier serpent de bois. Il lance un regard de reproche à Elizabeth, qui se prosterne de plus belle. — Prends-le, Elizabeth, dit le père. Casse-le en deux. Jette-le dehors. Elle rampe, le prend, le brise net, se relève, visage cendré de peur, ouvre la porte et jette les morceaux. Nous revenons au lit. Le garçon respire calmement. Le prêtre le secoue. Il ouvre des yeux noyés — des yeux d’ivrogne. Il louche stupidement. — Tu es vivant — par la miséricorde de Dieu, dit le prêtre, sévère. Debout. Il est bien passé midi. Tenez — Mr Canevin te montrera sa montre. Tu n’es pas mort. Que cela te serve : laisse à Dieu ce qu’il a mis hors de ta portée. Le garçon s’assied, hébété, la mince couverture autour des épaules, au bord du lit. — On peut repartir, dit le père, très simple, en prenant son sac. Je tourne la voiture à droite, juste devant la barrière du village. Je jette un coup d’œil : le village grouille de Noirs qui se pressent à la case d’Elizabeth Aagaard. À côté de moi, la voix un peu monotone du père. Il parle pour lui, peut-être à haute pensée. — Créateur — de toutes choses — visibles et invisibles. Je roule lentement, pour les canards, poules, porcelets, marmots, carrioles à bourricots, entre la ville et le presbytère. — C’était, dis-je en serrant sa main à l’adieu, une expérience. — Oh — ça ! Oui, oui, tout à fait ! dit-il. Je pensais — pardonnez — à mes malades de l’après-midi. Mon vicaire n’est pas remis de sa dernière dengue. Je suis chargé. Venez prendre le thé — un de ces jours, vers cinq. Je rentre au pas. Un prêtre des Indes occidentales. Ce vent soudain — le petit serpent de bois — la peur nue dans les yeux du garçon noir. Tout ça — travail du jour pour le père Richardson. Dans ces grandes mains carrées un peu maladroites, celles qui tiennent le Sacrement chaque matin. Parfois je me lève tôt et je vais à l’église moi-même, en semaine, par les routes douces dans le gris avant l’aube, parmi des dizaines de Noirs aux pas doux, pieds nus, allant à l’église, à l’aube, chercher force et puissance pour la vieille bataille entre Dieu et Satan — le Serpent — ici où les fils de Cham tremblent encore sous la peur persistante de l’antique malédiction tombée sur leur ancêtre pour avoir ri de son père Noé. FIN.|couper{180}

traductions
Trancrède Le Noir
D'après un récit de Henry S. WhytheHead "The Black Tancrède" parut dans Weird Tales (vol. 13, n° 6), numéro daté juin 1929Tancrède Le Noir C’est vrai : Tancrède-le-Noir n’a pas lâché de malédiction sur Hans De Groot quand son corps en bouillie s’est affaissé sur le chevalet. Il a maudit Gardelin. Mais faut se souvenir : le gouverneur Gardelin est reparti chez lui, au Danemark, donc hors d’atteinte—quoi que ce soit qui ait frappé Achilles Mendoza et Julius Mohrs. Et Tancrède-le-Noir, disait-on, tenait toujours parole : il en avait voué trois. Le Grand Hotel de St. Thomas, îles Vierges, renvoie une lumière qui fait presque mal, tout badigeonné de chaux, chaque hiver, jusqu’aux coins. Élevé un peu plus d’un siècle plus tôt, c’est du tropical pur, architecture qui fait sa loi à partir d’une seule urgence : tenir quand passent les cyclones d’été. Des murs épais, pierre, brique, ciment lourd. Des pièces carrées, énormes, plafond à six mètres. Solide, oui, et pourtant le cyclone de 1916 a décapité l’étage supérieur ; jamais reconstruit. Le profil uniforme sur deux niveaux casse la symétrie d’origine, mais l’ensemble garde sa prestance—du temps où la Haute Cour coloniale danoise siégeait dans une aile, et où ses « cages d’esclaves » étaient réputées pour leur sûreté. Le long de la grande cour intérieure que la masse du bâtiment enserre, côté rade—jadis un cratère, quand l’Atlantide et sa sœur Antillea levaient leurs civilisations au milieu de l’océan—on a rajouté deux maisons, croit-on, un peu après le gros œuvre. Les vieux de St. Thomas se chamaillent encore là-dessus. Sous celle qui touche l’hôtel, escalier commun vers sa vaste galerie, se trouvent ces mêmes cages : aujourd’hui un atelier unique, gigantesque, où le linge de l’hôtel passe toute l’année aux lessives et aux fers, sans pitié. Au début, l’endroit s’appelait « Hôtel du Commerce ». C’est dans la plus proche des deux maisons, la plus petite, que je me suis installé pour l’hiver. J’avais accepté cette maison parce que je voyageais avec mon cousin, Stephen de Lesseps, quatorze ans. Sa mère, ma cousine Marie, m’avait prié de l’emmener respirer un autre climat. Stephen est un garçon facile à vivre. Je lui faisais la classe, il lisait beaucoup, donc les livres avançaient et le reste, ce que l’on apprend autrement, prenait de l’ampleur. À la longue, Stephen s’est révélé d’une tenue, d’un bon sens, d’une compagnie telle que je me suis félicité d’avoir dit oui à Marie. Au milieu de l’hiver, Marie et sa sœur Suzanne nous ont rejoints pour un mois. Joseph Reynolds, l’Américain qui possède le Grand Hotel, leur a donné la chambre 4, énorme double pièce ouvrant sur la salle de bal, là où se tient d’ordinaire le grand monde de la capitale des îles Vierges. Je dois poser ce décor si je veux que mon histoire tienne. Sans Stephen, je ne serais pas resté à St. Thomas : j’ai préféré la capitale à mon île chérie, Santa Cruz, pour lui. Un maître de castillan renommé, Don Pablo Salazar, vit ici ; le directeur de l’instruction dans la maison voisine—bref, de bonnes raisons. Et sans Stephen, Marie et Suzanne n’auraient pas fait ce voyage, n’auraient pas dormi un mois dans la 4, et cette histoire peut-être n’aurait jamais trouvé son chemin. Elles sont arrivées début janvier, après une virée à travers « les îles du bas »—ces bijoux où l’Angleterre et la France se disputaient la mer il y a un siècle. Ravis de la 4. Des lits à baldaquin en acajou, gigantesques. Tout le monde les recevait. Les boutiques les appâtaient. Elles se gorgeaient de la chaleur d’un été en plein hiver, dans ce climat de baume et d’épices. Elles n’en revenaient pas de comme Stephen avait poussé, ni du polissage que l’une des sociétés les plus polies du monde avait ajouté à ses bonnes manières naturelles. Bref, mes cousines se sont régalées et sont reparties enthousiasmées par la grâce étrange et l’hospitalité sans mesure de la capitale—dernière conquête coloniale de l’Oncle Sam, ex-Indes occidentales danoises. Seule ombre au tableau, ont-elles fini par dire : la 4 ne leur laissait pas vraiment dormir. Air, commodités, lits splendides, rien n’y faisait. Toujours le même passage à vide : le réveil autour de quatre heures, le plus mauvais moment de la nuit. Elles m’en ont peu parlé. Plus tard j’ai compris : elles n’osaient pas admettre qu’un détail, quoi que ce soit, contrariait leur plaisir chez moi. À tout prendre, Suzanne l’avait dit en riant : on a frappé aux doubles portes à cet horaire-là. Ça n’avait pas imprimé, sur le moment. Bien plus tard, à force de les cuisiner, j’ai su que c’était presque chaque matin. Elles avaient glissé le mot à la femme de chambre, une fille noire, qui les avait regardées avec des yeux ronds, « bête », disait Marie. Elles ont tenté des explications : balais mal tenus à l’aube ; un appel tôt pour un client—un officier de marine, mettons—qu’il fallait sortir du lit. Abandonné. Elles ont opté pour l’idée d’un dévot allant à l’office le plus matinal—anglican comme catholique, ici, c’est cinq heures, elles savaient, elles s’étaient levées pour voir. Elles savaient aussi—parce que plusieurs fois elles ont ouvert—qu’il n’y avait personne derrière la porte. Elles ont donc parlé d’un phénomène d’oreille, une illusion. Je l’ai dit, elles étaient fascinées par St. Thomas, et rien, surtout pas une broutille nocturne, ne les a détournées des bizarreries locales, la langue étrange des Noirs, l’accueil prodigue, les meubles d’un autre âge, les réverbères, les petites échappées de rue, l’indigo impossible de la mer, et, je crois, surtout les histoires, les histoires qu’on entend ici à demi-mot. Parce qu’ici, cœur battant d’un vieux roman, les histoires pullulent. En septembre 1824, on a pendu le pirate Fawcett et ses deux lieutenants. Aujourd’hui encore de grandes portes d’acier protègent les commerces et la Dansk Vestindiske Nationalbank—autrefois c’était contre les flibustiers qu’on verrouillait ainsi. Plusieurs fois, le sang a coulé dans les rues ; ville de proue comme Panama, elle a subi le sac, même si on ne l’a jamais brûlée, elle, comme Frederiksted, à Santa Cruz, la voisine. Parmi ces récits, celui de Tancrède-le-Noir. Dahoméen, dit la tradition. Il aurait vécu là même, dans une de ces cages, sous ma maison. Étrangeté : réfugié d’Haïti, tout noir, africain pur sang. À St. Thomas, à l’époque de Dessalines, Toussaint, Christophe—Christophe, roi noir du Nord, son citadelle invraisemblable perchée derrière le Cap—des Blancs ont fui Haiti par grappes. Christophe, tyran mémorable, mais le seul peut-être à avoir fait des millions avec le « travail libre » de ses frères noirs. Tancrède avait, dit-on, courroucé Christophe : malheur absolu. Pourtant, contrairement à d’autres, il avait échappé au bourreau du roi, celui qui se vantait de trancher net sans tacher le col. Par un enchaînement d’astuces, planqué dans une cale qui empestait le rat, sur une goélette du XIXe, sous des peaux de chèvre ou des ballots de morue sèche, Tancrède s’est faufilé jusqu’au refuge danois de St. Thomas. Ici, il est tombé vite dans l’endettement sans issue—guerrier, fils d’un peuple guerrier, pas marchand. Il a fini propriété de Julius Mohrs, et c’est là que l’hôtel entre en scène : on a logé Tancrède, pour sûreté, dans une de ces cages sous ma maison. Il s’est échappé—âme trop raide pour courber l’échine—et a gagné St. Jan, l’île d’à côté. Là, on le retrouve « travailleur libre » dans les cannes d’Erasmus Espersen. Lors de l’Insurrection de 1833, il mène les siens contre les lois du gouverneur Gardelin. Puis, empoigné vivant—par des troupes françaises venues de la Martinique pour aider les Danois à casser la révolte, ou des Espagnols de Porto Rico—grave erreur de sa part—on le ramène enchaîné à St. Thomas, et on le tue, par la torture. La sentence tombe à la Haute Cour coloniale danoise, siégeant dans ses murs—l’hôtel—sous l’œil du juge de Gardelin. On lui a coupé les mains, l’une par jour. On lui a broyé les pieds—après « trois pincées avec un fer rouge »—, punition achevée à la barre de fer par Achilles Mendoza, bourreau, esclave noir. Le fer a cassé ses tibias comme des branches. « Pincé », mutilé, pour l’exemple : on l’avait pris les armes à la main, insurgé, et Gardelin, dont le nom reste maudit chez les Noirs, voulait marquer. À l’ultime souffle, Tancrède a maudit. Mendoza. Julius Mohrs. Le gouverneur Gardelin. On a jeté son corps fracassé dans la chaux vive, cour du fort, avec sa main gauche, restée cramponnée au barreau du chevalet—on n’a pas pu l’en détacher. Mendoza a cassé le bois, main accrochée, et tout a filé dans la fosse. L’autre main, coupée la veille, disparue ; personne n’a cherché. À l’époque, ce genre de « curiosité » trouvait vite un amateur dans la foule. Quatre mois plus tard, on retrouve Julius Mohrs étranglé dans son lit. La cravache n’a sorti aucun mot des domestiques. Personne n’a jamais su qui avait fait le coup. Mohrs, comme Gardelin, passait pour un maître dur. Achilles Mendoza est mort « d’une crise » en 1835, dehors, dans la cour de l’hôtel, à deux pas des portes des cages. Beaucoup ont vu sa chute, même de nuit—la lune caribéenne, à sa pleine, sur laquelle j’ai lu, moi, tant il y a de lumière. À Santa Cruz comme ici, les nuits de pleine lune ont longtemps permis d’économiser les réverbères ; on fait encore pareil. Certains Noirs, d’abord, ont déclaré que Mendoza s’était étranglé lui-même. Idée absurde née du geste : ses deux mains étaient déjà à sa gorge avant la chute, bave aux lèvres, haletant, et on les a retrouvées serrées, muscles noués, rien à faire, quand on a ramassé le corps et l’a roulé pour l’enterrement à la première heure. Évidemment, tous ceux qui se souvenaient de Tancrède-le-Noir—de sa parole, de sa magie autant que de lui—ont conclu qu’il avait achevé sa vengeance depuis l’au-delà. Peut-être Mohrs aussi… Les Danois ont balayé tout ça d’un rire poli. Ça n’a pas fait bouger d’un millimètre la croyance noire. Quashee n’était qu’à une génération de l’Afrique, où ce sont des choses ordinaires. Les pratiques, des gris-gris à la nécromancie, le Vaudou mortel au « dent d’un mort » pour la veine au jeu, tout ça est venu par Carthagène et d’autres routes, sinueuses, directes, depuis la Côte de l’Or, le Dahomey, l’Achanty, le golfe du Bénin—de Dakar au Congo—puis s’est assis ici, aux Antilles. Et Quashee, aujourd’hui chrétien de toute couleur, passé par lycée ou fac, plus nombreux que jamais, a dépassé en nombre ses anciens maîtres blancs. Les Blancs ne commandent plus. Ils vivent avec, sous la même lune, le même soleil, à l’ombre des tamariniers, dans l’éclat qui brûle l’œil des hibiscus, le magenta violent des bougainvillées. Gardelin a regagné le Danemark tout de suite après la Guerre des Esclaves de 1833, où, à lire les archives, il est mort au lit, plein d’années et d’honneurs. Mes cousines sont retournées sur le continent. Elles ont quitté l’île autour du 10 février. Stephen et moi, navrés, avons repris notre rythme, retour prévu mi-mai. Un matin, quelques semaines après, Reynolds, le patron, m’interpelle. — Vous avez entendu le boucan cette nuit, enfin ce matin tôt ? — Non, dis-je. Quoi ? Si ça s’est passé dehors, peut-être. Mais dedans, depuis ma maison, on n’entend rien. — C’était dedans, dit Reynolds, donc non. Les domestiques en parlent encore—pour eux, c’est la Jumbee de la 4 qui recommence. Au fait, vos cousines étaient dans cette chambre. Elles vous ont dit quelque chose ? — Oui, maintenant que vous le dites. Suzanne m’a parlé de coups frappés à leur porte, vers quatre heures. Plus d’une fois, je crois. Elles se sont dit que c’était un « appel » très matinal, qu’on se trompait de porte. Elles n’ont pas insisté. Qu’est-ce que c’est que cette « Jumbee de la 4 » ? Je ne la connaissais pas, celle-là. Une Jumbee, c’est un fantôme ouest-indien. Dans les îles françaises, on dit zombi. Mille variantes—je ne détaille pas—mais un trait : c’est toujours noir. Les Blancs ne « marchent » pas après la mort, paraît-il, quoique j’aie connu trois planteurs que l’on disait loups-garous. Chez les Noirs des Antilles, il y a tout, du porte-bonheur au nécromant, le Vaudou violent, la dent de mort pour la chance. Jumbee, c’est l’ombre en général. Qu’une chambre de l’hôtel ait la sienne ne m’étonne pas. Ma surprise, c’est de ne pas l’avoir appris plus tôt. Et désormais je repensais à Marie, à Suzanne. — Racontez, dis-je. Reynolds sourit. Homme instruit, il connaît ses îles. — Là, c’est du flou, dit-il. On dit qu’il y a « toujours eu une Jumbee » liée à cette chambre. Ce matin, on a eu un touriste, Ledwith, juste de passage—il venait de Porto Rico sur la Catherine, reparti ce matin sur la Dominica, « down the islands ». Il est rentré tard de soirée. Plus moyen de dormir : on frappait à sa porte. Il a crié, rien. Les coups ont continué, il s’est fâché. Il a saisi la cruche en terre sur la table de nuit, lancé, plein centre du loquet ; la cruche a éclaté. Puis, furieux, il a ouvert, personne. Il a décidé qu’on se moquait de lui. Absurd, l’homme ne connaissait personne. Il a tempêté dans la salle de bal, réveillé les Gilbertson et Mrs Peck—leurs chambres donnent là—, fini par me réveiller. Je l’ai calmé. Plus de coups ensuite. J’ai craint que ça vous ait dérangés, vous et Stephen. Content que non. On n’a pas ces bruits d’ordinaire. — Hm, fis-je. Eh bien ! Je pensais à Ledwith. Parti déjà. Intrigué désormais—cet incident, plus le souvenir flou de mes cousines. Je n’avais presque rien, mais assez pour me mettre la Jumbee de la 4 en tête. Plus rien pendant un temps. Puis, quand « ça » a repris, j’étais dans la 4 moi-même. Voilà comment. Une famille américaine, les Barnes, installés ici—lui, je crois, petit fonctionnaire aux travaux publics ou à l’agriculture—laissa tomber leur bail et décida d’entrer à l’hôtel au mois, pour la paix. Deux enfants, madame lasse des corvées. Mauvais personnel, ici c’est toujours lourd quand il est mauvais. Une des maisons de l’hôtel leur allait. L’autre, louée à l’année au directeur de l’instruction et sa famille, des Américains charmants. C’était le premier mai, et comme Stephen et moi devions embarquer le douze, je propose à Reynolds de céder notre maison aux Barnes et de nous loger quinze jours dans une double. Il nous donne la 4, sans doute la mieux, libre par chance. La première nuit, je rentre tard. J’étais allé avec le colonel des marines et sa femme accueillir un navire : Major Upton revenait d’un mois de congé. Deux jours plus tôt, un câble avait appris au colonel la mort soudaine de Mrs Upton, en Virginie. Nous ignorions si Upton l’avait appris à bord par fil sans fil—on pensait que non. Le navire annoncé à 1 h a accosté après 2 h. Upton avait reçu le message. Nous avons fait au mieux pour l’accueil. Je rentre vers 3 h 30. J’entre par la porte latérale, toujours ouverte, traverse la salle de bal sur la pointe, ouvre doucement la 4. La lune, en nappe, inonde la pièce par les jalousies entrouvertes. À travers la moustiquaire de son baldaquin, on devine Stephen, silhouette immobile. Je me déshabille sans bruit, pour ne pas le réveiller. Mes vêtements blancs dans le sac de lavage, les chaussures boisées, tout rangé—je suis maniaque—quand, à une minute des quatre heures, dans mon dos, sur la porte donnant sur la salle, un net, sec : toc-toc-toc. Impossible à confondre. J’étais à moins d’un mètre. Je ne mens pas : la peur, celle qui grimpe la colonne comme une eau froide, je l’ai sentie ; ces fourmillements aux racines des cheveux, comme si ça se dressait. Mais si je suis vieille fille sur mes affaires et trop scrupuleux dans mes récits, personne n’aura le droit de me traiter de lâche. Un pas, j’ouvre. Et—que Dieu m’en soit témoin—au moment même où ma main tourne le petit bouton de laiton, les derniers coups—car l’appel se répétait, comme l’avait dit Ledwith—tombent, à trois doigts de ma paume, de l’autre côté. La salle de bal est vide, blanche, immobile. Rien ne bouge. Tout est visible, la lune—pleine il y a deux nuits—déverse le jour sur la galerie aux neuf arches maures qui encadre la rade. Rien. Absolument rien à voir ni à entendre. Je jette un œil vers le mur où s’ouvre la 4. Quoi, là ? Le cœur saute, puis cogne. Une chose, une ombre plus dense que les autres, grand Noir épaissi dans la nuit, glisse contre le mur vers le passage—rideau—qui mène à l’entrée. À peine le temps de voir que déjà ça se dissout. Puis un bruit sourd, mat, du côté où j’avais cru l’apercevoir filer. Je scrute, le cœur tambour. Là, sur le sol, filant vite dans la même direction, démarche oblique, comme un crabe, mais sans un bruit, une chose de la taille d’une balle. Pieds nus, pyjama de soie fine, mais je pars—sans arme—derrière. J’ai pensé : la plus grosse tarentule que j’aie vue, ici ou ailleurs. Ce n’était pas un crabe : sa façon de courir y faisait penser, compacte, latérale, mais un crabe, sur ce plancher dur, on l’entendrait cliquer. Ici, rien. Velours. Qu’est-ce que j’en ferais si je l’attrapais ? Instinct, seulement. Je gagne sur elle. Elle se glisse sous le rideau, disparaît dans le couloir de palier. En passant le rideau, je vois bien : impossible à coincer. Trop de cachettes. Les grandes portes d’entrée sont closes en bas. La cage d’escalier, poix noire. Je rebrousse, referme doucement la 4, et me coule dans mon baldaquin. Bord la moustiquaire. Je dors aussitôt, ne me réveille qu’à 9 h 30. Stephen, parfait, a compris ; il s’est levé sans bruit, a fait monter mon petit-déjeuner. C’était samedi—pas de leçons. Journée prise à la machine ; j’étais lancé dans un texte qu’il me fallait boucler pour le courrier de New York via Porto Rico. Petite sieste en compensation. Décidé : lever pour l’office de 5 h dimanche—je hais cela en secret, mais ça me donnerait un vrai départ. On s’est couchés tôt, vers 9 h 30, Stephen de retour du cinéma à la base. Je devais être plus fatigué que je ne croyais. Un sommeil de pierre. Combat avec le réveil à 4 h 15. À l’heure à l’église, retour juste avant six. Aube à peine ouverte quand j’entre par le côté, monte l’escalier. Le long de la salle encore grise, la tarentule—ou quoi—revient, même démarche, longeant la plinthe, vers moi cette fois. Elle rentrait, pensais-je, de la cache où je l’avais chassée. J’avais à la main un bâton de marche, bois de wattle noir, souple, taillé à Estate Ham’s Bay, à Santa Cruz. Je presse le pas. L’aube blanchit, je vois ce qui n’allait pas : c’est une bête mutilée. Pas un crabe. Une araignée sur cinq ou six pattes, pas huit. D’où ce côté crabe. Elle arrive près de la 4. J’accélère—la porte est entrebâillée—je ne veux pas de cette horreur dans la chambre de Stephen. Je frappe, net, elle esquive et se glisse sous le grand conque qui cale la porte. Des conques, ici, servent à tout. Aux Bahamas, on mange la chair. Parfois, elles donnent des « perles ». On voit les coquilles partout—bordures d’allées, cimetières, rangées dans le ciment comme briques roses. Au Grand Hotel, chaque porte a son conque. Le nôtre, très vieux, peint brun foncé pour résister à l’air salin. J’approche avec prudence. La piqûre des tarentules d’ici n’est presque jamais mortelle, mais elle vous colle l’hôpital pour quelques jours, et celle-ci était la plus grosse que j’aie vue. Je glisse l’extrémité du bâton sous le bord, renverse. Plus d’araignée. Elle s’était glissée dedans. Un conque a de la place. Je me décide : je ne veux pas d’un tel pensionnaire. Je bourre vite l’ouverture triangulaire avec une bonne boule de papier—un supplément dominical de New York d’il y a une semaine, ramassé au milieu de la salle—, c’est risqué, la tarentule est batailleuse, mais ça tient. Puis je sors le coquillage sur la galerie dallée. Là, ça y voit. Je lève le conque et le brise d’un coup au sol. Ce que j’attendais : des éclats partout, du gros au poudreux. Je me tiens prêt, wattle levé, pour écraser la bête au saut. Surprise : rien ne sort. Je me penche. Parmi les gros morceaux, l’un a une forme qui me heurte, un dessin qui fait signe, tout rose sale comme la nacre. Je le retourne au bout du bâton. C’était une main de Noir. Paume vers le haut, rose d’abord—la paume, chez les plus noirs, est rose, comme la plante des pieds. Mais le dos, cet ongle, le poignet, c’était sans erreur. Une main tranchée, qui avait appartenu à un Noir sans mélange. Le nom s’est planté en moi : Tancrède. N’appelait-on pas « Tancrède-le-Noir »—plus noir que noir ? La vieille histoire, la noirceur de cette relique, et la conclusion s’est imposée, folle, inouïe : la main de Tancrède-le-Noir—ou du moins la main d’un Noir très noir—était là, sous mes yeux, au milieu des débris d’un conque. Je respire, me baisse, la prends. Sèche et dure comme du conque, étonnamment lourde. Je la tourne, l’examine. Personne encore debout, même la cuisine silencieuse. Je glisse la main dans la poche de ma veste de drill et rentre dans la 4. Je la pose sur la table au marbre du centre, la regarde. Stephen, je l’ai vu d’un coup, n’était plus là. Il avait filé à la douche. À peine le temps de la fixer qu’une idée, invraisemblable mais obstinée, s’incruste. Quelque chose à cinq ou six « pattes » avait couru sous le conque. Rien d’autre n’est sorti quand j’ai brisé. Ces faits-là, je les ai vus. Pas des on-dit. Pas une fable de Quashee. J’entends des pas feutrés, sandales. La main retourne à la poche quand Stephen entre, ruisselant. — Bonjour, cousin Gerald. Levé tôt, on dirait. J’ai entendu l’alarme, moi j’ai replongé. — Oui, dis-je. Beaucoup de travail. — Je t’aurais accompagné, reprend Stephen en s’habillant ; je file au service de six si je peux. Il s’habille vite, me lance un mot, et court—l’église anglaise est à deux pas. Je me lève, traverse la salle en biais, et entre dans le bureau de Reynolds, à l’ouest. J’ai une idée. Vérifier, ou enterrer. Je tire du bas d’une bibliothèque les trois gros registres, cuir fauve, de l’Hôtel du Commerce. Je veux—si la numérotation n’a pas changé—savoir qui occupait la 4 à l’époque du procès et de la malédiction. D’instinct, le point clé. Et je tombe des nues en voyant, brunie, frisottée, l’écriture faire surface. De 1832 à 1834 inclus, la chambre 4, Hôtel du Commerce, Raoul Patit, propriétaire, était occupée par un certain Hans de Groot. Le juge de la Haute Cour. Celui qui a condamné Tancrède à l’amputation, au « pincement », au chevalet. J’avais mon explication. Si c’était un roman, je raconterais que j’ai demandé la permission d’aller rendre la main à la fosse de chaux de Tancrède. Je déroulerais la recherche d’archives, la localisation de la fosse, la main qui s’échappe, me traque, la chance, le feu purificateur, etc. Mais ce n’est pas un roman—et je n’embellis pas. Ce que j’ai fait : filer à la cuisine. Lucinda, large, découpait le bacon. Deux aides noires pressaient les oranges. — Bonjour, Lucinda, le feu est parti ? — Mornin’, Massa Canevin, sah, feu bien chaud, sah. Vou’ voulez cuisiner quelque chose, sah ? Un rire des deux filles. Je souris. — Je veux seulement brûler quelque chose. Je m’avance, soulève un rond de fonte, et laisse tomber la chose—cette horreur momifiée—au cœur du lit de braises rouge cerise. Elle s’est tordue—comme si c’était vivant, protestant. Une odeur mince, cuir très ancien. En quelques minutes, la peau sèche, l’os calciné ne sont plus que braises informes. Je remets le rond, et, pour compenser la curiosité de Lucinda, je lui laisse un billet brun de cinq francs—c’est encore la monnaie de la banque danoise, et elle a cours ici. — Merci, sah, God bless you, Massa Canevin, sah, souffle Lucinda. Je sors, assez sûr que la Jumbee de la 4 ne réveillera plus personne à quatre heures—ni à aucune autre—, et que l’éternité a enfin repris Tancrède-le-Noir, homme tenace, qui, disait-on, tenait parole. C’est vrai, je l’ai dit d’entrée : Tancrède n’a pas maudit Hans de Groot, et Gardelin est rentré mourir au Danemark—hors de portée de ce qui est arrivé à Achilles Mendoza et Julius Mohrs. Peut-être que l’ombre tenace de Tancrède, limitée dans son pouvoir—canalisée par cette main coupée—ne pouvait agir que sur l’île où il était mort. Je n’en sais rien. Il y a des règles, presque, à ces affaires-là—des règles auxquelles Quashee croit comme à l’évangile. Mais depuis ce matin-là, moi, Gerald Canevin, qui prétends dire vrai, je n’ai plus jamais vu une grosse araignée sans un frisson dedans. Je crois savoir ce que c’est, la peur des araignées. Parce que j’ai vu cette chose courir dans la salle de bal comme une araignée mutilée—je l’ai vue filer sous le conque. Et elle n’est pas sortie comme elle y est entrée.|couper{180}

traductions
La Bête Noire
*Henry St. Clair Whitehead (5 mars 1882 – 23 novembre 1932) fut un écrivain américain de récits fantastiques et horrifiques, mais aussi un clerc épiscopal au parcours riche et atypique. Diplômé de Harvard en 1904 aux côtés de Franklin D. Roosevelt, il y fut un athlète reconnu avant de publier un journal politique à Port Chester, puis de diriger des initiatives sportives pour la AAU. Ordonné diacre en 1912, Whitehead embrassa une carrière religieuse qui le mena à devenir archidiacre des Îles Vierges de 1921 à 1929, notamment à Saint‑Croix. Ce séjour aux Antilles marqua son œuvre : il puisa dans les légendes, les croyances et les rituels vaudous de ces îles un matériau unique, imprégnant ses récits d’un exotisme envoûtant. Correspondant et ami d’H. P. Lovecraft, il contribua dès 1924 à Weird Tales, Strange Tales et autres pulps. Lovecraft lui-même évoqua ses nouvelles comme une « fiction étrange d’une puissance discrète et réaliste », saluant notamment The Passing of a God comme l’apogée de son génie. Après son retour aux États-Unis, Whitehead exerça à Dunedin (Floride), jusqu'à sa mort en 1932. Ses récits, collectés dans des volumes comme Jumbee and Other Uncanny Tales (1944) et West India Lights (1946), continuent d’être célébrés pour la finesse de leur atmosphère et la singularité de leur cadre caribéen.* — - ## La Bête Noire (traduction littérale) En diagonale, de l’autre côté du marché du dimanche de Christiansted, sur l’île de Santa Cruz, en face de la maison connue sous le nom d’Old Moore’s, où j’ai séjourné une saison — c’est-à-dire, le long du côté sud de l’antique place du marché de la vieille ville, bâtie sur l’emplacement abandonné de l’ancienne ville française de Bassin — se dresse, dans une austère grandeur fanée, une autre et bien plus vaste demeure ancienne connue sous le nom de « Gannett’s ». Pendant près d’un demi-siècle, la Gannett House est restée vide et inoccupée, sa solide façade de maçonnerie donnant sur la place du marché affichant un aspect morne et distant, avec ses rangées de fenêtres hermétiquement closes, ses pierres assombries et décolorées, et l’ensemble de son allure, sévère et rebutante. Durant ces cinquante années environ où elle était restée close, lançant un regard sombre et vide à la foule humaine qui passait devant sa masse imposante et ses portes closes et rébarbatives, divers individus avaient tenté, à maintes reprises, de la faire rouvrir. Une telle demeure — l’une des plus vastes résidences privées des Antilles, et aussi l’une des plus belles — ainsi fermée et inutilisée, simplement parce que telle était la volonté de son propriétaire absent, homme arbitraire et plutôt mystérieux, que l’île n’avait pas revu depuis la durée de vie d’un homme mûr, ne pouvait manquer de susciter l’intérêt de locataires potentiels. Je sais, parce qu’il me l’a raconté, que le Révérend Père Richardson, de l’Église anglicane, tenta de l’obtenir en 1926 pour y installer un couvent pour ses religieuses. Pour ma part, j’essayai d’en louer une partie pour la saison ; l’année où, faute d’y parvenir, je pris à la place Old Moore’s — maison aux ombres étranges, aux vastes pièces, aux portes immenses et hautes par lesquelles, d’innombrables fois, Old Moore lui-même, portant — si les rumeurs étaient vraies — un étrange fardeau d’appréhension mentale, avait glissé autrefois, dans un frisson d’anticipation terrible… Une enquête auprès des bureaux du Gouvernement révéla que le vieux Maître Malling, survivant du régime danois, vivant à Christiansted et d’une aide précieuse pour nos fonctionnaires lorsqu’il s’agissait de démêler de vieux documents danois, avait la charge de Gannett’s. Herr Malling, que j’allai voir à son tour, se montra courtois mais ferme : la maison ne pouvait être louée en aucune circonstance ; telles étaient ses instructions — des instructions permanentes, consignées dans ses dossiers. Non, c’était impossible, hors de question. Je me rappelai alors quelques vagues allusions que j’avais reçues à propos d’un vieux scandale. Et puis, soudain, l’occasion se présenta, totalement inattendue. Au début de l’année suivante, on m’informa que la maison avait été rouverte et qu’une dame, Mrs Garde, l’avait occupée, seule avec quelques domestiques. On me dit aussi qu’elle recevait volontiers, et que je pourrais, si je le souhaitais, la rencontrer. Je me rendis donc chez elle. Ce fut par un après-midi brûlant de la saison sèche. Les volets de la façade donnant sur la place étaient grands ouverts, laissant entrer des vagues de lumière dans les pièces immenses. Mrs Garde m’accueillit sur la large véranda, vêtue d’une robe légère aux tons pâles, le visage à la fois cordial et réservé. Elle me parla de son installation, des réparations qu’elle avait dû faire pour rendre la maison habitable, et, presque tout de suite, aborda ce que je n’osais espérer : la raison pour laquelle Gannett House était restée close si longtemps. Elle ne prétendait pas tout savoir, mais disait qu’il y avait « quelque chose » dans la maison. À ce stade, elle me proposa de revenir un soir, en compagnie de mon ami Haydon, pour en parler plus à loisir. Nous revînmes donc, Haydon et moi, deux jours plus tard, vers le milieu de l’après-midi. La chaleur semblait moins lourde que lors de ma première visite, et la véranda, baignée d’ombre, offrait un semblant de fraîcheur. Après quelques minutes de conversation sur des sujets banals, Mrs Garde prit un ton plus grave et commença son récit. — La première fois, dit-elle, c’était il y a plus de quinze ans. Mon mari vivait encore. C’était une nuit chaude, au cœur de la saison des pluies. La maison dormait, et j’étais assise là, justement, à cette place. La lune éclairait la cour, et je pensais à mille choses, quand j’ai senti… oui, senti d’abord, puis entendu… un souffle lourd, irrégulier. Elle hésita, comme si elle revivait l’instant. — J’ai cru qu’un animal s’était introduit. Mais quand j’ai levé les yeux, je n’ai rien vu… rien que l’ombre de l’arbre. Pourtant, le souffle continuait. Puis des pas se sont fait entendre. Lents. Lourds. Comme si quelque chose tournait autour de moi. Elle marqua un silence. — Depuis cette nuit-là, cela revient… sans prévenir. Parfois des mois passent. Parfois plusieurs fois dans la même semaine. Toujours le même ordre : le souffle, les pas… puis l’impression qu’une présence se penche sur vous. Elle nous invita alors à la suivre jusqu’à une aile latérale de la maison. Là, dans une pièce presque nue, elle s’arrêta et désigna le sol : — C’est ici que cela commence souvent. À cet instant, je crus percevoir une légère vibration dans l’air, comme si une onde invisible venait de traverser la pièce. Je ne fis aucune remarque, mais Haydon, qui se tenait à ma gauche, eut un petit mouvement de tête, comme s’il confirmait avoir perçu la même chose. Ce que Mrs Garde nous avait raconté était déjà assez étrange en soi. Mais plus tard, lorsque nous eûmes l’occasion d’examiner certains vieux papiers laissés dans la maison par la famille Gannett, nous trouvâmes quelque chose de plus étrange encore. Il s’agissait d’un cahier relié en cuir, terni et craquelé par le temps, dont le fermoir de cuivre portait une oxydation verte. C’était le journal d’Angus Gannett, daté des années 1840. Une entrée, en particulier, attira notre attention : « La nuit dernière, alors que je traversais la cour, je fus pris d’un malaise soudain. L’air semblait vibrer autour de moi, et je perçus un souffle rauque, proche mais invisible. Puis vinrent des pas, lents, pesants, dont je ne pus discerner la provenance. La lune éclairait la cour, mais je n’y vis aucune créature. Les chiens, habituellement prompts à aboyer, restèrent muets, les oreilles basses. Je crois qu’ils savaient. » D’autres passages du journal décrivaient des incidents similaires, espacés parfois de plusieurs mois. Gannett mentionnait aussi les rumeurs persistantes parmi les esclaves : celles d’un « esprit animal » lié à une cérémonie vaudoue ayant mal tourné, bien avant que la propriété ne passe aux mains de sa famille. Mrs Garde referma le journal avec précaution. — Comme vous le voyez, dit-elle, ce n’est pas un phénomène récent. Et depuis tout ce temps, personne n’a jamais pu le voir clairement… mais tous ceux qui l’ont senti savent qu’il est là. Le soir même, nous restâmes à dîner chez Mrs Garde. La chaleur devint lourde, et un ciel noir comme de l’encre s’abattit sur la plantation. Vers minuit, un bruit soudain rompit le silence : un mugissement puissant, suivi d’un fracas métallique. — Le taureau ! s’exclama Mrs Garde. Nous courûmes jusqu’à l’enclos. Sous la lumière de la lune, le grand taureau noir de la plantation se cabrait, frappant de ses cornes les barrières de bois. Ses yeux roulaient de frayeur, et sa respiration haletante ressemblait à celle d’un animal traqué. Haydon tenta de l’approcher pour le calmer, mais l’animal reculait, évitant quelque chose que nous ne voyions pas. Puis, soudain, il chargea un coin sombre de l’enclos… vide. Le bois éclata, et le taureau s’échappa dans la cour avant de disparaître entre les manguiers. À cet instant, je sentis distinctement ce que Mrs Garde avait décrit : un souffle chaud, animal, mais dont la source restait invisible. Puis un bruit de pas lourds, comme en procession, contournant la maison. Nous suivîmes ces pas jusqu’au vieux jardin, à l’endroit où, selon les anciens, se trouvait jadis un cercle de pierres. C’est là que nous entendîmes, étouffés mais distincts, le battement d’un tambour, le cliquetis métallique d’instruments rituels, et une sorte de chant monotone. Mais il n’y avait personne. La lune éclairait des pierres moussues qui semblaient former un dessin oublié. L’air vibrait comme chauffé par une source invisible. Puis, sans transition, tout s’arrêta : plus de pas, plus de souffle, plus de sons. Les jours suivants furent calmes. Pas de souffle, pas de pas, pas d’agitation chez les animaux. Pourtant, l’impression d’une présence latente persistait. Une semaine plus tard, au matin, un domestique nous prévint qu’il avait trouvé quelque chose au pied des vieux manguiers, près du cercle de pierres. Nous découvrîmes le corps du taureau noir, étendu dans l’herbe humide. Aucune trace de lutte, aucune blessure. Ses yeux ouverts semblaient figés dans une vision d’horreur. Mrs Garde se signa lentement. — C’est terminé, dit-elle d’une voix basse. Pour cette fois. Le taureau fut enterré à l’ombre des manguiers. Ce soir-là, la maison sembla plus légère, comme débarrassée d’un poids invisible. Mais en me couchant, je pensai aux mots d’Angus Gannett dans son journal : « Ce n’est pas une bête ordinaire. C’est un souvenir. Et les souvenirs ne meurent pas vraiment. » Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné à la plantation Gannett. Mais parfois, dans mes rêves, il me semble entendre, quelque part dans l’obscurité, ce souffle rauque et ces pas lents qui contournent ma chambre. Et je me réveille, le cœur battant, à l’affût du silence.|couper{180}

traductions
Qu’était-ce ? Un mystère | 2
*Cet article présente une réécriture contemporaine de la nouvelle What Was It ? A Mystery (Qu’était-ce ? Un mystère) de Fitz-James O’Brien, publiée en 1859. L’objectif n’est pas de produire une traduction littérale, mais de moderniser le style et le rythme tout en conservant fidèlement les événements et l’atmosphère de l’original. Ce travail explore ce que devient un texte du XIXᵉ siècle lorsqu’il est transposé dans une prose plus directe et actuelle : phrases plus resserrées, vocabulaire simplifié, détails sensoriels mis en avant. Il s’agit à la fois d’un exercice de traduction et d’adaptation, destiné à rendre l’histoire plus accessible au lecteur contemporain, sans trahir sa substance.* ## Qu'était-ce ? Un mystère | 2 Je ne sais pas comment raconter ça sans passer pour un fou. Ce qui m’est arrivé est tellement improbable que je pourrais presque écrire ici : « Riez tout de suite, c’est permis ». Mais c’est arrivé. En juillet dernier. J’habitais au numéro… de la 26ᵉ Rue, à New York. Une grande maison un peu oubliée, qu’on disait hantée depuis deux ans. Avant, il y avait un jardin avec fontaine, arbres fruitiers, ombre fraîche. Maintenant ? Juste une pelouse pelée, des cordes à linge, et le bassin vide d’où l’eau ne coule plus. À l’intérieur : un vaste hall, un escalier en spirale, des pièces hautes de plafond. Construite vingt ans plus tôt par un riche marchand, ruiné dans un scandale bancaire. Parti en Europe, mort là-bas. À peine la nouvelle de sa mort arrivée, les bruits ont commencé : meubles déplacés, portes ouvertes toutes seules, pas dans l’escalier, frôlements de robes invisibles, mains qu’on sent sur la rampe. Les gardiens qu’on plaçait là partaient tous, effrayés. La maison restait vide. Ma logeuse, Mme Moffat, tenait alors pension rue Bleecker. Elle voulait déménager plus haut dans la ville. Elle nous a proposé la maison de la 26ᵉ : elle n’a rien caché des rumeurs. Deux pensionnaires ont pris peur et sont partis. Les autres, moi compris, avons dit oui. On a emménagé en mai. Le quartier est agréable : derrière les maisons, les jardins descendent presque jusqu’au fleuve. L’air vient droit de Weehawken, pur et vif. Même notre jardin un peu en friche avait son charme : le soir, on s’asseyait dehors pour fumer, regarder les lucioles. Bien sûr, on attendait les fantômes. Les conversations à table tournaient autour du surnaturel. Un pensionnaire avait acheté The Night Side of Nature de Mrs Crowe ; tout le monde voulait le lire. Moi, on me sollicitait aussi : j’avais écrit une histoire de fantôme pour Harper’s Monthly. Un mois passa. Rien. Pas le moindre signe. Sauf une fois où le majordome noir jura que sa bougie s’était éteinte toute seule — mais il était connu pour boire un peu trop. Puis, le 10 juillet. Après dîner, je suis allé au jardin avec mon ami Hammond, médecin. On fumait nos grosses pipes en écume, tabac turc. La conversation glissait vers des idées sombres. Hammond me demanda : — Quelle est la chose la plus terrifiante qu’on puisse imaginer ? Je n’ai pas su. Il cita des romans, des figures effrayantes… mais disait qu’il y avait pire. On se souhaita bonne nuit. Je suis monté me coucher. Comme d’habitude, j’ai pris un livre. Mauvaise idée : c’était Histoire des monstres de Goudon, un ouvrage bizarre acheté à Paris. Pas l’idéal quand on a l’esprit embrumé par des conversations sur le surnaturel. Je l’ai jeté de l’autre côté de la chambre, j’ai baissé le gaz jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un point bleu, et je me suis allongé dans le noir. Impossible de dormir. Les questions de Hammond tournaient dans ma tête. Et puis… Quelque chose est tombé du plafond. Directement sur ma poitrine. Deux mains, osseuses, ont serré ma gorge. Pas le temps de réfléchir. Mes bras ont agi avant ma tête. J’ai enserré la chose et l’ai écrasée contre moi. Les doigts autour de mon cou ont lâché prise, mais la lutte a commencé. Dans le noir complet, sans comprendre ce qui m’attaquait, je sentais ma prise glisser sur une peau nue et lisse. Des dents m’ont mordu à l’épaule, au cou. Des mains puissantes cherchaient à reprendre ma gorge. J’ai fini par le plaquer au sol. Un genou sur ce qui semblait être sa poitrine. J’ai repris mon souffle. La chose haletait. J’ai pensé à mon grand mouchoir de soie, toujours sous mon oreiller. J’ai fouillé, trouvé le tissu, et je lui ai entravé les bras du mieux possible. Il fallait voir à quoi j’avais affaire. Sans lâcher ma prise, j’ai reculé vers le gaz. J’ai tourné le robinet. La lumière a jailli. Rien. Rien à voir. Mais j’avais toujours dans les bras un corps chaud, solide, qui respirait, qui se débattait. Invisible. Mon cœur battait à tout rompre. Au lieu de lâcher, j’ai resserré ma prise. Hammond est entré, suivi des pensionnaires réveillés par mon cri. — Qu’est-ce qu’il y a, Harry ? — Je tiens quelque chose ! Ça m’a attaqué… mais je ne le vois pas ! La plupart se sont mis à rire. Ça m’a rendu fou de rage. Hammond a approché, a posé la main sur l’endroit que je désignais. Il a reculé en criant. Il l’avait senti. Il a trouvé une corde et a ligoté l’être invisible. Je me suis laissé tomber sur le lit, vidé de forces. Les autres reculaient, pétrifiés. Personne ne voulait toucher. Pour prouver que ce n’était pas un délire, Hammond et moi avons soulevé la chose et l’avons déposée sur le lit. Le matelas s’est affaissé sous son poids. Un corps. Un vrai. Mais qu’aucun œil ne pouvait voir. On est restés seuls dans la chambre. La chose respirait, haletait, se débattait sous les draps. Hammond et moi, on s’est assis. On a fumé en silence, incapable de détourner les yeux. C’était irréel : un corps bien présent, mais impossible à voir. Au bout d’un moment, Hammond a parlé. — C’est affreux. — Tu m’étonnes. — Non… affreux, mais pas impossible à expliquer. Je l’ai fixé. Pas expliquer ? Comment ? — Harry, on touche un corps mais on ne le voit pas. L’air, on ne le voit pas non plus. Le verre, presque pas. Imagine une matière vivante qui laisserait passer toute la lumière… — Sauf que l’air et le verre ne respirent pas, Hammond. Là, il y a un cœur qui bat. Des poumons. Une volonté. — Et dans les “cercles spirites”, tu n’as jamais entendu parler de mains invisibles qui serrent les tiennes ? Je n’ai pas répondu. On s’est contentés de rester là, à écouter la respiration s’apaiser. À un moment, on a compris qu’il dormait. Le matin, tout le monde s’est amassé sur le palier, mais personne n’a voulu entrer. Ils se contentaient de regarder, crispés, les draps qui se soulevaient comme si quelqu’un se débattait dessous. Avec Hammond, on avait réfléchi toute la nuit : comment savoir à quoi il ressemblait ? En passant nos mains, on devinait un corps humain — un visage lisse, presque sans nez, des mains, des pieds. On a pensé à tracer son contour à la craie. Ridicule. Puis j’ai eu l’idée : un moulage en plâtre. Restait le problème : il bougerait, et tout serait raté. Hammond a trouvé la solution : le chloroforme. On a fait venir un médecin. Trois minutes après l’inhalation, la créature était inconsciente. On a retiré les liens, un sculpteur a recouvert son corps invisible d’argile. Quelques heures plus tard, on avait le moulage. Et là… on a vu. Petit, pas plus d’1m35, corps sec, muscles saillants, proportions étranges. Et le visage… un cauchemar figé dans le plâtre. Pas humain. Presque animal. Comme un ghoul. Le genre de visage qui te donne envie de reculer, même figé à jamais. Reste qu’on ne savait pas quoi en faire. Impossible de le garder dans la maison. Impensable de le relâcher. Débattre ne servait à rien : personne ne voulait assumer. Et il refusait tout ce qu’on lui donnait à manger. Les jours passaient. On entendait sa respiration ralentir, faiblir. Puis un matin, plus rien. Froid, immobile. Mort. On l’a enterré dans le jardin. Sans cérémonie. Juste Hammond, moi, et un trou dans la terre. Le moulage, je l’ai donné au médecin. Il le garde encore, paraît-il, dans son cabinet — figé là, comme un avertissement qu’on ne comprend pas.|couper{180}
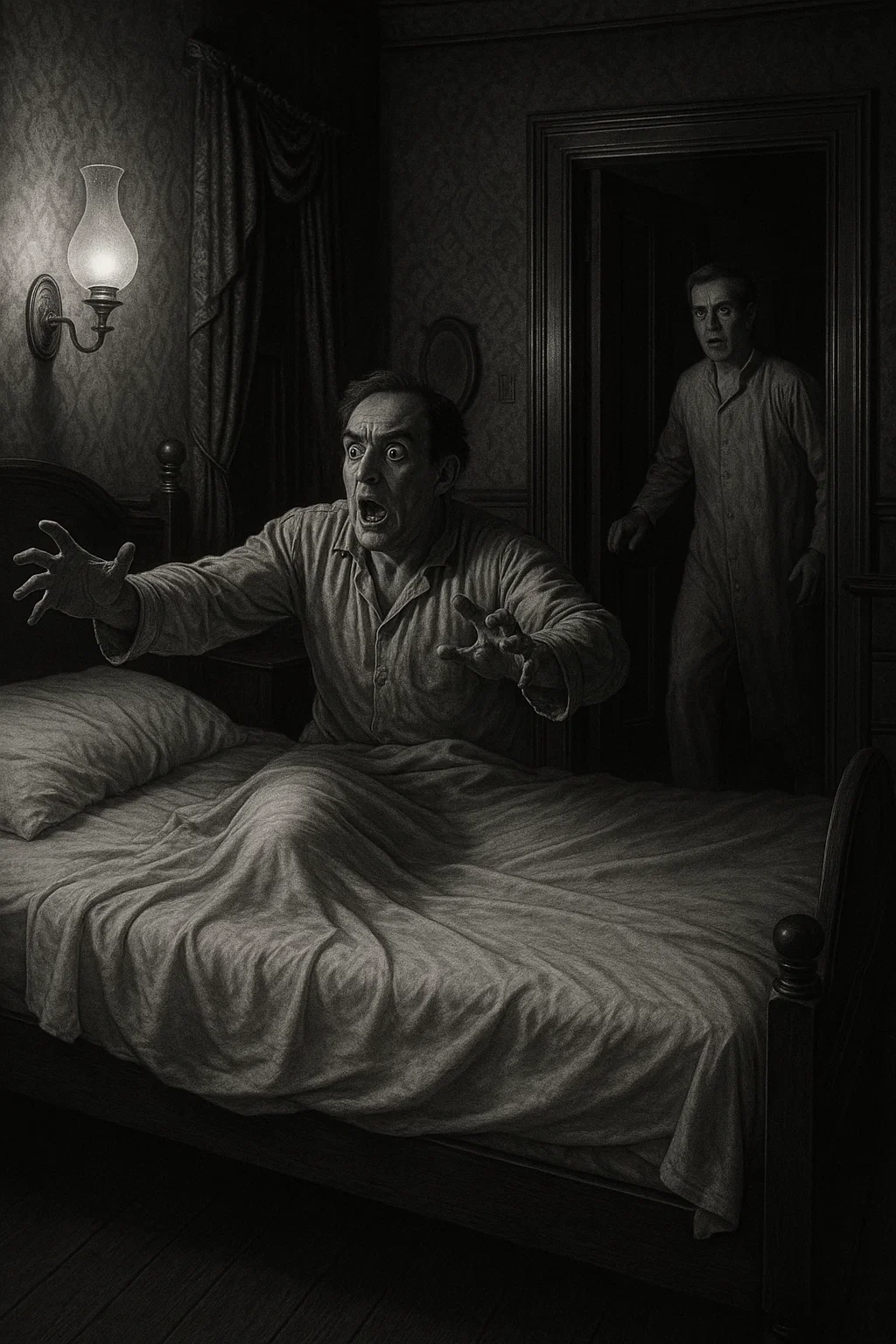
traductions
Qu’était-ce ? Un mystère
*Fitz-James O’Brien (1828-1862) reste l’un des écrivains les plus singuliers de la littérature fantastique américaine du XIXᵉ siècle. Né en Irlande, il émigre à New York dans les années 1850 et se fait remarquer par ses nouvelles mêlant imagination scientifique et atmosphère surnaturelle, publiées dans les revues littéraires de l’époque (Harper’s Monthly, Atlantic Monthly). Précurseur de la science-fiction et du fantastique modernes, il explore des thèmes comme l’invisibilité, les automates ou les expériences étranges, souvent avec une précision quasi scientifique. Mort jeune, à trente-quatre ans, des suites d’une blessure reçue pendant la guerre de Sécession, il laisse une œuvre brève mais influente. Sa nouvelle What Was It ? A Mystery (Qu’était-ce ? Un mystère), publiée en 1859, est considérée comme l’un des tout premiers récits mettant en scène une créature invisible — bien avant H.G. Wells.* Pour une version plus *contemporaine" c'est [ici](https://ledibbouk.net/qu-etait-ce-un-mystere-2.html) — - ## Qu’était-ce ? Un mystère J’avoue qu’avec une certaine appréhension, je me décide à relater l’histoire étrange qui suit. Les faits que je vais exposer sont si extraordinaires, si inédits, que je m’attends d’avance à susciter incrédulité et moqueries. J’accepte tout cela sans broncher. J’ose espérer avoir le courage littéraire d’affronter l’incrédulité. Après mûre réflexion, j’ai résolu de raconter, aussi simplement et directement que possible, quelques événements survenus sous mes yeux au mois de juillet dernier, et qui, dans les annales des mystères de la science physique, n’ont absolument aucun équivalent. J’habite au numéro ---- de la Vingt-Sixième Rue, dans cette ville. La maison, à bien des égards, est singulière. Depuis deux ans, elle traîne la réputation d’être hantée. C’est une grande et belle demeure, autrefois entourée d’un jardin, aujourd’hui réduit à un simple enclos herbeux servant à faire sécher du linge. La vasque asséchée d’une ancienne fontaine, et quelques arbres fruitiers effilochés, non taillés, témoignent qu’il fut jadis un agréable refuge ombragé, parfumé de fleurs et animé du doux murmure de l’eau. L’intérieur est spacieux : un vaste hall ouvre sur un grand escalier en spirale s’élevant en son centre, et les différentes pièces sont d’une ampleur imposante. Elle fut construite il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années par M. A----, un marchand new-yorkais bien connu, qui, il y a cinq ans, jeta le monde des affaires dans la stupeur par une fraude bancaire retentissante. M. A----, comme chacun le sait, s’enfuit en Europe, où il mourut peu après, le cœur brisé. Presque aussitôt la nouvelle de sa mort confirmée, le bruit courut dans la Vingt-Sixième Rue que le numéro ---- était hanté. Des procédures légales avaient dépossédé la veuve du propriétaire, et la maison n’était plus occupée que par un gardien et sa femme, placés là par l’agent immobilier qui en avait la charge pour la louer ou la vendre. Ces derniers affirmèrent être tourmentés par des bruits surnaturels. Des portes s’ouvraient sans qu’on puisse en voir l’auteur. Le maigre mobilier resté épars dans les pièces se retrouvait, au matin, empilé les uns sur les autres par des mains invisibles. On entendait, même en plein jour, des pas descendre et monter l’escalier, accompagnés du froissement de robes de soie inexistantes et du glissement de doigts impalpables le long de la rampe. Le couple assura qu’il ne resterait pas une semaine de plus. L’agent immobilier se moqua d’eux, les congédia et plaça d’autres locataires à leur place. Les phénomènes se répétèrent. Le quartier reprit l’histoire à son compte, et la maison resta inoccupée trois ans durant. Plusieurs personnes se montrèrent intéressées pour l’acquérir ; mais toujours, avant que la transaction ne soit conclue, elles entendaient ces rumeurs inquiétantes et se retiraient. C’est dans cet état de choses que ma logeuse — qui tenait alors une pension dans Bleecker Street et souhaitait s’installer plus au nord — eut l’idée audacieuse de louer le numéro ---- de la Vingt-Sixième Rue. Elle avait sous son toit une clientèle plutôt hardie et philosophique, et nous exposa franchement tout ce qu’elle avait entendu sur le caractère “hanté” de la maison où elle voulait nous emmener. À l’exception de deux pensionnaires timorés — un capitaine de marine et un Californien fraîchement revenu — qui annoncèrent aussitôt leur départ, tous les hôtes de Mme Moffat déclarèrent qu’ils l’accompagneraient dans cette incursion chevaleresque au royaume des esprits. Notre déménagement eut lieu au mois de mai, et nous fûmes tous enchantés de notre nouvelle demeure. La portion de la Vingt-Sixième Rue où elle se trouve — entre la Septième et la Huitième Avenue — est l’un des quartiers les plus agréables de New York. Les jardins à l’arrière des maisons, qui descendent presque jusqu’à l’Hudson, forment, l’été, une véritable allée de verdure. L’air y est pur et vivifiant, venant droit des hauteurs de Weehawken. Même le jardin mal entretenu qui bordait notre maison sur deux côtés, bien qu’un peu encombré de cordes à linge les jours de lessive, nous offrait un carré d’herbe à contempler et un coin frais, le soir, où nous fumions nos cigares dans le crépuscule, en regardant les lucioles allumer et éteindre leurs lanternes dans l’herbe haute. À peine installés au numéro ---- que nous guettions déjà les fantômes. Nous attendions leur apparition avec une impatience presque enfantine. À table, les conversations tournaient invariablement au surnaturel. L’un des pensionnaires, qui avait eu l’imprudence d’acheter La face cachée de la nature de Mrs. Crowe pour sa lecture personnelle, devint l’ennemi public : on lui reprochait de ne pas en avoir acheté vingt exemplaires. Sa vie fut un enfer : s’il posait le livre un instant et quittait la pièce, il se retrouvait aussitôt subtilisé et lu à voix basse, en comité restreint, dans un coin. Pour ma part, je devins rapidement un personnage important, car il avait filtré que j’étais assez versé dans l’histoire du surnaturel et que j’avais autrefois publié, dans Harper’s Monthly, une nouvelle intitulée Le Pot de tulipes, dont le point de départ était un fantôme. Si une table craquait ou si un panneau de lambris se déformait alors que nous étions réunis dans le grand salon, le silence se faisait aussitôt, et chacun se préparait à entendre le cliquetis des chaînes ou à voir surgir une silhouette spectrale. Après un mois de cette excitation psychologique, il fallut bien reconnaître, non sans dépit, que rien, absolument rien, d’approchant le surnaturel ne s’était manifesté. Seul le majordome noir assura qu’une bougie s’était éteinte toute seule pendant qu’il se déshabillait pour la nuit. Mais comme il m’était déjà arrivé de le surprendre dans un état où une bougie lui apparaissait en double, je supposai que, s’il avait poussé ses libations un peu plus loin, il avait pu inverser le phénomène et ne plus en voir du tout là où il y en avait une. Les choses en étaient là lorsqu’un événement survint, si terrible et inexplicable que ma raison vacille encore au souvenir de cette nuit. C’était le 10 juillet. Après le dîner, je me rendis avec mon ami, le docteur Hammond, dans le jardin pour fumer notre pipe du soir. Nous étions d’humeur étrangement philosophique. Allumant nos larges fourneaux d'écume de mer , bourrées d’un fin tabac turc, nous nous mîmes à marcher de long en large en discutant. Une étrange force semblait détourner notre conversation de toute légèreté. Impossible de rester sur les sujets lumineux où nous voulions l’amener. Inévitablement, nos pensées glissaient vers des rives sombres et désertes, où flottait une pénombre oppressante. Nous avions beau évoquer, comme à notre habitude, les bazars éclatants de l’Orient, la splendeur du règne de Haroun, les harems et les palais dorés, des ifrits noirs, tels celui que le pêcheur libéra de sa jarre de cuivre, se dressaient sans cesse dans nos propos, grandissaient jusqu’à occulter toute clarté. Peu à peu, nous cédâmes à cette influence obscure et nous nous laissâmes aller à des spéculations lugubres. Nous parlâmes de la tendance humaine au mysticisme et de l’attrait presque universel pour le Terrible, quand Hammond me demanda soudain : — Selon toi, quel est l’élément le plus effrayant qui soit ? La question me prit au dépourvu. Certes, beaucoup de choses sont effrayantes : trébucher sur un cadavre dans le noir ; voir, comme il m’est arrivé, une femme emportée par un fleuve rapide, les bras tendus, le visage déformé d’horreur, criant jusqu’à se briser la voix, pendant que, figés derrière la vitre d’une fenêtre surplombant de vingt mètres la rivière, nous la regardions sombrer sans pouvoir lever le moindre geste… Ou encore croiser, en mer, l’épave d’un navire sans âme qui vive, flottant comme au hasard : l’ampleur du drame qu’elle suggère, voilée par l’absence de témoins, glace le sang. Mais je compris pour la première fois qu’il devait exister une incarnation suprême de la peur, un “roi des terreurs” auquel toutes les autres se soumettent. Quel pouvait-il être ? De quelles circonstances naîtrait-il ? — Je n’y ai jamais réfléchi, répondis-je. Qu’il existe une chose plus terrifiante que toutes les autres, je le crois. Mais impossible d’en donner ne serait-ce qu’une esquisse. — Je suis un peu comme toi, Harry, dit Hammond. Je sens que je pourrais éprouver une frayeur encore jamais conçue par l’esprit humain… quelque chose qui mêlerait, dans une union monstrueuse, des éléments qu’on croyait incompatibles. Les voix dans Wieland de Charles Brockden Brown sont terribles ; l’apparition du “Gardien du Seuil” dans Zanoni de Bulwer-Lytton l’est tout autant… mais il y a pire encore. — Écoute, Hammond, épargnons-nous ce genre de propos, veux-tu ? — Je ne sais pas ce que j’ai ce soir, répondit-il, mais mon esprit ne cesse d’aller vers des visions étranges et effrayantes. Je crois que je pourrais écrire une histoire à la manière de Hoffmann, si seulement je maîtrisais assez bien le style. — Dans ce cas, repris-je, je te souhaite bonne nuit. Il fait une chaleur étouffante. — Bonne nuit, Harry. Que tes rêves soient agréables. — À toi aussi, sinistre compagnon… afrits, goules et enchanteurs compris. Nous nous séparâmes et chacun gagna sa chambre. Je me déshabillai rapidement et me glissai dans mon lit, emportant, comme à mon habitude, un livre que je lisais jusqu’à sombrer dans le sommeil. À peine avais-je posé la tête sur l’oreiller que j’ouvris l’ouvrage… pour le lancer aussitôt à l’autre bout de la chambre. C’était l’Histoire des monstres de Goudon, un curieux volume français que j’avais récemment rapporté de Paris. Dans l’état d’esprit où je me trouvais, c’était tout sauf une lecture apaisante. Je résolus donc de dormir immédiatement. J’abaissai le bec de gaz jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un minuscule point bleu à son sommet, et je me mis en quête du repos. La chambre était dans une obscurité totale ; cette lueur résiduelle n’éclairait pas à plus de trois centimètres autour du brûleur. Je passai mon bras sur mes yeux, comme pour me protéger même de cette ténèbre, et tentai de ne penser à rien. En vain. Les thèmes qu’Hammond et moi avions effleurés au jardin revenaient sans cesse. J’essayai de dresser des murailles mentales pour les écarter, mais ils se faufilaient malgré tout. Je restai immobile comme un cadavre, pensant que l’inaction physique hâterait le repos de l’esprit… C’est alors qu’un incident effroyable survint. Quelque chose tomba, apparemment du plafond, droit sur ma poitrine. L’instant d’après, deux mains osseuses m’encerclèrent la gorge et serrèrent pour m’étrangler. Je ne suis pas un lâche et je possède une certaine force physique. L’attaque, loin de me paralyser, me mit les nerfs en tension maximale. Mon corps réagit avant que mon esprit n’ait le temps de mesurer l’horreur de la situation : j’enroulai mes bras autour de la créature et la pressai contre ma poitrine de toutes mes forces. En quelques secondes, les mains lâchèrent ma gorge et je pus à nouveau respirer. Alors commença une lutte d’une intensité inouïe. Plongé dans une obscurité absolue, ignorant tout de la nature de mon assaillant, je sentais ma prise glisser sans cesse, comme si sa peau était nue et lisse. Je reçus des morsures aiguës à l’épaule, au cou et à la poitrine. Il me fallut protéger ma gorge contre ces mains agiles et puissantes que je n’arrivais pas à immobiliser. La combinaison de ces facteurs exigeait toute ma force, toute ma ruse, toute mon endurance. À force d’efforts presque surhumains, je parvins enfin à le renverser. Genou sur ce qui semblait être sa poitrine, je sus que j’avais l’avantage. Je repris mon souffle. Je l’entendais haleter dans le noir, sentais les battements précipités de son cœur. Épuisé, il l’était autant que moi — un maigre réconfort. Je me rappelai alors que je gardais toujours sous mon oreiller un grand mouchoir de soie jaune pour la nuit. Je le trouvai à tâtons et parvins, tant bien que mal, à lui entraver les bras. Je me sentais enfin relativement en sécurité. Restait à allumer le gaz pour voir la créature et alerter la maison. Sans lâcher prise, je le tirai hors du lit et, pas à pas, atteignis le bec de gaz. D’une main, j’ouvris brusquement le robinet. Une lumière vive emplit la pièce. Je me retournai vers mon prisonnier… Et je ne vis rien. Impossible de décrire mes sensations à cet instant. Je crois que j’ai dû pousser un cri, car moins d’une minute plus tard, ma chambre était pleine de monde. Je frémis encore en pensant à ce moment : j’avais un bras enserrant fermement une forme tangible, respirante, haletante ; ma main droite serrait une gorge chaude, apparemment de chair et de sang… et pourtant, sous cette lumière éclatante, je ne voyais rien. Pas même un contour. Pas l’ombre d’une vapeur. Je ne peux toujours pas, même aujourd’hui, reconstituer mentalement la situation. L’imagination s’y brise. La chose respirait ; je sentais son souffle chaud sur ma joue. Elle se débattait avec force. Ses mains me saisissaient. Sa peau était lisse comme la mienne. Elle pesait de tout son poids contre moi… et pourtant elle était invisible. Je m’étonne de ne pas avoir perdu connaissance ou la raison sur-le-champ. Au lieu de relâcher ma prise, une force étrange sembla m’envahir, et je serrai encore plus fort, jusqu’à sentir la créature frissonner de douleur. À ce moment, Hammond entra, suivi de quelques pensionnaires. En me voyant, il se précipita : — Par le ciel, Harry ! Qu’est-ce qui se passe ? — Hammond ! Accours ! C’est… c’est affreux ! J’ai été attaqué dans mon lit par… quelque chose… je le tiens… mais je ne peux pas le voir ! Les autres, massés derrière lui, laissèrent échapper des rires nerveux. Cette moquerie me rendit fou de rage. Qu’on se moque d’un homme dans ma situation ! Un instant, j’aurais voulu les voir frappés de la même terreur. — Hammond, pour l’amour de Dieu, aide-moi ! Je ne pourrai pas le retenir longtemps… Il m’épuise ! Il s’approcha, d’abord sceptique. Mais lorsqu’il posa la main à l’endroit que je lui indiquais, il poussa un cri d’horreur. Il l’avait senti. En un instant, il trouva une corde dans la chambre et, sans lâcher prise, commença à ligoter le corps invisible. — C’est bon, Harry. Laisse-le, maintenant. Il ne peut plus bouger. Brisé de fatigue, je relâchai enfin mon étreinte. Hammond tenait les extrémités de la corde, enroulées autour de ses mains. Devant lui, les nœuds et les boucles dessinaient un vide, comme si elles emprisonnaient un fantôme. Les spectateurs, malgré la peur qui se lisait sur leur visage, n’osèrent pas s’approcher. Certains s’enfuirent. Les autres restèrent agglutinés près de la porte, incapables de se décider à avancer. Ils doutaient, mais n’osaient vérifier par eux-mêmes. Alors Hammond et moi, surmontant notre répugnance, soulevâmes ensemble la créature et la déposâmes sur mon lit. Elle pesait à peu près comme un adolescent de quatorze ans. — Regardez bien, dis-je. Vous allez voir que c’est un corps solide, quoique invisible. Observez le matelas. À un signal, nous lâchâmes prise. On entendit le bruit mat d’un corps tombant sur le lit, les ressorts gémirent, et un creux net se forma sur l’oreiller et la couverture. Un cri collectif retentit… et ils s’enfuirent tous, nous laissant seuls avec le mystère. Nous restâmes un moment silencieux, écoutant la respiration irrégulière de la créature sur le lit et observant les draps qui frémissaient sous ses efforts pour se libérer. Puis Hammond parla : — Harry… c’est effroyable. — Oui… effroyable. — Mais pas inexplicable. — Pas inexplicable ? Comment peux-tu dire ça ? Jamais rien de tel n’est arrivé depuis que le monde existe. Je ne sais pas quoi penser. Par Dieu, pourvu que je ne sois pas fou, que tout ceci ne soit pas un délire ! — Raisonnons, Harry. Voilà un corps solide, que nous touchons, mais que nous ne voyons pas. C’est si inhabituel que cela nous terrifie. Mais n’existe-t-il pas des parallèles ? Prenons un morceau de verre pur : il est tangible et transparent. Théoriquement, on pourrait fabriquer un verre si homogène qu’il ne réfléchirait pas un seul rayon, comme l’air que nous sentons mais ne voyons pas. — D’accord, mais le verre ne respire pas, l’air non plus. Cette chose a un cœur qui bat, des poumons qui fonctionnent, une volonté. — Tu oublies les phénomènes dont on parle aux séances de spiritisme : ces mains invisibles qu’on sent parfois, chaudes, palpables… et pourtant qu’on ne voit pas. — Tu penses donc que… — Je ne sais pas ce que c’est, répondit-il gravement. Mais, par les dieux, avec ton aide, je compte bien l’étudier à fond. Nous veillâmes toute la nuit, fumant pipe sur pipe, près de ce corps invisible qui finit par s’apaiser et, à en juger par sa respiration lente et régulière, s’endormit. Le lendemain, toute la maison était en émoi. Personne, à part nous, n’osait entrer dans la chambre. Les draps bougeaient tout seuls, preuve que l’être était réveillé et se débattait. Ce spectacle, ces signes indirects d’une lutte invisible, étaient d’une horreur difficile à décrire. Hammond et moi avions cherché, pendant la nuit, un moyen de découvrir son apparence. En le palpant, nous avions constaté que sa forme était humaine : une tête ronde, lisse, sans cheveux ; un nez à peine saillant ; des mains et des pieds semblables à ceux d’un adolescent. D’abord, nous songeâmes à tracer son contour sur une surface plane, comme un cordonnier dessine un pied. Mais cela ne donnerait qu’une silhouette inutile. Alors, une idée me vint : prendre un moulage en plâtre de Paris. On obtiendrait ainsi une reproduction exacte. Restait à résoudre un problème : il fallait qu’il tienne immobile. Nous décidâmes de l’endormir au chloroforme. Hammond fit venir le docteur X----, qui, après un moment de stupeur, procéda à l’anesthésie. En trois minutes, la créature était inconsciente. Nous retirâmes ses liens et, aidés d’un mouleur renommé, recouvrîmes son corps invisible d’argile humide pour former le moule. Quelques heures plus tard, nous tenions enfin sa reproduction : un être de petite taille, trapu, à la musculature impressionnante, mais au visage d’une laideur inimaginable. Une sorte de caricature humaine, qui rappelait vaguement l’idée qu’on se ferait d’un goule, apte à se nourrir de chair humaine. Une fois notre curiosité satisfaite, et après avoir lié tous les habitants de la maison au secret, restait à décider du sort de l’énigme. Il était impensable de la garder parmi nous, et tout aussi impensable de la relâcher dans le monde. Pour ma part, j’aurais voté sans hésiter pour sa destruction, mais qui accepterait d’en assumer la responsabilité ? Jour après jour, nous délibérâmes. Les pensionnaires finirent par partir un à un. Madame Moffat, désespérée, menaça Hammond et moi de poursuites si nous ne débarrassions pas sa maison de « l’Horreur ». Nous répondîmes : « Nous pouvons partir, si vous voulez, mais nous n’emmènerons pas cette chose. C’est chez vous qu’elle est apparue. C’est donc à vous d’agir. » Évidemment, elle n’avait pas de réponse. Et elle ne trouva personne — pas même contre rémunération — prêt à approcher la créature. Le plus étrange, c’est que nous ignorions totalement de quoi elle se nourrissait. Nous lui présentâmes toutes sortes d’aliments, en vain. Jour après jour, nous assistions au spectacle des draps qui se soulevaient, des respirations haletantes, et nous savions qu’elle dépérissait. Dix jours passèrent. Puis douze. Puis deux semaines. Elle vivait toujours, mais le battement de son cœur faiblissait, sa respiration se faisait rare. Elle mourait de faim. Cette agonie invisible me hantait. Aussi horrible qu’elle fût, il était insupportable de la voir — ou plutôt de ne pas la voir — souffrir ainsi. Un matin, elle était morte. Froide et raide, sans souffle, sans battement. Hammond et moi l’enterrâmes aussitôt dans le jardin. Ce fut un enterrement étrange : un corps invisible glissé dans un trou humide. Quant au moulage, je l’offris au docteur X----, qui le conserva dans son cabinet de curiosités, dixième rue. Aujourd’hui, à la veille d’un long voyage dont je pourrais ne pas revenir, j’ai consigné par écrit ce récit, le plus singulier de toute mon existence.|couper{180}
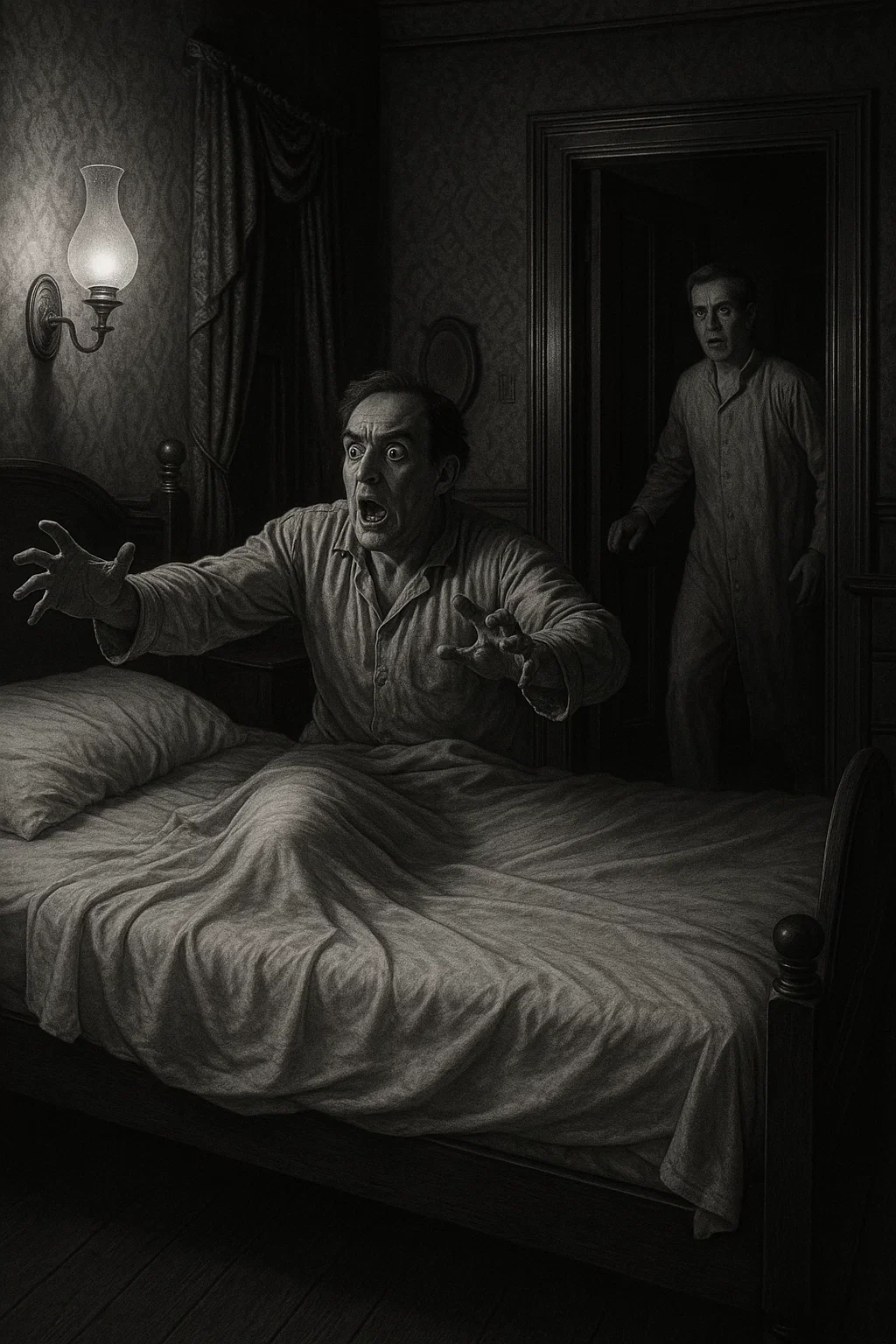
traductions
a cold greeting / un accueil glacial
Ambrose Bierce (1842 – disparu vers 1914) fut journaliste, nouvelliste et auteur du Dictionnaire du diable. Maître des nouvelles brèves et acérées, il aimait jouer avec l’ironie, le macabre et l’étrange. Lovecraft le cite dans Supernatural Horror in Literature comme l’une de ses influences directes. Dans cette micro-nouvelle, tout repose sur un retournement sec, presque clinique, qui laisse au lecteur la tâche de combler le vide. L’étrange surgit dans le banal, et disparaît aussi vite qu’il est apparu. Traduction littérale Un accueil glacial Ceci est une histoire racontée par feu Benson Foley de San Francisco : « À l’été 1881, je fis la connaissance d’un homme nommé James H. Conway, résident de Franklin, Tennessee. Il était en visite à San Francisco pour sa santé — pauvre homme abusé — et m’apporta une lettre de recommandation de la part de M. Lawrence Barting. J’avais connu Barting comme capitaine dans l’armée fédérale pendant la guerre de Sécession. À sa fin, il s’était installé à Franklin et, avec le temps, devint, j’avais des raisons de le penser, assez en vue comme avocat. Barting m’avait toujours semblé un homme honorable et véridique, et l’amitié chaleureuse qu’il exprimait dans sa lettre pour M. Conway était, pour moi, une preuve suffisante que ce dernier était en tous points digne de ma confiance et de mon estime. Un jour, au dîner, Conway me raconta qu’il avait été solennellement convenu entre lui et Barting que celui qui mourrait le premier devait, si possible, communiquer avec l’autre depuis l’au-delà d’une manière incontestable — la façon précise, ils l’avaient laissée (sagement, me sembla-t-il) à la décision du défunt, selon les opportunités que ses circonstances modifiées pourraient présenter. Quelques semaines après la conversation au cours de laquelle M. Conway avait parlé de cet accord, je le rencontrai un jour descendant lentement Montgomery Street, apparemment, à en juger par son air absorbé, en profonde réflexion. Il me salua froidement, simplement d’un mouvement de tête, et passa son chemin, me laissant debout sur le trottoir, la main à demi tendue, surpris et, naturellement, quelque peu froissé. Le lendemain, je le rencontrai de nouveau dans le hall de l’hôtel Palace, et, le voyant sur le point de répéter la désagréable scène de la veille, je l’interceptai dans une entrée, avec une salutation amicale, et lui demandai franchement une explication sur son changement d’attitude. Il hésita un moment ; puis, me regardant franchement dans les yeux, dit : -- Je ne pense pas, M. Foley, que j’aie encore un droit à votre amitié, puisque M. Barting semble avoir retiré la sienne à mon égard — pour quelle raison, je proteste que je n’en sais rien. S’il ne vous en a pas déjà informé, il le fera probablement. -- Mais, répondis-je, je n’ai pas eu de nouvelles de M. Barting. -- Des nouvelles de lui ! répéta-t-il, avec une apparente surprise. Mais il est ici. Je l’ai rencontré hier, dix minutes avant de vous croiser. Je vous ai salué exactement de la même manière qu’il m’a salué. Je l’ai revu encore il y a moins d’un quart d’heure, et son attitude fut précisément la même : il s’est contenté d’incliner la tête et de passer son chemin. Je n’oublierai pas de sitôt votre civilité envers moi. Bonjour, ou — comme il vous plaira — adieu. Tout cela me sembla d’une considération et d’une délicatesse singulières de la part de M. Conway. Comme les situations dramatiques et les effets littéraires sont étrangers à mon propos, je vais expliquer tout de suite que M. Barting était mort. Il était décédé à Nashville quatre jours avant cette conversation. Allant voir M. Conway, je l’informai de la mort de notre ami, lui montrant les lettres qui l’annonçaient. Il en fut visiblement ému, d’une façon qui m’empêcha de douter de sa sincérité. -- Cela semble incroyable, dit-il après un moment de réflexion. Je suppose que j’ai dû confondre un autre homme avec Barting, et que le salut froid de cet homme n’était qu’une politesse de la part d’un inconnu en réponse à la mienne. Je me souviens, en effet, qu’il n’avait pas la moustache de Barting. » Un accueil glacial — version modernisée C’est une histoire que m’a racontée Benson Foley, de San Francisco. « En 1881, j’ai rencontré un certain James H. Conway, originaire de Franklin, Tennessee. Il était à San Francisco pour raisons de santé — pauvre naïf — et portait une lettre d’introduction de Lawrence Barting. J’avais connu Barting comme capitaine dans l’armée fédérale pendant la guerre de Sécession. Après le conflit, il s’était installé à Franklin et, avec le temps, était devenu, je crois, un avocat assez en vue. Barting m’avait toujours semblé un homme fiable et droit, et l’amitié qu’il exprimait dans sa lettre à l’égard de Conway suffisait à me convaincre que celui-ci méritait toute ma confiance. Un soir, à table, Conway m’a confié qu’il avait passé un pacte avec Barting : le premier qui mourrait essaierait, si possible, de communiquer avec l’autre depuis l’au-delà, de façon indiscutable. La forme exacte de ce message, ils l’avaient laissée au choix du défunt, en fonction des “opportunités” que sa nouvelle condition pourrait offrir. Quelques semaines plus tard, je croise Conway sur Montgomery Street. Il marchait lentement, l’air absorbé. Il m’a salué d’un signe de tête froid, puis a continué son chemin, me laissant la main à moitié tendue. J’étais surpris, et un peu vexé. Le lendemain, je le revois dans le hall du Palace Hotel. Il allait répéter la scène, mais je l’ai intercepté, l’ai salué et lui ai demandé franchement la raison de son changement d’attitude. Il m’a regardé droit dans les yeux : -- Je crois, monsieur Foley, que je n’ai plus droit à votre amitié, puisque M. Barting semble avoir retiré la sienne envers moi — je ne sais pas pourquoi. S’il ne vous l’a pas déjà dit, il le fera sûrement. -- Mais… je n’ai pas eu de nouvelles de Barting. -- Pas eu de nouvelles ? répéta-t-il, surpris. Mais il est ici ! Je l’ai vu hier, dix minutes avant de vous croiser. Je vous ai salué exactement comme il m’a salué. Et je l’ai revu il y a moins d’un quart d’heure : même attitude, il a juste incliné la tête et continué. Je n’oublierai pas votre politesse envers moi. Bonjour… ou adieu, comme vous voudrez. Tout cela me sembla d’une délicatesse singulière de la part de Conway. Je vais couper court : Barting était mort. Décédé à Nashville quatre jours avant cette conversation. J’en ai informé Conway, preuves à l’appui. Il en a été sincèrement ébranlé. -- C’est incroyable, a-t-il dit après réflexion. J’ai dû confondre quelqu’un d’autre avec Barting, et ce salut froid n’était qu’une politesse d’un inconnu. D’ailleurs, il n’avait pas sa moustache. »|couper{180}
