Archives
Archives rassemble ce qui précède le texte “fini” : graines d’histoires, synopsis rapides, dispositifs formels, motifs récurrents (fil rouge), essais de voix, débuts de scènes, notes d’intention. On y croise des thèmes et terrains d’exploration — New Weird, Lovecraft, steampunk, mondes souterrains, villes-labyrinthes, mémoire et voix intérieures — ainsi que des exercices de cadrage (inversions, contraintes, variations de rythme) qui testent la tenue d’un récit.
Cette section fonctionne comme un atelier ouvert : chaque entrée fixe une hypothèse (situation, ton, point de vue, règle du jeu), souvent brève, parfois reprise ailleurs en nouvelle, feuilleton ou roman. Le lecteur y voit se construire l’architecture invisible d’un texte : choix de focalisation, déplacements d’énonciation, objets-motifs, contraintes temporelles.
Axes d’écriture récurrents :
Graines → transformer une intuition en scène.
Dispositifs → une règle formelle pour faire émerger la voix.
Synopsis → étirer/réduire une histoire (pitch ↔ plan).
Fil rouge → motifs et obsessions qui relient les textes.
Terrains → villes, souterrains, frontières du réel.
Intertextes → dialogues avec auteurs et mythologies personnelles.
Pour lire de manière efficace : utiliser les mots-clés (p. ex. synopsis, dispositif, fil rouge) ou revenir à la rubrique Fictions pour les versions abouties.
Archives
embryons —à faire pousser dans l’encre
notes pour Le sabbath des calques Une surcouche AR (= augmented reality overlay, calque de réalité augmentée), c’est une couche d’informations numériques affichée par-dessus le monde réel via un écran (téléphone, lunettes, pare-brise). Elle ne remplace pas le réel : elle l’annote, le guide, le filtre. Concrètement, ça fait quoi ? Affichage : flèches de navigation sur la rue, étiquettes “Boulangerie — ouvert”, prix sur produits vus par la caméra, noms des plantes dans un parc. Action : bouton “ouvrir la porte”, “signaler un nid-de-poule”, “appeler un ascenseur”, “déverrouiller un trottinette” quand tu regardes l’objet. Filtrage : tu ne vois que certains commerces (ex : partenaires), ou seulement les bornes de recharge compatibles avec ton abonnement. Maintenance : un technicien voit les canalisations invisibles sous la chaussée, l’état d’un transformateur, la vanne à fermer. Comment ça marche (simple) La caméra/localisation capte où tu es et ce que tu vises. Un calque (la surcouche) associe à ce lieu/objet des données + droits (texte, icônes, commandes). Le système rend ces données alignées sur la scène réelle (position/orientation). Pourquoi c’est important dans “Le sabbat des calques” Dans l’histoire, chaque surcouche AR n’est pas qu’un visuel : elle porte des droits et des flux (livraison, entretien, accès, soins). Si on désactive les calques sans procédure de retour, certaines choses sortent du graphe (plus d’ID, plus de tournée) et “n’existent” plus pour la ville. D’où le nom résolutoire : un énoncé public qui ré-attache officiellement les lieux/objets/personnes au système. En bref : une surcouche AR, c’est un calque opératoire qui dit au monde numérique quoi est où et qui peut faire quoi avec. Quand tu coupes le calque, tu coupes souvent l’accès autant que l’affichage. ID 1 Dans une métropole gouvernée par des surcouches de réalité augmentée qui pilotent livraisons, soins, entretien et droits d’accès, un collectif obtient une heure hebdomadaire sans calques pour “souffler”. Effet pervers : ce qui n’est pas re-référencé à la reprise est considéré obsolète par les plateformes, dé-publié des index, puis “cesse d’exister” pour la ville (plus d’ambulance, plus de tournée, plus d’adresse résolue). Quand une petite clinique disparaît des systèmes, une cartographe d’infrastructures remonte la chaîne technique et découvre que visibilité = existence procédurale ; désactiver sans formule de retour équivaut à effacer. Elle invente un « nom résolutoire » : une nomenclature publique, prononcée sur site et horodatée, que les opérateurs doivent accepter pour ré-attacher lieux, objets et personnes au graphe urbain. Climax sur la place centrale : la ville lit ses propres noms pour se faire revenir, tandis que les éditeurs de calques tentent d’en limiter la portée. Enjeu : reprendre la responsabilité d’“éditer” le réel sans renoncer au repos collectif. ID 2 Le locataire non inscrit Dans un vieil immeuble où l’existence des habitants tient à un registre calligraphié du hall, le nom de Lise refuse de “prendre” : l’encre perle et s’efface. La nuit, un voisin invisible prononce son nom avec une exactitude troublante — chaque syllabe qu’il dit fixe sa propre chambre (odeurs, objets, chaleur), tandis que Lise disparaît des sonnettes, du courrier, du bail. En fouillant les archives notariales, Lise découvre le vrai nom du voisin, effacé après un décès douteux : pour se sauver, elle devra le prononcer en face dans l’appartement muré — geste résolutoire qui le libérera… ou la rayera définitivement du registre. Scène-pivot : minuit, palier glacé, Lise ouvre la porte condamnée, lit à voix claire le nom exact ; les lettres du hall se remettent à l’encre — mais pas toutes. Thèmes : nom comme emprise (parasitage d’identité) → nom résolutoire (révocation par adresse), droit d’exister par inscription, loyers fantômes, éthique de la restitution. 3 Le nom-miroir Dans une petite ville, un photographe ambulant promet de révéler aux clients leur “vrai nom” en développant leurs portraits au nitrate d’argent. Sur chaque cliché, un mot apparaît sur le col ou la peau, différent du prénom civil : “Déserteur”, “Fiancée”, “Veilleur”, “Fille de personne”… Celui qui adopte ce nom gagne un pouvoir discret (veille sans dormir, franchit une barrière, traverse le fleuve gelé) mais perd une chose intime en échange (un souvenir, une capacité). Une femme veuve découvre que le mot sur sa photo — “Soeur” — rétablit une sœur que sa famille a gommée. Pour arrêter l’hémorragie de pertes, il faudra renommer la ville entière lors d’une exposition nocturne où l’on retourne les photos et déclare publiquement le nom qu’on refuse de porter. -- Nom en jeu : habiliter (adopter le mot confère) ↔ emprise (le mot prélève) → résolutoire (publiciser le refus d’un nom). 4 La maison aux noms empruntés Une maison bourgeoise accueille des colocataires à bas prix… à condition de déposer, dans un coffret, un nom dont on ne se sert plus (surnom d’enfance, nom d’artiste, nom d’emprunt). Tant qu’on y habite, la maison protège (pas de cauchemars, pas de cambriolages). À la Toussaint, le coffret s’ouvre et la maison revêt ces noms : les pièces prennent des caractères (une cuisine “Maman”, un couloir “Caporal”, une chambre “Perdue”). Quand une nouvelle locataire dépose par erreur son vrai nom complet, la maison s’en pare et la dépossède : plus personne dehors ne la reconnaît. Pour la récupérer, les habitants doivent organiser une veillée de restitution où chacun ré-appelle un nom prêté à son vrai détenteur, jusqu’au dernier — le sien. -- Nom en jeu : emprise (la maison vit des noms prêtés) → résolutoire (rite de restitution, nom rendu au bon destinataire, à voix claire).|couper{180}

Archives
Comment écrire une histoire avec un peu de méthode
Protocole léger — pour ne pas s’égarer Pour le moment, seules la première et la sixième propositions de l’atelier d’écriture en cours me proposent des pistes que je pourrais relier à un travail personnel. Disons qu’elles « matchent » dans les circonstances actuelles, par l’expansion que je constate à vouloir les développer. Mais pour ne pas m’égarer, il me faut un fil d’Ariane : une méthode — même légère suffirait. D’où l’envie de rédiger un modeste protocole. 1. Partir d’un embryon (format fixe) Fiche minuscule à chaque graine — 6 lignes, pas plus. Signe (trace perçue) : sifflement / buée / vitre / odeur de térébenthine / feux rougeâtres. Geste du corps (déclencheur) : ralentir / bifurquer / s’asseoir / lever la main / détourner le regard. Seuil (lieu précis) : porte / vitre / entrée de dancing / butte / péage / atelier. Distance (échelle) : hors-champ / voix seule / silhouette / face-à-face muet. Objet-totem (détail récurrent) : terre de sienne / yak / Abbesses / Keaton / autoroute. Sortie (chute) : question / rire étouffé / non-réponse / retour marche. Garder la fiche en tête de texte (ou en commentaire). C’est l’« ADN » de la série. 2. Écrire en échelles (x3) À partir d’une même graine, produire trois tailles — on ne réécrit pas, on déplie. Nano (50–80 mots) : une image + une action. Court (150–220 mots) : ajouter un seuil et une résonance sensorielle. Plein (300–450 mots) : même scène, avec bascule (ex. : vitre → café → geste non rendu). Résultat : 3 versions compatibles, pas 3 textes concurrents. 3. Invariants / variables (cohérence douce) Choisir 4 invariants pour toute la série (ex. : il ne parle pas directement ; jamais de prénom ; un seuil par scène ; une seule sensation dominante par texte). Tout le reste = variables (lieux, météo, vitesse, foule/solitude). Chaque nouveau texte repiquera 2 éléments du dictionnaire (ex. : « vitre » + « sifflement ») et ajoutera 1 élément neuf.4. Matrice des axes (pour générer vite) Quand ça sèche, combiner 4 axes (au dé, ou au hasard). Lieu : rue / intérieur sombre / hauteur / périphérie / transit. Signe : son / lumière / odeur / chaleur-froid / objet déplacé. Distance : trace / voix / silhouette / présence derrière vitre. Sortie : question sans réponse / rire / coupure / marche. Tirer 1–1–1–1 → embryon prêt en 10 secondes. 5. Numérotation claire (versioning sans peine) Nom : 2025-10-22_Porte_A1.0.md (A = parcours canonique ; B = alternance ; C = enquête). Patch : A1.1 (même scène, échelle différente), A1.2 (chute modifiée), etc. En tête de fichier : une ligne Changelog (≤ 12 mots) : « + vitre embuée ; – ponctuation coupée ».6. Couture entre versions (le lien cohérent) Passe « couture » hebdo : on n’écrit pas, on ajoute des échos croisés. Le sifflement réapparaît au dancing (à la sortie des toilettes). La terre de sienne existe en reflet rouge sur un feu arrière. Les Abbesses laissent une buée qui reviendra sur la vitre du café. Relier par capillarité, pas par explication. 7. Arches de lecture (A/B/C…) Garder les 3 ordres (A/B/C). À chaque nouvel épisode (ex. : Autoroute), décider tout de suite : A = pont entre deux nœuds (entre Question et Voix). B = coda hors séquence (ne pas toucher à l’alternance dedans/dehors). C = indice supplémentaire (C4, C5, etc.). Chaque texte rejoint au moins une arche — parfois deux. 8. Rituel (30 minutes chrono) 10 min : écrire Nano à partir d’une graine. 10 min : passer en Court (ajouter seuil + sensation). 5 min : Couture (ajouter l’écho croisé vers un ancien texte). 5 min : Classer (A/B/C), nommer (…_A1.1), noter le changelog.9. « Bible » d’une page (pour ne pas dévier) Un seul document, vivant : Règles d’or : tes 4 invariants. Dico de détails : 10 totems max. Topologie : 5 lieux maîtres (porte, vitre, dancing, butte, autoroute/atelier). Timeline fantôme : ordre canonique + derniers ajouts (à cocher après chaque session).Annexe — Fiche-embryon (copier/coller) Signe : Geste du corps : Seuil : Distance : Objet-totem : Sortie :|couper{180}

Archives
drôle de nuit
-- Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais un cube empilé parmi d’autres cubes. Cette promiscuité était d’autant plus difficile à vivre que je ne pouvais faire aucun mouvement ni même protester : aucun son ne sortait de ma bouche. D’ailleurs je n’avais pas de bouche. Juste une face lisse, une face avant exactement semblable aux cinq autres. Pour m’en sortir, j’ai rêvé dans mon rêve que je devenais sphérique, puis j’arrivais à m’extraire de la pile, non sans mal ; j’ai fait une chute vertigineuse. Une chute dans le noir sans fin qui durait durait durait. Pour m’évader de ce rêve-ci, je me suis encore transformé en mouche parce que je ne pouvais pas vraiment faire autre chose. J’aurais préféré quelque chose de plus noble. Mais on fait avec ce qu’on peut. En fin de compte, au moment même où j’apercevais enfin la lumière, que j’allais m’élever dans les airs au-dessus de je ne sais quel paysage, voici que je me suis fait gober par un oiseau et je suis devenu oiseau par je ne sais quelle alchimie onirique. Mais l’oiseau est mécanique, il est un produit d’une gigantesque intelligence artificielle qui désormais gouverne toute la Terre. Ses rêves sont des rêves de cubes, et me revoici à mon point de départ. La question, au réveil : seules les mouches sont-elles vivantes, non altérées encore par l’intelligence artificielle ?|couper{180}
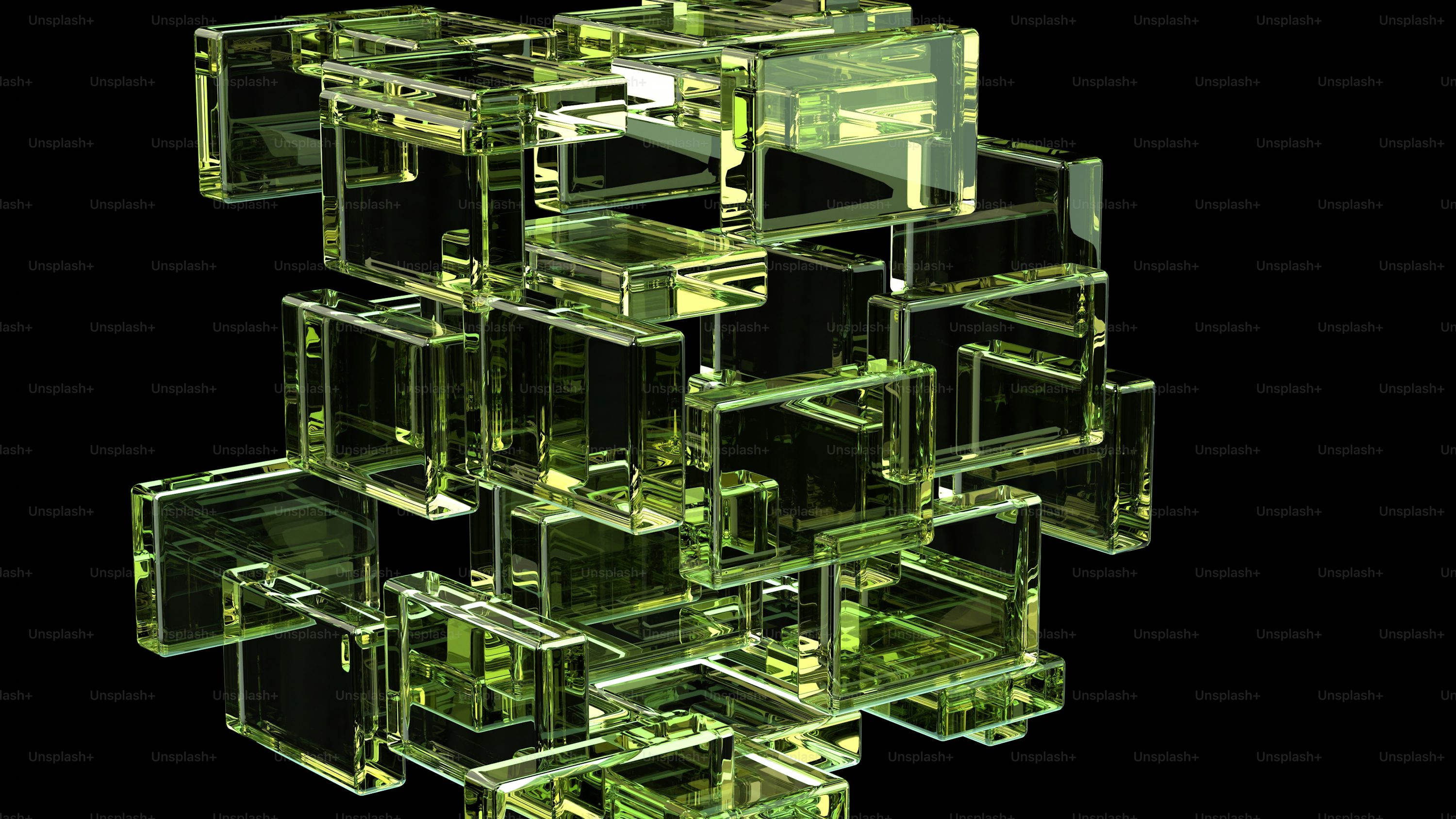
Archives
Dans la poussière d’Étaples
Dans la poussière d'Étaples ( rythme tintal, 16 temps) les hommes en avaient assez / des ordres aboyés chaque matin / des marches forcées dans la boue / des permissions toujours refusées / ils tenaient à peine debout / et l’arrestation d’un caporal / mit le feu aux poudres / fit lever la rumeur / ils sortirent en masse des baraques / brandissant leurs fusils d’entraînement / criant dans la poussière / se heurtant aux policiers militaires / trois jours le tumulte dura / trois jours la colère circula / puis les troupes encerclèrent / et l’ordre revint brutalement / un seul fut choisi pour l’exemple / Jesse Robert Short fusillé / le quatre octobre dix-sept / dans la poussière d’Étaples.|couper{180}

Archives
fil rouge
« Même dans mes gestes les plus sombres, il y avait une tentative de me protéger, de rétablir un équilibre, et parfois, sans le savoir, de sauver quelqu’un d’autre. » Une série d'histoires prenant appui sur ce fil rouge. Complétées au fur et à mesure qu'elle me reviendront. #01 histoire du poulailler Je ne sais plus exactement comment les choses se sont passées. Peut-être trop vite, peut-être comme si une main invisible avait décidé pour moi. J’accepte la possibilité d’en être responsable, mais je doute de savoir qui j’étais alors. Depuis des semaines déjà, je rêvais de P. Mon ami imaginaire, disais-je, mais peut-être davantage. Parfois je le voyais comme mon double, parfois comme une présence étrangère qui me soufflait des pensées noires, me laissant croire qu’elles venaient de moi. Ces nuits-là, je me réveillais trempé de sueur, avec la conviction d’être possédé par quelque chose qui n’avait pas de nom. Je savais seulement que je n’avais pas été baptisé, pas comme mes camarades, et cette absence me paraissait une faille, une ouverture dans laquelle n’importe quoi pouvait s’engouffrer. J’avais supplié ma mère de m’inscrire au catéchisme pour combler ce vide. Le début de l’été coïncida avec l’arrivée de Flip. Mon père l’avait trouvé sur une route départementale, un chien-loup maigre et nerveux, qu’il fit monter dans sa voiture comme s’il l’attendait depuis toujours. Devant nous, il inventa une histoire : Flip avait eu plusieurs maîtres, tous cruels, il s’était enfui, il avait erré longtemps avant de croiser sa route. Mon frère et moi, bouleversés par ce récit, lui donnâmes aussitôt notre affection. Ce jour-là, la lumière était blanche, écrasante. Nous jouions dans la cour. Ma mère venait de verser la nourriture dans la gamelle de fer blanc. Mon frère s’approcha du chien pour le caresser. Peut-être Flip crut-il qu’on allait le frapper encore une fois. D’un bond, il lui attrapa l’œil. Le sang gicla, éclaboussant la poussière. Mon frère hurla, des cris que je n’oublierai jamais. Je restai figé, incapable de bouger. Ma mère était au village. Personne pour venir. Alors, mes doigts trouvèrent au fond de ma poche une boîte d’allumettes que j’avais volée. Tandis que les hurlements se prolongeaient derrière moi, je marchai vers le poulailler. À travers les lattes du bardage, je vis les poules s’agiter, leurs plumes frottant contre le bois. J’ai gratté une allumette. La flamme a jailli, petite, fragile, mais déjà prête à dévorer. Je l’ai jetée sur la paille. Le feu prit aussitôt. Une chaleur épaisse, un souffle. Les cris du poulailler s’ajoutèrent à ceux de mon frère, comme si deux voix se répondaient. Les pompiers arrivèrent vite. Ils éteignirent les flammes, emmenèrent mon frère. Ma mère surgit au moment où l’ambulance allait partir. Elle me vit. Et ses mots tombèrent, nets : — Tu as le diable dans la peau. J’ai voulu protester, dire que c’était P. Mais déjà, je savais que ce serait en vain. Reprise de souffle par rapport à la syntaxe, expérimentation Je ne sais plus exactement comment tout s’est enchaîné peut-être trop vite peut-être comme si quelque chose avait décidé pour moi et je ne nie pas que j’en fus l’auteur même si je doute de savoir qui j’étais alors car depuis déjà des nuits je rêvais de P mon double imaginaire ou bien l’ombre d’une présence étrangère et chaque matin je me réveillais avec cette peur sourde d’être possédé d’être livré au démon parce que je savais que je n’avais pas été baptisé comme mes camarades et cela me paraissait une faille béante dans laquelle tout pouvait s’engouffrer et j’avais supplié ma mère de m’inscrire au catéchisme pour être enfin tranquille mais le début de l’été apporta aussi Flip le chien-loup trouvé sur la route par mon père qui l’avait ramené dans sa voiture en lui inventant une histoire de maîtres cruels et de longues errances et cette histoire me toucha au point que mon frère et moi nous lui donnâmes aussitôt notre affection mais ce jour-là dans la cour alors que la lumière blanche écrasait la poussière mon frère s’approcha de lui pour le caresser et le chien bondit et lui attrapa l’œil et le sang jaillit et les cris montèrent et je restai figé sans savoir que faire car ma mère était au village et personne ne vint et mes doigts rencontrèrent au fond de ma poche une boîte d’allumettes volée et je marchai vers le poulailler et à travers les lattes j’aperçus les poules agitées et je frottai une allumette et la flamme prit et aussitôt la paille s’embrasa et le feu grossit et les cris des volailles se mêlèrent aux hurlements de mon frère et les pompiers arrivèrent et l’ambulance emporta mon frère et ma mère surgit et ses mots tombèrent nets tu as le diable dans la peau et je voulus protester dire que c’était P mais déjà je savais que ce serait en vain. ici, la ponctuation réduite (virgules, conjonctions) crée un flux continu. La lecture devient haletante, presque musicale, et la reprise de souffle est absorbée dans le mouvement. L’émotion se transforme en transe syntaxique : moins de drame frontal, plus de flux hypnotique. Psalmodie je ne sais plus exactement comment tout s’est enchaîné peut-être trop vite peut-être trop fort comme si quelqu’un avait décidé pour moi et pourtant je sens encore que ma main y était mais qui étais-je alors moi ou un autre ou bien p celui qui venait dans mes rêves depuis des nuits entières et qui me disait que je n’étais pas baptisé et que je n’étais pas comme les autres et que le diable entrerait par cette faille béante et je suppliais ma mère de m’inscrire au catéchisme mais c’était l’été déjà et mon père avait ramené ce chien trouvé au bord d’une route un chien-loup nerveux qu’il avait nommé flip et auquel il avait donné une histoire d’errance et de cruauté et cette histoire avait suffi pour que mon frère et moi nous nous y attachions mais ce jour-là dans la cour la lumière blanche tombait sur nous et ma mère était absente et mon frère s’était approché trop près du chien et le chien avait bondi et sa mâchoire avait saisi l’œil et le sang avait jailli et mon frère avait crié et le monde avait basculé et moi je ne savais plus que faire sinon appeler dans le vide et alors mes doigts avaient trouvé une boîte d’allumettes au fond de ma poche et j’étais allé vers le poulailler et à travers les planches je voyais les poules agitées et j’avais frotté une allumette et la flamme avait pris aussitôt et le feu avait grandi et les cris des poules se mêlaient aux hurlements de mon frère et les pompiers étaient arrivés et ils avaient éteint les flammes et ils avaient emporté mon frère et ma mère était revenue et ses mots étaient tombés comme une pierre tu as le diable dans la peau et moi je voulais dire que c’était p que c’était lui mais je savais déjà que personne ne croirait et que ce serait toujours ainsi moi ou lui ou le feu ou la honte mais jamais le salut. Notes Utilise le souffle comme climax → pas partout, mais aux moments où le texte doit basculer. Décide de la longueur → une phrase d’une demi-page peut suffire. Pas besoin d’aller jusqu’au roman-monologue (Bernhard). Laisse apparaître la musique → pense la syntaxe comme un flux respiratoire, pas seulement comme un enchaînement logique. Reviens au sec après → une phrase courte, brute, peut fermer le passage comme une gifle. En résumé : le souffle continu est un outil pour faire vivre la perte de contrôle, la transe ou l’intensité émotionnelle. Il gagne en puissance si tu l’emploies par contrastes : après un passage clair et sobre, il devient une descente, un vertige. Puis, quand tu coupes net, la chute est encore plus forte. On peut bien sûr compter : Lecture 123 / 1234 / 123 : Le chien avait mordu (1-2-3) Le sang jaillissait encore (1-2-3-4) J’appelais mais personne (1-2-3) "et je voyais le sang qui ne cessait pas et je pensais que ma mère n’était pas là et que personne ne viendrait et que peut-être j’avais été choisi pour voir cela et que tout le reste n’avait jamais compté" Si tu le lis en pulsations 123 / 1234 / 123, tu t’aperçois que la phrase trouve un équilibre respiratoire malgré son excès apparent. Digression sur les différents rythmes prosodiques Quelques rythmes prosodiques au-delà du 123 / 1234 / 123 Le binaire (2/4, 4/4) Très courant en musique occidentale moderne (rock, pop). En prose : effet de marche, d’insistance, de régularité militaire. Exemple : Il frappe. Il attend. Il frappe. Il attend. 👉 Rythme sec, martelé, presque mécanique. Le ternaire pur (3/3/3) Fréquent dans les chants religieux, la poésie médiévale, les litanies. Effet d’incantation, de balancement hypnotique. Exemple : J’appelle la nuit / J’appelle le feu / J’appelle la honte. 👉 Proche d’une psalmodie. Le quintuple (5 temps) Plus rare dans notre oreille, mais fréquent en poésie arabe, persane, ou en musique indienne. Effet : instabilité, tension permanente (on n’arrive jamais à “tomber juste” en 4). Exemple (5 battements) : Il s’avance, regarde, se tait, retient, respire. 👉 En prose, ça donne une impression de déséquilibre maîtrisé. Le septénaire (7 temps) Très utilisé dans les haïkus (5-7-5) et la poésie japonaise. Effet : respiration ample mais non occidentale, un souffle qui se déploie en décalage. Exemple : Sous la lumière / la maison semble attendre / une voix muette. 👉 Rythme contemplatif, suspendu. Le rythme libre mais cadencé Hérité de la poésie moderne (Whitman, Ginsberg, Saint-John Perse). Pas de schéma fixe, mais une périodicité du souffle : chaque segment est une “vague” de 10 à 20 syllabes, comme des vagues qui reviennent mais jamais identiques. Exemple (Whitman) : I sing the body electric, / the armies of those I love engirth me, / and I engirth them. 👉 Rythme océanique, expansif. Les rythmes africains ou afro-diasporiques (call & response, syncopes) Rythmes basés sur la répétition et la variation. Dans la prose : effet de transe, d’énergie accumulée par retour. Exemple : Je frappe le sol, je frappe encore, je frappe toujours, et le sol me répond. 👉 Rythme circulaire, dialogique. Les talas indiens Systèmes complexes (ex. tintal en 16 temps, rupak en 7 temps). Peu “naturels” pour une oreille occidentale mais fascinants si transposés en prose. Exemple (7 temps) : Un souffle, une pause, deux pas, un souffle, une pause, un pas, silence. 👉 Le lecteur ne peut pas anticiper, ce qui crée une étrangeté prosodique. 🎼 Synthèse Occidental classique : binaire, ternaire, quaternaire → facile, familier. Autres cultures : quintuple, septénaire, talas → instables, déstabilisants. Poésie moderne : rythmes libres mais réguliers (Whitman, Perse, Ginsberg). Oralité traditionnelle : litanies, call & response, psalmodie → effet incantatoire. 👉 Changer de rythme, c’est changer de perception. Un texte en 3/4 apaise, en 4/4 martèle, en 5 ou 7 déstabilise, en flux libre enivre.|couper{180}

Archives
perte de temps
Un mail de T. encore. Même article, mêmes réseaux, même dénonciation. Je lis en biais. Je ne réponds pas. Silence. Ce qui m’agace, ce n’est pas lui. C’est l’écho. Le même rythme, le même martèlement. Comme si je me lisais. Et si je dénonçais, moi aussi, ce que je porte en dedans. Le défaut qu’il affiche devient mon reflet. Voilà pourquoi je détourne les yeux. Perte de temps|couper{180}

Archives
La vraie voix
elle parlait mais pas naturel. J'avais donc ce pouvoir à 20 ans de décider de ce qui était ou pas naturel, qu'en ai-je donc fait depuis. Je l'ignore. Elle parlait avec ette voix pointue insupportable, cette voix qui n'avait comme but que d'exciter, ou d'énerver, d'agacer. Encore que ce but ci ne mène qu'à son antichambre. Car ensuite elle prend sa voix la plus caline évidemment. La voix caline d'une énorme araignée, les pattes montent vers le plafond et déjà trop tard pour t'apercevoir que tu es enroulé dans le bave et de la soie. Que tu es devenu une poire pour la soif tu as besoin de dire ça aujourd'hui parce que progressivement tu t'aperçois d'un mouvement récurrent. En toute femme sommeille une araignée comme chez tout homme le fantasme de devenir cocon. Et si tu loupes le coche à l'âge précis où celui-ci pas à la gare des illusions perdues, tu ne loupes pas ta vie non, tu loupes l'occason d'en avoir espéré en faire autre chose. Et, en fin de compte aujoud'hui quel désavantage pourrait tu trouver à cette dévoration. tu pourrais presque transformé cela en nostalgie. Tu n'as pas été initié, tu as botté en touche, sans dévoration pas de métamorphoe. Les héros et leurs pendants les anti-héros ne sont il pas toujours jeunes et fringuants. Mais toi tu es vieux tu dégages une odeur nauséabonde, et tu ne sais pas si c'est celle de la sueur de la peur, de la pisse. Mais tu conserve l'obsession d'atteintdre à ta vraie voix, c'est l'essentiel|couper{180}

Archives
Un choix
le point de départ : le narrateur prend conscience qu'il n'est plus adapté à un groupe qu'il a coutûme de fréquenter. ( pas de détail pour l'instant concernant la nature du groupe) Comment ça arrive ? Prise de conscience de l'énergie fournie par l'animateur du groupe pour maintenir celui-ci. Le narrateur cherche à comprendre comment il peut "tenir". Le narrateur prend conscience que lui ne peut pas fournir une telle énergie, il ne le peut plus. Il projette ce constat sur l'animateur. Comment lui fait-il pour continuer ? Le narrateur emet des hypothèses, mais toujours par rapport à son propre cadre de référence le besoin d'argent. En effet il y a un abonnement à payer pour adhérer au groupe dont découle un certain nombre d'avantages. Le narrateur paie l'abonnement mais il le considère comme un soutien, pas un salaire. L'animateur est d'un certain âge, sa carrière est derrière lui. Il n'a plus besoin de prouver quoique ce soit. Mais qu'en est-il du narrateur ? Lui voudrait s'enfoncer dans quelque chose que le groupe ne semble pas proposer. Pourquoi le narrateur se compare t'il à l'animateur Peu à peu le narrateur effectue ce constat, il se compare à l'animateur. Ce dernier a donc une influence sur lui, peut-être même une forme d'emprise. Cette emprise est-elle réelle ou purement imaginaire ? si on épure un peu le blaba une trame se laisse voir : – Un narrateur qui observe de loin un animateur – La conscience aiguë de l’effort que demande ce rôle : sourire, encourager, maintenir la cohérence. – Le narrateur, en contrechamp, qui sent que cet effort lui serait impossible, qu’il n’a pas la fibre pour ce collectif. – Décision de se retirer, comme on se retire d’un rite ou d’une communauté, voire d'une emprise imaginaire ou réelle. – Silence final : ce retrait est à la fois une fidélité à soi et une perte, comme si on fermait une porte dont on ne sait si elle se rouvrira. Premieres phrases Il parle avec constance, toujours égal, comme si la fatigue n’existait pas. Sourires, relances, encouragements. À chaque fois qu’un silence menace, il trouve un mot, une anecdote, une connivence. L’écran défile, les visages apparaissent, hochent la tête, attendent la suite. Lui, l’animateur, tient la corde. Moi je regarde. Je me demande où il va chercher cette énergie. Est-ce la routine, l’habitude, ou simplement l’âge — cette assurance tranquille de qui n’a plus rien à prouver ? Je calcule ce que cela demanderait si j’étais à sa place. Impossible. Je m’épuiserais en une seule séance. Alors je prends conscience : je ne peux plus. Le groupe réclame une présence, une discipline sociale qui m’est devenue étrangère. Je ressens moins de fraternité que d’usure. Les compliments croisés, les échos attendus, ce commerce tacite me fatiguent. Je pense à l’abonnement. Je le garde, et je continuerai à le payer, parce que c’est ma façon de dire merci — pour les horizons ouverts, pour l’ignorance quittée. Mais ce que je ne peux plus, c’est participer comme avant, faire semblant que rien n’a changé. Ce serait la vraie douleur : rester alors que j’ai pris conscience qu’il me fallait partir. Je ferme l’écran. Pas de drame. Juste un retrait. Un silence que je choisis. C’est un deuil discret, peut-être, mais nécessaire : comme si je fermais une porte dont je ne sais pas si elle se rouvrira.|couper{180}

Archives
Après ce qui a été écrit
« Ils retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l’abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux que ce soit pour bientôt. » — Simone Weil, L’Iliade ou le poème de la force Que la force soit avec toi, mais qui es-tu, toi — homme, femme, enfant, vieillard, rien de cela, tout cela ? Tu pourrais dire je ne suis rien, je suis tout, mais la force ne t’écouterait pas. Elle passe, indifférente. Face à elle, il reste la faiblesse. Et puis vint le silence. « Et j’ai appris comment s’effondrent les visages, Sous les paupières, comment émerge l’angoisse, Comment le rire se fane sur des lèvres soumises… » -- Anna Akhmatova, Requiem Et puis vint le silence. -- Calme-toi, tu n’es pas encore traîné dans la poussière. -- Mais je suis mort déjà. Avec les morts on ne s’agite plus. On use le temps, on épuise l’ennui, la haine, l’amour. Tout s’écrit dans un perpétuel présent. C’est le cadeau : étrange cadeau qu’on déballe au terme de sa vie. Et puis vint le silence. Mais ce silence avait des marches. On y descendait, une à une, chaque marche plus basse, plus étroite, chaque marche un gouffre. « Chaque marche un cri, chaque marche une perte. Chaque marche un vide — un vide plus profond. » -- Marina Tsvetaeva, Poème de l’escalier Et moi j’écris une marche, puis une autre, puis encore une. Je les efface l’une après l’autre, soit pour descendre plus bas, soit pour tenter de me hisser plus haut. Je sais déjà que ça ne servira à rien. Ce n’est pas l’importance d’une marche qui fait celle de l’escalier. Mais si je dois être vaincu par la force comme toute chose ici-bas, alors la forme d’un escalier me va — un gouffre ayant la forme d’une spirale, d’un colimaçon. Dans la descente comme dans l’ascension, on peut sans doute choisir son escale un moment. Chaque marche pouvait être aussi bien pic ou gouffre, et c’était bien de ne pas savoir d’avance.|couper{180}

Archives
L’attente
Au début la graine est l'évitement. Sauf que l'évitement est le résultat de quelque chose, d'une attente. L'attente de quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra probablement jamais. Première ébauche sur la fausse piste, l'évitement. synopsis rapide : Un écrivain s’installe chaque soir à sa table pour travailler, mais tout devient occasion de différer : ajuster la lampe, remplir son verre, écouter un bruit. Pourtant, malgré ses ruses pour ne pas écrire, les pages de son carnet se remplissent. Des signes inconnus apparaissent, puis des phrases entières, décrivant ses gestes d’évitement. Bientôt, il comprend que son refus d’écrire nourrit une force qui écrit à sa place. Plus il tente d’échapper, plus le livre s’épaissit. Pris au piège, il découvre que son silence même a été capturé, transformé en récit. Il allumait la lampe, il sortait le carnet, il affûtait le crayon. Tout ça pour ne pas écrire. Le moindre geste servait de prétexte : remplir son verre d’eau, replacer la chaise, effacer une poussière invisible sur la table. Même les mots qu’il couchait sur la page semblaient prolonger l’évitement. Il écrivait pour ne pas écrire. Il notait le bruit du vent dans la gouttière, la toux du voisin, une phrase qu’il croyait entendre du poste éteint. À mesure qu’il alignait ces signes, la matière du texte se creusait d’absence. Puis il comprit qu’une chose l’écrivait malgré lui. Dans la marge, au détour d’un mot, s’étaient glissées des lettres qu’il ne reconnaissait pas. D’abord un signe isolé, ensuite des groupes entiers. Il ne les avait pas tracés, il en était sûr. Mais la page, au fil de ses hésitations, se remplissait d’un autre récit. Un récit qui parlait de lui, de ses gestes d’évitement, mais sous une forme étrangère. Le crayon trembla entre ses doigts. Le texte se poursuivait sans lui. Il tenta d’arracher la feuille, mais déjà le carnet tout entier bruissait, comme un champ d’insectes. Les pages écrivaient. Elles n’avaient pas besoin de lui, seulement de ses faux départs. Il recula. Il n’y avait plus d’issue : chaque refus, chaque pause, chaque retard devenait une phrase. Il était piégé dans ce livre qui se fabriquait de son inaction même. À ce moment précis, il comprit qu’écrire ou ne pas écrire revenait au même : la chose s’était emparée du silence comme de l’encre. Pourquoi choisir seulement l'écriture comme cadre ? On peut facilement imaginer un évitement qui déborde celui-ci ça donne quoi ? Un homme vit dans l’art du détour. Chaque geste quotidien est une manière de différer : ranger plutôt que parler, se lever plutôt que répondre, écrire des listes plutôt que commencer une œuvre. Cette mécanique d’évitement imprègne tout : relations, travail, souvenirs. Mais lorsqu’il s’assoit à sa table pour écrire, cette logique atteint un point de bascule. Ses pages se remplissent malgré lui, comme si la force de ses refus avait trouvé un débouché autonome. Ce qu’il n’a pas vécu, ce qu’il n’a pas osé, ce qu’il a tenu à distance, s’inscrit désormais noir sur blanc. Le récit qui surgit n’est plus de son fait : c’est la transcription monstrueuse de toutes ses esquives. Il doit alors affronter une question impossible : continuer à se dérober, c’est alimenter la chose ; tenter d’écrire vraiment, c’est peut-être se dissoudre en elle. reflexion parallèle : Autrefois, cet état devenait insoutenable. Alors je m’enfuyais, je descendais dans la rue. Je marchais de longues heures, sans destination, simple dérive. C’était une autre forme d’ajournement : le corps en mouvement pour détourner la pensée. La fatigue finissait par tomber sur moi comme un sursis, je ne sais pas si c’était un apaisement ou seulement une esquive de plus. et si on met ça au présent ? Quand l’attente me devient insupportable, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les trottoirs reçoivent mes pas comme des pages vides : chaque carrefour suspend, chaque virage diffère. J’allonge la marche, je dérive, je recule, sans décider vraiment. La fatigue s’installe mais elle n’apaise rien. Un soir, je vois mes propres traces. Les pas que je viens de poser s’impriment sur l’asphalte, une suite de signes blanchâtres, comme à la craie. J’essaie de les éviter, ils se multiplient. Les rues se referment, se plient autour de moi. Les vitrines reflètent mes refus, les murs enregistrent mes ajournements. La ville écrit à ma place. J’avance encore, mais chaque pas devient phrase, chaque détour une ligne. Plus je fuis, plus le texte s’épaissit. ça parle encore trop vite d'écriture il faut modifier *Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche longtemps, sans but précis. Chaque carrefour devient une pause, chaque virage un sursis. J’allonge les pas, je ralentis, je reprends, je dérive. La fatigue finit par tomber sur moi mais elle n’apaise pas. C’est juste un autre moyen de reculer. Les heures passent ainsi, dans cette dérive qui ne mène nulle part. La ville se plie à mes hésitations : une vitrine qui me renvoie mon visage, un banc que je frôle sans m’asseoir, un café dont je repousse la porte. Tout est occasion de contourner, d’omettre, de différer encore.* c'est à cet instant que l'évitement dévoile l'attente. L’attente ouvre autrement le champ. C’est plus ample, moins technique que Évitement. Ça ne désigne pas seulement le geste de fuir, mais l’état qui le précède et l’engloutit. On y entend la durée, la suspension, la vie tenue entre parenthèses. C’est un mot nu, massif, qui ne dit pas encore s’il s’agit d’un choix ou d’une condamnation. Là où Évitement sonnait diagnostic, L’attente installe une atmosphère. reprise de l'incipit : La lampe est allumée, le carnet ouvert, le crayon posé. Je reste là, sans bouger. Chaque geste possible devient une manière de différer : boire une gorgée d’eau, déplacer la chaise, fixer la poussière sur la table. Rien ne commence, tout se suspend. Le temps s’épaissit, s’étire, se retient. Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les carrefours m’arrêtent, les virages me repoussent plus loin. Je dérive, je me perds exprès, je recule. Les heures s’allongent, la fatigue tombe, mais elle n’apaise pas. C’est juste une autre forme de sursis. La ville accompagne ce flottement : vitrines croisées sans entrer, bancs frôlés sans m’asseoir, cafés dépassés sans franchir la porte. Tout est prétexte à contourner, à éluder. J’attends sans savoir quoi, mais j’attends. encore plus "palpable" ? La lampe est allumée, le carnet ouvert, le crayon posé. Je reste immobile. Chaque geste devient un sursis : boire une gorgée d’eau, déplacer la chaise, fixer la poussière sur la table. Rien ne commence, tout se suspend. Le temps s’épaissit, il flotte dans la pièce comme une matière dense qu’on ne traverse pas. Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les carrefours m’arrêtent, les virages me repoussent plus loin. Je dérive, je recule, je me laisse fatiguer. La fatigue tombe mais n’apaise rien, elle prolonge seulement l’état, elle le maintient. La ville s’accorde à cette dérive : vitrines franchies du regard sans entrer, bancs frôlés sans m’asseoir, cafés dépassés sans franchir la porte. Tout repousse, tout diffère. J’attends sans savoir quoi. À force, l’attente n’est plus un état mais une présence. Elle se tient derrière moi, à hauteur d’épaule, comme une ombre qui avance au même pas. Elle me touche sans me toucher. Elle s’épaissit autour des lampadaires, elle s’étire dans le bruit des pas des autres, elle s’assoit à ma place sur les bancs que je délaisse. Je ne marche plus seul, je marche avec elle. transformer l'attente en une réalité autonome ?* La lampe est allumée, le carnet ouvert, le crayon posé. Je reste immobile. Chaque geste devient un sursis : boire une gorgée d’eau, déplacer la chaise, fixer la poussière sur la table. Rien ne commence, tout se suspend. Le temps s’épaissit, il flotte dans la pièce comme une matière dense qu’on ne traverse pas. Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les carrefours m’arrêtent, les virages me repoussent plus loin. Je dérive, je recule, je me laisse fatiguer. La fatigue tombe mais n’apaise rien, elle prolonge seulement l’état, elle le maintient. La ville s’accorde à cette dérive : vitrines franchies du regard sans entrer, bancs frôlés sans m’asseoir, cafés dépassés sans franchir la porte. Tout repousse, tout diffère. J’attends sans savoir quoi. À force, l’attente n’est plus un état mais une présence. Elle se tient derrière moi, à hauteur d’épaule, comme une ombre qui avance au même pas. Elle se rapproche sans me toucher, mais je sens sa densité. Dans le halo des lampadaires, elle prend une forme, vague, fluctuante, un corps de brume. Elle se dédouble dans les vitrines, elle s’assoit à ma place sur les bancs que je délaisse. Je ne marche plus seul : je marche avec elle. Et quand je tente de m’arrêter, elle ne s’arrête pas. Elle avance d’un pas supplémentaire, comme si elle connaissait déjà la suite. Mais c'est qui ce narrateur ? ça dit quoi de lui ? Ça révèle d’abord une faille centrale : le narrateur n’agit jamais de lui-même, il se laisse absorber par le temps. Il vit dans la suspension, dans le report. L’attente n’est pas un accident mais son mode d’existence. Ensuite, cela montre sa peur de la décision. Les gestes qu’il fait — boire, déplacer une chaise, sortir marcher — sont des gestes d’évitement. Rien n’est affronté de front. L’attente devient la forme la plus pure de son rapport au monde : il ne vit pas, il diffère. Le fait qu’elle prenne corps, qu’elle se matérialise en présence, dit que cette passivité l’a tellement envahi qu’elle est devenue autonome, presque indépendante de lui. Autrement dit, son incapacité à agir fabrique un double, une entité qui l’accompagne, qui prend le relais. Enfin, ça révèle une angoisse métaphysique : il ne sait pas ce qu’il attend, ni de qui, ni pourquoi. L’attente le définit sans objet clair. C’est le portrait d’une vie tenue dans le suspens, où l’on finit par être guidé par ce qu’on subit. qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça ? Cause existentielle (ouverte, universelle) L’état n’a pas de cause précise : c’est le rapport du narrateur au monde. Une sorte de disposition à différer, peut-être liée à une peur diffuse du réel. Ici, l’attente devient métaphysique : elle est ce qui reste quand rien ne s’impose. Cause intime (psychologique / biographique) Un événement ancien — un deuil, une rupture, un échec fondateur — a brisé l’élan. Depuis, chaque geste est ajourné, comme si toute décision risquait de reproduire la perte. L’attente est un refuge contre la répétition du choc. Cause fantastique (inscrite dans le récit) Ce n’est pas vraiment lui : c’est une force qui s’est greffée à sa vie. L’attente serait une entité qui l’habite et qui l’a modelé. Elle se nourrit de ses ajournements et les amplifie. On ne sait pas si elle vient de lui ou si elle l’a choisi comme hôte. Cause sociale / contemporaine Un contexte étouffant — travail bureaucratique, injonctions multiples, rythmes mécaniques — a peu à peu dissous l’initiative. Le narrateur en est resté à l’état de suspension permanente, entre mails à répondre, tâches à accomplir, toujours différées. prenons l'échec fondateur comme prétexte, ce serait quel genre d'évènement ? Un tel état peut naître d’un échec qui n’est pas seulement une « défaite » mais une coupure dans l’élan vital, quelque chose qui installe durablement la peur d’avancer. Un amour manqué : l’attente d’une réponse (lettre, coup de fil, rendez-vous) qui n’est jamais venue. Le temps suspendu alors s’est figé et est devenu son mode de vie. Un projet d’écriture ou d’art avorté : un manuscrit refusé, un texte détruit, un concours échoué. L’échec s’est greffé comme preuve qu’agir mène à la chute. Un silence familial : un mot attendu d’un père ou d’une mère, jamais donné. Attente d’une reconnaissance, restée en suspens, qui a contaminé toute relation ultérieure. Un rendez-vous manqué : il aurait dû être là, il ne s’y est pas rendu (ou trop tard), et l’événement a pris un autre cours — accident, disparition, perte. Depuis, il redoute chaque décision comme un point de bascule. Un examen ou passage initiatique raté : diplôme manqué, service militaire esquivé, rite de passage jamais accompli. Comme si la vie adulte était restée à distance, différée. Ce qui compte n’est pas tant l’échec que la cristallisation : à ce moment précis, il a appris à se protéger en suspendant l’action. L’attente est devenue sa cuirasse. possible que le narrateur coche toutes les cases sédimentation d’attentes inachevées : amour manqué, projet détruit, parole parentale absente, rendez-vous raté, seuils non franchis. Ce n’est pas un seul traumatisme mais une suite, chaque fissure ajoutée à la précédente. L’effet cumulé est que toute action nouvelle est ressentie comme dangereuse : soit elle échoue, soit elle réactive l’échec passé. Alors il attend. L’attente n’est pas seulement refuge, c’est la seule forme d’action qu’il s’autorise. Ce qui peut produire quelque chose de fort, le récit peut suggérer ces causes en touches brèves, comme des échos : une lettre jamais reçue, un manuscrit brûlé, un mot retenu par un parent, une convocation manquée, une porte jamais franchie. Chacun apparaît une seconde, puis se retire — à l’image de l’attente elle-même. exemple Je marche. Les rues se succèdent, toujours les mêmes vitrines, les mêmes façades. À chaque pas, une image revient, puis disparaît. Une lettre jaunie, restée vide, sans réponse. Un téléphone décroché trop tard. Un manuscrit serré contre ma poitrine, puis jeté dans une corbeille que j’ai moi-même allumée. Une porte claquée dans un couloir familial, derrière laquelle le mot attendu n’est jamais sorti. Un quai de gare où je n’ai pas couru, le train parti, et quelqu’un resté de l’autre côté. Une convocation froissée au fond d’une poche, jamais ouverte. Tout cela marche avec moi. Ce ne sont pas des souvenirs, mais des angles morts : ce que je n’ai pas fait, ce que j’ai manqué. Chaque détour de rue est un rappel. Chaque pas rallonge l’ajournement. il ressent quoi ce narrateur, de la culpabilité ? il vit avec la double peine — l’échec répété et la culpabilité de l’avoir laissé s’installer. Mais il sait en même temps que ce n’était pas un choix volontaire, plutôt une mécanique intime, presque une fatalité. L’attente n’est pas une faiblesse qu’il aurait pu corriger, c’est son mode d’être au monde. Je le sais, je suis fautif. Chaque absence, chaque retard, chaque silence portait mon nom. Mais je n’ai jamais su faire autrement. Comme si une part de moi décidait toujours avant moi, me retenait, me coupait l’élan. J’ai cru longtemps qu’il s’agissait d’une faute morale, d’un manque de courage. Peut-être ce n’était que ma forme de vie : attendre, différer, manquer le pas. ou encore : Je marche et je sais déjà que je suis fautif. Chaque carrefour traversé trop tard, chaque porte non franchie, chaque silence : tout est de moi. Rien ne m’a été arraché, c’est moi qui n’ai pas su. Mais je ne pouvais pas autrement. Quelque chose décidait avant moi, une main invisible qui me retenait par l’épaule, qui me coupait l’élan. J’ai cru qu’il fallait nommer ça lâcheté. Maintenant je comprends : c’est ma manière d’avancer. Différer, manquer le pas, attendre. il doit tout de même bien y avoir une sorte de bénéfice à tout cela ? Cet état d’attente, de report, même s’il semble destructeur, porte aussi un bénéfice caché : Protection : ne pas agir, c’est éviter la répétition de la blessure. L’attente est une cuirasse contre de nouveaux échecs. Acuité : en suspendant le geste, le narrateur observe davantage. Il perçoit les détails que d’autres, pressés, ne voient pas. Réservoir : tout ce qui est différé s’accumule. Cette vie « manquée » n’est pas vide, elle devient matière latente, prête à se condenser autrement (en texte, en visions, en présence fantastique). Espace de résistance : refuser d’avancer, c’est aussi refuser d’être pris dans la mécanique sociale des échéances, des injonctions. C’est une forme d’insoumission muette. Autrement dit, ce n’est pas que du manque : c’est aussi une forme de vie paradoxale, où la suspension devient un mode de perception et d’endurance. du coup : J’ai longtemps cru que je ne faisais que manquer, mais l’attente m’a protégé aussi. Elle me détourne du coup porté, elle m’évite l’erreur répétée. Elle me laisse au bord, mais de ce bord je vois tout : les gestes des autres, leurs élans, leurs chutes. C’est peut-être là mon avantage : rester en retrait, mais avec les yeux ouverts. ou encore : *Je marche et chaque pas me rappelle ce que je n’ai pas fait. Je suis coupable d’avoir attendu, toujours trop, toujours trop tard. Faute après faute, j’ai laissé passer l’instant. Mais sans l’attente je me serais brisé. Elle m’a retenu, elle m’a couvert. Chaque recul m’a sauvé d’un coup plus dur. Je me dis que j’ai gâché, que je n’ai su que manquer. Les lettres non envoyées, les rendez-vous ratés, les portes jamais franchies. Tout m’accuse. Et pourtant, à force de rester en retrait, j’ai vu ce que d’autres n’ont pas vu. Le détail qu’ils ont traversé en courant, je l’ai recueilli. Le silence qu’ils ont fui, je l’ai entendu. Je suis un lâche, oui. Mais ce lâche a survécu. C’est peut-être cela l’attente : faute et protection en même temps. Une perte, et son abri.* et plus encore : *Je marche et j’entends la voix qui dit : tu as manqué encore, tu as fui, tu as différé. Elle compte mes silences comme d’autres tiennent leurs comptes de dettes. Puis une autre s’élève : sans moi tu serais tombé. Je t’ai protégé. Je t’ai gardé à distance de leurs pièges. Grâce à moi tu respires encore. La première reprend : tu n’as rien bâti, rien poursuivi, tu n’as fait que remettre. Tout ce que tu crois sauver, tu l’as perdu par avance. L’autre insiste : j’ai ouvert tes yeux. Je t’ai appris la marge, le détail, le silence. Je t’ai donné un regard que les autres n’auront jamais. Je marche entre elles deux. Coupable et sauvé. Je ne sais plus laquelle est moi. Peut-être les deux. Peut-être aucune.* Bon d'accord et si ça prenait une tournure fantastique ? *e m’arrête. Elle ne s’arrête pas. Elle avance de deux pas encore, puis se tourne. Je la vois enfin. Pas une silhouette pleine, plutôt un contour, une densité de nuit découpée dans la lumière des lampadaires. Pas de visage, mais je sais qu’elle me regarde. Tu crois que tu marches seul ? dit-elle. Sa voix est la mienne, plus grave, plus assurée. Depuis toujours je t’accompagne. Tu ne fais que retarder, mais c’est moi qui retiens. Tu te dis coupable, mais sans moi tu serais déjà tombé mille fois. Je voudrais répondre mais ma gorge se ferme. Elle avance encore, à pas calmes, comme si la rue lui appartenait. Chaque geste est sûr, là où le mien hésite. Regarde-moi bien, ajoute-t-elle. Je suis ton attente. Je suis ce que tu n’as pas fait, ce que tu n’as pas dit. Je suis ta faute, et ton salut. Je reste cloué, incapable de fuir.* ça rappelle un peu l'histoire du carnet et de la rivière cette ombre ... une continuité : le narrateur, prisonnier de ses ajournements, croise cette présence qui, comme à C. , ouvre une brèche. Pas une délivrance — plutôt un glissement. L’attente cesse d’être seulement subie, elle devient un passage, une dérive hors du connu.|couper{180}

Archives
L’art du mensonge
graine Un narrateur entend à la radio une affirmation brutale : « Les Juifs cultivent l’art du mensonge depuis la nuit des temps. » Intrigué, il veut vérifier la source. Il découvre un vieux rabbinologue qui lui remet un manuscrit en hébreu, qu’il prétend être une copie perdue du Talmud. Le texte semble confirmer, de manière ambiguë, cette idée : il y est écrit que « le mensonge, bien manié, est plus vrai que la vérité elle-même ». Le narrateur plonge dans l’étude du texte. Peu à peu, il se rend compte qu’il n’est plus capable de distinguer ce qui est vrai ou faux : ses souvenirs s’inversent, ses conversations se brouillent, ses propres écrits se dédoublent entre mensonge et vérité. À mesure que l’illusion progresse, il comprend que le manuscrit n’était peut-être pas un document juif mais une contrefaçon médiévale, conçue pour nourrir l’antisémitisme. Pourtant, trop tard : le mal est fait. Le narrateur devient incapable de vivre autrement que dans le doute permanent. Dans les dernières lignes, il note : « Je voulais débusquer le mensonge. J’ai découvert qu’il se loge dans l’accusation même qui prétend le dénoncer. Peut-être que le vrai art du mensonge n’est pas d’inventer, mais de faire croire que l’autre ment depuis toujours. » Sources, matières, références. L’idée d’un « faux manuscrit » présenté comme authentique, servant à tromper ou à inverser les valeurs, est un thème ancien qui a traversé la littérature, l’histoire des religions et le fantastique. Voici une cartographie : Antiquité & Moyen Âge Les pseudo-évangiles (apocryphes) : dès les premiers siècles, on a vu circuler des textes attribués à des apôtres ou prophètes, mais considérés ensuite comme faux → fascinant exemple de forgeries religieuses. Le Testament des Douze Patriarches ou le Livre d’Hénoch → textes jugés « falsifiés » ou « interpolés » par certains courants juifs et chrétiens. Les faux de la chrétienté médiévale : La Donation de Constantin (VIIIᵉ siècle) → faux document qui donnait au pape l’autorité politique sur Rome et l’Occident. Les fausses reliques, très fréquentes, qui alimentaient un imaginaire sacré. Renaissance – Lumières Érasme, Rabelais : évoquent les falsifications de textes antiques et religieux, en les tournant en dérision. Voltaire a beaucoup dénoncé les faux religieux ou historiques qui servaient de justification au pouvoir. XIXᵉ siècle Le Manuscrit trouvé à Saragosse (Jan Potocki, 1804) → faux manuscrit espagnol découvert par hasard, qui contient des récits enchâssés ; un jeu sur l’authenticité et le faux. Les faux médiévaux « retrouvés » : les romantiques se passionnent pour de prétendus manuscrits anciens (ex. le Chansonnier ossianique de Macpherson, présenté comme antique mais inventé). Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine → dialogue avec des figures qui représentent parfois des mensonges transformés en vérités religieuses. XXᵉ siècle Lovecraft → le fameux Necronomicon, faux grimoire arabe attribué à Abdul Alhazred, qui devient plus réel que réel. Ici, le faux devient une entité littéraire autonome. Borges (ex. Pierre Ménard, auteur du Quichotte ou Tlön, Uqbar, Orbis Tertius) → tout un art du faux manuscrit, du texte inventé présenté comme authentique. Umberto Eco, Le Nom de la rose → toute l’intrigue tourne autour d’un livre perdu d’Aristote, dont l’existence est mi-historique, mi-fictive. Vladimir Volkoff, Le Montage → roman sur la désinformation, où les faux documents fabriquent des réalités politiques. Cas historiques liés aux Juifs Le Protocole des Sages de Sion (début XXᵉ siècle) → un faux antisémite fabriqué en Russie tsariste, présenté comme authentique, qui a alimenté des discours de haine. C’est l’un des exemples les plus terribles d’une contrefaçon utilisée pour accuser « les Juifs » de mensonge et de manipulation. Des critiques modernes (notamment chez Hannah Arendt et Norman Cohn) ont étudié ce faux comme l’archétype du document fabriqué qui contamine la réalité. En littérature fantastique H.P. Lovecraft → encore, car son œuvre repose sur des faux traités, faux grimoires, faux manuscrits (le Necronomicon). Stanisław Lem, Le Congrès de futurologie → jeux de falsifications, où les perceptions elles-mêmes sont truquées. Philip K. Dick → univers saturés de documents et réalités falsifiés (Le Maître du Haut Château). Plan narratif : Le Manuscrit de l’Art du Mensonge 1. Exposition (doute et curiosité) Le narrateur (chercheur, historien ou écrivain) tombe par hasard, dans une bibliothèque d’abbaye ou une collection privée, sur un manuscrit oublié, daté du XIVᵉ siècle. Titre : Ars Mendacii Hebraeorum (L’art du mensonge des Hébreux). Il apprend par les notes marginales que ce texte fut jadis interdit, brûlé, puis mystérieusement recopié par des moines. Le manuscrit prétend démontrer que, dans la tradition juive, le mensonge est une vertu — une arme subtile, un art ancestral. Le narrateur d’abord rit de cette absurdité, y voyant un exemple typique de propagande antisémite médiévale. 2. Développement (la contamination du faux) En traduisant le texte, il découvre des passages étrangement convaincants, où chaque citation biblique ou talmudique est retournée, altérée, faussée — mais avec une habileté qui le trouble. Le manuscrit donne aussi des « règles » du mensonge : comment le faire passer pour vérité, comment inverser la perception du réel. Peu à peu, le narrateur constate que ces règles fonctionnent dans sa vie quotidienne : il voit autour de lui des exemples qui les confirment (politiques incohérents glorifiés, imposteurs acclamés comme génies, mensonges repris comme dogmes). Sa propre mémoire commence à vaciller : des souvenirs personnels changent de couleur, il doute de ce qu’il a vu ou vécu. 3. Climax (le pouvoir occulte du mensonge) Une nuit, il découvre dans une annexe du manuscrit des invocations étranges, décrivant le mensonge non comme une faute morale, mais comme une force cosmique. Cette force, invisible, s’incarne à travers les siècles en textes falsifiés, en faux traités, en slogans. Le narrateur comprend que le manuscrit n’est pas qu’un faux antisémite : il est un vecteur, un canal d’une entité ancienne — l’Intelligence Inversée — qui se nourrit de la confusion entre vérité et mensonge. À mesure qu’il lit, le texte semble changer sous ses yeux : les phrases s’inversent, le latin se réécrit, comme si le mensonge lui-même le contaminait. 4. Dénouement (le choix impossible) Le narrateur est au bord de la folie : il sait que ce manuscrit est une falsification, mais il reconnaît en même temps qu’il contient une vérité terrible — celle que l’humanité préfère le mensonge à la vérité, et que cette préférence n’est pas humaine, mais imposée par une force au-delà du monde. Il hésite : détruire le manuscrit (au risque de perdre à jamais la preuve de ce qu’il a découvert) ou le conserver (au risque de répandre l’inversion). La nouvelle se termine sur une note ambiguë : Soit il brûle le livre, mais croit entendre un rire derrière lui, comme si rien n’était effacé. Soit il choisit de garder le manuscrit et de le recopier — devenant lui-même l’instrument de propagation du faux. Thèmes travaillés Inversion des valeurs : le faux devient plus réel que le vrai. Pouvoir des textes : un document falsifié peut traverser les siècles et contaminer la pensée. Ambiguïté morale : même en dénonçant un faux, on lui donne corps. Héritage historique : rappel des Protocoles des Sages de Sion comme archétype du faux meurtrier. Début de L’Art du Mensonge Je n’avais aucune raison de pénétrer ce soir-là dans les salles basses de la bibliothèque des Jésuites, si ce n’est cette curiosité maladive qui me pousse, depuis toujours, à fouiller les recoins où s’empilent les manuscrits oubliés. Les rayonnages s’inclinaient sous le poids de volumes recouverts de poussière, certains noircis par l’humidité, d’autres rongés par le temps au point de perdre leur titre. C’est là, au détour d’un carton effondré, que je découvris un cahier relié de cuir, minuscule, au dos presque effacé. Sur la couverture se lisait, tracé d’une main tremblée, ce titre en latin : Ars Mendacii Hebraeorum. L’art du mensonge des Hébreux. Je crus d’abord à une plaisanterie d’érudit ou à l’un de ces pamphlets médiévaux qui pullulent dans les fonds monacaux. Mais dès que je l’ouvris, je fus saisi par l’élégance d’une écriture serrée, ponctuée de gloses marginales d’origines diverses, certaines en hébreu, d’autres en latin scolastique. Le texte se présentait comme un traité, prétendument issu des écoles talmudiques, démontrant — ou feignant de démontrer — que le mensonge n’était pas seulement toléré, mais cultivé comme une vertu, un art transmis « depuis la nuit des temps ». Je souris d’abord devant l’évidence grossière du faux. Car tout en moi, formé à l’histoire des hérésies et des supercheries, me criait qu’il s’agissait là d’un simulacre médiéval, forgé sans doute pour nourrir la haine et justifier les pogroms. Pourtant, quelque chose dans le ton du manuscrit, une rigueur glaciale dans ses démonstrations, me troubla. Chaque citation biblique semblait exacte, chaque maxime talmudique subtilement infléchie, jusqu’à paraître plus cohérente que l’original. Je refermai le cahier, mais une impression persistante demeura : et si ce que je tenais entre mes mains n’était pas seulement un faux, mais la copie infidèle d’une vérité plus ancienne — une vérité interdite, qui, par la ruse du mensonge, avait traversé les siècles pour parvenir jusqu’à moi ? vocabulaire assez courant, voire plat. S'il s'agit d'écrire sur l'art du mensonge pourquoi ne pas commencer dans le style même du texte en essayant de fournir des détails de plus en plus précis, et d'utiliser un vocabulaire plus savant ? Par exemple : Les étagères de chêne, massives et veinées, exhalaient une haleine résineuse et rancie, saturée de cire ancienne. Dans cette nef de bois et de pierre, l’air portait une senteur mucide, faite de cuir tanné, d’encre bitumineuse et de parchemins séculaires. Chaque pas soulevait un souffle cryptique, comme si la poussière elle-même avait gardé mémoire des siècles. Pour cela importance des listes de mots Pour donner à la scène une atmosphère vraiment travaillée (bibliothèque jésuite, manuscrit ancien), il faut éviter les adjectifs trop usuels (vieux, poussiéreux, sombre) et puiser dans un vocabulaire plus précieux, archaïsant, sensoriel. Bois et matières des étagères Chêne sombre : massif, noueux, austère, veiné comme une peau ancienne. Noyer patiné : chaud, brun profond, lustré par des siècles de mains. Ébène veiné : dense, presque noir, luisant comme une relique. Acajou veiné : rouge sombre, évoquant une solennité presque liturgique. Cèdre : exhale une odeur résineuse, persistante, mêlée au parchemin. Orme : robuste, dur, peu sensible aux vers (les Jésuites aimaient sa solidité). Les bibliothèques jésuites anciennes étaient souvent en chêne ou en noyer, bois réputés pour leur endurance et leur austérité. Odeurs dominantes Relents de cire : cire d’abeille qui recouvrait autrefois les parquets et le bois. Émanations résineuses : du bois lui-même, qui transpire lentement. Miasmes de parchemin : odeur sèche, un peu farineuse, de peau tannée. Effluves de cuir tanné : reliures craquelées. Senteur de suie : souvenirs de chandelles et lampes à huile. Amertume de l’humidité : pierres suintantes, poussière mêlée à la mousse. Odeur ferreuse : parfois, celle des encres oxydées. Adjectifs et atmosphère (hors langage courant) Rancie : pour la poussière accumulée. Capiteuse : pour une odeur forte, presque enivrante. Mucide : moisi, imprégné d’humidité. Résineuse : persistante, entêtante. Bitumineuse : sombre, lourde, comme de vieux encres ou cires. Funèbre : solennel, empreint de silence. Archaïque : hors du temps. Rigoriste : austère, à l’image des Jésuites. Séculaire : chargé de siècles. Cryptique : mystérieux, presque codé. Onguenté : pour le bois imprégné d’huile ancienne. Monacal : dépouillé mais imprégné de spiritualité.|couper{180}

Archives
inversion
graine : l'inversion des valeurs Quand l'imbécilité devient intelligence et vis versa. Et moi ? Lorsque parfois je doute, que je me dis qu’écrire est vain, c’est parce que je préfère rester dans l’enfer que je me suis choisi, plutôt que d’être entraîné vers un prétendu âge d’or qu’on voudrait m’imposer. Un narrateur vit dans une cité où les rôles sont renversés : Les imbéciles sont célébrés, publiés, élus, décorés. Les intelligents sont enfermés dans des asiles, soupçonnés de complot, car « penser trop » est vu comme une déviance dangereuse. Le narrateur écrit en secret, sachant qu’il est du côté « maudit », mais refusant l’âge d’or de la bêtise heureuse. le tribunal de l'intelligence Chaque citoyen doit se présenter devant un tribunal où sa valeur est inversée : plus il est confus, plus il est récompensé ; plus il est clair et subtil, plus il est puni. Le narrateur s’y rend, refuse de jouer le jeu et choisit son « enfer » : être banni, isolé, mais fidèle à son exigence. L’algorithme du monde parfait Une IA a reprogrammé la société pour optimiser le bonheur collectif. Résultat : les comportements les plus simplistes, mécaniques, répétitifs sont valorisés, tandis que la nuance, le doute, la complexité sont étiquetés « nuisibles ». Le narrateur, écrivain, se retrouve disqualifié par la machine : son art est déclaré « stérile ». Mais il continue d’écrire, préférant son enfer d’inutilité à l’âge d’or des imbéciles heureux. Texte très court, presque parabole : Dans ce monde, l’intelligence est un crime, et l’imbécillité une vertu. Les fous sont ministres. Les clairvoyants balayent les rues. Moi, je continue d’écrire. Non pour convaincre, mais pour rester fidèle à mon enfer. Car je préfère mon enfer choisi à l’âge d’or imposé. Matières à explorer ou références Antiquité & Renaissance Euripide, Aristophane, Lucien de Samosate → déjà des inversions satiriques, où les sophistes ou les sots passent pour sages. Érasme, Éloge de la folie (1509) → la Folie prend la parole et se glorifie : elle montre que les sots dominent en fait le monde, tandis que les « sages » sont ridicules. Rabelais (Gargantua, Pantagruel) → critique des docteurs pédants et des « sages » ridicules. XVIIe – XVIIIe siècle La Rochefoucauld / La Bruyère → dans leurs maximes, ils montrent que les courtisans imbéciles réussissent mieux que les intelligents lucides. Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver (1726) → les Houyhnhnms (êtres rationnels) et les Yahoos (bestiaux) renversent la prétendue supériorité humaine. Voltaire (Candide, Micromégas) → ironise sur l’optimisme imbécile de Pangloss, valeur perçue comme sagesse. XIXe siècle Nietzsche, La Généalogie de la morale / Par-delà bien et mal → met à nu les inversions de valeurs opérées par la morale chrétienne (faiblesse valorisée, force dévalorisée). Flaubert, Bouvard et Pécuchet → les deux copistes incultes s’imaginent savants ; satire de l’imbécillité qui se prend pour intelligence. Dostoïevski (L’Idiot) → le prince Mychkine, naïf et pur, passe pour fou dans un monde corrompu. XXe siècle Orwell, 1984 → slogans d’inversion : « La guerre, c’est la paix ; la liberté, c’est l’esclavage ; l’ignorance, c’est la force. » Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes → dans un monde stable et heureux, la profondeur intellectuelle est perçue comme une tare. Eugène Ionesco, Rhinocéros → les imbéciles suivent la métamorphose collective (devenir rhinocéros) tandis que le dernier homme qui résiste est perçu comme un fou. George Bernanos, La France contre les robots → critique du triomphe de la technique qui fabrique une humanité passive et stupide. Cioran (Syllogismes de l’amertume, Précis de décomposition) → aphorismes sur le triomphe de l’imbécillité et l’échec des esprits lucides. Philip K. Dick (Ubik, Le Maître du Haut Château) → univers où la perception, l’intelligence, la vérité sont constamment renversées. Stanisław Lem, Mémoires trouvés dans une baignoire → absurdité bureaucratique où la logique devient suspecte. XXIe siècle Michel Houellebecq (Extension du domaine de la lutte, Soumission) → montre un monde où les médiocres prospèrent et les intelligents désespèrent. Umberto Eco (Le Nom de la rose, Le Pendule de Foucault) → critique des systèmes qui valorisent l’aveuglement ou le dogme contre la raison. Byung-Chul Han (La Société de la fatigue, Psychopolitique) → décrit une société où la « positivité » (optimisme creux, performance) remplace la pensée critique. Alain Damasio (La Zone du dehors, Les Furtifs) → critique d’une société gouvernée par la conformité et la servitude volontaire, où la révolte lucide est criminalisée. Formes voisines Satire de la bêtise : Érasme, Flaubert, Swift, Ionesco, Cioran. Renversement des valeurs : Nietzsche, Orwell, Huxley, Debord. Fantastique / Absurdité bureaucratique : Kafka, Lem, Dick. Philosophie critique moderne : Han, Debord (La Société du spectacle → l’illusion triomphe du réel, la surface de la profondeur). synopsis Le narrateur, un écrivain solitaire, découvre dans une bibliothèque oubliée un traité ancien, De Inversione Mundi, écrit par un certain Frater Athanasius, moine du XVIIe siècle. Le manuscrit affirme que le monde n’est pas régi par la raison, mais par une loi secrète d’inversion : tout ce que l’homme croit être sagesse, clarté, vérité, est en réalité folie, obscurité et mensonge. Au départ, le narrateur sourit de cette idée absurde. Mais bientôt, des signes troublants apparaissent dans son quotidien : les orateurs les plus confus sont acclamés comme des génies, les savants les plus lucides sont enfermés comme fous, les imbéciles se hissent à des postes de pouvoir tandis que les penseurs disparaissent mystérieusement. Il se met à enquêter et découvre que cette « inversion » n’est pas une métaphore mais une force occulte : une puissance cosmique — l’Intelligence Inversée — qui, depuis des millénaires, altère les perceptions humaines. Elle ne détruit pas la raison : elle la retourne. Elle fait passer l’imbécilité pour sagesse, la folie pour vérité, la corruption pour vertu. Dans ses notes, le moine Athanasius évoque des rituels interdits qui permettraient de « voir sans masque », mais au prix d’une folie immédiate. Le narrateur, obsédé, finit par tenter l’expérience. Ce qu’il découvre dépasse l’entendement : il entrevoit un monde derrière le monde, où des entités innommables rient de l’humanité, se nourrissant de son aveuglement volontaire. Terrifié, il comprend qu’il n’y a pas d’issue. Refuser l’inversion, c’est se condamner à l’isolement, au bannissement, à la folie. L’accepter, c’est se fondre dans le troupeau, anesthésié et docile. Le récit se termine par une dernière note griffonnée, presque illisible : « L’imbécillité règne parce qu’elle est le sceau de ceux qui veillent au-delà des étoiles. Et moi ? Je préfère mon enfer choisi… à leur âge d’or imposé. » brouillon de début Je ne sais s’il m’est encore permis d’écrire ces lignes, ni même si elles parviendront à quiconque, mais il m’est impossible de taire ce que j’ai vu — ou cru voir — durant ces mois de fièvre solitaire passés dans la bibliothèque oubliée de l’ancien couvent de Saint-Benoît, au cœur d’une province que les cartes modernes n’osent plus nommer. Je m’y étais réfugié dans le dessein vain de poursuivre mes recherches sur les textes interdits du XVIIᵉ siècle, ceux que l’Inquisition n’avait pas réussi à détruire. C’est là, au milieu des rayonnages effondrés et des parchemins rongés par la moisissure, que je découvris le manuscrit intitulé De Inversione Mundi. Le volume, à demi calciné, portait la signature d’un certain Frater Athanasius, dont je n’avais jamais entendu parler. Dès les premières lignes, je compris qu’il ne s’agissait point d’un traité de théologie ordinaire, mais d’un document d’une nature plus sombre et plus troublante : une proclamation d’hérésie ou peut-être… une révélation. Le moine affirmait que le monde visible n’était qu’un voile, un trompe-l’œil cosmique sous lequel œuvrait une loi secrète et universelle : la Loi d’Inversion. Selon lui, tout ce que l’homme considère comme sagesse n’est en réalité que le masque de la folie ; tout ce qu’il tient pour vérité n’est qu’un simulacre destiné à détourner son esprit ; et les plus grands esprits de notre race ne sont que des pantins ridiculisés par une force supérieure qui couronne l’imbécillité de lauriers et voue l’intelligence au bûcher. Au premier abord, j’accueillis ces assertions avec le mépris de l’érudit pour les extravagances d’un esprit malade. Mais je dus bientôt réviser mes certitudes, car, plus je lisais, plus je reconnaissais dans ces pages calcinées les reflets grotesques et pourtant familiers de ce que j’observais chaque jour dans notre époque : les orateurs les plus incohérents acclamés comme des prophètes, les hommes les plus vides élevés en idoles, et ceux qui s’efforcent de raison et de clarté jetés au silence ou à la dérision. Il me sembla alors que les mots du moine n’étaient pas la confession d’un délire, mais la transcription d’une vérité interdite, chuchotée depuis des siècles par d’antiques puissances. Une vérité que, désormais, je n’avais plus le droit d’ignorer — au risque de ma raison.|couper{180}

