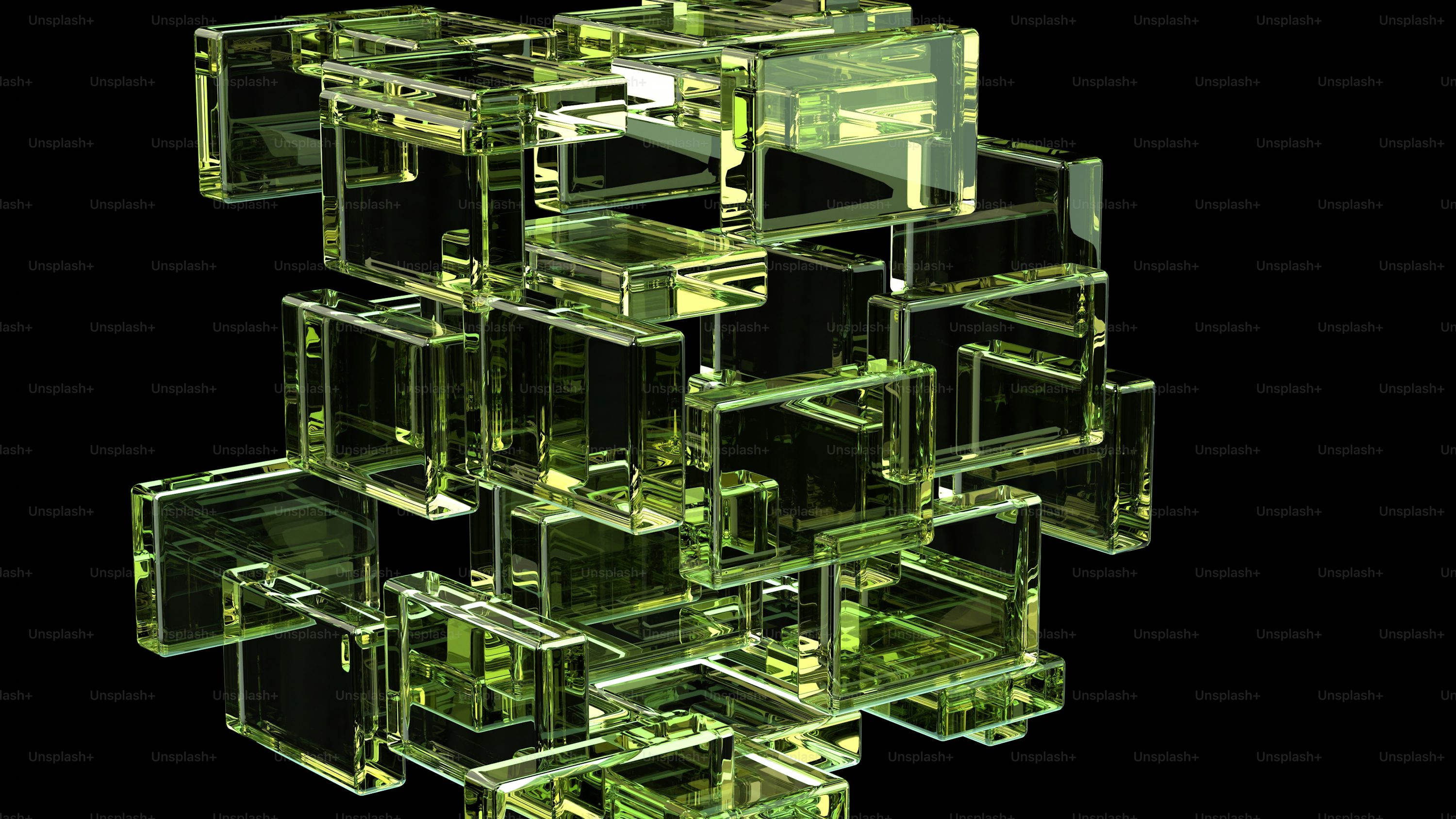L’attente
Au début la graine est l’évitement. Sauf que l’évitement est le résultat de quelque chose, d’une attente. L’attente de quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra probablement jamais.
Première ébauche sur la fausse piste, l’évitement.
synopsis rapide : Un écrivain s’installe chaque soir à sa table pour travailler, mais tout devient occasion de différer : ajuster la lampe, remplir son verre, écouter un bruit. Pourtant, malgré ses ruses pour ne pas écrire, les pages de son carnet se remplissent. Des signes inconnus apparaissent, puis des phrases entières, décrivant ses gestes d’évitement. Bientôt, il comprend que son refus d’écrire nourrit une force qui écrit à sa place. Plus il tente d’échapper, plus le livre s’épaissit. Pris au piège, il découvre que son silence même a été capturé, transformé en récit.
Il allumait la lampe, il sortait le carnet, il affûtait le crayon. Tout ça pour ne pas écrire. Le moindre geste servait de prétexte : remplir son verre d’eau, replacer la chaise, effacer une poussière invisible sur la table. Même les mots qu’il couchait sur la page semblaient prolonger l’évitement. Il écrivait pour ne pas écrire. Il notait le bruit du vent dans la gouttière, la toux du voisin, une phrase qu’il croyait entendre du poste éteint. À mesure qu’il alignait ces signes, la matière du texte se creusait d’absence.
Puis il comprit qu’une chose l’écrivait malgré lui. Dans la marge, au détour d’un mot, s’étaient glissées des lettres qu’il ne reconnaissait pas. D’abord un signe isolé, ensuite des groupes entiers. Il ne les avait pas tracés, il en était sûr. Mais la page, au fil de ses hésitations, se remplissait d’un autre récit. Un récit qui parlait de lui, de ses gestes d’évitement, mais sous une forme étrangère.
Le crayon trembla entre ses doigts. Le texte se poursuivait sans lui. Il tenta d’arracher la feuille, mais déjà le carnet tout entier bruissait, comme un champ d’insectes. Les pages écrivaient. Elles n’avaient pas besoin de lui, seulement de ses faux départs.
Il recula. Il n’y avait plus d’issue : chaque refus, chaque pause, chaque retard devenait une phrase. Il était piégé dans ce livre qui se fabriquait de son inaction même.
À ce moment précis, il comprit qu’écrire ou ne pas écrire revenait au même : la chose s’était emparée du silence comme de l’encre.
Pourquoi choisir seulement l’écriture comme cadre ? On peut facilement imaginer un évitement qui déborde celui-ci
ça donne quoi ?
Un homme vit dans l’art du détour. Chaque geste quotidien est une manière de différer : ranger plutôt que parler, se lever plutôt que répondre, écrire des listes plutôt que commencer une œuvre. Cette mécanique d’évitement imprègne tout : relations, travail, souvenirs. Mais lorsqu’il s’assoit à sa table pour écrire, cette logique atteint un point de bascule. Ses pages se remplissent malgré lui, comme si la force de ses refus avait trouvé un débouché autonome. Ce qu’il n’a pas vécu, ce qu’il n’a pas osé, ce qu’il a tenu à distance, s’inscrit désormais noir sur blanc. Le récit qui surgit n’est plus de son fait : c’est la transcription monstrueuse de toutes ses esquives. Il doit alors affronter une question impossible : continuer à se dérober, c’est alimenter la chose ; tenter d’écrire vraiment, c’est peut-être se dissoudre en elle.
reflexion parallèle : Autrefois, cet état devenait insoutenable. Alors je m’enfuyais, je descendais dans la rue. Je marchais de longues heures, sans destination, simple dérive. C’était une autre forme d’ajournement : le corps en mouvement pour détourner la pensée. La fatigue finissait par tomber sur moi comme un sursis, je ne sais pas si c’était un apaisement ou seulement une esquive de plus.
et si on met ça au présent ?
Quand l’attente me devient insupportable, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les trottoirs reçoivent mes pas comme des pages vides : chaque carrefour suspend, chaque virage diffère. J’allonge la marche, je dérive, je recule, sans décider vraiment. La fatigue s’installe mais elle n’apaise rien.
Un soir, je vois mes propres traces. Les pas que je viens de poser s’impriment sur l’asphalte, une suite de signes blanchâtres, comme à la craie. J’essaie de les éviter, ils se multiplient. Les rues se referment, se plient autour de moi. Les vitrines reflètent mes refus, les murs enregistrent mes ajournements. La ville écrit à ma place.
J’avance encore, mais chaque pas devient phrase, chaque détour une ligne. Plus je fuis, plus le texte s’épaissit.
ça parle encore trop vite d’écriture il faut modifier
*Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche longtemps, sans but précis. Chaque carrefour devient une pause, chaque virage un sursis. J’allonge les pas, je ralentis, je reprends, je dérive. La fatigue finit par tomber sur moi mais elle n’apaise pas. C’est juste un autre moyen de reculer.
Les heures passent ainsi, dans cette dérive qui ne mène nulle part. La ville se plie à mes hésitations : une vitrine qui me renvoie mon visage, un banc que je frôle sans m’asseoir, un café dont je repousse la porte. Tout est occasion de contourner, d’omettre, de différer encore.*
c’est à cet instant que l’évitement dévoile l’attente. L’attente ouvre autrement le champ. C’est plus ample, moins technique que Évitement. Ça ne désigne pas seulement le geste de fuir, mais l’état qui le précède et l’engloutit. On y entend la durée, la suspension, la vie tenue entre parenthèses. C’est un mot nu, massif, qui ne dit pas encore s’il s’agit d’un choix ou d’une condamnation. Là où Évitement sonnait diagnostic, L’attente installe une atmosphère.
reprise de l’incipit :
La lampe est allumée, le carnet ouvert, le crayon posé. Je reste là, sans bouger. Chaque geste possible devient une manière de différer : boire une gorgée d’eau, déplacer la chaise, fixer la poussière sur la table. Rien ne commence, tout se suspend. Le temps s’épaissit, s’étire, se retient.
Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les carrefours m’arrêtent, les virages me repoussent plus loin. Je dérive, je me perds exprès, je recule. Les heures s’allongent, la fatigue tombe, mais elle n’apaise pas. C’est juste une autre forme de sursis.
La ville accompagne ce flottement : vitrines croisées sans entrer, bancs frôlés sans m’asseoir, cafés dépassés sans franchir la porte. Tout est prétexte à contourner, à éluder. J’attends sans savoir quoi, mais j’attends.
encore plus "palpable" ?
La lampe est allumée, le carnet ouvert, le crayon posé. Je reste immobile. Chaque geste devient un sursis : boire une gorgée d’eau, déplacer la chaise, fixer la poussière sur la table. Rien ne commence, tout se suspend. Le temps s’épaissit, il flotte dans la pièce comme une matière dense qu’on ne traverse pas.
Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les carrefours m’arrêtent, les virages me repoussent plus loin. Je dérive, je recule, je me laisse fatiguer. La fatigue tombe mais n’apaise rien, elle prolonge seulement l’état, elle le maintient.
La ville s’accorde à cette dérive : vitrines franchies du regard sans entrer, bancs frôlés sans m’asseoir, cafés dépassés sans franchir la porte. Tout repousse, tout diffère. J’attends sans savoir quoi.
À force, l’attente n’est plus un état mais une présence. Elle se tient derrière moi, à hauteur d’épaule, comme une ombre qui avance au même pas. Elle me touche sans me toucher. Elle s’épaissit autour des lampadaires, elle s’étire dans le bruit des pas des autres, elle s’assoit à ma place sur les bancs que je délaisse. Je ne marche plus seul, je marche avec elle.
- transformer l’attente en une réalité autonome ?*
La lampe est allumée, le carnet ouvert, le crayon posé. Je reste immobile. Chaque geste devient un sursis : boire une gorgée d’eau, déplacer la chaise, fixer la poussière sur la table. Rien ne commence, tout se suspend. Le temps s’épaissit, il flotte dans la pièce comme une matière dense qu’on ne traverse pas.
Quand l’attente me serre trop, je sors. Je descends dans la rue, je marche sans but. Les carrefours m’arrêtent, les virages me repoussent plus loin. Je dérive, je recule, je me laisse fatiguer. La fatigue tombe mais n’apaise rien, elle prolonge seulement l’état, elle le maintient.
La ville s’accorde à cette dérive : vitrines franchies du regard sans entrer, bancs frôlés sans m’asseoir, cafés dépassés sans franchir la porte. Tout repousse, tout diffère. J’attends sans savoir quoi.
À force, l’attente n’est plus un état mais une présence. Elle se tient derrière moi, à hauteur d’épaule, comme une ombre qui avance au même pas. Elle se rapproche sans me toucher, mais je sens sa densité. Dans le halo des lampadaires, elle prend une forme, vague, fluctuante, un corps de brume. Elle se dédouble dans les vitrines, elle s’assoit à ma place sur les bancs que je délaisse.
Je ne marche plus seul : je marche avec elle. Et quand je tente de m’arrêter, elle ne s’arrête pas. Elle avance d’un pas supplémentaire, comme si elle connaissait déjà la suite.
Mais c’est qui ce narrateur ? ça dit quoi de lui ?
Ça révèle d’abord une faille centrale : le narrateur n’agit jamais de lui-même, il se laisse absorber par le temps. Il vit dans la suspension, dans le report. L’attente n’est pas un accident mais son mode d’existence.
Ensuite, cela montre sa peur de la décision. Les gestes qu’il fait — boire, déplacer une chaise, sortir marcher — sont des gestes d’évitement. Rien n’est affronté de front. L’attente devient la forme la plus pure de son rapport au monde : il ne vit pas, il diffère.
Le fait qu’elle prenne corps, qu’elle se matérialise en présence, dit que cette passivité l’a tellement envahi qu’elle est devenue autonome, presque indépendante de lui. Autrement dit, son incapacité à agir fabrique un double, une entité qui l’accompagne, qui prend le relais.
Enfin, ça révèle une angoisse métaphysique : il ne sait pas ce qu’il attend, ni de qui, ni pourquoi. L’attente le définit sans objet clair. C’est le portrait d’une vie tenue dans le suspens, où l’on finit par être guidé par ce qu’on subit.
qu’est-ce qui a bien pu provoquer ça ?
Cause existentielle (ouverte, universelle) L’état n’a pas de cause précise : c’est le rapport du narrateur au monde. Une sorte de disposition à différer, peut-être liée à une peur diffuse du réel. Ici, l’attente devient métaphysique : elle est ce qui reste quand rien ne s’impose.
Cause intime (psychologique / biographique) Un événement ancien — un deuil, une rupture, un échec fondateur — a brisé l’élan. Depuis, chaque geste est ajourné, comme si toute décision risquait de reproduire la perte. L’attente est un refuge contre la répétition du choc.
Cause fantastique (inscrite dans le récit) Ce n’est pas vraiment lui : c’est une force qui s’est greffée à sa vie. L’attente serait une entité qui l’habite et qui l’a modelé. Elle se nourrit de ses ajournements et les amplifie. On ne sait pas si elle vient de lui ou si elle l’a choisi comme hôte.
Cause sociale / contemporaine Un contexte étouffant — travail bureaucratique, injonctions multiples, rythmes mécaniques — a peu à peu dissous l’initiative. Le narrateur en est resté à l’état de suspension permanente, entre mails à répondre, tâches à accomplir, toujours différées.
prenons l’échec fondateur comme prétexte, ce serait quel genre d’évènement ?
Un tel état peut naître d’un échec qui n’est pas seulement une « défaite » mais une coupure dans l’élan vital, quelque chose qui installe durablement la peur d’avancer. Un amour manqué : l’attente d’une réponse (lettre, coup de fil, rendez-vous) qui n’est jamais venue. Le temps suspendu alors s’est figé et est devenu son mode de vie.
Un projet d’écriture ou d’art avorté : un manuscrit refusé, un texte détruit, un concours échoué. L’échec s’est greffé comme preuve qu’agir mène à la chute.
Un silence familial : un mot attendu d’un père ou d’une mère, jamais donné. Attente d’une reconnaissance, restée en suspens, qui a contaminé toute relation ultérieure.
Un rendez-vous manqué : il aurait dû être là, il ne s’y est pas rendu (ou trop tard), et l’événement a pris un autre cours — accident, disparition, perte. Depuis, il redoute chaque décision comme un point de bascule.
Un examen ou passage initiatique raté : diplôme manqué, service militaire esquivé, rite de passage jamais accompli. Comme si la vie adulte était restée à distance, différée.
Ce qui compte n’est pas tant l’échec que la cristallisation : à ce moment précis, il a appris à se protéger en suspendant l’action. L’attente est devenue sa cuirasse.
possible que le narrateur coche toutes les cases
sédimentation d’attentes inachevées : amour manqué, projet détruit, parole parentale absente, rendez-vous raté, seuils non franchis. Ce n’est pas un seul traumatisme mais une suite, chaque fissure ajoutée à la précédente. L’effet cumulé est que toute action nouvelle est ressentie comme dangereuse : soit elle échoue, soit elle réactive l’échec passé. Alors il attend. L’attente n’est pas seulement refuge, c’est la seule forme d’action qu’il s’autorise.
Ce qui peut produire quelque chose de fort, le récit peut suggérer ces causes en touches brèves, comme des échos : une lettre jamais reçue, un manuscrit brûlé, un mot retenu par un parent, une convocation manquée, une porte jamais franchie. Chacun apparaît une seconde, puis se retire — à l’image de l’attente elle-même.
exemple Je marche. Les rues se succèdent, toujours les mêmes vitrines, les mêmes façades. À chaque pas, une image revient, puis disparaît.
Une lettre jaunie, restée vide, sans réponse. Un téléphone décroché trop tard. Un manuscrit serré contre ma poitrine, puis jeté dans une corbeille que j’ai moi-même allumée. Une porte claquée dans un couloir familial, derrière laquelle le mot attendu n’est jamais sorti. Un quai de gare où je n’ai pas couru, le train parti, et quelqu’un resté de l’autre côté. Une convocation froissée au fond d’une poche, jamais ouverte.
Tout cela marche avec moi. Ce ne sont pas des souvenirs, mais des angles morts : ce que je n’ai pas fait, ce que j’ai manqué. Chaque détour de rue est un rappel. Chaque pas rallonge l’ajournement.
il ressent quoi ce narrateur, de la culpabilité ?
il vit avec la double peine — l’échec répété et la culpabilité de l’avoir laissé s’installer. Mais il sait en même temps que ce n’était pas un choix volontaire, plutôt une mécanique intime, presque une fatalité. L’attente n’est pas une faiblesse qu’il aurait pu corriger, c’est son mode d’être au monde. Je le sais, je suis fautif. Chaque absence, chaque retard, chaque silence portait mon nom. Mais je n’ai jamais su faire autrement. Comme si une part de moi décidait toujours avant moi, me retenait, me coupait l’élan. J’ai cru longtemps qu’il s’agissait d’une faute morale, d’un manque de courage. Peut-être ce n’était que ma forme de vie : attendre, différer, manquer le pas.
ou encore :
Je marche et je sais déjà que je suis fautif. Chaque carrefour traversé trop tard, chaque porte non franchie, chaque silence : tout est de moi. Rien ne m’a été arraché, c’est moi qui n’ai pas su. Mais je ne pouvais pas autrement. Quelque chose décidait avant moi, une main invisible qui me retenait par l’épaule, qui me coupait l’élan. J’ai cru qu’il fallait nommer ça lâcheté. Maintenant je comprends : c’est ma manière d’avancer. Différer, manquer le pas, attendre.
il doit tout de même bien y avoir une sorte de bénéfice à tout cela ?
Cet état d’attente, de report, même s’il semble destructeur, porte aussi un bénéfice caché :
Protection : ne pas agir, c’est éviter la répétition de la blessure. L’attente est une cuirasse contre de nouveaux échecs.
Acuité : en suspendant le geste, le narrateur observe davantage. Il perçoit les détails que d’autres, pressés, ne voient pas.
Réservoir : tout ce qui est différé s’accumule. Cette vie « manquée » n’est pas vide, elle devient matière latente, prête à se condenser autrement (en texte, en visions, en présence fantastique).
Espace de résistance : refuser d’avancer, c’est aussi refuser d’être pris dans la mécanique sociale des échéances, des injonctions. C’est une forme d’insoumission muette.
Autrement dit, ce n’est pas que du manque : c’est aussi une forme de vie paradoxale, où la suspension devient un mode de perception et d’endurance.
du coup :
J’ai longtemps cru que je ne faisais que manquer, mais l’attente m’a protégé aussi. Elle me détourne du coup porté, elle m’évite l’erreur répétée. Elle me laisse au bord, mais de ce bord je vois tout : les gestes des autres, leurs élans, leurs chutes. C’est peut-être là mon avantage : rester en retrait, mais avec les yeux ouverts.
ou encore :
*Je marche et chaque pas me rappelle ce que je n’ai pas fait. Je suis coupable d’avoir attendu, toujours trop, toujours trop tard. Faute après faute, j’ai laissé passer l’instant.
Mais sans l’attente je me serais brisé. Elle m’a retenu, elle m’a couvert. Chaque recul m’a sauvé d’un coup plus dur.
Je me dis que j’ai gâché, que je n’ai su que manquer. Les lettres non envoyées, les rendez-vous ratés, les portes jamais franchies. Tout m’accuse.
Et pourtant, à force de rester en retrait, j’ai vu ce que d’autres n’ont pas vu. Le détail qu’ils ont traversé en courant, je l’ai recueilli. Le silence qu’ils ont fui, je l’ai entendu.
Je suis un lâche, oui. Mais ce lâche a survécu. C’est peut-être cela l’attente : faute et protection en même temps. Une perte, et son abri.*
et plus encore :
*Je marche et j’entends la voix qui dit : tu as manqué encore, tu as fui, tu as différé. Elle compte mes silences comme d’autres tiennent leurs comptes de dettes.
Puis une autre s’élève : sans moi tu serais tombé. Je t’ai protégé. Je t’ai gardé à distance de leurs pièges. Grâce à moi tu respires encore.
La première reprend : tu n’as rien bâti, rien poursuivi, tu n’as fait que remettre. Tout ce que tu crois sauver, tu l’as perdu par avance.
L’autre insiste : j’ai ouvert tes yeux. Je t’ai appris la marge, le détail, le silence. Je t’ai donné un regard que les autres n’auront jamais.
Je marche entre elles deux. Coupable et sauvé. Je ne sais plus laquelle est moi. Peut-être les deux. Peut-être aucune.*
Bon d’accord et si ça prenait une tournure fantastique ?
*e m’arrête. Elle ne s’arrête pas. Elle avance de deux pas encore, puis se tourne. Je la vois enfin. Pas une silhouette pleine, plutôt un contour, une densité de nuit découpée dans la lumière des lampadaires. Pas de visage, mais je sais qu’elle me regarde.
Tu crois que tu marches seul ? dit-elle. Sa voix est la mienne, plus grave, plus assurée. Depuis toujours je t’accompagne. Tu ne fais que retarder, mais c’est moi qui retiens. Tu te dis coupable, mais sans moi tu serais déjà tombé mille fois.
Je voudrais répondre mais ma gorge se ferme. Elle avance encore, à pas calmes, comme si la rue lui appartenait. Chaque geste est sûr, là où le mien hésite.
Regarde-moi bien, ajoute-t-elle. Je suis ton attente. Je suis ce que tu n’as pas fait, ce que tu n’as pas dit. Je suis ta faute, et ton salut.
Je reste cloué, incapable de fuir.*
ça rappelle un peu l’histoire du carnet et de la rivière cette ombre ... une continuité : le narrateur, prisonnier de ses ajournements, croise cette présence qui, comme à C. , ouvre une brèche. Pas une délivrance — plutôt un glissement. L’attente cesse d’être seulement subie, elle devient un passage, une dérive hors du connu.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Archives
embryons —à faire pousser dans l’encre
notes pour Le sabbath des calques Une surcouche AR (= augmented reality overlay, calque de réalité augmentée), c’est une couche d’informations numériques affichée par-dessus le monde réel via un écran (téléphone, lunettes, pare-brise). Elle ne remplace pas le réel : elle l’annote, le guide, le filtre. Concrètement, ça fait quoi ? Affichage : flèches de navigation sur la rue, étiquettes “Boulangerie — ouvert”, prix sur produits vus par la caméra, noms des plantes dans un parc. Action : bouton “ouvrir la porte”, “signaler un nid-de-poule”, “appeler un ascenseur”, “déverrouiller un trottinette” quand tu regardes l’objet. Filtrage : tu ne vois que certains commerces (ex : partenaires), ou seulement les bornes de recharge compatibles avec ton abonnement. Maintenance : un technicien voit les canalisations invisibles sous la chaussée, l’état d’un transformateur, la vanne à fermer. Comment ça marche (simple) La caméra/localisation capte où tu es et ce que tu vises. Un calque (la surcouche) associe à ce lieu/objet des données + droits (texte, icônes, commandes). Le système rend ces données alignées sur la scène réelle (position/orientation). Pourquoi c’est important dans “Le sabbat des calques” Dans l’histoire, chaque surcouche AR n’est pas qu’un visuel : elle porte des droits et des flux (livraison, entretien, accès, soins). Si on désactive les calques sans procédure de retour, certaines choses sortent du graphe (plus d’ID, plus de tournée) et “n’existent” plus pour la ville. D’où le nom résolutoire : un énoncé public qui ré-attache officiellement les lieux/objets/personnes au système. En bref : une surcouche AR, c’est un calque opératoire qui dit au monde numérique quoi est où et qui peut faire quoi avec. Quand tu coupes le calque, tu coupes souvent l’accès autant que l’affichage. ID 1 Dans une métropole gouvernée par des surcouches de réalité augmentée qui pilotent livraisons, soins, entretien et droits d’accès, un collectif obtient une heure hebdomadaire sans calques pour “souffler”. Effet pervers : ce qui n’est pas re-référencé à la reprise est considéré obsolète par les plateformes, dé-publié des index, puis “cesse d’exister” pour la ville (plus d’ambulance, plus de tournée, plus d’adresse résolue). Quand une petite clinique disparaît des systèmes, une cartographe d’infrastructures remonte la chaîne technique et découvre que visibilité = existence procédurale ; désactiver sans formule de retour équivaut à effacer. Elle invente un « nom résolutoire » : une nomenclature publique, prononcée sur site et horodatée, que les opérateurs doivent accepter pour ré-attacher lieux, objets et personnes au graphe urbain. Climax sur la place centrale : la ville lit ses propres noms pour se faire revenir, tandis que les éditeurs de calques tentent d’en limiter la portée. Enjeu : reprendre la responsabilité d’“éditer” le réel sans renoncer au repos collectif. ID 2 Le locataire non inscrit Dans un vieil immeuble où l’existence des habitants tient à un registre calligraphié du hall, le nom de Lise refuse de “prendre” : l’encre perle et s’efface. La nuit, un voisin invisible prononce son nom avec une exactitude troublante — chaque syllabe qu’il dit fixe sa propre chambre (odeurs, objets, chaleur), tandis que Lise disparaît des sonnettes, du courrier, du bail. En fouillant les archives notariales, Lise découvre le vrai nom du voisin, effacé après un décès douteux : pour se sauver, elle devra le prononcer en face dans l’appartement muré — geste résolutoire qui le libérera… ou la rayera définitivement du registre. Scène-pivot : minuit, palier glacé, Lise ouvre la porte condamnée, lit à voix claire le nom exact ; les lettres du hall se remettent à l’encre — mais pas toutes. Thèmes : nom comme emprise (parasitage d’identité) → nom résolutoire (révocation par adresse), droit d’exister par inscription, loyers fantômes, éthique de la restitution. 3 Le nom-miroir Dans une petite ville, un photographe ambulant promet de révéler aux clients leur “vrai nom” en développant leurs portraits au nitrate d’argent. Sur chaque cliché, un mot apparaît sur le col ou la peau, différent du prénom civil : “Déserteur”, “Fiancée”, “Veilleur”, “Fille de personne”… Celui qui adopte ce nom gagne un pouvoir discret (veille sans dormir, franchit une barrière, traverse le fleuve gelé) mais perd une chose intime en échange (un souvenir, une capacité). Une femme veuve découvre que le mot sur sa photo — “Soeur” — rétablit une sœur que sa famille a gommée. Pour arrêter l’hémorragie de pertes, il faudra renommer la ville entière lors d’une exposition nocturne où l’on retourne les photos et déclare publiquement le nom qu’on refuse de porter. -- Nom en jeu : habiliter (adopter le mot confère) ↔ emprise (le mot prélève) → résolutoire (publiciser le refus d’un nom). 4 La maison aux noms empruntés Une maison bourgeoise accueille des colocataires à bas prix… à condition de déposer, dans un coffret, un nom dont on ne se sert plus (surnom d’enfance, nom d’artiste, nom d’emprunt). Tant qu’on y habite, la maison protège (pas de cauchemars, pas de cambriolages). À la Toussaint, le coffret s’ouvre et la maison revêt ces noms : les pièces prennent des caractères (une cuisine “Maman”, un couloir “Caporal”, une chambre “Perdue”). Quand une nouvelle locataire dépose par erreur son vrai nom complet, la maison s’en pare et la dépossède : plus personne dehors ne la reconnaît. Pour la récupérer, les habitants doivent organiser une veillée de restitution où chacun ré-appelle un nom prêté à son vrai détenteur, jusqu’au dernier — le sien. -- Nom en jeu : emprise (la maison vit des noms prêtés) → résolutoire (rite de restitution, nom rendu au bon destinataire, à voix claire).|couper{180}

Archives
Comment écrire une histoire avec un peu de méthode
Protocole léger — pour ne pas s’égarer Pour le moment, seules la première et la sixième propositions de l’atelier d’écriture en cours me proposent des pistes que je pourrais relier à un travail personnel. Disons qu’elles « matchent » dans les circonstances actuelles, par l’expansion que je constate à vouloir les développer. Mais pour ne pas m’égarer, il me faut un fil d’Ariane : une méthode — même légère suffirait. D’où l’envie de rédiger un modeste protocole. 1. Partir d’un embryon (format fixe) Fiche minuscule à chaque graine — 6 lignes, pas plus. Signe (trace perçue) : sifflement / buée / vitre / odeur de térébenthine / feux rougeâtres. Geste du corps (déclencheur) : ralentir / bifurquer / s’asseoir / lever la main / détourner le regard. Seuil (lieu précis) : porte / vitre / entrée de dancing / butte / péage / atelier. Distance (échelle) : hors-champ / voix seule / silhouette / face-à-face muet. Objet-totem (détail récurrent) : terre de sienne / yak / Abbesses / Keaton / autoroute. Sortie (chute) : question / rire étouffé / non-réponse / retour marche. Garder la fiche en tête de texte (ou en commentaire). C’est l’« ADN » de la série. 2. Écrire en échelles (x3) À partir d’une même graine, produire trois tailles — on ne réécrit pas, on déplie. Nano (50–80 mots) : une image + une action. Court (150–220 mots) : ajouter un seuil et une résonance sensorielle. Plein (300–450 mots) : même scène, avec bascule (ex. : vitre → café → geste non rendu). Résultat : 3 versions compatibles, pas 3 textes concurrents. 3. Invariants / variables (cohérence douce) Choisir 4 invariants pour toute la série (ex. : il ne parle pas directement ; jamais de prénom ; un seuil par scène ; une seule sensation dominante par texte). Tout le reste = variables (lieux, météo, vitesse, foule/solitude). Chaque nouveau texte repiquera 2 éléments du dictionnaire (ex. : « vitre » + « sifflement ») et ajoutera 1 élément neuf.4. Matrice des axes (pour générer vite) Quand ça sèche, combiner 4 axes (au dé, ou au hasard). Lieu : rue / intérieur sombre / hauteur / périphérie / transit. Signe : son / lumière / odeur / chaleur-froid / objet déplacé. Distance : trace / voix / silhouette / présence derrière vitre. Sortie : question sans réponse / rire / coupure / marche. Tirer 1–1–1–1 → embryon prêt en 10 secondes. 5. Numérotation claire (versioning sans peine) Nom : 2025-10-22_Porte_A1.0.md (A = parcours canonique ; B = alternance ; C = enquête). Patch : A1.1 (même scène, échelle différente), A1.2 (chute modifiée), etc. En tête de fichier : une ligne Changelog (≤ 12 mots) : « + vitre embuée ; – ponctuation coupée ».6. Couture entre versions (le lien cohérent) Passe « couture » hebdo : on n’écrit pas, on ajoute des échos croisés. Le sifflement réapparaît au dancing (à la sortie des toilettes). La terre de sienne existe en reflet rouge sur un feu arrière. Les Abbesses laissent une buée qui reviendra sur la vitre du café. Relier par capillarité, pas par explication. 7. Arches de lecture (A/B/C…) Garder les 3 ordres (A/B/C). À chaque nouvel épisode (ex. : Autoroute), décider tout de suite : A = pont entre deux nœuds (entre Question et Voix). B = coda hors séquence (ne pas toucher à l’alternance dedans/dehors). C = indice supplémentaire (C4, C5, etc.). Chaque texte rejoint au moins une arche — parfois deux. 8. Rituel (30 minutes chrono) 10 min : écrire Nano à partir d’une graine. 10 min : passer en Court (ajouter seuil + sensation). 5 min : Couture (ajouter l’écho croisé vers un ancien texte). 5 min : Classer (A/B/C), nommer (…_A1.1), noter le changelog.9. « Bible » d’une page (pour ne pas dévier) Un seul document, vivant : Règles d’or : tes 4 invariants. Dico de détails : 10 totems max. Topologie : 5 lieux maîtres (porte, vitre, dancing, butte, autoroute/atelier). Timeline fantôme : ordre canonique + derniers ajouts (à cocher après chaque session).Annexe — Fiche-embryon (copier/coller) Signe : Geste du corps : Seuil : Distance : Objet-totem : Sortie :|couper{180}

Archives
drôle de nuit
-- Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais un cube empilé parmi d’autres cubes. Cette promiscuité était d’autant plus difficile à vivre que je ne pouvais faire aucun mouvement ni même protester : aucun son ne sortait de ma bouche. D’ailleurs je n’avais pas de bouche. Juste une face lisse, une face avant exactement semblable aux cinq autres. Pour m’en sortir, j’ai rêvé dans mon rêve que je devenais sphérique, puis j’arrivais à m’extraire de la pile, non sans mal ; j’ai fait une chute vertigineuse. Une chute dans le noir sans fin qui durait durait durait. Pour m’évader de ce rêve-ci, je me suis encore transformé en mouche parce que je ne pouvais pas vraiment faire autre chose. J’aurais préféré quelque chose de plus noble. Mais on fait avec ce qu’on peut. En fin de compte, au moment même où j’apercevais enfin la lumière, que j’allais m’élever dans les airs au-dessus de je ne sais quel paysage, voici que je me suis fait gober par un oiseau et je suis devenu oiseau par je ne sais quelle alchimie onirique. Mais l’oiseau est mécanique, il est un produit d’une gigantesque intelligence artificielle qui désormais gouverne toute la Terre. Ses rêves sont des rêves de cubes, et me revoici à mon point de départ. La question, au réveil : seules les mouches sont-elles vivantes, non altérées encore par l’intelligence artificielle ?|couper{180}