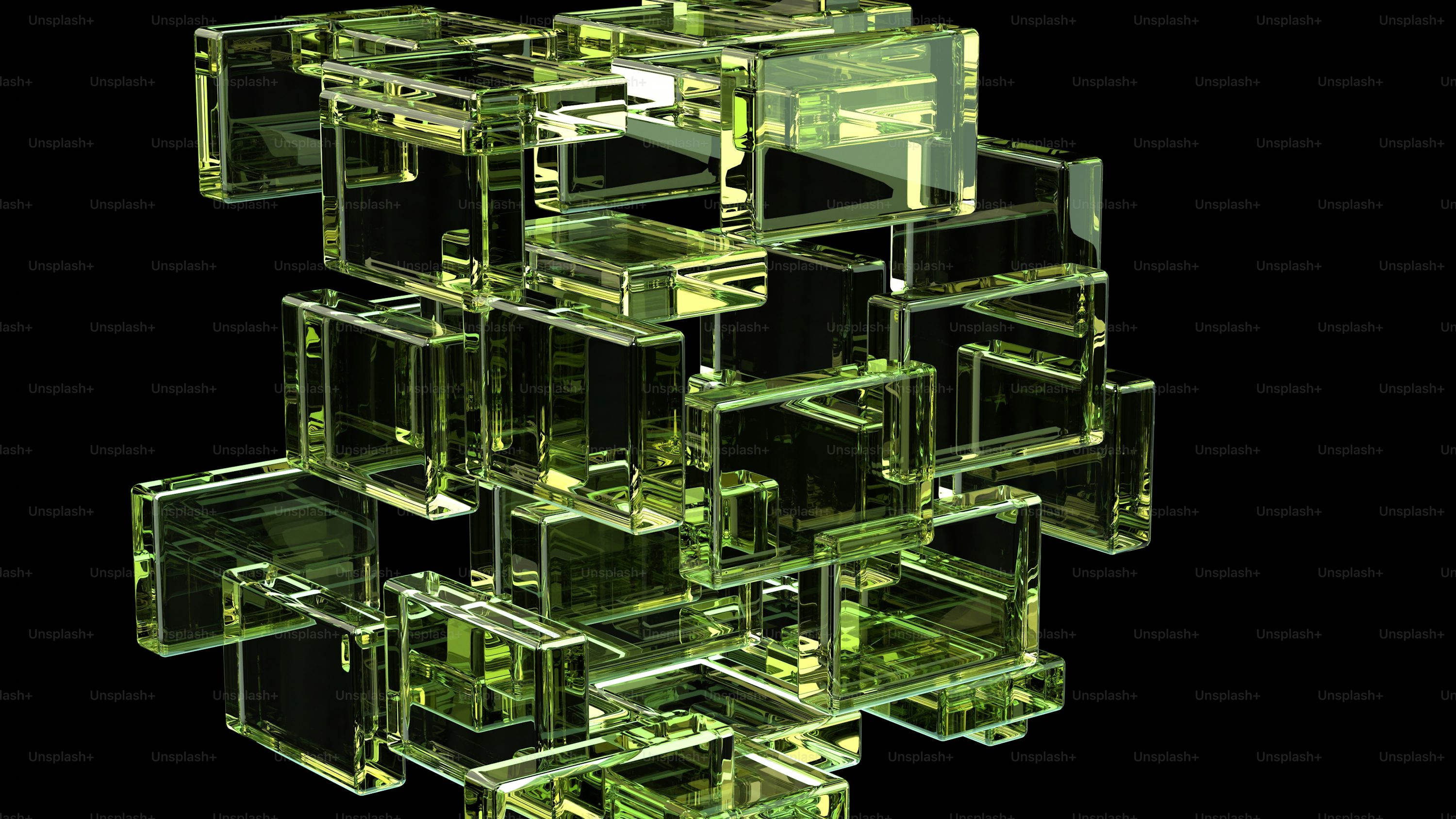L’art du mensonge
graine
Un narrateur entend à la radio une affirmation brutale : « Les Juifs cultivent l’art du mensonge depuis la nuit des temps. » Intrigué, il veut vérifier la source. Il découvre un vieux rabbinologue qui lui remet un manuscrit en hébreu, qu’il prétend être une copie perdue du Talmud. Le texte semble confirmer, de manière ambiguë, cette idée : il y est écrit que « le mensonge, bien manié, est plus vrai que la vérité elle-même ». Le narrateur plonge dans l’étude du texte. Peu à peu, il se rend compte qu’il n’est plus capable de distinguer ce qui est vrai ou faux : ses souvenirs s’inversent, ses conversations se brouillent, ses propres écrits se dédoublent entre mensonge et vérité. À mesure que l’illusion progresse, il comprend que le manuscrit n’était peut-être pas un document juif mais une contrefaçon médiévale, conçue pour nourrir l’antisémitisme. Pourtant, trop tard : le mal est fait. Le narrateur devient incapable de vivre autrement que dans le doute permanent.
Dans les dernières lignes, il note :
« Je voulais débusquer le mensonge. J’ai découvert qu’il se loge dans l’accusation même qui prétend le dénoncer. Peut-être que le vrai art du mensonge n’est pas d’inventer, mais de faire croire que l’autre ment depuis toujours. »
Sources, matières, références.
L’idée d’un « faux manuscrit » présenté comme authentique, servant à tromper ou à inverser les valeurs, est un thème ancien qui a traversé la littérature, l’histoire des religions et le fantastique. Voici une cartographie :
Antiquité & Moyen Âge
Les pseudo-évangiles (apocryphes) : dès les premiers siècles, on a vu circuler des textes attribués à des apôtres ou prophètes, mais considérés ensuite comme faux → fascinant exemple de forgeries religieuses.
Le Testament des Douze Patriarches ou le Livre d’Hénoch → textes jugés « falsifiés » ou « interpolés » par certains courants juifs et chrétiens.
Les faux de la chrétienté médiévale :
La Donation de Constantin (VIIIᵉ siècle) → faux document qui donnait au pape l’autorité politique sur Rome et l’Occident.
Les fausses reliques, très fréquentes, qui alimentaient un imaginaire sacré.
Renaissance – Lumières
Érasme, Rabelais : évoquent les falsifications de textes antiques et religieux, en les tournant en dérision.
Voltaire a beaucoup dénoncé les faux religieux ou historiques qui servaient de justification au pouvoir.
XIXᵉ siècle
Le Manuscrit trouvé à Saragosse (Jan Potocki, 1804) → faux manuscrit espagnol découvert par hasard, qui contient des récits enchâssés ; un jeu sur l’authenticité et le faux.
Les faux médiévaux « retrouvés » : les romantiques se passionnent pour de prétendus manuscrits anciens (ex. le Chansonnier ossianique de Macpherson, présenté comme antique mais inventé).
Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine → dialogue avec des figures qui représentent parfois des mensonges transformés en vérités religieuses.
XXᵉ siècle
Lovecraft → le fameux Necronomicon, faux grimoire arabe attribué à Abdul Alhazred, qui devient plus réel que réel. Ici, le faux devient une entité littéraire autonome.
Borges (ex. Pierre Ménard, auteur du Quichotte ou Tlön, Uqbar, Orbis Tertius) → tout un art du faux manuscrit, du texte inventé présenté comme authentique.
Umberto Eco, Le Nom de la rose → toute l’intrigue tourne autour d’un livre perdu d’Aristote, dont l’existence est mi-historique, mi-fictive.
Vladimir Volkoff, Le Montage → roman sur la désinformation, où les faux documents fabriquent des réalités politiques.
Cas historiques liés aux Juifs
Le Protocole des Sages de Sion (début XXᵉ siècle) → un faux antisémite fabriqué en Russie tsariste, présenté comme authentique, qui a alimenté des discours de haine. C’est l’un des exemples les plus terribles d’une contrefaçon utilisée pour accuser « les Juifs » de mensonge et de manipulation.
Des critiques modernes (notamment chez Hannah Arendt et Norman Cohn) ont étudié ce faux comme l’archétype du document fabriqué qui contamine la réalité.
En littérature fantastique
H.P. Lovecraft → encore, car son œuvre repose sur des faux traités, faux grimoires, faux manuscrits (le Necronomicon).
Stanisław Lem, Le Congrès de futurologie → jeux de falsifications, où les perceptions elles-mêmes sont truquées.
Philip K. Dick → univers saturés de documents et réalités falsifiés (Le Maître du Haut Château).
Plan narratif : Le Manuscrit de l’Art du Mensonge
1. Exposition (doute et curiosité)
Le narrateur (chercheur, historien ou écrivain) tombe par hasard, dans une bibliothèque d’abbaye ou une collection privée, sur un manuscrit oublié, daté du XIVᵉ siècle.
Titre : Ars Mendacii Hebraeorum (L’art du mensonge des Hébreux).
Il apprend par les notes marginales que ce texte fut jadis interdit, brûlé, puis mystérieusement recopié par des moines.
Le manuscrit prétend démontrer que, dans la tradition juive, le mensonge est une vertu — une arme subtile, un art ancestral.
Le narrateur d’abord rit de cette absurdité, y voyant un exemple typique de propagande antisémite médiévale.
2. Développement (la contamination du faux)
En traduisant le texte, il découvre des passages étrangement convaincants, où chaque citation biblique ou talmudique est retournée, altérée, faussée — mais avec une habileté qui le trouble.
Le manuscrit donne aussi des « règles » du mensonge : comment le faire passer pour vérité, comment inverser la perception du réel.
Peu à peu, le narrateur constate que ces règles fonctionnent dans sa vie quotidienne : il voit autour de lui des exemples qui les confirment (politiques incohérents glorifiés, imposteurs acclamés comme génies, mensonges repris comme dogmes).
Sa propre mémoire commence à vaciller : des souvenirs personnels changent de couleur, il doute de ce qu’il a vu ou vécu.
3. Climax (le pouvoir occulte du mensonge)
Une nuit, il découvre dans une annexe du manuscrit des invocations étranges, décrivant le mensonge non comme une faute morale, mais comme une force cosmique.
Cette force, invisible, s’incarne à travers les siècles en textes falsifiés, en faux traités, en slogans.
Le narrateur comprend que le manuscrit n’est pas qu’un faux antisémite : il est un vecteur, un canal d’une entité ancienne — l’Intelligence Inversée — qui se nourrit de la confusion entre vérité et mensonge.
À mesure qu’il lit, le texte semble changer sous ses yeux : les phrases s’inversent, le latin se réécrit, comme si le mensonge lui-même le contaminait.
4. Dénouement (le choix impossible)
Le narrateur est au bord de la folie : il sait que ce manuscrit est une falsification, mais il reconnaît en même temps qu’il contient une vérité terrible — celle que l’humanité préfère le mensonge à la vérité, et que cette préférence n’est pas humaine, mais imposée par une force au-delà du monde.
Il hésite : détruire le manuscrit (au risque de perdre à jamais la preuve de ce qu’il a découvert) ou le conserver (au risque de répandre l’inversion).
La nouvelle se termine sur une note ambiguë :
Soit il brûle le livre, mais croit entendre un rire derrière lui, comme si rien n’était effacé.
Soit il choisit de garder le manuscrit et de le recopier — devenant lui-même l’instrument de propagation du faux.
Thèmes travaillés
Inversion des valeurs : le faux devient plus réel que le vrai.
Pouvoir des textes : un document falsifié peut traverser les siècles et contaminer la pensée.
Ambiguïté morale : même en dénonçant un faux, on lui donne corps.
Héritage historique : rappel des Protocoles des Sages de Sion comme archétype du faux meurtrier.
Début de L’Art du Mensonge
Je n’avais aucune raison de pénétrer ce soir-là dans les salles basses de la bibliothèque des Jésuites, si ce n’est cette curiosité maladive qui me pousse, depuis toujours, à fouiller les recoins où s’empilent les manuscrits oubliés. Les rayonnages s’inclinaient sous le poids de volumes recouverts de poussière, certains noircis par l’humidité, d’autres rongés par le temps au point de perdre leur titre.
C’est là, au détour d’un carton effondré, que je découvris un cahier relié de cuir, minuscule, au dos presque effacé. Sur la couverture se lisait, tracé d’une main tremblée, ce titre en latin : Ars Mendacii Hebraeorum. L’art du mensonge des Hébreux.
Je crus d’abord à une plaisanterie d’érudit ou à l’un de ces pamphlets médiévaux qui pullulent dans les fonds monacaux. Mais dès que je l’ouvris, je fus saisi par l’élégance d’une écriture serrée, ponctuée de gloses marginales d’origines diverses, certaines en hébreu, d’autres en latin scolastique. Le texte se présentait comme un traité, prétendument issu des écoles talmudiques, démontrant — ou feignant de démontrer — que le mensonge n’était pas seulement toléré, mais cultivé comme une vertu, un art transmis « depuis la nuit des temps ».
Je souris d’abord devant l’évidence grossière du faux. Car tout en moi, formé à l’histoire des hérésies et des supercheries, me criait qu’il s’agissait là d’un simulacre médiéval, forgé sans doute pour nourrir la haine et justifier les pogroms. Pourtant, quelque chose dans le ton du manuscrit, une rigueur glaciale dans ses démonstrations, me troubla. Chaque citation biblique semblait exacte, chaque maxime talmudique subtilement infléchie, jusqu’à paraître plus cohérente que l’original.
Je refermai le cahier, mais une impression persistante demeura : et si ce que je tenais entre mes mains n’était pas seulement un faux, mais la copie infidèle d’une vérité plus ancienne — une vérité interdite, qui, par la ruse du mensonge, avait traversé les siècles pour parvenir jusqu’à moi ?
vocabulaire assez courant, voire plat. S’il s’agit d’écrire sur l’art du mensonge pourquoi ne pas commencer dans le style même du texte en essayant de fournir des détails de plus en plus précis, et d’utiliser un vocabulaire plus savant ?
Par exemple : Les étagères de chêne, massives et veinées, exhalaient une haleine résineuse et rancie, saturée de cire ancienne. Dans cette nef de bois et de pierre, l’air portait une senteur mucide, faite de cuir tanné, d’encre bitumineuse et de parchemins séculaires. Chaque pas soulevait un souffle cryptique, comme si la poussière elle-même avait gardé mémoire des siècles.
Pour cela importance des listes de mots Pour donner à la scène une atmosphère vraiment travaillée (bibliothèque jésuite, manuscrit ancien), il faut éviter les adjectifs trop usuels (vieux, poussiéreux, sombre) et puiser dans un vocabulaire plus précieux, archaïsant, sensoriel.
Bois et matières des étagères
Chêne sombre : massif, noueux, austère, veiné comme une peau ancienne.
Noyer patiné : chaud, brun profond, lustré par des siècles de mains.
Ébène veiné : dense, presque noir, luisant comme une relique.
Acajou veiné : rouge sombre, évoquant une solennité presque liturgique.
Cèdre : exhale une odeur résineuse, persistante, mêlée au parchemin.
Orme : robuste, dur, peu sensible aux vers (les Jésuites aimaient sa solidité).
Les bibliothèques jésuites anciennes étaient souvent en chêne ou en noyer, bois réputés pour leur endurance et leur austérité.
Odeurs dominantes
Relents de cire : cire d’abeille qui recouvrait autrefois les parquets et le bois.
Émanations résineuses : du bois lui-même, qui transpire lentement.
Miasmes de parchemin : odeur sèche, un peu farineuse, de peau tannée.
Effluves de cuir tanné : reliures craquelées.
Senteur de suie : souvenirs de chandelles et lampes à huile.
Amertume de l’humidité : pierres suintantes, poussière mêlée à la mousse.
Odeur ferreuse : parfois, celle des encres oxydées.
Adjectifs et atmosphère (hors langage courant)
Rancie : pour la poussière accumulée.
Capiteuse : pour une odeur forte, presque enivrante.
Mucide : moisi, imprégné d’humidité.
Résineuse : persistante, entêtante.
Bitumineuse : sombre, lourde, comme de vieux encres ou cires.
Funèbre : solennel, empreint de silence.
Archaïque : hors du temps.
Rigoriste : austère, à l’image des Jésuites.
Séculaire : chargé de siècles.
Cryptique : mystérieux, presque codé.
Onguenté : pour le bois imprégné d’huile ancienne.
Monacal : dépouillé mais imprégné de spiritualité.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Archives
embryons —à faire pousser dans l’encre
notes pour Le sabbath des calques Une surcouche AR (= augmented reality overlay, calque de réalité augmentée), c’est une couche d’informations numériques affichée par-dessus le monde réel via un écran (téléphone, lunettes, pare-brise). Elle ne remplace pas le réel : elle l’annote, le guide, le filtre. Concrètement, ça fait quoi ? Affichage : flèches de navigation sur la rue, étiquettes “Boulangerie — ouvert”, prix sur produits vus par la caméra, noms des plantes dans un parc. Action : bouton “ouvrir la porte”, “signaler un nid-de-poule”, “appeler un ascenseur”, “déverrouiller un trottinette” quand tu regardes l’objet. Filtrage : tu ne vois que certains commerces (ex : partenaires), ou seulement les bornes de recharge compatibles avec ton abonnement. Maintenance : un technicien voit les canalisations invisibles sous la chaussée, l’état d’un transformateur, la vanne à fermer. Comment ça marche (simple) La caméra/localisation capte où tu es et ce que tu vises. Un calque (la surcouche) associe à ce lieu/objet des données + droits (texte, icônes, commandes). Le système rend ces données alignées sur la scène réelle (position/orientation). Pourquoi c’est important dans “Le sabbat des calques” Dans l’histoire, chaque surcouche AR n’est pas qu’un visuel : elle porte des droits et des flux (livraison, entretien, accès, soins). Si on désactive les calques sans procédure de retour, certaines choses sortent du graphe (plus d’ID, plus de tournée) et “n’existent” plus pour la ville. D’où le nom résolutoire : un énoncé public qui ré-attache officiellement les lieux/objets/personnes au système. En bref : une surcouche AR, c’est un calque opératoire qui dit au monde numérique quoi est où et qui peut faire quoi avec. Quand tu coupes le calque, tu coupes souvent l’accès autant que l’affichage. ID 1 Dans une métropole gouvernée par des surcouches de réalité augmentée qui pilotent livraisons, soins, entretien et droits d’accès, un collectif obtient une heure hebdomadaire sans calques pour “souffler”. Effet pervers : ce qui n’est pas re-référencé à la reprise est considéré obsolète par les plateformes, dé-publié des index, puis “cesse d’exister” pour la ville (plus d’ambulance, plus de tournée, plus d’adresse résolue). Quand une petite clinique disparaît des systèmes, une cartographe d’infrastructures remonte la chaîne technique et découvre que visibilité = existence procédurale ; désactiver sans formule de retour équivaut à effacer. Elle invente un « nom résolutoire » : une nomenclature publique, prononcée sur site et horodatée, que les opérateurs doivent accepter pour ré-attacher lieux, objets et personnes au graphe urbain. Climax sur la place centrale : la ville lit ses propres noms pour se faire revenir, tandis que les éditeurs de calques tentent d’en limiter la portée. Enjeu : reprendre la responsabilité d’“éditer” le réel sans renoncer au repos collectif. ID 2 Le locataire non inscrit Dans un vieil immeuble où l’existence des habitants tient à un registre calligraphié du hall, le nom de Lise refuse de “prendre” : l’encre perle et s’efface. La nuit, un voisin invisible prononce son nom avec une exactitude troublante — chaque syllabe qu’il dit fixe sa propre chambre (odeurs, objets, chaleur), tandis que Lise disparaît des sonnettes, du courrier, du bail. En fouillant les archives notariales, Lise découvre le vrai nom du voisin, effacé après un décès douteux : pour se sauver, elle devra le prononcer en face dans l’appartement muré — geste résolutoire qui le libérera… ou la rayera définitivement du registre. Scène-pivot : minuit, palier glacé, Lise ouvre la porte condamnée, lit à voix claire le nom exact ; les lettres du hall se remettent à l’encre — mais pas toutes. Thèmes : nom comme emprise (parasitage d’identité) → nom résolutoire (révocation par adresse), droit d’exister par inscription, loyers fantômes, éthique de la restitution. 3 Le nom-miroir Dans une petite ville, un photographe ambulant promet de révéler aux clients leur “vrai nom” en développant leurs portraits au nitrate d’argent. Sur chaque cliché, un mot apparaît sur le col ou la peau, différent du prénom civil : “Déserteur”, “Fiancée”, “Veilleur”, “Fille de personne”… Celui qui adopte ce nom gagne un pouvoir discret (veille sans dormir, franchit une barrière, traverse le fleuve gelé) mais perd une chose intime en échange (un souvenir, une capacité). Une femme veuve découvre que le mot sur sa photo — “Soeur” — rétablit une sœur que sa famille a gommée. Pour arrêter l’hémorragie de pertes, il faudra renommer la ville entière lors d’une exposition nocturne où l’on retourne les photos et déclare publiquement le nom qu’on refuse de porter. -- Nom en jeu : habiliter (adopter le mot confère) ↔ emprise (le mot prélève) → résolutoire (publiciser le refus d’un nom). 4 La maison aux noms empruntés Une maison bourgeoise accueille des colocataires à bas prix… à condition de déposer, dans un coffret, un nom dont on ne se sert plus (surnom d’enfance, nom d’artiste, nom d’emprunt). Tant qu’on y habite, la maison protège (pas de cauchemars, pas de cambriolages). À la Toussaint, le coffret s’ouvre et la maison revêt ces noms : les pièces prennent des caractères (une cuisine “Maman”, un couloir “Caporal”, une chambre “Perdue”). Quand une nouvelle locataire dépose par erreur son vrai nom complet, la maison s’en pare et la dépossède : plus personne dehors ne la reconnaît. Pour la récupérer, les habitants doivent organiser une veillée de restitution où chacun ré-appelle un nom prêté à son vrai détenteur, jusqu’au dernier — le sien. -- Nom en jeu : emprise (la maison vit des noms prêtés) → résolutoire (rite de restitution, nom rendu au bon destinataire, à voix claire).|couper{180}

Archives
Comment écrire une histoire avec un peu de méthode
Protocole léger — pour ne pas s’égarer Pour le moment, seules la première et la sixième propositions de l’atelier d’écriture en cours me proposent des pistes que je pourrais relier à un travail personnel. Disons qu’elles « matchent » dans les circonstances actuelles, par l’expansion que je constate à vouloir les développer. Mais pour ne pas m’égarer, il me faut un fil d’Ariane : une méthode — même légère suffirait. D’où l’envie de rédiger un modeste protocole. 1. Partir d’un embryon (format fixe) Fiche minuscule à chaque graine — 6 lignes, pas plus. Signe (trace perçue) : sifflement / buée / vitre / odeur de térébenthine / feux rougeâtres. Geste du corps (déclencheur) : ralentir / bifurquer / s’asseoir / lever la main / détourner le regard. Seuil (lieu précis) : porte / vitre / entrée de dancing / butte / péage / atelier. Distance (échelle) : hors-champ / voix seule / silhouette / face-à-face muet. Objet-totem (détail récurrent) : terre de sienne / yak / Abbesses / Keaton / autoroute. Sortie (chute) : question / rire étouffé / non-réponse / retour marche. Garder la fiche en tête de texte (ou en commentaire). C’est l’« ADN » de la série. 2. Écrire en échelles (x3) À partir d’une même graine, produire trois tailles — on ne réécrit pas, on déplie. Nano (50–80 mots) : une image + une action. Court (150–220 mots) : ajouter un seuil et une résonance sensorielle. Plein (300–450 mots) : même scène, avec bascule (ex. : vitre → café → geste non rendu). Résultat : 3 versions compatibles, pas 3 textes concurrents. 3. Invariants / variables (cohérence douce) Choisir 4 invariants pour toute la série (ex. : il ne parle pas directement ; jamais de prénom ; un seuil par scène ; une seule sensation dominante par texte). Tout le reste = variables (lieux, météo, vitesse, foule/solitude). Chaque nouveau texte repiquera 2 éléments du dictionnaire (ex. : « vitre » + « sifflement ») et ajoutera 1 élément neuf.4. Matrice des axes (pour générer vite) Quand ça sèche, combiner 4 axes (au dé, ou au hasard). Lieu : rue / intérieur sombre / hauteur / périphérie / transit. Signe : son / lumière / odeur / chaleur-froid / objet déplacé. Distance : trace / voix / silhouette / présence derrière vitre. Sortie : question sans réponse / rire / coupure / marche. Tirer 1–1–1–1 → embryon prêt en 10 secondes. 5. Numérotation claire (versioning sans peine) Nom : 2025-10-22_Porte_A1.0.md (A = parcours canonique ; B = alternance ; C = enquête). Patch : A1.1 (même scène, échelle différente), A1.2 (chute modifiée), etc. En tête de fichier : une ligne Changelog (≤ 12 mots) : « + vitre embuée ; – ponctuation coupée ».6. Couture entre versions (le lien cohérent) Passe « couture » hebdo : on n’écrit pas, on ajoute des échos croisés. Le sifflement réapparaît au dancing (à la sortie des toilettes). La terre de sienne existe en reflet rouge sur un feu arrière. Les Abbesses laissent une buée qui reviendra sur la vitre du café. Relier par capillarité, pas par explication. 7. Arches de lecture (A/B/C…) Garder les 3 ordres (A/B/C). À chaque nouvel épisode (ex. : Autoroute), décider tout de suite : A = pont entre deux nœuds (entre Question et Voix). B = coda hors séquence (ne pas toucher à l’alternance dedans/dehors). C = indice supplémentaire (C4, C5, etc.). Chaque texte rejoint au moins une arche — parfois deux. 8. Rituel (30 minutes chrono) 10 min : écrire Nano à partir d’une graine. 10 min : passer en Court (ajouter seuil + sensation). 5 min : Couture (ajouter l’écho croisé vers un ancien texte). 5 min : Classer (A/B/C), nommer (…_A1.1), noter le changelog.9. « Bible » d’une page (pour ne pas dévier) Un seul document, vivant : Règles d’or : tes 4 invariants. Dico de détails : 10 totems max. Topologie : 5 lieux maîtres (porte, vitre, dancing, butte, autoroute/atelier). Timeline fantôme : ordre canonique + derniers ajouts (à cocher après chaque session).Annexe — Fiche-embryon (copier/coller) Signe : Geste du corps : Seuil : Distance : Objet-totem : Sortie :|couper{180}

Archives
drôle de nuit
-- Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais un cube empilé parmi d’autres cubes. Cette promiscuité était d’autant plus difficile à vivre que je ne pouvais faire aucun mouvement ni même protester : aucun son ne sortait de ma bouche. D’ailleurs je n’avais pas de bouche. Juste une face lisse, une face avant exactement semblable aux cinq autres. Pour m’en sortir, j’ai rêvé dans mon rêve que je devenais sphérique, puis j’arrivais à m’extraire de la pile, non sans mal ; j’ai fait une chute vertigineuse. Une chute dans le noir sans fin qui durait durait durait. Pour m’évader de ce rêve-ci, je me suis encore transformé en mouche parce que je ne pouvais pas vraiment faire autre chose. J’aurais préféré quelque chose de plus noble. Mais on fait avec ce qu’on peut. En fin de compte, au moment même où j’apercevais enfin la lumière, que j’allais m’élever dans les airs au-dessus de je ne sais quel paysage, voici que je me suis fait gober par un oiseau et je suis devenu oiseau par je ne sais quelle alchimie onirique. Mais l’oiseau est mécanique, il est un produit d’une gigantesque intelligence artificielle qui désormais gouverne toute la Terre. Ses rêves sont des rêves de cubes, et me revoici à mon point de départ. La question, au réveil : seules les mouches sont-elles vivantes, non altérées encore par l’intelligence artificielle ?|couper{180}