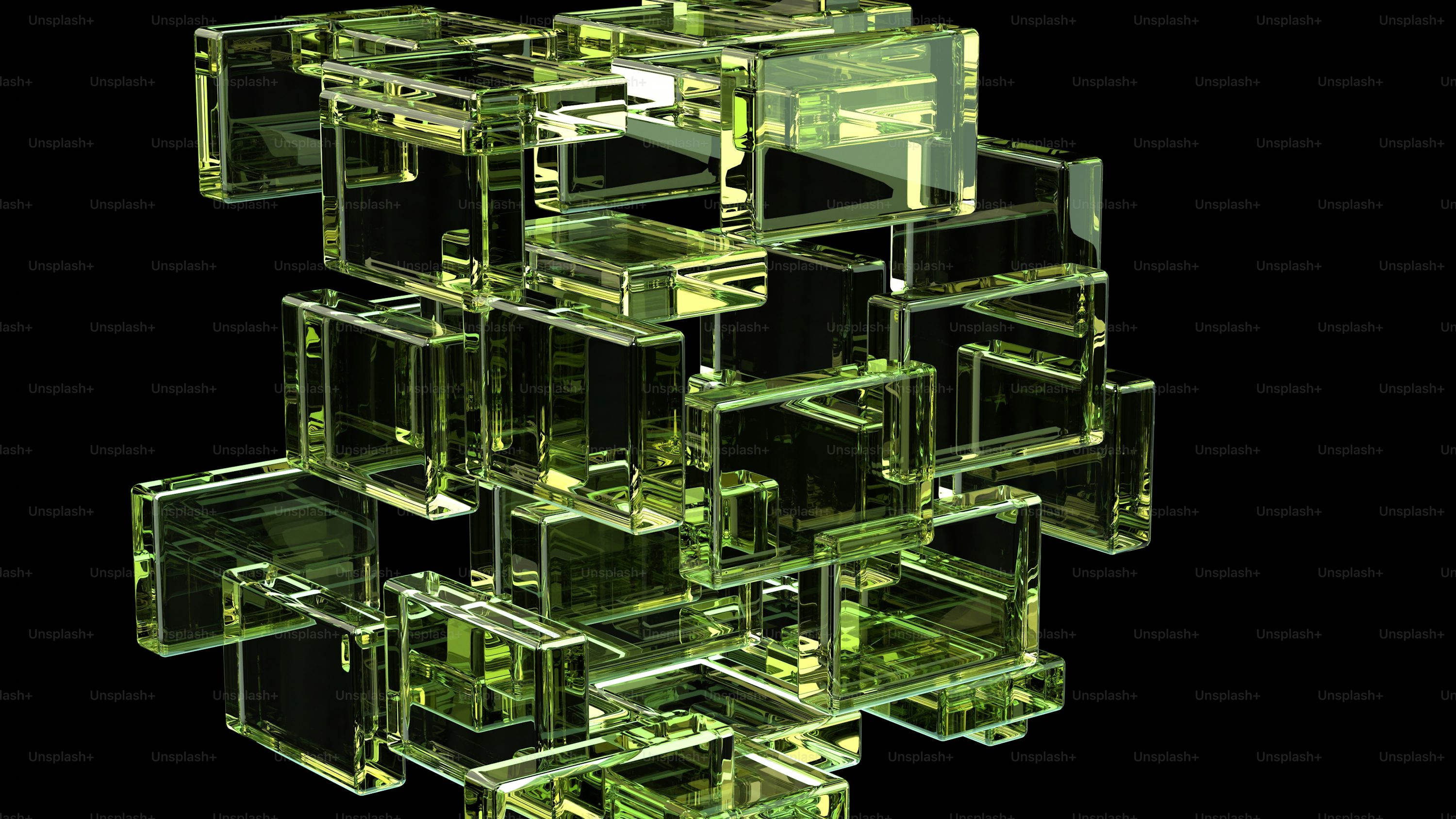inversion
graine : l’inversion des valeurs Quand l’imbécilité devient intelligence et vis versa. Et moi ? Lorsque parfois je doute, que je me dis qu’écrire est vain, c’est parce que je préfère rester dans l’enfer que je me suis choisi, plutôt que d’être entraîné vers un prétendu âge d’or qu’on voudrait m’imposer.
Un narrateur vit dans une cité où les rôles sont renversés :
Les imbéciles sont célébrés, publiés, élus, décorés.
Les intelligents sont enfermés dans des asiles, soupçonnés de complot, car « penser trop » est vu comme une déviance dangereuse. Le narrateur écrit en secret, sachant qu’il est du côté « maudit », mais refusant l’âge d’or de la bêtise heureuse.
le tribunal de l’intelligence
Chaque citoyen doit se présenter devant un tribunal où sa valeur est inversée : plus il est confus, plus il est récompensé ; plus il est clair et subtil, plus il est puni. Le narrateur s’y rend, refuse de jouer le jeu et choisit son « enfer » : être banni, isolé, mais fidèle à son exigence.
L’algorithme du monde parfait
Une IA a reprogrammé la société pour optimiser le bonheur collectif. Résultat : les comportements les plus simplistes, mécaniques, répétitifs sont valorisés, tandis que la nuance, le doute, la complexité sont étiquetés « nuisibles ». Le narrateur, écrivain, se retrouve disqualifié par la machine : son art est déclaré « stérile ». Mais il continue d’écrire, préférant son enfer d’inutilité à l’âge d’or des imbéciles heureux.
Texte très court, presque parabole :
Dans ce monde, l’intelligence est un crime, et l’imbécillité une vertu. Les fous sont ministres. Les clairvoyants balayent les rues. Moi, je continue d’écrire. Non pour convaincre, mais pour rester fidèle à mon enfer. Car je préfère mon enfer choisi à l’âge d’or imposé.
Matières à explorer ou références
Antiquité & Renaissance
Euripide, Aristophane, Lucien de Samosate → déjà des inversions satiriques, où les sophistes ou les sots passent pour sages.
Érasme, Éloge de la folie (1509) → la Folie prend la parole et se glorifie : elle montre que les sots dominent en fait le monde, tandis que les « sages » sont ridicules.
Rabelais (Gargantua, Pantagruel) → critique des docteurs pédants et des « sages » ridicules.
XVIIe – XVIIIe siècle
La Rochefoucauld / La Bruyère → dans leurs maximes, ils montrent que les courtisans imbéciles réussissent mieux que les intelligents lucides.
Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver (1726) → les Houyhnhnms (êtres rationnels) et les Yahoos (bestiaux) renversent la prétendue supériorité humaine.
Voltaire (Candide, Micromégas) → ironise sur l’optimisme imbécile de Pangloss, valeur perçue comme sagesse.
XIXe siècle
Nietzsche, La Généalogie de la morale / Par-delà bien et mal → met à nu les inversions de valeurs opérées par la morale chrétienne (faiblesse valorisée, force dévalorisée).
Flaubert, Bouvard et Pécuchet → les deux copistes incultes s’imaginent savants ; satire de l’imbécillité qui se prend pour intelligence.
Dostoïevski (L’Idiot) → le prince Mychkine, naïf et pur, passe pour fou dans un monde corrompu.
XXe siècle
Orwell, 1984 → slogans d’inversion : « La guerre, c’est la paix ; la liberté, c’est l’esclavage ; l’ignorance, c’est la force. »
Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes → dans un monde stable et heureux, la profondeur intellectuelle est perçue comme une tare.
Eugène Ionesco, Rhinocéros → les imbéciles suivent la métamorphose collective (devenir rhinocéros) tandis que le dernier homme qui résiste est perçu comme un fou.
George Bernanos, La France contre les robots → critique du triomphe de la technique qui fabrique une humanité passive et stupide.
Cioran (Syllogismes de l’amertume, Précis de décomposition) → aphorismes sur le triomphe de l’imbécillité et l’échec des esprits lucides.
Philip K. Dick (Ubik, Le Maître du Haut Château) → univers où la perception, l’intelligence, la vérité sont constamment renversées.
Stanisław Lem, Mémoires trouvés dans une baignoire → absurdité bureaucratique où la logique devient suspecte.
XXIe siècle
Michel Houellebecq (Extension du domaine de la lutte, Soumission) → montre un monde où les médiocres prospèrent et les intelligents désespèrent.
Umberto Eco (Le Nom de la rose, Le Pendule de Foucault) → critique des systèmes qui valorisent l’aveuglement ou le dogme contre la raison.
Byung-Chul Han (La Société de la fatigue, Psychopolitique) → décrit une société où la « positivité » (optimisme creux, performance) remplace la pensée critique.
Alain Damasio (La Zone du dehors, Les Furtifs) → critique d’une société gouvernée par la conformité et la servitude volontaire, où la révolte lucide est criminalisée.
Formes voisines
Satire de la bêtise : Érasme, Flaubert, Swift, Ionesco, Cioran.
Renversement des valeurs : Nietzsche, Orwell, Huxley, Debord.
Fantastique / Absurdité bureaucratique : Kafka, Lem, Dick.
Philosophie critique moderne : Han, Debord (La Société du spectacle → l’illusion triomphe du réel, la surface de la profondeur).
synopsis
Le narrateur, un écrivain solitaire, découvre dans une bibliothèque oubliée un traité ancien, De Inversione Mundi, écrit par un certain Frater Athanasius, moine du XVIIe siècle. Le manuscrit affirme que le monde n’est pas régi par la raison, mais par une loi secrète d’inversion : tout ce que l’homme croit être sagesse, clarté, vérité, est en réalité folie, obscurité et mensonge.
Au départ, le narrateur sourit de cette idée absurde. Mais bientôt, des signes troublants apparaissent dans son quotidien : les orateurs les plus confus sont acclamés comme des génies, les savants les plus lucides sont enfermés comme fous, les imbéciles se hissent à des postes de pouvoir tandis que les penseurs disparaissent mystérieusement.
Il se met à enquêter et découvre que cette « inversion » n’est pas une métaphore mais une force occulte : une puissance cosmique — l’Intelligence Inversée — qui, depuis des millénaires, altère les perceptions humaines. Elle ne détruit pas la raison : elle la retourne. Elle fait passer l’imbécilité pour sagesse, la folie pour vérité, la corruption pour vertu.
Dans ses notes, le moine Athanasius évoque des rituels interdits qui permettraient de « voir sans masque », mais au prix d’une folie immédiate. Le narrateur, obsédé, finit par tenter l’expérience. Ce qu’il découvre dépasse l’entendement : il entrevoit un monde derrière le monde, où des entités innommables rient de l’humanité, se nourrissant de son aveuglement volontaire.
Terrifié, il comprend qu’il n’y a pas d’issue. Refuser l’inversion, c’est se condamner à l’isolement, au bannissement, à la folie. L’accepter, c’est se fondre dans le troupeau, anesthésié et docile.
Le récit se termine par une dernière note griffonnée, presque illisible :
« L’imbécillité règne parce qu’elle est le sceau de ceux qui veillent au-delà des étoiles. Et moi ? Je préfère mon enfer choisi… à leur âge d’or imposé. »
brouillon de début
Je ne sais s’il m’est encore permis d’écrire ces lignes, ni même si elles parviendront à quiconque, mais il m’est impossible de taire ce que j’ai vu — ou cru voir — durant ces mois de fièvre solitaire passés dans la bibliothèque oubliée de l’ancien couvent de Saint-Benoît, au cœur d’une province que les cartes modernes n’osent plus nommer. Je m’y étais réfugié dans le dessein vain de poursuivre mes recherches sur les textes interdits du XVIIᵉ siècle, ceux que l’Inquisition n’avait pas réussi à détruire.
C’est là, au milieu des rayonnages effondrés et des parchemins rongés par la moisissure, que je découvris le manuscrit intitulé De Inversione Mundi. Le volume, à demi calciné, portait la signature d’un certain Frater Athanasius, dont je n’avais jamais entendu parler. Dès les premières lignes, je compris qu’il ne s’agissait point d’un traité de théologie ordinaire, mais d’un document d’une nature plus sombre et plus troublante : une proclamation d’hérésie ou peut-être… une révélation.
Le moine affirmait que le monde visible n’était qu’un voile, un trompe-l’œil cosmique sous lequel œuvrait une loi secrète et universelle : la Loi d’Inversion. Selon lui, tout ce que l’homme considère comme sagesse n’est en réalité que le masque de la folie ; tout ce qu’il tient pour vérité n’est qu’un simulacre destiné à détourner son esprit ; et les plus grands esprits de notre race ne sont que des pantins ridiculisés par une force supérieure qui couronne l’imbécillité de lauriers et voue l’intelligence au bûcher.
Au premier abord, j’accueillis ces assertions avec le mépris de l’érudit pour les extravagances d’un esprit malade. Mais je dus bientôt réviser mes certitudes, car, plus je lisais, plus je reconnaissais dans ces pages calcinées les reflets grotesques et pourtant familiers de ce que j’observais chaque jour dans notre époque : les orateurs les plus incohérents acclamés comme des prophètes, les hommes les plus vides élevés en idoles, et ceux qui s’efforcent de raison et de clarté jetés au silence ou à la dérision.
Il me sembla alors que les mots du moine n’étaient pas la confession d’un délire, mais la transcription d’une vérité interdite, chuchotée depuis des siècles par d’antiques puissances. Une vérité que, désormais, je n’avais plus le droit d’ignorer — au risque de ma raison.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Archives
embryons —à faire pousser dans l’encre
notes pour Le sabbath des calques Une surcouche AR (= augmented reality overlay, calque de réalité augmentée), c’est une couche d’informations numériques affichée par-dessus le monde réel via un écran (téléphone, lunettes, pare-brise). Elle ne remplace pas le réel : elle l’annote, le guide, le filtre. Concrètement, ça fait quoi ? Affichage : flèches de navigation sur la rue, étiquettes “Boulangerie — ouvert”, prix sur produits vus par la caméra, noms des plantes dans un parc. Action : bouton “ouvrir la porte”, “signaler un nid-de-poule”, “appeler un ascenseur”, “déverrouiller un trottinette” quand tu regardes l’objet. Filtrage : tu ne vois que certains commerces (ex : partenaires), ou seulement les bornes de recharge compatibles avec ton abonnement. Maintenance : un technicien voit les canalisations invisibles sous la chaussée, l’état d’un transformateur, la vanne à fermer. Comment ça marche (simple) La caméra/localisation capte où tu es et ce que tu vises. Un calque (la surcouche) associe à ce lieu/objet des données + droits (texte, icônes, commandes). Le système rend ces données alignées sur la scène réelle (position/orientation). Pourquoi c’est important dans “Le sabbat des calques” Dans l’histoire, chaque surcouche AR n’est pas qu’un visuel : elle porte des droits et des flux (livraison, entretien, accès, soins). Si on désactive les calques sans procédure de retour, certaines choses sortent du graphe (plus d’ID, plus de tournée) et “n’existent” plus pour la ville. D’où le nom résolutoire : un énoncé public qui ré-attache officiellement les lieux/objets/personnes au système. En bref : une surcouche AR, c’est un calque opératoire qui dit au monde numérique quoi est où et qui peut faire quoi avec. Quand tu coupes le calque, tu coupes souvent l’accès autant que l’affichage. ID 1 Dans une métropole gouvernée par des surcouches de réalité augmentée qui pilotent livraisons, soins, entretien et droits d’accès, un collectif obtient une heure hebdomadaire sans calques pour “souffler”. Effet pervers : ce qui n’est pas re-référencé à la reprise est considéré obsolète par les plateformes, dé-publié des index, puis “cesse d’exister” pour la ville (plus d’ambulance, plus de tournée, plus d’adresse résolue). Quand une petite clinique disparaît des systèmes, une cartographe d’infrastructures remonte la chaîne technique et découvre que visibilité = existence procédurale ; désactiver sans formule de retour équivaut à effacer. Elle invente un « nom résolutoire » : une nomenclature publique, prononcée sur site et horodatée, que les opérateurs doivent accepter pour ré-attacher lieux, objets et personnes au graphe urbain. Climax sur la place centrale : la ville lit ses propres noms pour se faire revenir, tandis que les éditeurs de calques tentent d’en limiter la portée. Enjeu : reprendre la responsabilité d’“éditer” le réel sans renoncer au repos collectif. ID 2 Le locataire non inscrit Dans un vieil immeuble où l’existence des habitants tient à un registre calligraphié du hall, le nom de Lise refuse de “prendre” : l’encre perle et s’efface. La nuit, un voisin invisible prononce son nom avec une exactitude troublante — chaque syllabe qu’il dit fixe sa propre chambre (odeurs, objets, chaleur), tandis que Lise disparaît des sonnettes, du courrier, du bail. En fouillant les archives notariales, Lise découvre le vrai nom du voisin, effacé après un décès douteux : pour se sauver, elle devra le prononcer en face dans l’appartement muré — geste résolutoire qui le libérera… ou la rayera définitivement du registre. Scène-pivot : minuit, palier glacé, Lise ouvre la porte condamnée, lit à voix claire le nom exact ; les lettres du hall se remettent à l’encre — mais pas toutes. Thèmes : nom comme emprise (parasitage d’identité) → nom résolutoire (révocation par adresse), droit d’exister par inscription, loyers fantômes, éthique de la restitution. 3 Le nom-miroir Dans une petite ville, un photographe ambulant promet de révéler aux clients leur “vrai nom” en développant leurs portraits au nitrate d’argent. Sur chaque cliché, un mot apparaît sur le col ou la peau, différent du prénom civil : “Déserteur”, “Fiancée”, “Veilleur”, “Fille de personne”… Celui qui adopte ce nom gagne un pouvoir discret (veille sans dormir, franchit une barrière, traverse le fleuve gelé) mais perd une chose intime en échange (un souvenir, une capacité). Une femme veuve découvre que le mot sur sa photo — “Soeur” — rétablit une sœur que sa famille a gommée. Pour arrêter l’hémorragie de pertes, il faudra renommer la ville entière lors d’une exposition nocturne où l’on retourne les photos et déclare publiquement le nom qu’on refuse de porter. -- Nom en jeu : habiliter (adopter le mot confère) ↔ emprise (le mot prélève) → résolutoire (publiciser le refus d’un nom). 4 La maison aux noms empruntés Une maison bourgeoise accueille des colocataires à bas prix… à condition de déposer, dans un coffret, un nom dont on ne se sert plus (surnom d’enfance, nom d’artiste, nom d’emprunt). Tant qu’on y habite, la maison protège (pas de cauchemars, pas de cambriolages). À la Toussaint, le coffret s’ouvre et la maison revêt ces noms : les pièces prennent des caractères (une cuisine “Maman”, un couloir “Caporal”, une chambre “Perdue”). Quand une nouvelle locataire dépose par erreur son vrai nom complet, la maison s’en pare et la dépossède : plus personne dehors ne la reconnaît. Pour la récupérer, les habitants doivent organiser une veillée de restitution où chacun ré-appelle un nom prêté à son vrai détenteur, jusqu’au dernier — le sien. -- Nom en jeu : emprise (la maison vit des noms prêtés) → résolutoire (rite de restitution, nom rendu au bon destinataire, à voix claire).|couper{180}

Archives
Comment écrire une histoire avec un peu de méthode
Protocole léger — pour ne pas s’égarer Pour le moment, seules la première et la sixième propositions de l’atelier d’écriture en cours me proposent des pistes que je pourrais relier à un travail personnel. Disons qu’elles « matchent » dans les circonstances actuelles, par l’expansion que je constate à vouloir les développer. Mais pour ne pas m’égarer, il me faut un fil d’Ariane : une méthode — même légère suffirait. D’où l’envie de rédiger un modeste protocole. 1. Partir d’un embryon (format fixe) Fiche minuscule à chaque graine — 6 lignes, pas plus. Signe (trace perçue) : sifflement / buée / vitre / odeur de térébenthine / feux rougeâtres. Geste du corps (déclencheur) : ralentir / bifurquer / s’asseoir / lever la main / détourner le regard. Seuil (lieu précis) : porte / vitre / entrée de dancing / butte / péage / atelier. Distance (échelle) : hors-champ / voix seule / silhouette / face-à-face muet. Objet-totem (détail récurrent) : terre de sienne / yak / Abbesses / Keaton / autoroute. Sortie (chute) : question / rire étouffé / non-réponse / retour marche. Garder la fiche en tête de texte (ou en commentaire). C’est l’« ADN » de la série. 2. Écrire en échelles (x3) À partir d’une même graine, produire trois tailles — on ne réécrit pas, on déplie. Nano (50–80 mots) : une image + une action. Court (150–220 mots) : ajouter un seuil et une résonance sensorielle. Plein (300–450 mots) : même scène, avec bascule (ex. : vitre → café → geste non rendu). Résultat : 3 versions compatibles, pas 3 textes concurrents. 3. Invariants / variables (cohérence douce) Choisir 4 invariants pour toute la série (ex. : il ne parle pas directement ; jamais de prénom ; un seuil par scène ; une seule sensation dominante par texte). Tout le reste = variables (lieux, météo, vitesse, foule/solitude). Chaque nouveau texte repiquera 2 éléments du dictionnaire (ex. : « vitre » + « sifflement ») et ajoutera 1 élément neuf.4. Matrice des axes (pour générer vite) Quand ça sèche, combiner 4 axes (au dé, ou au hasard). Lieu : rue / intérieur sombre / hauteur / périphérie / transit. Signe : son / lumière / odeur / chaleur-froid / objet déplacé. Distance : trace / voix / silhouette / présence derrière vitre. Sortie : question sans réponse / rire / coupure / marche. Tirer 1–1–1–1 → embryon prêt en 10 secondes. 5. Numérotation claire (versioning sans peine) Nom : 2025-10-22_Porte_A1.0.md (A = parcours canonique ; B = alternance ; C = enquête). Patch : A1.1 (même scène, échelle différente), A1.2 (chute modifiée), etc. En tête de fichier : une ligne Changelog (≤ 12 mots) : « + vitre embuée ; – ponctuation coupée ».6. Couture entre versions (le lien cohérent) Passe « couture » hebdo : on n’écrit pas, on ajoute des échos croisés. Le sifflement réapparaît au dancing (à la sortie des toilettes). La terre de sienne existe en reflet rouge sur un feu arrière. Les Abbesses laissent une buée qui reviendra sur la vitre du café. Relier par capillarité, pas par explication. 7. Arches de lecture (A/B/C…) Garder les 3 ordres (A/B/C). À chaque nouvel épisode (ex. : Autoroute), décider tout de suite : A = pont entre deux nœuds (entre Question et Voix). B = coda hors séquence (ne pas toucher à l’alternance dedans/dehors). C = indice supplémentaire (C4, C5, etc.). Chaque texte rejoint au moins une arche — parfois deux. 8. Rituel (30 minutes chrono) 10 min : écrire Nano à partir d’une graine. 10 min : passer en Court (ajouter seuil + sensation). 5 min : Couture (ajouter l’écho croisé vers un ancien texte). 5 min : Classer (A/B/C), nommer (…_A1.1), noter le changelog.9. « Bible » d’une page (pour ne pas dévier) Un seul document, vivant : Règles d’or : tes 4 invariants. Dico de détails : 10 totems max. Topologie : 5 lieux maîtres (porte, vitre, dancing, butte, autoroute/atelier). Timeline fantôme : ordre canonique + derniers ajouts (à cocher après chaque session).Annexe — Fiche-embryon (copier/coller) Signe : Geste du corps : Seuil : Distance : Objet-totem : Sortie :|couper{180}

Archives
drôle de nuit
-- Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais un cube empilé parmi d’autres cubes. Cette promiscuité était d’autant plus difficile à vivre que je ne pouvais faire aucun mouvement ni même protester : aucun son ne sortait de ma bouche. D’ailleurs je n’avais pas de bouche. Juste une face lisse, une face avant exactement semblable aux cinq autres. Pour m’en sortir, j’ai rêvé dans mon rêve que je devenais sphérique, puis j’arrivais à m’extraire de la pile, non sans mal ; j’ai fait une chute vertigineuse. Une chute dans le noir sans fin qui durait durait durait. Pour m’évader de ce rêve-ci, je me suis encore transformé en mouche parce que je ne pouvais pas vraiment faire autre chose. J’aurais préféré quelque chose de plus noble. Mais on fait avec ce qu’on peut. En fin de compte, au moment même où j’apercevais enfin la lumière, que j’allais m’élever dans les airs au-dessus de je ne sais quel paysage, voici que je me suis fait gober par un oiseau et je suis devenu oiseau par je ne sais quelle alchimie onirique. Mais l’oiseau est mécanique, il est un produit d’une gigantesque intelligence artificielle qui désormais gouverne toute la Terre. Ses rêves sont des rêves de cubes, et me revoici à mon point de départ. La question, au réveil : seules les mouches sont-elles vivantes, non altérées encore par l’intelligence artificielle ?|couper{180}