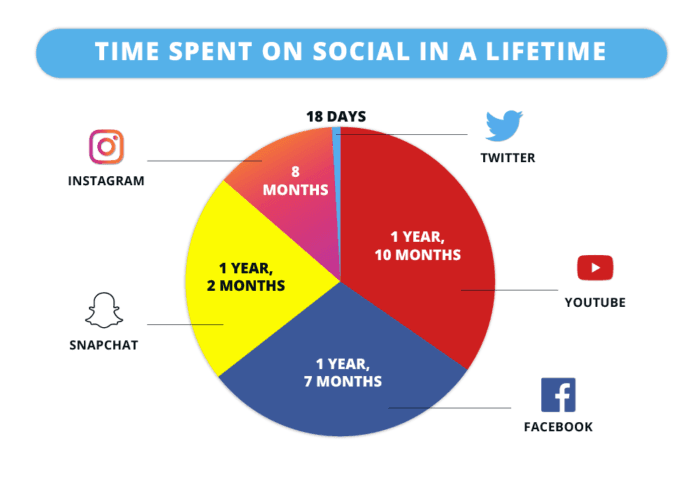Autofiction et Introspection
Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.
C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.
articles associés
Carnets | Atelier
03 mars 2025
Submergé par les événements. Ces derniers jours ont glissé sans bruit, emportant mon emploi du temps avec eux. Tout s’est déréglé, et les retards s’empilent comme des dossiers qu’on ne veut plus ouvrir. Mais au moins, l’ordinateur est réparé. Tous les logiciels réinstallés. Les sites locaux remis en place. Seul MySQL a résisté, obstiné, parce que j’avais gardé l’ancienne version sur une partition. Il a fallu tout sauvegarder avant de formater. Redondant, sans doute, la Dropbox a déjà tout. Mais sait-on jamais. J’ai perdu le fil. Les vacances avaient un plan. Elles en ont toujours un. Mais voilà, le plan est un leurre, un décor en carton-pâte que le hasard se charge d’éventrer. Ce qui me conforte dans l’idée de ne pas faire de plan. Ce qui est aussi une excuse facile, je l’admets. Je me sens plus bête qu’hier. Ce qui prenait quelques minutes en réclame des heures. Pourtant, après deux jours de panique, j’ai rouvert mon traitement de texte. J’écris. Pour qui ? À vrai dire, cela n’intéressera personne, sauf moi. Ce n’est pas un manque d’idées. C’est un manque d’énergie. Et pourtant, je continue à tirer des plans sur la comète. C’est là que je suis bête. Et têtu. Alors que le bonheur est à portée de main. Il suffirait de prendre son manteau, de sortir, d’aller sur le Pilat. Renifler l’odeur de terre, surprendre les premiers bourgeons, retrouver la lumière oblique de mars. Dehors, l’air doit être léger, coupant juste ce qu’il faut. Les bourgeons doivent frémir sous la lumière, et l’odeur de terre remuée par le printemps doit monter. Je pourrais ouvrir la porte, descendre l’escalier, sentir sous mes semelles l’aspérité des cailloux. Mais non. Je suis là, encore, à compiler des notes qui ne serviront à rien, un archiviste du néant. À peine la machine réparée, je trace des guides, des fiches en Markdown pour documenter le chemin, ne pas oublier le processus. Obsidian les archive. Besoin maladif de baliser les choses. Comme si j’avais le diable dans la peau, disaient-ils. Dehors, la nature s’agite sans moi. Les branches craquent doucement, les ruisseaux bavardent. Même le vent doit avoir des choses à dire. Et moi, ici, en train de consigner méthodiquement la résurrection de mon disque dur, comme si c’était l’événement du siècle. Le dibbouk, lui, a disparu depuis vendredi. Il a quitté le bureau, l’atelier, la maison. Trop c’est trop, a-t-il dû se dire. Il m’a laissé. Je l’imagine, paresseux, vautré sous le soleil, quelque part derrière la fenêtre. Quand il reviendra, je l’ignorerai. Ça lui apprendra. Mais je sais bien comment ça finira. Il reviendra, je l’accueillerai. Et les choses reprendront leur cours. Les choses reprennent toujours leur cours.|couper{180}

Carnets | Atelier
28 février 2025
Je me suis réveillé avec cette phrase en tête. Ce qui est proche se doit de rester loin. Je me dépêche de la noter avant qu’elle ne s’efface, avant qu’elle ne rejoigne ces limbes où s’échouent les textes morts-nés, ceux qui naissent dans les rêves et n’atteignent jamais le jour. Vers 2h. Un Doliprane effervescent. Puis relecture des Montagnes de la folie. (Hallucinées). Je n’avais jamais pris la peine de lire la préface de David Camus. Cette fois, je m’y attarde. C’est comme du Lovecraft, me suis-je dit. Puis l’esprit a bifurqué. Impossible de rester concentré. Le Procès. K. J’ai vu passer une annonce récemment. The Trial d’Orson Welles, avec Anthony Perkins dans le rôle de K. J’ai cherché, retrouvé, visionné une bonne partie du film en attendant que le médicament fasse effet. Il doit y avoir un lien entre HPL et Kafka. Ces personnages, chez Lovecraft, contraints de dire alors qu’ils préféreraient se taire. Comme K., figé devant le portail de la Justice. Et puis cette idée : Ce portail, il l’a créé lui-même. Ce n’est pas une barrière extérieure. C’est sa propre idée de la Loi, un concept d’inaccessibilité qu’il est condamné à ne jamais franchir. Parce que son rôle, le seul qu’il s’autorise en silence, c’est de ne pas pouvoir passer. Et alors, une évidence : L’absurde d’hier paraît aujourd’hui plus réel que jamais. J’ai toujours pensé que nous étions les créateurs de tout ce que nous traversons. Que nous étions, chacun, à l’origine de nos propres labyrinthes. Que le sens de cette existence ne se joue pas dans le rêve que nous appelons réalité, mais dans une autre dimension, un hors-champ immense, supranaturel, qui nous dépasse. Que nous ne sommes que des histrions, des figures égarées sur une fresque gigantesque dont nous ne percevons que les contours. Un couloir d’hôpital. Sous terre. Des centaines de corps nus, entassés sur des étagères. Les camps. Mais quelque chose cloche. Les corps ne sont pas maigres. Ils sont luisants, pleins, presque gras. Et de leur juxtaposition insensée se dégage une étrange sensualité. Un mélange de visions. Je ne sais pas si c’est un rêve ou un souvenir. Au moment où j'écris ces lignes, la douleur est supportable. La douleur est une foreuse de conscience. Avoir mal est une chose. Entretenir ce mal en est une autre. Mais quand ai-je compris cela pour la première fois ? Je ne sais plus. Était-ce ce jour où je suis resté allongé sur le carrelage froid de la cuisine à V., après une trempe magistrale ? Cette sensation de froid collé à la peau, ce corps immobilisé, incapable de pleurer, incapable même de penser ? Mais détaché totalement de cet ensemble bourreau/victime qui, dans le recul soudain, ne faisait plus qu’un. Ou était-ce cette autre fois, dans l’enfance, quand la branche du cerisier s’est rompue sous mon poids, m’envoyant percuter la terre avec une violence inattendue ? L’impact. La douleur vive. La respiration coupée. Ce moment suspendu où on se demande si l’on va se relever. On revisite la chute et l'on s'aperçoit que tout ne tombe pas au même rythme. Un précipité reste suspendu. Un témoin silencieux qui observe l’ensemble. Ou peut-être n’était-ce ni l’un ni l’autre. Peut-être était-ce J., et son absence soudaine. Sa disparition. Un matin, elle n’était plus là. Et alors, ce n’était plus une douleur localisée. C’était autre chose. Un vide sidéral, froid, effroyable. Mais encore une fois, l’étrange possibilité de mise à distance, de mise en abîme. Ce racisme que tant de gens reprochent à Lovecraft me fait penser à un rêve récurrent de mon enfance. Un géant terrassé par des créatures affreuses. (Gulliver ?). Leur langage était la pire torture. Plus que les coups. Plus que la douleur physique. Je ne sais pas si c’était la peur de l’étrangeté, de l’étrange, ou de l’étranger. Je ne sais même pas si c’était de la peur. C’était du mépris. On pouvait me torturer autant qu'on le voulait, cela ne m'effrayait pas. Je comprenais que ces créatures existaient parce que je les inventais. Elles tiraient leur raison d’être à la fois de mon mépris pour elles et de leur mépris pour moi. Elles étaient les sentinelles d’un territoire inconnu. Elles m’accompagnaient dans cette tâche absurde : Explorer quoi ? L’âme humaine ? La douleur ? L’illusion magistrale que je m’étais inventée afin d’essayer, chichement, de m’incarner dans ce monde.|couper{180}

Carnets | Atelier
27 février 2025
Ce texte, entre carnet et fiction, capte des fragments d’un quotidien où la distance s’installe, où le monde semble légèrement se déliter. Réel ou réécrit ? Peu importe. Il s’agit ici d’explorer un état, une impression fugace.|couper{180}

Lectures
Mémoire vive
Je me souviens d’une lampe verte sur le bureau de mon grand-père. Ou était-elle bleue ? Peut-être n’y avait-il pas de lampe du tout. Ce qui me revient, ce n’est pas un fait, c’est une impression, un reflet de lumière posé sur un coin d’enfance. Si je l’écris, je la fixe. Et pourtant, déjà, elle m’échappe. La phrase vient de l’attraper, mais ce n’est plus la même lampe. Quand on écrit un souvenir, que retient-on vraiment ? Est-ce une archive du passé ou une réinvention ? On croit que l’on restitue, mais on recrée. C’est une illusion tenace, cette idée que la mémoire serait un enregistrement fidèle. Proust l’a démontré mieux que personne. Dans À la recherche du temps perdu, ce ne sont pas les souvenirs conscients qui portent la vérité du passé, mais ces surgissements imprévisibles, ces éclats sensoriels qui dépassent la volonté. L’odeur d’une madeleine, le bruit d’une cuillère sur une assiette, et c’est tout un monde qui refait surface. Mais ce monde n’existe plus. Il se reconstruit dans l’écriture, il se plie au rythme des phrases, à la logique du récit. Ce n’est pas une restitution, c’est une transfiguration. Écrire, c’est composer avec l’oubli. Barthes en joue aussi. Dès la première page de Roland Barthes par Roland Barthes, il avertit : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. » Même en parlant de lui-même, il s’invente. Qui raconte, lorsqu’on se souvient ? Qui décide du cadre, du ton, des ellipses ? On croit se souvenir, mais en réalité, on choisit. On accentue une couleur, on coupe un détail, on arrange. Peut-on dire qu’un souvenir écrit est vrai ? Peut-être l’est-il plus que le souvenir lui-même. La mémoire est un atelier où l’on sculpte ce qui nous reste. Perec, lui, a fait de cette incertitude un projet littéraire. Je me souviens aligne des bribes de passé, toutes introduites par la même formule incantatoire : « Je me souviens… » Il ne cherche pas à recomposer une histoire, juste à fixer des fragments, ces éclats épars qui font une vie. Mais l’exercice révèle autre chose : certains souvenirs paraissent inventés. Ou sont-ils simplement contaminés par d’autres récits, d’autres lectures ? Perec lui-même l’admet dans W ou le souvenir d’enfance : son passé est troué, il le recompose par nécessité, et parfois, par pure fiction. C’est là toute la question : écrit-on ce dont on se souvient, ou se souvient-on de ce que l’on écrit ? Nathalie Sarraute, elle, hésite. Enfance n’est pas un récit ordinaire. C’est une conversation à voix basse entre elle et elle-même, un dialogue interrompu, une succession de doutes. À chaque souvenir évoqué, une seconde voix s’élève pour interroger : « Était-ce vraiment ainsi ? » Rien n’est certain, tout est fragile. L’écriture n’affirme pas, elle explore. Ricœur parle de « mémoire reconstructive ». Nous ne sommes pas des archivistes fidèles de notre propre vie. Nos souvenirs se modèlent selon nos attentes, nos désirs, nos regrets. On se raconte une histoire. On la modifie sans s’en rendre compte. Peut-être que la mémoire ne se contente pas d’oublier ; peut-être qu’elle invente aussi. Alors écrire, c’est quoi ? C’est reconnaître que la vérité du souvenir ne tient pas dans sa précision, mais dans sa résonance. Gabriel García Márquez disait : « La vie n’est pas ce que l’on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s’en souvient. » Ce qui importe, ce n’est pas la fidélité à un passé factuel, mais la justesse d’une sensation retrouvée, d’une émotion qui refait surface. Peut-être qu’au fond, écrire, c’est inventer un passé qui tienne debout. Un passé qui, une fois couché sur la page, semble plus réel que celui qu’on croyait posséder. Peut-être que cette lampe verte — ou bleue — n’existait pas. Mais maintenant qu’elle est là, dans ces lignes, elle existe un peu plus qu’avant. C’est peut-être ça, la mémoire. Une fiction qu’on apprend à croire. Musique Claude Debussy Rêverie|couper{180}

Carnets | Atelier
25 février 2025
Le fragile territoire du peu Il s’en faudrait de peu. D’un presque rien. Un grain de sel, une ombre, un souffle d’air suspendu au bord de la fenêtre. Cette sensation de peu, cousue de bric et de broc, est une étoffe effilochée qu’on drape autour des épaules en guise de certitude. Ce peu est un territoire mouvant, une ligne tracée du bout du doigt sur une vitre embuée, une parole suspendue, prête à basculer dans le vide. C’est un équilibre instable, une marche hésitante sur un fil qui tremble. On avance sans savoir si le prochain pas portera ou s’il nous laissera tomber dans l’indéfini. Un frisson de précaution guide chaque geste. Le monde entier semble s’être resserré autour de cette sensation fugace, ce presque rien qui fait toute la différence entre le vide et l’existence. Écrire comme on rapièce Une maille de solitude, une autre d’ironie, une troisième d’impatience. On tricote, on rapièce. Voilà un début de journée en forme de casquette irlandaise, rugueuse et chamarrée, posée de travers sur un crâne encombré d’idées dissonantes. C’est ça, écrire. Une couverture en patchwork où chaque morceau a une humeur propre : la chaleur d’un souvenir, la fraîcheur d’une peur qui mord la peau, la laine rêche d’un regret. On coud des mots comme on répare une veste trouée par l’usure du temps. On rajoute un pan ici, une couleur là, sans trop savoir si l’ensemble tiendra, si la structure ne s’effondrera pas sous le poids de son propre déséquilibre. Mais il faut avancer, bâtir, même à coups de rafistolages. Parfois, dans la couture maladroite d’une phrase, surgit une beauté imprévue, une harmonie accidentelle. L’effort et la boucle D’ici peu, je pourrais sortir dans la rue et courir n’importe comment. Faire le tour du pâté de maisons comme on trace une boucle dans une histoire, revenir au même point et prétendre qu’on avance. Mais non. Il y a cette promesse, ces 1500 mots qui s’alignent comme une rangée de moutons sur une lande battue par le vent. Ils résistent, s’accrochent, s’effacent parfois avant d’être repris, réécrits, redessinés dans un effort aussi vain que nécessaire. L’écriture est un marathon sans ligne d’arrivée. On court, on s’essouffle, on trébuche. On pense atteindre un sommet et, en réalité, on tourne en rond. L’illusion du mouvement, un chemin balisé d’ombres, un jeu de piste dont le but reste inconnu. Silence et fuite Le silence grignote l’espace. Un silence feutré, comme la neige qui tombe sans bruit sur un sol glacé. Ça me rappelle Zatopek, sa foulée chaotique, son souffle coupé en lambeaux. Est-ce que je cours après quelque chose ? Ou est-ce que je fuis ? Le silence est un piège. Il attend, se tend, se tapit dans les interstices. Il pèse de tout son poids sur l’air. Un silence habite, un silence qui bruisse, rempli de ce que l’on ne dit pas, de ce que l’on tait par habitude, par peur ou par fatigue. Alors on écrit, pour briser cette chape étouffante, pour donner une voix à ce qui autrement resterait conféré aux replis de la conscience. Gigue de mots Je voudrais écrire en dentelle et en granit, avec la souplesse d’une lumière d’automne et la rudesse d’une pluie de novembre. Mais les mots viennent comme ils veulent. Parfois ils tombent dru, parfois ils s’effilochent. Peu ou prou. Peu me chaut. Les mots sont capricieux. Ils glissent, ils s’effacent, ils résistent. On les cherche, on les trouve, on les perd. Parfois ils s’alignent avec une évidence éclatante, parfois ils s’entrelacent en un chaos indomptable. On essaie de les guider, mais ils nous échappent toujours, comme une musique qui refuse de se fixer sur une partition. Assembler et rapiécer Alors j’écris. Pour assembler, pour rapiécer. Pour voir si, de tous ces morceaux, peut naître une forme qui tienne debout, comme une casquette irlandaise qu’on enfonce bien sur la tête avant d’affronter le vent. J’écris pour conjurer l’absence, pour donner une texture aux pensées éparses, pour broder du sens sur ce qui, parfois, semble n’en avoir aucun. J’écris en espérant que, quelque part, entre les lignes et les silences, se cache une vérité que je n’ose pas nommer. Et si ce n’était que ça, après tout ? Une quête absurde, mais nécessaire. Un pas après l’autre, un mot après l’autre, sans jamais vraiment savoir où l’on va. Le flot incontrôlable des poèmes Depuis quelques jours, des poèmes sortent de mes doigts comme des filets de bave d’une bouche édentée. Ça ne m’appartient pas. Je me le dis et me le répète. C’est un refus dans le refus. Une tour de rondins qui dépasse la canopée de mon marasme. Placer du gras et des titres saucissonnés à la manière marketing le rendra-t-il plus lisible, plus digeste, me demande le Dibbouk. On se regarde. Rien ne passe. Tension. Suspens qui dure. Et qui s’achève par une défaite. La mienne, comme toujours. Alors je retrousse les manches, j’éteins ma conscience. J’écris sous la dictée. Musique : Nils Frahms "Says" SPACES|couper{180}

Carnets | Atelier
22 février 2025
Coincé entre dystopie et utopie, écrire quelque chose qui ne serait pas complètement idiot. Qui ne s'autodétruirait pas presque aussitôt l'avoir écrit ? C'est sans doute pour cette raison que la bêtise devient un vecteur. On s'accroche à la bêtise, à la blague, à la connerie comme à une fusée espérant qu'elle nous emportera vers d'autres cieux. Mais comme tout est inversé, c'est dans les profondeurs de la fosse des Mariannes que l'on s'enfonce sans jamais voir le bout. Dans ce no man's land, une foule d'ectoplasmes aux yeux blancs dévisagent les égarés. Le sourire se fige en un rictus crispé. Ici pas d'Atlantide, pas de base extraterrestre, que de vagues méduses dansant un ballet lent dans la profondeur du rien. La blague, dans l'effort de lucidité qu'elle tente de masquer à peine, tombe à l'eau au plus profond de l'eau. Les maux de dents repartent de plus belle, poire pour la soif, l'attention s'y accroche de toute sa force pour s'extraire de la force centrifuge de l'horreur environnante. Ce n'est pas parce que j'écris :" je vais chez le dentiste" que c'est vrai. C'est juste pour ne pas passer pour un parfait imbécile. La perfection m'étant à ce point insupportable même dans ma propre imbécilité. S'il n'y avait pas d'être humain, le monde existerait vraiment tel qu'il est, sans bien ni mal. De là à souhaiter l'extinction, d'en éprouver de la peur comme du désir, ce ne serait pas idiot. Cette ambivalence de l'être humain, qui peut à l'origine permettre aux voyants d'équilibrer effroi et merveille, demande un effort surhumain à présent et plus que de simples dons de clairvoyance. Le dégoût monte d'autant plus rapidement que la foi s'amenuise. Non pas le dégoût de l'autre, qui permet toujours des rassemblements, de s'inventer l'adversaire, mais le dégoût de soi. Et le pire est qu'on n'a même pas envie de philosopher plus avant, de se perdre dans un labyrinthe de conjectures sur les raisons d'un tel dégoût. Pas une seule graine de haricot magique disponible pour s'évader dans la supputation, la pénitence, le pardon, la sympathie, l'empathie. Peut-être est-ce là la seule forme de transcendance possible : un ricanement étouffé dans l'abîme, une ironie glacée qui évite l'écueil de l'espoir. Nous ne nous envolons pas, nous coulons avec une certaine grâce, une chute en apesanteur. La pensée elle-même se dissout dans cette immersion totale. Tout est disséqué, analysé, démystifié, et pourtant tout nous échappe. Un univers sans Atlantis, sans utopie, juste des profondeurs aveugles où l'on devine, entre les ombres, les contours d'un mirage que personne ne pourra jamais atteindre. Ainsi, écrire reste un acte ambigu, un geste de fou qui inscrit dans l'eau une trace appelée à disparaître. Mais c'est peut-être dans cette absurdité même que réside la réponse : ne rien attendre, ne rien chercher à sauver, juste jouer le jeu de la dérive et voir où cela mène, si tant est qu'il y ait un ailleurs. Musique : Tim Hecker – Virgins / incense at Abu Ghraib (Abu Ghraib est une prison utilisée pour détenir des prisonniers pendant la guerre en Afghanistan, où de nombreux abus horribles ont eu lieu. La pochette de l' album montre un homme qui pose pendant une séance de torture. Ce même homme a plaidé non coupable de multiples accusations portées contre lui, mais a quand même subi tous les coups et agressions. Il était essentiellement « vierge » au milieu de la violence.)|couper{180}

Carnets | Atelier
21 février 2025
Carnet de mémoire : L'attente ou l'amour ? en écho à un texte écrit sur l'utopie dans la rubrique lectures. Un amour du passé qui hante. L'idée s'impose d'abord comme une évidence. Mais quelque chose cloche. Trop affirmatif. Après tout, rien n’est certain. Impossible d’en faire une généralité. Replonger dans cette histoire, et le doute s'installe. Sommes-nous hantés par l’attente de l’amour plus que par l’amour lui-même ? Peut-être est-ce cette illusion, cette promesse, qui obsède davantage que les êtres aimés. Et si, au fond, ce qui compte n’a jamais été l’amour, mais cet état d’expectative, ce vertige du "peut-être" ? Un récit qui explore cette zone grise, là où l’amour ne se vit pas encore et où, paradoxalement, il est peut-être à son apogée. Comme une utopie qui n’existe que dans la distance, un idéal insaisissable qui recule dès qu’on s’en approche. Le désir se nourrit de ce qui échappe, de ce qui ne se possède jamais vraiment. L’été s’annonce immobile. À peine arrivé sur le quai de la gare, une chape invisible s’abat. Un mélange d’ennui et de langueur, une torpeur inévitable. G.-p. attend, en cotte noire, maculée de taches anciennes, le regard dissimulé sous la visière de sa casquette. Un hochement de tête, une main qui agrippe le bras, et sans un mot, la route vers la ferme. Première nuit. Le tic-tac de l’horloge emplit la maison, se diluant dans l’odeur d’encaustique et de tabac froid. Couché dans le lit étroit, à l’écoute des bruits du dehors – des coucous dans le lointain, le vent froissant les peupliers – une certitude s’impose : l’été sera long. Les journées s’étirent avec la lenteur propre à la campagne. Matinées passées à errer sur les chemins, mains dans les poches, mâchant un brin d’herbe sèche. Après-midis à retrouver P., le fils du facteur, près de la mare. Des lianes séchées en guise de cigarette, peu de paroles. La rumeur du village s’élève, étouffée par la chaleur. Puis un jour, B. apparaît. Derrière les prunelliers, un éclat de rire. Une robe légère, des jambes brûlées de soleil. P. devient rouge comme une pivoine, bégayant des mots absurdes, l’accent du pays s’alourdit dans sa bouche. Un regard qui balaie l’assemblée, un sourire en coin, bras croisés sur la poitrine, déjà en position de force. Mais ce n’est pas elle qui bouleversera cet été. Ce sera N., sa sœur aînée. Un soir de pluie, toute de blanc vêtue, les cheveux blonds collés à la peau par l’humidité. Un regard moqueur, une démarche assurée. Tout en elle semble hors de portée. Dès le lendemain, un rendez-vous tacite s’installe. Chaque soir, après le dîner, une sortie prétextée. Toujours la même attente derrière la barrière. Un menton levé, un sourire qui oscille entre retenue et insolence. Des marches sur les sentiers, frôlant les fossés bordés d’orties. Des mains s’approchant sans jamais se toucher. L’air du soir imprégné de camomille et de paille humide. Un rire discret, une tête détournée. Que peuvent bien attendre les filles d’un garçon ? Ignorance totale des règles du jeu. L’espoir secret d’un premier pas de sa part. Et, paradoxalement, la crainte de ce moment. Les nuits se succèdent, équilibre fragile entre attente et retenue. Puis l’été s’achève. Une adresse échangée. Peu de foi en une réponse. Pourtant, quelques semaines plus tard, une enveloppe oblitérée de Vallon-en-Sully. Un cœur battant au moment de l’ouvrir, à l’abri des regards. Des mots simples, banals, prudents. Mais ils sont là. Une réponse. Puis une autre. Bientôt, des lettres quotidiennes. Une impatience douloureuse à chaque attente. L’hiver passe, réchauffé par cette correspondance secrète. Puis l’été revient. Le voyage entrepris seul. Huit kilomètres sous le soleil, valise à la main, cœur en feu. Aucun avertissement préalable. Chaque instant doit être savouré. Sur le chemin, la maison de N. apparaît. Dans la cour, un homme en blouson de cuir. Une étreinte. Elle, suspendue à son cou. Un regard échangé. Pas de surprise. Pas de trouble. Un léger sourire, un geste distant. Demi-tour. Retour chez G.-p., un sourire figé, l’estomac noué. Les lettres de N. restent longtemps dans une boîte, jusqu’au jour où elles sont brûlées. Un autre temps. L’amour s’est transformé, devenu autre chose. Peut-être à cet instant son véritable visage se révèle-t-il : le désir, ce désir de posséder l’autre plus que tout. Une incapacité neuve d’attendre quoi que ce soit – une fille, une femme, une prétendue sécurité affective, un soi-disant bonheur. Et encore, sans doute qu'à l'époque, tout cela n’était qu’une illusion de plus : imaginer le dégoût de posséder l'autre alors qu’il ne s'agissait que du reflet d'une impossibilité plus profonde – celle de se posséder soi-même. Certains souvenirs dorment, bien rangés, attendant d’être déterrés. Comme des peintures oubliées dans un grenier, suspendues à un regard qui leur rendra enfin leur importance. Ce qui est caché définit souvent bien plus que ce qui est montré. Pendant longtemps, ces histoires semblent n’intéresser personne. Puis, un jour, une oreille attentive. Quelqu’un qui comprend. Et le passé reprend vie. À la relecture de cette histoire des années plus tard, une interrogation persiste : l’attente de l’amour n’est-elle pas, en fin de compte, plus précieuse que l’amour lui-même ? Peut-être est-ce cette promesse, ce vertige du possible, qui confère au désir sa force et son mystère. Comme si toute possession portait en elle la fin de l’enchantement, la dissipation de l’illusion. Un mécanisme silencieux, une mécanique intime qui trouve un écho troublant dans ce monde où l’on chérit plus l’illusion d’un avenir radieux que la réalité d’un présent atteint. Peut-être l’amour, comme tout ce qui se convoite, ne se vit-il pleinement que dans le manque qu’il creuse.|couper{180}

Carnets | Atelier
19 février 2025
Il pense que c’est fini. Que cette boucle, il va encore la boucler, pour la forme, histoire d’être sûr. Depuis plusieurs jours, une douleur assez précise, assez tenace — une dent, disons, mais pas n’importe laquelle, celle qui fait mal — l’empêche de penser correctement, ou du moins d’avoir l’illusion qu’il pense correctement. Il résiste, encore, dans une posture qui tient autant du stoïcisme que du pur entêtement. Il observe, avec une sorte de patience scientifique, la douleur monter, descendre, pulser, se diffuser, revenir plus vive. Pendant ce temps, le monde s’effondre, paraît-il. Ce n’est pas une exagération, c’est juste une observation factuelle : guerres, famines, politiques absurdes, températures record. Une dystopie de série B qui s’écrit en temps réel. Il pourrait s’en alarmer, il pourrait agir, mais la douleur de la dent a ceci de pratique qu’elle ramène tout à une échelle plus proche. Plus domestique. Un nerf exposé, une mâchoire qui proteste. Un micro-drama dans un macro-chaos. Il n’ira pas chez le dentiste. Pas encore. Pas maintenant. Pourquoi ? Toutes les raisons d’y aller semblent évidentes, toutes les raisons de ne pas y aller également. Il reste là, dans cet entre-deux parfait où la nécessité ne s’impose jamais vraiment. Autrefois, il aurait attendu qu’une femme s’en mêle. Un appel, une voix légèrement inquiète, une main sur son bras : Tu devrais vraiment consulter. Mais il sait qu’il ne l’écouterait même plus. Il hoche peut-être la tête, marmonne une promesse vague, mais rien ne suit. Il n’y croit pas plus qu’à tout le reste. Et pourtant, il écrit. C’est sa seule concession au mouvement.Une lucidité qu’il qualifie de terrifiante certains jours, d’apaisante d’autres. Une lucidité qui ne sert à rien, mais qui est là, qui tient bon, qui le garde debout. Voilà où il en est : pas guéri, pas fichu, pas sauvé. Juste là. Quelques heures plus tard : Dans ces cas-là, la sagesse, autant qu’elle puisse exister, impose de se rendre chez le dentiste. Musique douce, basculement du fauteuil vers l’arrière, bouche grande ouverte, la sensation un peu désagréable d’un doigt caoutchouteux qui pénètre dans la bouche. Une voix jeune, presque joyeuse : "Et là, ça vous fait mal ?" C’est à ce moment qu’il pense au "de base" que ne cessent de dire les petits-enfants. De base, il suffit de se rendre chez le dentiste pour ne plus savoir quelle dent fait mal. Et c’est vrai. Maintenant qu’il est là, impossible de désigner avec certitude le point d’origine. Il a mal, oui, mais où exactement ? Cette molaire, celle du fond, ou plutôt celle d’à côté ? La douleur se dérobe au moment où elle devient soignable. Forcément. Bon, a dit la voix jeune derrière lui, je vois plusieurs caries donc on va soigner tout ça. Mais avant, je vais vous faire un petit détartrage. C’est là qu’il demande qu’on le pique. Sans doute à cause de la volonté d’amoindrir le supplice du détartrage par l’adjectif qualificatif apposé. "Un petit détartrage." Non, il ne veut pas de ce "petit". Il sait ce que ça cache. Il ne veut pas d'euphémisme, ni de la douceur feinte. Il veut l’anesthésie, tout de suite, avant qu’on ne tente de lui faire croire que ça ne fait pas mal. La voix jeune hésite, sourit. Le doigt en caoutchouc bat en retraite. Un patient qui réclame une anesthésie pour un détartrage, ce n’est pas si fréquent. "Vous êtes sûr ?" Il l’est.|couper{180}

Carnets | Atelier
8 février 2025
Des fois, j’ai honte, des fois non. Ça dépend de la résonance du monde. Si j’ouvre la fenêtre et que j’entends les oiseaux, oui. Si j’entends le camion-poubelle, non. La honte ne dépend pas que de moi. C’est la résultante d’une mise en scène, à la fois côté cour et côté jardin. Il est assez rare d’avoir honte assis dans une salle de cinéma. Cela ne m’est arrivé que trois fois, au collège, lorsqu’on m’infligea la vision d’Auschwitz, le père Kolbe se sacrifiant à la place d’un autre. Mais honte pour nous tous. Pour l’espèce. Ensuite, la honte est une prémisse. Je reste rarement figé de honte, empêtré dans la honte. Honteux n’est pas un état stable, mais volatile. Ou du moins, une fois la honte bue, il reste ce dépôt crasseux au fond du verre, sur lequel on ne se gênera pas pour resservir du rouge à son voisin. Si tant est qu’un voisin, dans les environs, soit assez cinglé ou ignorant pour venir boire un coup à la maison. Bien sûr, il y a de la honte, mais elle se transforme généralement assez vite en rage, en haine. C’est la pente naturelle de la chose. Il faut attendre parfois des mois pour que certaines hontes se transforment en trésor. Toujours la vieille histoire de dragon et de meurtre. Tout cela est imaginaire, virtuel évidemment. Mais, quand même, à chaque fois, on y laisse un petit bout de cœur ou de cerveau bien réel. J’aurais du mal à être ami avec quelqu’un qui ne montrerait aucune réticence à table. Qui engloutirait de bon cœur du bifteck, des choux-fleurs, tout en parlant d’autre chose que de la tendreté de la viande, de l’onctuosité des crèmes. Je veux dire, dans le fond, que j’ai simplement bien du mal désormais à vouloir être ami avec qui que ce soit. À la fois parce que ma honte naturelle m’en empêche, et d’autre part parce que la sienne, au bout d’un temps, de même. Voilà où va l’humanité, dans ce lieu où l’on n’ose plus être ami parce qu’on ne veut jamais le croupion, toujours la cuisse. Passé une sale journée comme prévu. Maux de gorge, nez coulant, du coup, parlé au minimum. Même mis de la musique pour meubler. Travail à l’encre de Chine le matin, collages l’après-midi. Et toujours ces phrases : **ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Il faisait un vent à décorner les cocus l’après-midi. **Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Bruits de voiture passant dans la rue. Train qui fonce sur la voie ferrée. Porte qui claque dans la profondeur du bâtiment. **Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas où je vais.** Peut-être que chaque texte que j’écris dans ce journal est un *çaneresemblarien*, un *jenesaipasouj’vais.* La honte vient aussi du fait de se rendre compte que l’on n’est pas seul à éprouver les mêmes hontes. C’est un réflexe étonnant. De même qu’il est aussi étonnant de voir que les amis qui disparaissent le plus vite sont ceux qu’on a le plus aidés. Comme si la honte et une forme d’ingratitude étaient étroitement liées. La honte, en fait, peut désormais surgir de toute part, et je ne peux pas croire que ce n’est pas voulu. À nous tenir ainsi dans la honte perpétuelle de qui l’on est, on nous gouverne certainement bien plus efficacement. On ne partage que très peu ses hontes, on les conserve comme des têtes réduites accrochées au sombre réduit de la maison. Nos hontes sont nos mânes, nos lares, nos lémures, nos génies tout autant. — **"Voilà, gars, appelle-moi génie"**, me dit le dibbouk en conservant les yeux fermés quand il fait semblant de lire par-dessus mon épaule. Cette fois-ci je n'y fais pas attention. Je ne réplique même pas. je sais à présent que le dibbouk peut être aussi con que moi, aussi honteux parfois, encore que de le savoir me fait une belle jambe.|couper{180}

Carnets | Atelier
6 février 2025
© Florie Cotenceau Le mot articule, quand il s'agit d'un impératif, me fait encore pouffer sitôt que je l'entends. Puis le mot abattis s'amène avec sa tête de comptable. Et derrière lui, toute une armée d'abrutis. Numérote tes abattis, disent-ils tous en chœur. Je ne me souviens pas avoir regardé ces mots dans un dictionnaire. Leur rencontre frontale m'a enseigné un sens figuré et personnel. Voilà comment je me figure (si tu te figures qu'ça va qu'ça) le borborygme incessant du monde qui m'environne et cherche par tous moyens possibles, imaginables, à me phagocyter. Mais revenons à articule, je voulais dire quelque chose et ça m'a tellement vite échappé. Réticules serait un sac à main rempli de bruits de clefs, de cartilages en décomposition, d'osselets blancs. Quant à pédoncule, il n'indique qu' un filet baveux laissé par les limaces traversant les champs de batavia. Je dis tout ça de bonne heure pour ne pas l'oublier. Parce que j'ai lu encore qu'un homme de mon âge s'était présenté à l'hôpital pour des maux de tête et qu'on lui a diagnostiqué un océan d'eau dans le crâne. Je ne m'intéresse plus guère qu'aux événements arrivant aux femmes et aux hommes de mon âge. Il faut bien faire un choix. Parfois, je m'accorde un peu de distraction pour aller voir ce qui peut bien se passer chez les septuagénaires, voire quelques octogénaires, mais c'est tellement déprimant que je reviens vite au temps présent. À tout ce qui a l’heur d'être de mon âge. C'est de son âge, disait-on au café après avoir englouti la poire et le fromage. Sous-entendu, ça lui passera. L'âge et ses inconvénients, je suis bien désolé de le dire, ne passent jamais : ils filent, ils emportent tout sur leur passage. L'âge, le nôtre, indubitablement, nous conduit vers la pourriture, la décomposition à la fois psychologique et physique. Du coup, je me serais laissé emporter, je ne sais plus très bien où j'en suis. Un océan liquide dans le crâne, voilà. Savez-vous que ce ne serait pas pour me déplaire ? Et même, ça me botterait. Moi qui ai toujours eu des velléités de pêcheur au harpon ou de baleine blanche. Dans un crâne, certainement, les contradictions, les paradoxes s'abordent-ils copieusement, se sabrent. Hier, vers 17h30, j'ai soulevé un loup. J'étais en train de relire ce bon vieux Horla quand, tout à coup, j'ai repensé à ces impressions étranges que j'avais traversées adolescent en parvenant sur le seuil de La Ville sans nom. Comme il était l'heure du thé, j'ai laissé en plan, non sans faire un nœud à mon mouchoir afin d'y repenser vers 19h, heure à laquelle je suis suffisamment tranquille pour penser à des choses absconses, idiotes, affreusement inutiles. Figure-toi, me suis-je dit, que L. ait lu Le Horla, qu'il ne l'ait dit à personne et s'en soit inspiré. Et à partir de là, trois petits articles que l'on pourra trouver dans la rubrique lectures. Quand ils seront prêts évidemment, il faut encore les relire, sait-on jamais qu'on voie encore des pans entiers de mystère se lever, numéroter leurs abattis et, quelque part, au-dessus de cette masse grouillante et gluante, une espèce de bouffon en guenilles hurlant : — ARTICULE ! ARTICULE ! L’empereur impérial, impérativement. Le dibbouk a sorti un vieux mouchoir sale de la poche de sa redingote et l'a agité devant lui. --Adieu raison, vaches et cochons ! a t'il ajouté en se moquant bien sûr. De mon côté je me suis demandé si je n'allais pas me raser c'est jeudi, l'heure d'aller enseigner arrive à grand pas.|couper{180}

Carnets | Atelier
26 janvier 2025
Réveil à 11h. Passé la nuit à retravailler des textes, à m'arracher quelques poils du nez ou des oreilles pour tenter de comprendre ce que je voulais dire. Des voix venues d'un tréfonds insondable, abscons. Mais qu'il faut respecter malgré cela. Il faut tout respecter, même ce qui se présente comme l'irrespectuosité flagrante. Non pas dans cette sorte de servilité abominable qu'affichent les collabos malgré eux, encore qu'elle soit respectable aussi, si l'on veut. À condition de le vouloir, d'être en suffisamment bonne forme, d'avoir bu un café fort et sans sucre, amer, et d'être prêt à affronter le vaste ciel bleu qui s'étend au-dessus de la ville. Il y a dans l'auto-sabotage une forme de joie sauvage qui peut prendre la place de la mélancolie pathologique. Ce que permet le réseau social, cette mise en scène de l'auto-sabotage, est-elle un acte purement narcissique ou un acte de résistance, de révolte ? Pas à toi de le dire. Il faut sans doute ne pas vouloir le savoir pour poursuivre. L'algorithme en perd son latin et toi, tu apprends la déclinaison.|couper{180}

Carnets | Atelier
25 janvier 2025
La saturation prend à la gorge dès l'ouverture d'un fil d'actualité. Cinq milliards qu'ils sont maintenant, tous là, à scroller sans fin dans le fil des catastrophes. Le doigt qui glisse et l'œil qui suit, mécanique bien huilée de notre temps. Deux heures vingt-trois en moyenne qu'on y passe, à s'intoxiquer de ces fragments de monde qui nous explosent à la figure. Le cerveau est comme ça. Plus on lui balance du négatif, plus il en redemande. Circuit de la récompense qu'ils appellent ça, les scientifiques. On cherche la menace, on fouille dans les recoins sombres de l'actualité. Comme si ça pouvait nous préparer au pire. Illusion de contrôle, qu'ils disent. L'algorithme, lui, il connaît la chanson. Il te sert ce qui fait mal, ce qui choque, ce qui indigne. Plus tu cliques, plus il t'en donne. Huit personnes sur dix qui ne lisent que les titres, alors il faut que ça saigne dès la première ligne. Dans les têtes, ça travaille. La fatigue informationnelle, nouveau mal du siècle. Le stress monte, l'anxiété s'installe, la dépression guette. On appelle ça le "doomscrolling" maintenant - ce besoin compulsif de plonger toujours plus profond dans les mauvaises nouvelles. Les chiffres sont là pour témoigner. Huit minutes de moins cette année , sur ces réseaux. Comme si le corps, quelque part, commençait à dire non. Mais c'est pas si simple de décrocher quand la peur de rater quelque chose te tient par les tripes - la FOMO qu'ils appellent ça, ces spécialistes en acronymes. Et pendant ce temps-là, la machine tourne à plein régime. Des millions de textes, de vidéos, d'images qui déferlent chaque jour. L'attention, denrée rare dans cet océan de stimuli. Tous se battent pour un bout de cerveau disponible, pour un clic, pour un like. La surcharge fait son œuvre. Cognitive qu'ils disent, les experts. Modification de la mémoire à long terme, altération du jugement, indécision. Le cerveau qui sature, qui dit stop, mais la main qui continue de scroller. Alors certains, ils commencent à lever le pied. La JOMO - la joie de rater des trucs - nouveau mantra de ceux qui veulent reprendre leur souffle. Dix, vingt minutes par jour, pas plus. Se fixer des limites, comme un sevrage. Le paradoxe est là : plus on est connecté, plus on se sent seul. Plus on consomme d'infos, moins on comprend le monde. La saturation qui mène à la paralysie, à l'impuissance. Mais peut-être que c'est ça, la vraie résistance : réapprendre à respirer entre les nouvelles. Laisser le temps au temps, comme on disait avant. Quand les écrans n'avaient pas encore avalé nos vies. La saturation, elle nous guette tous. Mais peut-être qu'il suffit parfois de lever les yeux, de regarder ailleurs. — Le monde continue de tourner même quand je ne scrolle pas- dites-le 20 fois le matin, comme un avé Maria.|couper{180}