Atelier
Carnets | Atelier
Lutter contre l’insignifiance
Quand le fils alla trouver le père pour lui apprendre qu'il désirait être écrivain, ce dernier haussa les épaules et dit « ce n'est pas un métier », sur quoi il appuya sur le bouton du poste de télévision et ils allèrent s'installer à la grande table de la salle à manger. Ni la mère ni le frère ne s'aperçurent de rien. Il y avait eu une déflagration silencieuse et nul ne se rendit compte qu'à l'intérieur de la cervelle du fils, une plaie béante venait tout juste d'apparaître. Tout le monde mangea la soupe sans mot dire puis, une fois la table débarrassée, comme chaque soir, tout le monde alla s'échouer sur les fauteuils, les canapés pour s'endormir doucement devant un programme soporifique à souhait. Le fils ce soir-là s'endormit le premier. Dans son rêve il imagina qu'il courait mais ne pouvait avancer d'un seul centimètre. En fait, il s'éveilla au bout d'un moment et constata qu'il était le seul à être resté au salon, tout le monde était parti se coucher. Il se leva et aussitôt un sentiment d'insignifiance formidable s'empara de lui. C'était comme un nouveau costume qu'il venait d'enfiler. En l'espace de quelques minutes, tout au plus une heure, tout ce qui avait eu jusque-là la moindre importance à l'extérieur comme à l'intérieur de lui s'était engouffré dans cette étrange sensation qu'il éprouvait désormais. Pour pallier l'angoisse qu'il éprouva, il se rendit dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Il avala quelques tranches de jambon, puis piocha dans un paquet de pain de mie dont il déchira la tranche à pleines dents. Il termina sa collation intempestive par deux yaourts qu'il engloutit rapidement en employant une cuillère à soupe. Une fois qu'il trouva la satiété, il s'étira sans toutefois éprouver de contentement véritable. La sensation d'insignifiance était toujours là malgré la nourriture qu'il avait avalée, malgré le poids de celle-ci qu'il sentait peser sur son estomac. Alors il monta l'escalier doucement pour ne réveiller personne, s'allongea sur son lit et fit le tour de toutes les images des femmes qui provoquaient en lui du désir. Il s'arrêta sur celle de la voisine, une hôtesse de l'air hystérique à la poitrine généreuse et au langage vulgaire, et se masturba. Il espérait que le sommeil reviendrait une fois qu'il aurait joui, mais au contraire la sensation d'insignifiance qu'il éprouvait désormais avait encore augmenté. Ce fut à cet instant probablement qu'il s'empara du petit carnet qu'il venait d'acheter quelques jours auparavant en se promettant de tenir son « journal de bord ». Il inscrivit la date du jour et l'heure, il était désormais 2h52 du matin, et puis sa main resta en suspens dans l'attente de l'inspiration qui ne vint pas cette nuit-là.|couper{180}

Carnets | Atelier
Ce texte propose une réflexion sur la nature du cerveau humain et de...
Notre cerveau est une machine fascinante, mais son fonctionnement et ses relations avec l’esprit restent entourés de mystère. Alors que les neurosciences tentent d’apporter des réponses, de nombreuses questions demeurent : le cerveau est-il simplement une interface ou une antenne qui capte quelque chose de plus grand ? Et la conscience, est-elle seulement un phénomène électrique ou une porte vers l’inconnu ? Autant d’interrogations que l’auteur explore à travers un prisme à la fois scientifique et poétique.|couper{180}

Carnets | Atelier
La solitude insondable des femmes
C'est en réécoutant une interview de mon ami chaman Luis Ansa qui parlait de la solitude de la femme que ça a fait tilt. Mais oui, mais c'est bien sûr, cet attrait extraordinaire qu'elles ont toujours exercé sur ma vie, au-delà des premiers stades plastiques et émotionnels, c'est bien de cette solitude que tout est parti. À commencer par ma mère que j'apercevais enfant au-delà des vitres de la couveuse dans laquelle je développais ce sentiment de solitude moi-même et qui, par réflexivité ou projection, m'aura aidé autant qu'handicapé à chaque fois que j'aurais eu à aborder la présence de la femme. Ce serait simple de me dire que c'est en raison de cette précocité à venir au monde que j'aurais inventé cette sensation de solitude féminine. La petite phrase de Luis m'a libéré soudain de cette angoisse, ouvrant ainsi en grand les portes d'une vision bien plus large, et même cosmique. Qu'elle soit prostituée, institutrice, ménagère, chef d'entreprise, artiste, fille de peu ou fille de rien, la femme exerce une attraction puissante par le gouffre infini que je perçois au fond de chacune d'elles et dans lequel je tente systématiquement de m'introduire par l'esprit, par le cœur, et toujours en vain. Il en va de même de pétrir un sein et de ne jamais pouvoir atteindre à la réalité de celui-ci, tenu ontologiquement à l'écart par notre imaginaire, notre désir, notre rêverie. Tout sein comme toute femme est avant tout une fabrication mentale de l'homme pour l'homme. Il faudra bien des accidents de parcours pour que l'illusion commence à se fissurer, de nombreux renoncements et un amour infini et patient, la foi tout bêtement, pour se rendre enfin compte de l'évidence : la solitude de la femme est insondable. Insondable tant que nous sommes des hommes raisonnant comme des hommes sur les femmes. Les portant aux nues, ou les jetant plus bas que terre. Entre la putain et la maman, la femme ne se livre que si l'on accepte de regarder sans ciller l'interstice. Et encore, ce n'est pas tant elle qui se livre que notre incapacité, notre vertige. Au fond, c'est souvent une porte que l'on croit fermée tant qu'on veut le croire, parce que cela nous rassure ou nous arrange. Mais soudain s'aperçoit-on que cette porte ne possède pas de serrure, et mieux, qu'elle n'existe que dans nos têtes, alors soudain quelque chose se produit, comme un saut quantique. Nous avons traversé quelque chose, sans même nous en apercevoir, passé de l'autre côté de l'imaginaire millénaire, nous voici devant la femme à nouveau et qu'on ne verra jamais plus de la même façon désormais. La découvrant ainsi au bout du corridor comme au bout d'un nouvel utérus, une renaissance s'opère pour toute l'humanité dans son ensemble. Et l'on découvre alors que la solitude insondable de la femme, c'est la solitude insondable des étoiles qui n'attendaient que notre visite et notre regard enfin pour briller et se transformer en lumière. Sauf que lorsqu'on les voit, celles-ci ont déjà disparu.|couper{180}

Carnets | Atelier
La conscience de la conscience.
Notre cerveau, d'après les dernières informations dont je dispose, est une bien étrange entité. Il est froid, il n'éprouve aucune émotion, aucune douleur, et sa constitution est extraordinairement complexe, si bien qu'on ne sait toujours pas rivaliser avec celui-ci, notamment pour le modéliser, pour créer des cerveaux, doter les machines de ceux-ci, ou même s'en approcher. Lors de son développement, le cerveau de l'enfant, dans le ventre de la mère, produit à une vitesse sidérante un nombre de cellules chaque seconde. En revanche le cerveau préfrontal ne serait pas achevé avant l'âge de trente ans. On ne sait pas grand-chose comme je te le dis et surtout on ne sait pas si le cerveau et l'esprit ne sont qu'une seule et même chose, on n'en sait absolument rien. On a beau faire de jolis films d'imagerie médicale de quelqu'un qui serait en train de penser, ça n'explique pas du tout si c'est le cerveau qui pense ou s'il entre en interaction avec autre chose, qu'on peut appeler l'esprit, en latin spiritus, qui anime. Possible que le cerveau ne soit qu'une interface, un périphérique tout simplement ou une antenne pourquoi pas. Il existe en lui un centre de commandes (qu'on ne voit pas) pour chaque organe. Ainsi nous avons la possibilité de respirer durant 75 % de notre existence grâce à ce centre de commande qui prend en charge, que nous le voulions ou pas, cette fonction vitale. Il suffirait que je t'en parle pour que tu te mettes à prêter attention à ta respiration et c'est là un mystère encore : nous avons cette possibilité en tant qu'être humain d'être conscient du fait de respirer, et nous pouvons même contrôler notre respiration, ce que ne peut pas faire un animal. Le primate notamment est incapable de contrôler sa respiration. Depuis Galien et ses dissections de cerveau de singe, environ 200 différences ont été relevées entre un cerveau de singe et un cerveau humain. On ne saurait donc vraiment dire que l'homme descend naturellement du singe, il s'est passé quelque chose entre les deux assurément. En revanche il existe un centre de commande sur lequel nous n'avons pas la main, celui du cœur. En cas de détérioration grave de celui-ci, lorsqu'il est clair que tout va se terminer, quelques millisecondes avant l'arrêt cardiaque définitif, c'est bel et bien du cerveau que provient le signal de couper la machinerie. 16 millions de cellules dans un cerveau de singe, 75 millions de cellules dans un cerveau humain. Bon, des fois on se demande à quoi ça nous sert vu le résultat. Si on mettait bout à bout l'ensemble des nerfs, des canaux du cerveau, on obtiendrait une distance égale à deux fois le tour de la terre. Entouré par une glue pas très ragoûtante, le cerveau ne se laisse pas explorer aisément. Avec ses 5 étages, il ressemble à une forteresse imprenable. Qu'est-ce qui fait une telle différence entre un cerveau de primate et un cerveau humain, pourquoi le chaînon manquant reste-t-il introuvable ? On peut évoquer tout un tas de théories y compris une intervention génétique extraterrestre pourquoi pas, et celle-ci ne serait pas la plus loufoque de toutes. Quant à l'esprit, à la conscience, nul ne saurait expliquer ce que sont ces deux entités mais, peut-être une piste intéressante par la poésie liée à l'astrophysique. En effet, si l'on observe la quantité inimaginable de cellules, de neurones et les connexions innombrables de chaque neurone avec les autres, si on fait le compte nous ne sommes pas loin du nombre d'étoiles, de corps célestes que nous sommes en mesure de compter dans l'univers connu... De plus on découvre désormais que tout est plus ou moins baignant dans l'énergie noire ou la matière noire. Comme c'est étrange, nous avons aussi la même énigme dans notre cerveau, on appelle cela le corps noir... Il faut remonter à l'alchimie sans doute pour effleurer quelques idées déjà pensées bien en amont de nos soi-disant découvertes scientifiques. Je ne vais pas en dire bien plus sur ce sujet car cela mériterait un livre entier, mais cet esprit qui nous anime est familier de Paracelse notamment, mais de bien d'autres. L'esprit primordial, ou le Grand Esprit des Amérindiens, ou encore Dieu, nous pouvons l'appeler par de multiples noms. Cela signifie juste que nous sentons bel et bien sa présence sans toutefois pouvoir définir scientifiquement ce que c'est. Il en va un peu de même pour la conscience. Aujourd'hui nous vivons une époque formidable où les neurosciences, les neuroscientifiques sont à la mode. Cependant aucun ne peut non plus vraiment dire ce qu'est la conscience. Est-ce un phénomène électrique produit par le cerveau ou autre chose ? On ne peut pas encore le dire mais je penche bien sûr pour autre chose qu'une ampoule qui s'allume et s'éteint. 20 watts je crois, c'est la puissance dont le cerveau a besoin pour faire fonctionner toute la machinerie. Encore bien étrange qu'une si faible puissance puisse tant produire... De plus l'électricité dont il a besoin, il la produit lui-même, on commence tout juste à se pencher là-dessus aussi. Il serait peut-être bon de se tourner alors vers le Tibet qui pratique la méditation pleine conscience depuis belle lurette pour en savoir plus sur la conscience, sur l'esprit et le cerveau. Non, ça ne sera pas scientifique comme on a l'habitude de le concevoir, la belle affaire ! Pour avoir conscience de la conscience, il est nécessaire d'avoir du recul comme de la considération, ce mot formidable qui veut dire voir toutes les étoiles en même temps.|couper{180}

Carnets | Atelier
16 septembre 2019
Il y a quelques années, une rétrospective des frères peintres Bram et Geer Van Velde se tenait à Lyon. À travers l’histoire de ces deux artistes, l’auteur explore la force du déracinement, l’influence de l’exil et la naissance d’un langage pictural unique. Ce parcours témoigne de la nécessité de la faim créatrice et du travail acharné, indispensables à la révélation artistique.|couper{180}
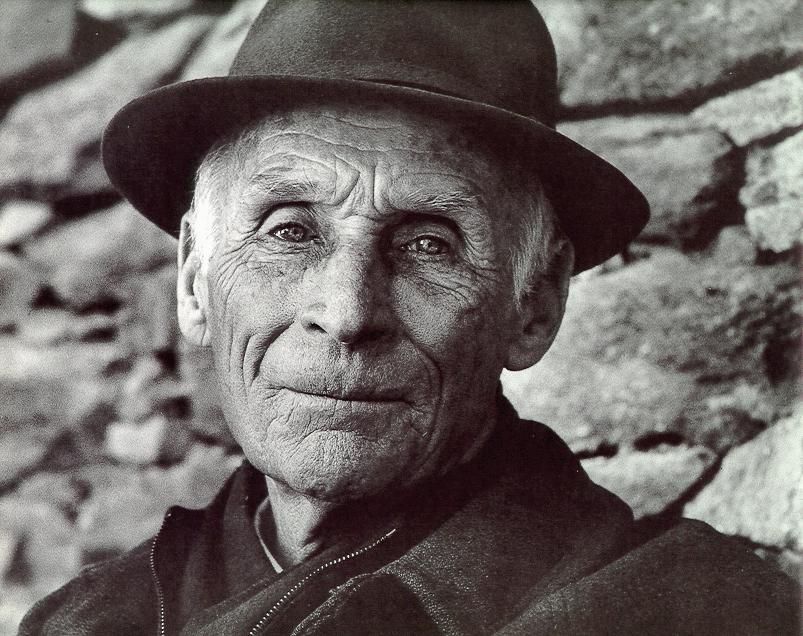
Carnets | Atelier
La peinture de Patrick Robbe-Grillet
Il arrive, rarement mais toujours avec force, que la peinture me détourne — non par indifférence, mais par effroi. Une panique douce m’attrape, un pas de côté, comme si j’approchais quelque chose de trop dense, trop nu. Ainsi en fut-il des toiles de Patrick, croisées un soir sur l’écran fade d’un site d’art contemporain. Je crus d’abord à une fumisterie mystique, de celles qui maquillent de spiritualité leur vacuité. On rabaisse souvent ce qui nous résiste. C’est plus facile, moins honteux que d’admettre qu’on n’y entre pas. Et pourtant, j’y suis retourné. Plusieurs fois, à distance. Pour rien, apparemment. Ou pour ce rien qui insiste, ce rien qui demande que l’on s’y tienne, juste là, au bord. Comme si l’image me disait : attends. Attends que le sens ne soit plus affaire de signes. Je crois que c’est cela, précisément, qui aveugle : l’habitude. Elle bâillonne l’œil. Elle fortifie autour de nous des cloisons de répétitions, et derrière ces murs on croit être à l’abri — alors qu’on ne fait que tourner en rond dans la cour familière de nos certitudes. On peut, bien sûr, s’arrêter à la beauté immédiate de ses grandes toiles, à leur éclat, à la séduction première des champs monochromes. Je l’ai fait. Mais très vite, une gêne est venue fendre le ravissement. Quelque chose, comme un courant inverse. J’ai fouillé, cherché des traces de Patrick, des bouts de biographie. Peu. Presque rien. Sinon un séjour en Chine, et ce qu’on dit souvent : concentration, gestuelle, silence du corps en action. Des mots déjà vus ailleurs, chez Fabienne Verdier par exemple. Mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait plus. Aucune narration dans ces toiles. Aucun récit pour que l’on puisse, à la faveur d’un miroir, y projeter la fable de soi. Rien que la matière, brute. Des clairs, des sombres. Le racloir. Un désordre qui, peut-être, n’est même pas un désordre. Peut-être est-ce le réel qui a cessé de se contraindre. Et c’est là que m’est venu le mot. S’absenter. Voilà. Le geste y est, sans son auteur. Le peintre s’est écarté. Et c’est dans ce retrait qu’apparaît le vrai. S’absenter — non pour disparaître, mais pour laisser place. S’absenter, comme une élégance. Un effacement actif. Ce n’est pas l’abandon, mais un don plus subtil : celui du silence. On pourrait croire cela à l’opposé d’un De Kooning, éclatant, saturé, frontal. Et pourtant, ces deux-là — Patrick le discret, Willem le fracas — me semblent se parler. Champ de bataille d’un côté, nef de cathédrale de l’autre. Même lieu, deux acoustiques. Ce dont ils parlent, en vérité, c’est d’une même chose : la nécessité de s’effacer pour peindre. Car c’est dans le vide que surgit le visible. Et cette trace-là, ce vestige du peintre rendu à l’absence, voilà ce que je reçois aujourd’hui comme un savoir. Illustration : Envolée Lyrique, Patrick Robbe Grillet|couper{180}

Carnets | Atelier
Impeccabilité
En tant que peintre, il suit une voie qu’il n’a pas choisie. L’envie de créer ne lui a apporté que des problèmes. Longtemps, il lutte contre elle. Il culpabilise quand ce plaisir l’éloigne de ce que l’on appelle « la vie active ». Il met des années à se débarrasser de cette culpabilité. C’est sans doute l’un de ses travaux les plus importants. Il ne sait pas exactement ce qui l’aide à assumer ce rôle. C’est un peu comme un rat dans un labyrinthe : au début, il se cogne partout, puis il comprend. Une seule voie mène à l’assiette. Il explore beaucoup, mais rien ne mène directement à soi. Pourtant, c’est l’ensemble de ces détours qui lui révèle qui il est. Et cela aussi, il le refuse. Une petite voix murmure : « Ne te berne pas toi-même. » Il apprend à l’écouter. Il l’appelle l’impeccabilité. L’impeccabilité n’est pas la perfection. Elle ne s’atteint pas. On ne peut que vouloir l’être. Pour cela, deux outils : devenir excellent et maîtriser son art. Il faut cesser d’obéir. Non seulement aux autres, mais aussi à nos propres convictions. Elles finissent par nous emprisonner. Plus il se déleste, plus la petite voix devient claire. Elle n’a pas besoin d’emphase. « La petite voix », cela suffit. Être impeccable, ce n’est pas vivre en ermite. C’est être pleinement engagé. On peut vivre dans la société en gardant ce son en soi. Il y a un humour dans cette voix, comme dans la vie. On apprend à le savourer. Il enseigne l’humilité. Il faut parfois serrer les dents, avaler des couleuvres. Et si l’on tente de s’éloigner, la vie nous ramène. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Mais mieux vaut ne pas rester cancre trop longtemps. Il y a un but à tout cela.|couper{180}

Carnets | Atelier
15 septembre 2019
En tant que peintre, je me suis engagé dans une voie que je n’ai pas choisie. L’envie de créer ne m’a apporté que des problèmes, et longtemps j’ai lutté contre cette envie. Je culpabilisais quand ce que je considérais comme une « perte de temps » — écrire, peindre — me procurait plaisir et paix, alors que je pensais devoir être à l’usine ou au bureau, dans ce que tout le monde appelle « la vie active ». Il m’a fallu des années pour me défaire de cette culpabilité. C’est sans doute l’un de mes travaux les plus importants. Je serais bien en peine de dire exactement ce qui m’a permis d’assumer mon rôle de peintre, tant les facteurs de convergence sont multiples. C’est un peu comme un rat dans un labyrinthe : au début je me cogne à chaque impasse, puis, peu à peu, je comprends qu’une seule mène à l’assiette. J’ai exploré quantité de sentiers : la philosophie, le mysticisme, la magie blanche et noire, les jeux vidéo, les amours. Je suis curieux de tout. Aucune de ces voies ne mène directement à soi, mais l’ensemble de ces expériences m’a aidé à découvrir qui je suis. J’ai pourtant résisté à cette idée. Pour qui me prenais-je ? Quelle prétention ! Quand je pensais à ces parcours, une petite voix murmurait : « Ne te berne pas toi-même. » En chemin, j’ai fini par sympathiser avec elle. Je l’ai appelée « l’impeccabilité », en souvenir de mes lectures de Carlos Castaneda et de Luis Ansa. Qu’est-ce que j’entends par impeccabilité ? J’essaie de le clarifier. Peut-être que chacun peut reconnaître en lui cette même petite voix et se dire : « Oui, c’est exactement cela. » Ne nous pressons pas : lisons attentivement. L’impeccabilité n’est pas la perfection. Elle est trop insaisissable pour se confondre avec la solidité rigide de la perfection. L’impeccabilité n’est pas quelque chose qu’on atteint : on ne peut que vouloir être impeccable. La nuance est subtile, mais essentielle. Pour cela, je crois que nous disposons de deux outils : devenir excellents et maîtriser notre art. Je parle de peinture, mais je pourrais tout aussi bien parler d’un tout autre domaine : dans la quête d’impeccabilité, l’objet compte moins que la rigueur. Une fois ces compétences acquises, on devient apte à suivre les recommandations de la petite voix et à délaisser celles dictées par nos peurs. Il me paraît crucial de cesser d’être compétent seulement pour répondre aux injonctions de la peur, aux attentes de la société ou de la famille. Il faut aussi cesser d’obéir à la fidélité aveugle que l’on porte à ses propres convictions : elles finissent souvent par nous emprisonner. Plus je me déleste de tout cela, plus j’entends clairement la petite voix, et plus j’avance sur mon chemin — le seul qui soit fait pour moi. Chacun peut l’appeler comme il veut, mais l’emphase brouille la vue et l’ouïe. Mieux vaut rester simple : « la petite voix » suffit amplement. Être impeccable ne signifie ni vivre en ermite, ni se croire au-dessus du bien et du mal. Pas du tout. Il s’agit d’être soi, pleinement engagé dans la relation que l’on entretient avec le monde. On peut vivre tout à fait normalement dans la société en conservant le son de cette petite voix. On peut percevoir la permanence de l’être tout en demeurant plongé dans l’impermanence du changement et du temps, et vivre ces deux réalités comme une seule et même chose : son chemin. J’ajoute qu’on peut chercher à se faire initier par qui l’on veut, et peut-être trouver quelqu’un de sérieux, d’intention juste. Le problème est de reconnaître ces qualités chez un maître… On peut aussi se tromper et tomber sur des charlatans. J’en ris : cela fait aussi partie de la quête d’impeccabilité. Les choses sont plus simples qu’on ne l’imagine. Si elles paraissent compliquées, c’est précisément parce qu’on pense trop. Une chose m’est certaine : cette petite voix a un grand sens de l’humour, comme la vie elle-même. On l’accepte mal au début, surtout quand on a été aussi orgueilleux que je l’ai été. L’orgueil blesse facilement. Avec le temps, j’ai appris à savourer ces conjonctions spirituelles, ces moments drôles où la petite voix et la vie frappent juste. Je suis persuadé qu’il y a un combat à mener pour ne pas sombrer dans le néant moderne, dépourvu de magie et de rêve, ce « à quoi bon » désespéré qui envahit notre époque. Mais je crois qu’il faut garder courage : traverser ce néant pour en ressortir plus fort. « Beaucoup d’appelés, peu d’élus », dis-je. Cela fait partie du chemin. Je vois des gens bien plus forts que moi et, parfois, je me sens ridicule. Cette expérience m’enseigne l’humilité, la vraie. Je conclus : il faut serrer les dents, avaler des couleuvres, des cafards, parfois. Que faire d’autre ? Si je tente de m’éloigner de ce que mon être et la vie ont choisi pour moi, inutile de m’inquiéter : la vie me remettra toujours sur mon chemin, que cela me plaise ou non. Mais mieux vaut ne pas jouer les cancres trop longtemps : il y a un but à tout cela. Une fois l’impeccabilité approchée, il ne reste qu’à s’engager pour les autres, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui, sans doute, ne la connaîtront jamais, parce qu’ils ignorent ce qu’elle signifie.|couper{180}

Carnets | Atelier
12 septembre 2019
Le départ se fait dans la bourse paternelle, starting-blocks gluants. Puis le coup de feu. L'autoroute. Certains restent au bord, essoufflés avant d'avoir couru. D'autres se font dépasser, écrasés par le flux. Des milliards de concurrents au départ, un seul arrive : toi. Tu es le champion. Celui qui a tenu. Tous ceux que tu croises sont des champions comme toi – cicatrices aux genoux, souffle court, mais debout. Avant, tu courais par instinct. Maintenant tu sais que tu cours. Conscience : ce cadeau étrange d'être à la fois le coureur et le spectateur de sa propre course. Tu perds du temps à te plaindre ? La course continue. Elle continue même si tu t'arrêtes, même si tu crois reculer. L'important n'est pas la vitesse, mais l'angle du regard. Ce que tu dois apprendre est déjà écrit quelque part. Mais ton cœur – ce muscle qui bat depuis le premier coup de feu – peut infléchir le tracé. Donner sens au parcours. Changer, même légèrement, la pente de l'autoroute. Je réecris ce texte en 2025 et il ne parle pas de la peur véritable qui en est le moteur, la nécéssité. C'est une peur banale, la peur de l'insignifiance. Si je devais réecrire ce texte aujourd'hui, j'essaierais de le reposer en trois parties L'esquive de la banalité de l'existence : Que la plupart des vies ne sont ni des épopées ni des courses effrénées, mais des séquences de routines, de petites joies, de souffrances ordinaires. La responsabilité personnelle : Que nos choix ont des conséquences, que nous ne sommes pas seulement des "champions sélectionnés" mais aussi des acteurs responsables. La souffrance spécifique : La douleur singulière, non métaphorique. Et surtout j'essaierais de trouver une transition honnête entre la violence de la sélection naturelle et la dignité de l'existence consciente. Car Le texte fait un saut magique de l'un à l'autre, évitant la question difficile : Comment devient-on un "champion conscient" dans un système qui produit mécaniquement des "victimes" ? Version 2025 — Sans métaphore de course Je suis né d'une course. Des milliards de concurrents, un seul gagnant : moi. Cette statistique devrait m'émerveiller. Pourtant, je me réveille chaque matin avec la même lassitude. La vérité est que la grande course, c'est le métro, le travail, les courses à faire, l'envie de se recoucher. Des routines, pas une épopée. Hier, j'ai parlé sèchement à S.. Elle a pleuré. J'étais fatigué. Le "champion" sélectionné parmi des milliards peut être cruel par fatigue. La responsabilité n'est pas dans la grandeur, mais dans ces moments-là. Je pense à mon cousin, mort à vingt ans. Lui n'a pas "tenu". À quoi bon lui dire qu'il était un champion ? Sa souffrance était spécifique : une chambre d'hôpital, des tubes, l'odeur du désinfectant. Pas une métaphore. Alors comment concilier ? Comment être à la fois le miraculé statistique et l'homme qui pète les plombs par fatigue ? Peut-être en arrêtant de chercher des champions et des victimes. En acceptant que nous sommes tous, simplement, des survivants. Avec nos cicatrices, nos lâchetés, nos moments de grâce. Le vrai courage n'est pas de gagner la course, mais de regarder en face la banalité de sa propre vie, d'assumer la douleur qu'on cause, de se souvenir des visages de ceux qui n'ont pas tenu. Et de continuer, malgré tout, à mettre un pied devant l'autre.|couper{180}

Carnets | Atelier
11 septembre 2019
Reprise du texte en 2025. À relecture tout me paraît grandiloquent, pas faux complètement mais reconstruit naïvement. Je reviens donc en arrière pour réexaminer la scène et j'écris un tout autre texte. Je me souviens de cette journée où j’ai rendu visite à Thierry Lambert. Aujourd’hui, je vois clairement ce que je cherchais : moins à rencontrer un homme qu’à trouver un miroir qui me renvoie l’image d’un artiste. J’étais fatigué. J’avais enchaîné les ateliers pour enfants, le déjeuner rapide. J’arrivais avec l’espoir confus qu’un « grand » me reconnaisse, me donne une clé, ou simplement me regarde comme un égal. Sa maison était pleine d’œuvres. Des piles de toiles, des sculptures. Je me suis perdu dans les noms, les références. Je voulais tout retenir, prouver que j’étais digne de comprendre. Puis j’ai lâché prise — ou j’ai cru lâcher prise. En réalité, je jouais au disciple émerveillé. Je me suis mis à parler de chamanisme, d’art sacré, de transmission ancestrale. De Luis Hansa que j'avais connu lorsque j'habitais Paris. Des mots trop grands pour une simple rencontre. Je crois que j’avais peur que ce moment soit banal. Alors je l’ai enrobé de mystère. J’ai fait de Thierry un chamane, de sa maison une forêt, de sa collection un chemin initiatique. Nous avons bu du thé. Parlé peinture, marché de l’art, parcours. C’était concret, simple. Mais dans ma tête, je dramatise déjà. Je me voyais en train de vivre quelque chose d’important. Aujourd’hui, je sais ce qui était vrai : sa générosité, le partage d’un gâteau, la lumière dans la cuisine, les chats derrière la vitre. Le reste — le vocabulaire initiatique, l’insistance sur le caractère unique — était de la construction. Une tentative de me grandir par procuration. Parfois, on se raconte des histoires pour traverser le doute. Ce jour-là, j’avais besoin de croire que l’art était une voie sacrée, et moi, un pèlerin. J’avais besoin de Thierry comme guide. Je ne suis plus ce pèlerin. Je n’ai plus besoin de chamanes.|couper{180}

Carnets | Atelier
10 septembre 2019
Quand Georges Bataille abandonne son père malade et handicapé à Reims pendant la guerre, il accomplit un acte qui nourrira toute son œuvre. On peut le traiter de salaud. Mais le jugement moral est une facilité qui éloigne du cœur des choses. Ce que cet abandon révèle, c’est que nous sommes parfois poussés par le futur — un futur encore invisible — à briser les trajectoires prévues. La loi, la morale, le bon goût : tout peut voler en éclats en un instant. Nous ne savons pas, sur le coup, d’où vient cette force qui modifie la formule chimique de nos cellules dans un éclair d’inadvertance. Il faut attendre des années, parfois une vie entière, pour que quelqu’un — nous-mêmes ou un exégète — commence à dénouer le fil des actes et de leurs conséquences. Sommes-nous responsables ? Oui, mais la conscience n’est qu’une partie du jeu. Il faut explorer la mémoire comme une jungle, sans s’attarder sur chaque détail, mais en aiguisant son regard à mesure qu’on découvre les sentiers. Les chamans, quand ils opèrent un nettoyage, commencent par la mémoire. En remontant à rebours, ils comprennent que l’histoire personnelle est peu de chose face aux forces qui nous traversent : éléments, cosmogonies, lumières et ombres qui luttent en nous. Notre mission, si mission il y a, est de fonder une harmonie — pas seulement un équilibre. L’équilibre, c’est un pas après l’autre, avec le risque permanent de chuter. L’harmonie, c’est un nouveau monde où les contraires ne s’annulent plus, mais chantent ensemble. Les grands voyageurs cherchent d’abord l’équilibre, puis se dirigent vers l’harmonie. D'autres encore marchent en somnambules. On ne peut que souhaiter qu’un rêve de chute les réveille — mais s’ils n’ont pas programmé ce rêve à l’avance, peu de chances qu’il survienne.|couper{180}

Carnets | Atelier
9 septembre 2019
Les béquilles de S. sont d'un bleu profond, presque neuves. Elles s'adossent au mur depuis l'opération. S. vit dans le présent. Moi, je fais des allers-retours constants. Le présent est une lumière blanche qui brûle – il me faut ces lunettes de soudeur pour seulement regarder. Sculpter un sens tolérable. Je pars en quête de bribes, ferraille rouillée, et je les soude comme je peux. Urgence. Sans cela, je resterais bras ballants dans l'incendie. S. a relégué ses béquilles dans un angle. Elle n'y pense plus. Moi, j'y pense. Pas aux siennes. Aux miennes : ces verres fumés, ce masque qui me permet de travailler sans être aveuglé. Je les ai détestées, bien sûr. Toute cette colère d'être handicapé. Aujourd'hui, je leur écrirais un mot. L'homme que j'étais, je ne le suis plus. Il m'a fallu des années à bourlinguer avec pour comprendre. Quand ma mère s'époumonait, le manche du martinet à la main – j'en avais coupé les lanières –, ma grand-mère Valentine grognait : « Tu te fatigues pour rien. Il ne comprend pas. Il ne peut pas. » Même dans la tempête, cette phrase : un point fixe, sorti d'une bouche édentée qui puait le tabac froid. Quand mon père me cinglait les reins, la voix de ma mère : « Non, Claude, pas la tête. » J'ai collecté ces phrases comme des bouts de métal tordu. Matière première. Ces haines enfantines, ces colères, ces mensonges, ces vols, ces fugues – tout cela est devenu mon stock. La colère, mon chalumeau. La haine, ma pince. Bien plus sûrement que tout amour factice. Je les ai améliorées, affûtées, comme on affine un geste d'atelier. S. vend au petit matin, dans des lieux improbables, des objets devenus inutiles. Je suis étonné que ces béquilles bleues ne soient pas déjà parties. Moi, j'écris ces textes au jour le jour. Ma manière d'écouler mon stock – le souvenir et la réflexion qui va avec. Une façon de dire adieu aux vieilles béquilles, et de reconnaître qu'elles m'ont, malgré tout, tenu debout. Qu'elles me tiennent encore, maintenant que je soude.|couper{180}

