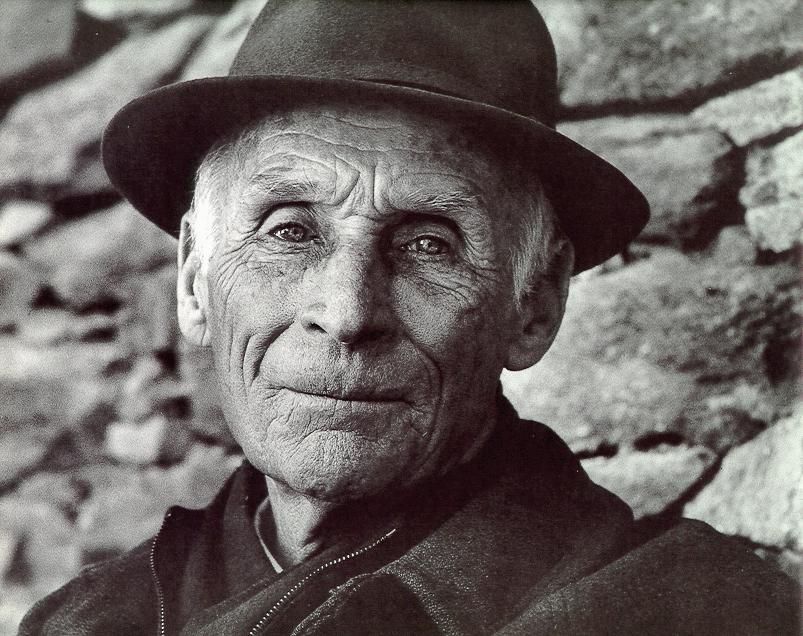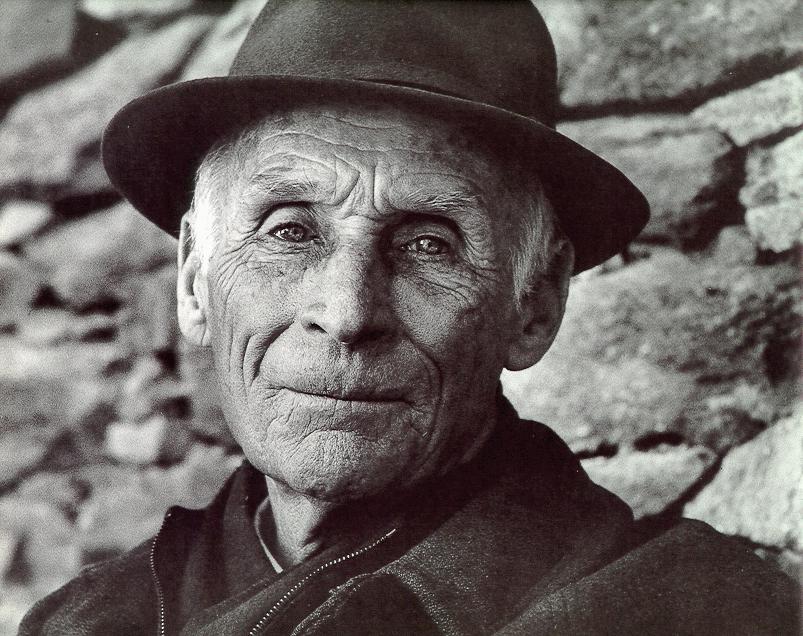16 septembre 2019
Il y a quelques années, une exposition magistrale se tient à Lyon, une rétrospective des frères peintres Bram et Geer Van Velde.
Sur des voies parallèles, les deux frères ne se rejoignent qu’à la limite que propose la fratrie, à l’horizon de sa volonté de trouver des « points communs ». Il suit le parcours proposé par le musée des Beaux-Arts, sous la direction de la commissaire Sylvie Ramond et de l’historien d’art Rainer Michael Mason.
À travers le cheminement des œuvres, il retrouve une sensation qui lui est chère, peut-être même le moteur invisible de la naissance de ces deux œuvres enfin réunies côte à côte : le déracinement.
Hollandais d’origine, les deux frères entretiennent une relation étroite, marquée par l’exil et la distance avec leur pays natal. Cela lui permet de saisir quelque chose d’important : l’inconnu dans lequel ils se plongent, laissant derrière eux le cercle familier de leurs habitudes, de leurs repères, et de leur identité.
Employés tous deux dans une entreprise de peinture et de décoration à La Haye, Bram et Geer suivent un cursus classique pour apprendre les techniques de peinture. Nous sommes entre les années 1915 et 1920.
C’est grâce à un voyage en Allemagne, proposé par son patron, que Bram continue à développer sa culture artistique, dans un village où il côtoie de nombreux artistes. Ses inspirations viennent alors de Van Gogh, de Munch — à l’origine de l’expressionnisme — et d’Emil Nolde, qui lui apprend à placer la subjectivité au centre de toute représentation.
Plus tard, Bram se rend à Paris, où il tâtonne en s’essayant à plusieurs genres, jusqu’à recevoir la « leçon de Matisse » et la « révélation » de ses couleurs, un peu comme un indien qui apprend son nom en passant à l’âge adulte. Mais c’est en Corse qu’il élabore véritablement son langage.
Geer rejoint son frère à Paris et tente lui aussi de trouver son propre langage pictural en explorant divers genres, dont l’art naïf. Les deux frères commencent alors à exposer ensemble, inséparables.
Dans les années 30, Bram s’installe à Majorque, où il restera jusqu’à la guerre d’Espagne. C’est là qu’il s’éloigne définitivement de la figuration tout en continuant à peindre ce qu’il voit, tel qu’il le voit. Il trouve alors les imbrications, les grandes plages, les recouvrements qui définiront son style pour toujours. Son langage pictural devient l’expression d’une peinture pure, un fait plastique authentique fondé sur une vision intériorisée du monde.
Il lui semble important de raconter ce parcours, car il indique plusieurs choses essentielles à ses yeux.
D’une part, il faut la faim, celle de peindre, celle de s’exprimer. Malheureusement, Bram ne connaît pas que cette faim artistique, mais aussi la vraie faim, celle qui tord les boyaux. D’autre part, il faut travailler sans relâche, multiplier les tentatives, échouer encore et encore, s’égarer pour mieux se trouver. Nul ne sait comment survient véritablement la révélation d’une palette de couleurs ou d’un langage formel, mais une chose est certaine : elle n’arrive pas par hasard. Il faut travailler énormément pour cela.
Personne ne peut dire pourquoi certains artistes passent à la postérité. Pourquoi Bram devient-il plus « célèbre » que Geer, sans doute jugé trop conventionnel par les gardiens du temple de l’art ? Pourtant, les choses changent avec le temps : ceux qui étaient célèbres jadis peuvent tomber dans l’oubli, et vice versa, au gré des humeurs des politiques, des marchands, et surtout de l’air du temps.
Loin de lui l’idée de jouer les critiques d’art à travers ces petits textes sur les peintres qui ont compté dans son parcours. Non, écrire lui permet avant tout de clarifier ses pensées, de les hiérarchiser, d’en comprendre l’importance, et peut-être, par ricochet, de les faire saisir à d’autres. Ce qui serait déjà un petit miracle en soi.
Il reviendra sur la peinture de Bram Van Velde, car il est tard et il doit aller peindre. Et ce besoin soudain de s’éloigner du sujet lui fait comprendre combien ce peintre a été d’une importance capitale dans son parcours.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | Atelier
Itinéraires
Très tôt je ressens l'appel de la forêt, c'est plus fort que moi, comme une voix à l'intérieur qui ne cesse de me dire : vas-y, abandonne tout ce que tu es en train de faire, et rejoins les arbres. Je crois que je viens juste d'obtenir mon premier vélo quand les premières injonctions intérieures débutent. Je viens tout juste d'avoir sept ans, ma tête est en feu, le monde entier me semble être un cauchemar permanent, alors je décide de partir. La forêt de Tronçais est proche dans mon esprit mais il me faut beaucoup de temps et d'efforts néanmoins pour parvenir à la rejoindre. Il y a tout d'abord cette grande côte à grimper sur quelques kilomètres avant de prendre à gauche et rejoindre l'Aumance, à la hauteur d'Hérisson dont j'aperçois les ruines du château, ensuite ça file à peu près droit mais sur un ruban qui n'en finit pas de s'allonger encore et encore... Peu importe, le soleil traverse le tissu de ma chemise pour me chauffer le corps, je sens la caresse du vent sur ma joue et continue de pédaler, ivre de liberté, entre les champs de blé, de luzerne, de maïs, sur la petite départementale. Enfin je l'aperçois. Une grande masse sombre se découpe à l'horizon. La route au loin s'enfonce dans celle-ci. Je mets le cap vers le Rond du Trésor, et ce faisant je me répète l'histoire que me racontait mon grand-oncle. « Entre le premier coup et le dernier coup de l'horloge de Saint-Bonnet, le village voisin, tu peux venir voir car tout est vrai : le soir de Noël à minuit, la terre s'ouvre exactement ici et laisse alors entrevoir des quantités inouïes de trésors, si tu es rapide, tu peux vite t'engouffrer mais prends garde de ne pas rester enfermé, car la terre ne s'ouvrira à nouveau que l'année suivante. » Cette question me hantera, je crois, toute ma vie. Que faire alors ? Tenter le coup et se dépêcher de s'emparer des trésors de la terre ? Ou bien renoncer carrément en les contemplant de loin ? À presque soixante ans, je dois avouer que je n'ai toujours pas résolu cette question. IllustrationChêne de la forêt de Tronçais Photographie Philippe Morize|couper{180}

Carnets | Atelier
La jauge
Mon grand-père le faisait déjà, il continuait à conduire des bornes et des bornes après que le témoin de la jauge d'essence s'est allumé. J'ai évidemment fait mien cet héritage, ce peu, ce presque rien à hériter m'étant devenu, j'imagine, d'autant plus précieux au fur et à mesure des années que j'ai été spolié de tout le reste. Non pas que j'en conserve une rancune particulière désormais. Non, j'ai tout pardonné bien sûr, sinon il m'aurait été proprement impossible de vivre. La rage et la haine ne durent qu'un temps pour apprendre à se construire différemment, il faut cependant éviter de les conserver comme des alliés persistants, car nul doute que ceux-ci auraient tôt fait de nous dévorer les entrailles. J'allais m'engager sur la route de Vanosc lorsque j'en ai eu marre tout à coup de jouer avec le feu. J'ai fait signe aux quatre véhicules qui me suivaient de me dépasser en indiquant sommairement la destination vers laquelle nous nous dirigions, et puis j'ai rebroussé chemin vers la nationale, je me suis engagé dans la direction de Saint-Agrève, autrement dit vers l'inconnu, dans la quête d'une station d'essence. La route s'enfonçant entre les flancs des collines ardéchoises ne présageait rien qui vaille, nulle maison, nul village, pendant quelques kilomètres je me demandais à la fois jusqu'où il allait falloir rouler en même temps que je faisais un point rapide sur les conséquences désagréables de la sale manie qui m'avait été transmise. Tomber en panne serait tellement ridicule, plusieurs fois j'avais imaginé m'arrêter à une station, elles étaient nombreuses dans Annonay tout à l'heure, mais à l'idée d'interrompre le convoi tout entier, j'avais éludé. Entre deux situations ridicules, c'est souvent la pire qu'il s'agit de choisir évidemment. Un bref instant, j'aperçois la silhouette falote de ce petit gamin sur le dos duquel les parents ont placardé leur dépit dans le mot « cancre » et qui devait se rendre au village le samedi pour aller quérir le pain et le journal. C'est derrière un nouveau virage que soudain j'aperçus la station, au début j'ai cru qu'elle était abandonnée, tout paraissait si désuet, à l'abandon, pas même d'enseigne lumineuse indiquant les tarifs des carburants. J'allais presque la dépasser avec dépit lorsque j'ai aperçu la porte du bureau entrouverte. Coup de frein, marche arrière, et me voilà devant une charmante petite dame qui me demande pour combien je veux de 95. Le destin une fois de plus aura donc été clément et m'aura pardonné cette nouvelle provocation, quasiment automatique. Il faudra tout de même que je creuse un peu plus un jour d'où me vient cette sensation d'avoir toujours plus ou moins peur d'être ridicule.|couper{180}

Carnets | Atelier
L’invitation merveilleuse
Au volant de la Twingo de mon épouse, je roule lentement sur la route étroite menant vers les hauteurs d'une des mille et une collines de la Drôme. Le cap est tracé par la présence, au loin, des gigantesques éoliennes dont la blancheur se découpe sur fond de ciel bleu profond. Enfin j'arrive à Saint-Martin-des-Rosiers et actionne le clignotant pour indiquer que je vais tourner à gauche. À l'angle, les bâtiments de l'école sont déserts ce samedi. Alors je tente de me remémorer les quelques souvenirs de mes interventions ici en tant que prof d'arts plastiques, mais je comprends que c'est surtout pour calmer l'excitation que j'éprouve à chaque tour de roue supplémentaire. Aujourd'hui, samedi, je suis invité à déjeuner par des personnes formidables, Michel et Marie, et je me mets des claques, je me pince, afin de chasser loin de moi les quelques miasmes de dépression chronique dont j'aime être la victime chaque automne. Étrangement, toutes les applications de mon smartphone sont en panne, Maps ne donne plus signe de vie. Je dois donc faire confiance à mon instinct pour trouver la maison que je cherche. L'entrée du village de Fay-le-Clos est un champ de bataille organisé par la voirie du coin. Coup de chance, quelques centaines de mètres après avoir emprunté au hasard la route de droite, j'aperçois une pancarte qui m'indique l'atelier « MCA ART ». Me voici en train de me garer devant une vieille bâtisse avec dépendances, deux grands arbres majestueux l'ombragent sur la face avant et je reste un instant pour regarder en contrebas la vallée qui s'étend. Ici pas d'usine, rien que des champs. Au sommet de la colline derrière la maison, je peux encore apercevoir les immenses pales tourner silencieusement. D'autres véhicules sont déjà là, je regarde mon portable, il n'est pas loin d'être 13 h, je dois être bon dernier à l'aune de mes pensées dépressives que je tente de balayer encore en poussant le portail et en levant la main tout en criant « coucou ». Michel, bien que toujours calme, a l'air content de me voir et je souffle un peu, et puis tout de suite Marie qui vient à ma rencontre et qui m'apprend avec émotion en m'embrassant combien elle est contente et soulagée que je sois venu. Bon, alors je peux vraiment respirer un bon coup et en finir avec mes angoisses dépressives, je me dis : ouf, je vais passer un bon moment, allez. Je lui tends les gâteaux et le cadeau que j'ai préparés pour mon grand ami Chaman qui est là lui aussi et dont nous devons célébrer l'anniversaire. Enfin, ça y est, je les aperçois tous, les invités, déjà attablés, portant les verres à leurs lèvres. Pendant que Marie disparaît dans la pénombre de la cuisine, je marche vers la grande table, embrasse des visages connus, serre des mains et m'installe. Bon sang, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été invité que je me féliciterais presque de ma prise de décision de ce matin, de m'être encouragé et de cette attention à ne pas me laisser submerger par mes émotions contradictoires de ces derniers jours. Après quelques gorgées d'un délicieux vin de sureau concocté par la maîtresse des lieux, je parviens enfin à me détendre. Le soleil est chaud et achève d'apaiser toutes mes angoisses qui peu à peu se dissipent en écoutant le chant global des multiples sujets de conversation. Je retrouve un peu de ces anciens moments perdus dans le temps que je n'aimais pas cependant, enfant. Ils me reviennent soudain transformés de manière inédite, peut-être par la nostalgie, et cela évoque tout à coup un vrai repas de famille. Nous abordons le temps comme une plage longue et sablonneuse propice à la rêverie, le luxe du temps avant de repartir vers Vanosc dans l'Ardèche voisine en fin d'après-midi pour participer au finissage d'une exposition à laquelle deux seulement d'entre nous, Marie et moi, participent. Le grand chaman ne dit presque rien, il est heureux, cela se voit, de temps en temps je jette un coup d'œil vers lui et il me tire discrètement la langue en souriant. Le grand chien blanc de la maison s'approche de moi et vient poser sa tête sur ma jambe dans un mouvement d'abandon qui m'émeut presque aux larmes soudain. En lui caressant le museau et le crâne, je repense à toutes les amitiés que j'ai laissées filer un bref instant, moi le paria perpétuel, le déchiré de toujours, et ce moment familial m'étrille en profondeur. Puis je me reprends vite en lui parlant : « Hum, tu es attiré par la bouffe, toi ? » Sans doute aussi, pour me ressaisir, je me lève tout à coup en constatant l'incompétence marquée en matière de découpe de volaille de mon voisin d'en face. Moi, petit-fils de volailler, je ne peux pas accepter qu'on maltraite ainsi une bestiole. Mais non, pas besoin de découper les os avec une cisaille, les cartilages existent ! Il suffit de les retrouver ! Et de m'emparer du grand couteau puis de tenter de découper chirurgicalement, et surtout sans perdre mon honneur, le poulet en de jolis morceaux bien présentés. Encore une chose de bien, c'est le fait d'y arriver, me dis-je en aparté. En fait, je ne sais plus vraiment de quoi nous avons parlé tout le long du repas. Ce n'est pas cela l'important dans le fond. L'important, c'est cette bouffée de chaleur humaine que j'ai pu accueillir à cœur ouvert, courageusement, sans me réfugier dans le jugement ou la pitrerie. Il est possible en fait que tout ce que l'on raconte sur la vallée en dessous soit vrai, que tous les gens qui vivent là sont un peu magnétiseurs, voyants, connaissent le langage des animaux et savent guérir autrement qu'avec des pilules. De temps en temps j'aperçois un chat qui traverse l'espace du jardin, puis deux, chacun cherchant un lieu ensoleillé pour s'allonger et jouir de la caresse chaude de ces premiers jours d'automne. Je suis si bien d'un coup que lorsque j'entends Marie dire : « Personne ne veut plus de whisky ? », mon sang ne fait qu'un tour et je lui tends mon verre. La chaleur de l'alcool que je sens pénétrer dans mon gosier me fait l'effet d'un shoot pour un drogué en manque depuis longtemps. Soudain, nous nous apercevons au fil de la discussion, Grégory mon voisin de gauche, Marie et moi, que nous avons tous été des gamins maltraités. Cela me fiche un coup qu'on en fasse le constat à cet instant précis où j'étais en train justement de ruminer toutes ces choses de façon solitaire. Un silence tout à coup, quelque chose de suspendu, et puis quelqu'un dit : « Bonjour, mossieur Olive Taponade ! » Tous nous nous engouffrons dans un fou rire salvateur, le temps reprend son cours, nous nous éloignons du nœud brûlant des souffrances. Mon attention se porte sur Michel, le calme Michel dont les cheveux repoussent et qui me dit que cela va de mieux en mieux depuis qu'il a arrêté un traitement. Grégory aussi a eu un épisode terrible il y a de cela cinq ans et c'est grâce au même traitement dont il aura été le cobaye à l'époque qu'il a survécu. Difficile de leur emboîter le pas dans cette conversation que je laisse se déployer en conservant le silence. Ils se connaissent depuis longtemps, Michel et Marie, ils semblent avoir bourlingué beaucoup, essuyé tempêtes et naufrages, j'entends parler de la Nouvelle-Calédonie, et d'autres lieux encore au bout du monde. Il me semble surprendre à un moment un passage à l'académie navale. Je ne pose pas de question, j'écoute. Michel s'exprime avec clarté et précision, une maîtrise qui m'en dit long sur les barrières à franchir pour conquérir son amitié. Marie est chaleureuse, bienveillante, elle ne craint rien, sa confiance en l'autre semble avoir dépassé le besoin de tout retour, de toute compensation. Je découvre des gens merveilleux au fur et à mesure que le repas s'étend, ce merveilleux, je le soupçonnais déjà un peu mais je me méfiais encore tout à l'heure qu'il ne fût encore l'une de mes inventions habituelles pour embellir la tristesse des jours. Mais non, cette fois pas besoin d'inventer, les gens ils sont réels comme j'aime la réalité, cette réalité qui se loge dans la profondeur du monde et qui ne surgit que trop rarement pour reprendre son souffle. Le grand chaman est resté silencieux pendant presque tout le repas. Il écoutait l'ensemble et aussi certainement bien plus encore. Poliment, comme seul lui sait le faire, avec cette extrême pudeur qui fait pendant à son orgueil presque enfantin parfois, il a déclaré qu'il était touché par cette célébration comme jamais il ne l'avait été. Peut-être que finalement lui aussi a passé une enfance difficile, me suis-je dit, mais nous n'en savons rien, il s'est tu en savourant le verre de champagne qu'il tenait puis il nous a encore une fois tiré la langue et j'ai su que tout était parfait, exactement comme il le fallait.|couper{180}