avril 2022
Carnets | avril 2022
notule 4
Et puis un jour de débine, j’ai craqué, j’ai fait bouillir de l’eau j’ai épluché des légumes imaginaires, j’ai fait bouillir de la viande rêvée, parmi les meilleurs morceaux, puis j’ai jeté l’oignon invisible planté de son clou authentique dans la marmite. Et bien ce fut un succulent repas pour tout vous dire. Pas aussi émotionnant qu’un soir de Noël à bouffer des patates imaginaires devant Chantal Goya transformée par moi-même en l’occasion en fée Viviane, non tout de même pas. J’ai pleuré deux fois plus fort malgré tout poussé par l’extrême nécessité de célébrer ce moment . Puis malin comme pas deux, j’ai recueillis les larmes dans un petit flacon. ça pourra servir l’année prochaine à la même heure au même moment si je me retrouvais par infortune soudain les yeux secs.|couper{180}

Carnets | avril 2022
Un véritable ami.
Peu à peu le son du pipeau est en train de m'anéantir. Il est en train de tout dissoudre de ce que je crois être la réalité de ma vie, de qui je suis . Arrive un moment où j'ai du mal à savoir qui je suis. Je ne vois que la guerre, des champs de batailles interminables ici sur terre et sur d'innombrables planètes. je vois des massacres incessants, et le pire est que je participe à tous ces massacres. L'être que je vois en tuer d'autres par milliers c'est moi. Je le fais sans la moindre émotion, sans remord ni regret comme le fait un soldat. La part humaine qui est encore en moi à ce moment là est horrifiée face à une telle absence d'émotion ou de sentiment, et en même temps je parviens néanmoins à éprouver de la compassion pour cet être qui passe le plus clair de son temps à tuer. D'un certain point de vue je peux dire que je le comprends. Il est animé par la nécessité, par l'instinct de survie. Deux races principales de géants s'affrontent. Deux races principales de reptiliens et il y a de cela des millions d'années que la guerre a commencé. Je suis un parmi des milliards d'autres qui se bat pour sauvegarder une idée de vivre ensemble. Je suis un reptilien terrestre. Je suis né il y a 60 millions d'années, peu de temps après la grande extinction qui décima une grande partie de mes congénères. L'histoire officiel parle d'une météorite tombée sur la péninsule du Yucatan, mais c'est inexact. Il s'agit ni plus ni moins d'un génocide. L'histoire officielle sur Terre ment souvent elle ne parle pas de l'évolution des survivants du génocide. Nous avons évolué sur des millions d'années, avons bâti des civilisations, découvert des technologies qu'aucun être humain ne serait même en mesure d'imaginer. Puis nous avons du nous cacher pour ne pas éveiller l'attention de nos ennemis dans les profondeurs de différentes planètes de la galaxie dont la terre évidemment. Soudain je vacille et m'effondre au sol. Que se passe t'il donc ? Le son du pipeau reflue lentement vers l'extérieur en même temps que je recouvre mes esprits humains si je puis dire. J'ouvre les yeux et je vois Jim empoigné par les gardes. Il vient de faire quelque chose qui ne leur plait pas du tout visiblement. Et pour cause, il a bondit sur le conseiller et d'un coup lui a enfoncé le pipeau au fond de la gorge. Le conseiller git à terre désormais. La reine regarde la scène, elle est au bord de l'apoplexie. Son regard se fait cruel et menaçant. — Tuez les tous hurle t'elle Jim se relève et fait barrage immédiatement à un garde qui tire avec une étrange arme métallique une sorte de rayon laser. Il est malheureusement touché en pleine poitrine. Il a juste le temps de dire sauve toi mon frère, Shanti sauve toi. C'est alors qu'un raie de lumière éblouissant pénètre par le plafond de la salle, tout notre groupe est soudain emporté comme dans les films de Star Trek. Lorsque nous arrivons à destination je comprends que nous sommes dans un autre vaisseau un peu semblable au notre mais qui a l'air encore bien plus vaste. Devant nous se tient un personnage de petite taille que je reconnais aussitôt sans pouvoir pour autant poser un nom sur son visage. —Décidemment Shanti, il faudra toujours que je vole à ton secours. Je souris bêtement comme je le fais à chaque fois que je ne comprends pas ou bien que je n'entends pas car j'ai l'ouïe un peu défaillante parfois. — Occupons-nous de lui vite dis-je tout à coup en voyant que Jim git encore au sol sans connaissance. Notre hôte sort lui aussi un objet métallique de sa poche et le porte à sa petite bouche sans lèvre. Une musique céleste envahit toute la salle et au même moment un nom surgit : Myrddin ! — J'ai bien peur hélas que nous ne puissions plus rien faire pour lui dit Myrddin. Sa mission s'achève ici. —Tu devrais garder au moins garder ça en mémoire Shanti, Jim est un véritable ami. Il t'a rejoint dans cette vie pour arriver à ce but, t'empêcher de mourir, comme tu l'as déjà fait des centaines de fois pour lui. Je me souvenais déjà de tellement de choses. Jim était intervenu sans doute pour que je ne me souvienne pas de tout, pour que je ne redevienne pas l'être totalement insensible que j'avais été déjà dans des milliers d'autres vies. La seule chose de bonne est que j'ai retrouvé mon vrai nom apparemment. Shanti, je m'appelle Shanti. Il faudra que j'aille voir sur Wikipédia à quoi ça correspond pour les humains car il me semble avoir déjà croisé ce nom, peut-être dans la mythologie hindou. Et tout à coup je me souviens que Myrddin correspond aussi à Merlin. Tout cela est incroyable. Si ce n'était la perte de mon ami je rirais de bon cœur. A quoi tout cela mène t'il me demandais je — Nous travaillons tous de concert pour la conscience et le but me dit Myrddin sans que je ne vois bouger sa bouche à un seul moment.|couper{180}

Carnets | avril 2022
notule 3
On glose. On interprète. Surtout sur la forme sans vraiment s’attarder sur le fond. Cette notion de vide et de plein n’est pas évidente à saisir pour des personnes qui ont besoin d’amasser quantités d’objets, de concepts, pour se sentir en sécurité. Créer le vide c’est travailler sur sa peur. Une fois cette notion acquise il n’y a plus de séparation. On peut même remplir totalement l’espace d’un tableau et provoquer exactement la même émotion qu’une peinture chinoise. On peut y percevoir la même légèreté, la même liberté. Ici j’aimerais mettre en relation la peinture de madubhani et l’art brut Je décèle dans ces œuvres un lien de parenté. Par quoi ces peintres sont ils animés ? Est-ce la peur ? La volonté de perpétrer au point prêt une tradition ? Une forme inédite de folie ? Qu’importe au final C’est le même mystère que l’on peut percevoir et ce mystère nous touche, me touche. Aller jusqu’au bout d’une possibilité de remplissage de l’espace et voir soudain le plein s’inverser en vide…|couper{180}

Carnets | avril 2022
notule 2
Mes cours s’arrêtent demain. Les vacances.. raison de plus pour mettre les bouchées doubles. En plein travail à l’atelier Mon programme est de revenir sous chaque soleil dessiner et peindre ce qui peut remonter dans mon souvenir. Le premier soleil, l’âge d’or, hyperborée il y a de ça quelques centaines de milliers d’années. Une paille à côté des 4 milliards d’années d’existence de la Terre soi disant. Une petite esquisse, puis un encrage au feutre et la recherche des couleurs …|couper{180}
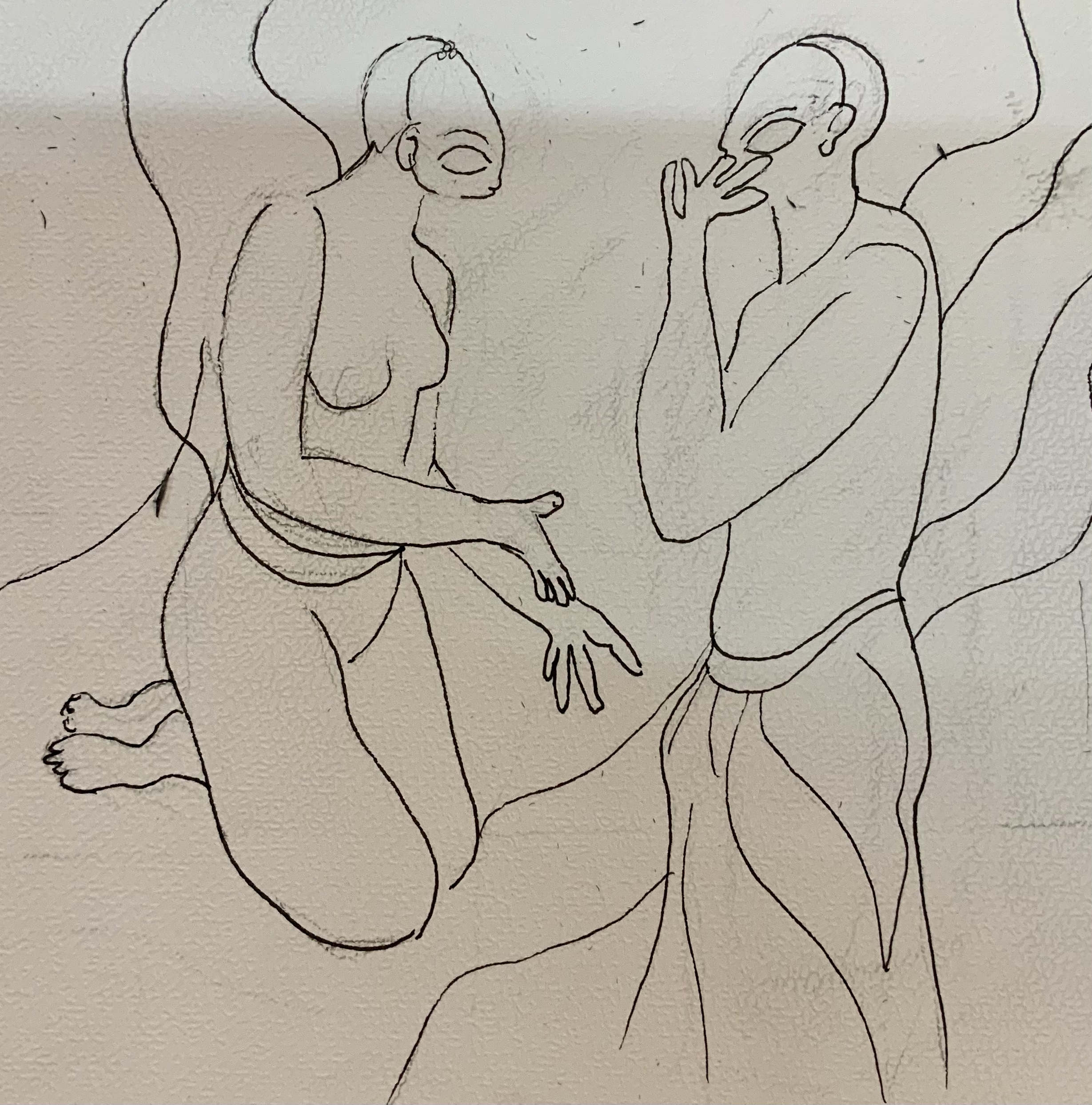
Carnets | avril 2022
Notule 1
Notule comme Nautilus le vaisseau submersible du Capitaine Némo, héros de l’enfance. La notule c’est une idée qui passe comme une anguille électrique et qui très vite disparait dans les abysses. Pourquoi pas note tout simplement ? A cause de canule aussi ( allez donc voir sur Google) Non mais notule c’est bien ça fait aussi penser à rotule à une articulation, à des assemblages cartilagineux qui eux mêmes évoquent Carthage, et quelques guerres Puniques Punique comme pugnace et toute la sainte clique des mots en nique. Belle panique ! Donc une nouvelle catégorie qui n’est toujours que le prolongement de quelque chose d’autre un raffinement comme on fabrique des scoubidous à partir de résidu de pétrole Le fameux pet de Troll. qui d’ailleurs vient à manquer depuis qu’on ne croit plus aux Trolls. Comment ça marche ? et bien je crois que je vais numéroter. Notule 1 Notule 2 et comme ça comme Opalka jusqu’à la fin ça me détend d’énumérer.|couper{180}

Carnets | avril 2022
Frères galactiques
Le lendemain après Pâques je me réveille avec la gueule de bois. Bien que je n'ai bu aucune goutte d'alcool. Je pense à ce roman que je suis en train d'écrire et je me demande ce que j'ai bien pu faire pour que rien de bon ne vienne ce matin. Comme si j'étais lourd, embourbé dans une suite d'empêchements. Auparavant je mettais cela sur le compte de la fatalité, ou d'une dépression chronique, ou encore d'un manque d'estime pour moi-même. Cette sensation perpétuelle qui me revient depuis l'enfance d'être nul, de n'avoir nulle part droit à une place. Mais je ne peux plus penser ce genre de choses à présent. J'ai cette responsabilité désormais de comprendre ce qui provient de moi et ce qui désormais doit être considéré comme une attaque extérieure. Je sais que ça va paraitre fou pour bon nombre de personnes mais la magie noire existe. Je n'ai pas d'autre mot pour qualifier ces attaques. Et peu importe d'ailleurs. Tout ce que je sais c'est qu'il faut que je me recentre profondément dans mon cœur, dans ma mémoire pour retrouver la paix et repousser l'Ennemi. En même temps je réfléchis et je ne peux m'empêcher de récapituler les différents événements. Depuis le premier moment où j'ai osé parler de mes contacts extraterrestres et aujourd'hui presqu'un mois désormais c'est écoulé. De plus j'ai publié régulièrement tout ce qui m'était comme dicté sans m'attacher aux conséquences d'une telle divulgation. En me rassurant sur le fait que la plupart des gens qui liront cela penseront qu'il ne s'agit que d'une fiction. Mais je n'ai pas pensé qu'en agissant ainsi j'allais forcément attiré l'attention d'êtres beaucoup moins bienveillants. Je remarque également que la sensation d'empêchement est devenu plus concrète si je peux dire depuis que j'ai commencé ma série de petits tableaux qui porte le titre "Révélations". Je me suis même inscrit sur le réseau VK, le Facebook russe, pour les poster sans savoir pourquoi. C'est comme si j'avais été guidé là aussi. J'ai juste eu la présence d'esprit de ne pas mettre mon vrai nom cette fois-ci , d'utiliser un pseudonyme. Autre élément perturbateur, et que j'aurais trouvé amusant il y a quelques semaines encore : Les emails répétés de ce prétendu Chaman qui me sollicite afin que je l'aide à soigner une louve géante malade, moyennant quelques euros évidemment. Cela fait trois ans je crois que je reçois des emails de sa part. Je ne me suis jamais désabonné car je trouve ses récits, ses pages de vente si on veut, extraordinaires. Il sait manier l'empathie, le copywriting à la perfection. Il m'a même tellement épaté que je lui ai acheté un talisman une fois. Tout travail mérite salaire je m'étais dit. Au delà de l'aspect risible de cette anecdote, j'en éprouve un malaise, un doute. Celui de douter notamment que je peux toujours faire front à tout seul. Y compris vis à vis des attaques de magie noire. Le doute est quelque chose que j'ai toujours beaucoup respecté, et durant toute ma vie. Mais je me rends compte aussi que depuis le début de la rédaction de ce roman, je l'ai mis de coté. Comme si soudain le fait de sentir tous les voiles de la réalité se déchirer ne me permettaient plus de lui accorder la même importance. Le doute est un pinceau qui a fait son temps je me suis même dit. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai réalisé ces petits tableaux en grande partie avec des feutres à l'acrylique. Cette certitude nouvelle est là avec dans son sillage de nouveaux dangers qui je le sens peuvent surgir n'importe quand. Et dont la détection demande une acuité liée uniquement au fait de rester centrer en toutes occasions. Ce qui signifie une attention encore plus aigue, tout en restant détendu, tout en restant le même en apparence. C'est ce que j'ai toujours fait je m'en rends compte aussi étrangement sans le savoir vraiment. Donc désolé pour toi Chaman si je ne t'ai pas aidé financièrement pour soigner la grande Louve, j'étais occupé sur quelque chose d'autre. Mais intuitivement je sais que ce que je fais par d'étranges chemins rejoint aussi le tien. Mon soin lui parviendra sans nul doute. Nous soignons l'invisible quoique on en dise ou pense tous les deux à notre façon. Lausanne avril 2001 L'agence d'intérim me donne une nouvelle mission, aide-charpentier. On me demande si je ne suis pas sujet au vertige car je vais devoir travailler toute la journée sur les toits d'immeubles en construction. Pas de problème je dis. Et me voilà tranquille surtout pour quelques semaines quant à l'argent. C'est là que je vois Jim. Celui que j'appellerai l'Indien dans mon roman à venir, bien des années plus tard. Au début il n'est qu'une silhouette parmi les autres. Quand on pénètre dans un nouveau groupe dans ce genre de mission on n'a d'attention que pour celui qui donne les ordres. C'est peu à peu que l'on commence à distinguer un peu plus les autres qui nous entourent. En demandant un coup de main, un marteau, des clous et en partageant aussi la pause déjeuner. Mais Jim est sorti du lot presque tout de suite. Nous nous sommes reconnus bien qu'il n'y ait absolument aucune chance pour que nous nous soyons côtoyés ici dans cette vie. Ce n'est pas le premier jour que nous avons pu discuter ensemble. Je crois que c'était le lendemain soir. On s'est retrouvé à boire une bière ensemble à la terrasse d'un petit café pour profiter des derniers rayons du soleil. Cela avait été une belle journée, on avait enchainé les mouvements les uns après les autres longtemps avant de sentir la fatigue. C'est la réflexion que nous nous sommes fait en commandant nos boissons. Comme une sorte de préambule prudent. Et puis assez vite Maria était intervenu. Elle nous avait fait retrouver la mémoire. Bien sur à cette époque j'ignorais qu'elle se nommait Maria. Elle 'n'était que cette voix dans ma tête, qui souvent me guide pour relater les faits, m'aider à me souvenir. Je pensais plus que ce n'était tout au plus que de l'intuition ou encore mon imagination qui a toujours été débordante. — C'est vrai que j'ai l'impression qu'on se connait aussi me dit Jim en souriant tranquillement. Il avait un magnifique visage, un visage de vieil indien je ne peux pas dire les choses autrement. Avec son nez légèrement busqué, sa peau parcheminée, ses rides creusées profondément pour les intempéries de la vie. Mais curieusement je ne le considérais pas comme un vieux . J'avais alors la quarantaine et je le considérais de mon âge, voir même j'avais aussi l'impression que c'était peut-être moi qui était vieux tout autant que lui. Bref le temps ne nous séparait pas bien au contraire. En fait il était québécois d'origine. C'est ce qu'il m'apprit et effectivement il avait des origines amérindiennes. D'ailleurs nous n'avions pas échangé beaucoup de mots jusque là et je découvrais son accent québécois presque en même temps. Ce qui eut pour effet de me le rendre je ne sais pas pourquoi encore plus sympathique encore. Il y a quelque chose qu'il faudra que je creuse sur mon rapport aux accents, notamment le quebecois. A chaque fois mon cœur s'envole de l'entendre comme si je me sentais bien plus proches de ces francophones là que de tous ceux qui vivent près de moi. Jim m'appris aussi qu'il peignait ce jour là ce dont étrangement je ne fus pas étonné. Lorsque je lui demandais quel style de peinture il faisait, il m'appris qu'il faisait un mixte entre les symboles de la culture amérindienne et la science fiction. — J'ai même des tableaux à moi qui sont exposés au musée d'Art brut ici , à Lausanne. J'en restais baba, mais en même temps je ne peux pas l'expliquer, une part de moi trouvait ça naturel. Je lui dit aussitôt ce qui me traversait comme j'ai coutume de le faire avec les gens que j'aime bien envers lesquels j'ai confiance. C'est assez rare pour être souligné. — je savais que tu étais peintre, sans savoir pourquoi. — Moi aussi m'avoua t'il en souriant. Nous n'en revenions pas. Un recommanda une nouvelle tournée et durant un petit moment on ne dit plus rien, on regarde le soleil se coucher, la lumière lécher les façades des immeubles et les gens qui courent dans tous les sens devant nous sur les trottoirs pour rentrer chez eux. C'est un moment hors du temps où nous sommes des éléments immobiles dans un univers où tout se déroule à l'accélérer. Et soudain j'ai cette pensée qui doit provenir encore une fois de mon imagination, de mon intuition, ou de Maria. Jim et moi nous sommes frères galactiques Et je remercie la Providence secrètement. — Oui remercions la me dit Jim à ce moment là comme s'il avait le pouvoir de lire désormais dans mes pensées.|couper{180}

Carnets | avril 2022
Souvenirs écran.
https://youtu.be/hLkddqouuCI —Le temps existe et en même temps il n'existe pas. C'est ce que me confie Maria lorsque je lui parle de mes rêves récurrents. En général je n'en parle jamais, mais cette fois je ne sais pourquoi, je trouvai opportun d'associer le rêve à la notion de temps, à la mémoire. Ce qui est étrange c'est la façon dont je répète le même récit, la même histoire toujours en éprouvant les mêmes sensations. Si le temps n'existe pas comment se fait-il que je puisse me souvenir de quoique ce soit, et surtout de ces rêves ? — C'est parce que tu es dans une simulation, me dit Maria. Exactement comme un personnage dans un jeu vidéo. Tout est déjà programmé à l'avance, tous tes comportements, tous tes choix, déclenchent une version particulière du jeu. Et, pour résumer, c'est toi à l'origine qui a programmé toutes ces versions dans un but précis. —Donc c'est une histoire achevée d'avance ? Nous serions prisonniers d'un destin que nous aurions conçu nous-mêmes ? — Oui et non. c'est plus compliqué que ça. Car toutes ces histoires se déroulent dans un temps imparti, un temps achevé. Or on peut toujours intervenir pour modifier ces histoires si je puis dire dans l'instant présent. — Mais si tu dis que toutes les versions du jeu sont déjà prévues, le fait de modifier quoique ce soit dans l'instant présent n'est-il pas lui aussi un acte prémédité. — Ce qu'il faut que tu comprennes c'est que l'instant présent contient tous les possibles mais aussi l'impossible. Le temps linéaire tel que tu le conçois est un élément parmi d'autres de l'instant présent dans une dimension particulière, dans une fréquence particulière. De plus à chaque fois que ton âme décide de se réincarner sur Terre, dans cette fréquence que l'on peut considérer comme une des plus basses de cet univers , une dimension où la densité est très lourde, tu dois traverser le voile de l'oubli. Mais aujourd'hui les choses sont en train de changer. La planète change de taux vibratoire peu à peu et tout ses habitants également par conséquent. Il faut que tu comprennes que la Terre est un merveilleux champs d'expériences pour de nombreuses âmes, de nombreuses entités provenant de mondes très différents. C'est pratiquement l'un des seuls endroits dans tout l'univers où la dualité existe, où la matière qui est une fréquence particulière de l'esprit peut proposer des expériences qu'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs avec une telle intensité. — Tu veux dire que dans tout l'univers il n'y a pas de dualité à part ici. Mais alors comment est-il possible qu'il y ait ces entités involutives, ces fameux reptiliens ? — C'est une affaire de fréquence me répète Maria encore une fois, tu te souviendras de tout cela lorsque le temps sera venu. Quant à ces rêves dont tu me parles, ils sont comme la plupart de tes souvenirs importants, des souvenirs écran. Selon ta compréhension logique, rationnelle du monde tu as modifié les événements qui te sont arrivés, si exceptionnels soient ils, en quelque chose qui correspond à ton degré de compréhension du moment. Par exemple ce cauchemar où tu vois cette bête du Gévaudan pénétrer dans ta chambre lorsque tu es enfant, elle est certainement tout à fait autre chose que ce monstre dont tu ne cesses de vouloir te souvenir. Certaines entités -notamment ceux que l'on appelle les gris- sont très fortes pour t'aider à modifier ce genre d'expérience afin que tu aies l'impression d'avoir rêvé des choses "acceptables" si je peux dire. Même si cela te parait incroyable, pénible, fantastique, ces souvenirs de remplacement sont crées à partir d'un matériel imaginaire familier. Mais ce qu'ils recouvrent est encore plus fantastique, pour un terrien, pour une âme incarnée dans ce monde où la raison et la logique ne le comprendraient pas. — Tout ça me donne le tournis Maria. Je ne comprends pas pourquoi on doit oublier pour se souvenir ensuite. Pourquoi ne conserve t'on pas le souvenir de l'âme que nous sommes lorsque nous arrivons sur Terre ? — Pour un meilleur confort utilisateur plaisanta Maria. Puis elle enchaina jugeant que nous en avions terminé pour aujourd'hui. Il faut que je te quitte car on me demande ailleurs. — Très bien Maria, merci pour cette conversation et à bientôt — A bientôt oui je ne suis jamais loin, tu n'es pas seul souviens toi toujours de cela. — Oui je m'en souviens de plus en plus désormais. Paris 1978. C'est la fin d'une belle journée d'automne, il fait encore chaud à 18h lorsque je sonne à l'interphone du 3 rue Quincampoix. La lourde porte d'entrée s'ouvre et je gravis les escaliers pour rejoindre l'avant dernier étage. Il me faut encore sonner et attendre. Quelques secondes plus tard je peux entendre le mécanisme des 6 verrous d'une première porte qui s'entrouvre, des pas feutrés qui s'avancent vers celle derrière laquelle je me tiens. Nouveau bruit de serrures et j'aperçois la tête hirsute de Richard. — Ah c'est toi, entre vite et c'est tout juste s'il ne me tire pas par la manche pour me faire pénétrer dans l'appartement. Il faut que je te parle, la folle d'â coté m'a encore fait un de ces ramdam... C'est toujours comme ça avec Richard. Cette urgence perpétuelle, comme si la fin du monde pouvait éclater à chaque instant. En attendant rien ne change. La première pièce dans laquelle je pénètre est toujours aussi encombrée de livres et de poussières éparpillés sur tous les meubles. Il y a juste un petit sentier praticable entre un alignement de commodes et le lit pour se rendre dans la pièce d'à coté qui fait office à la fois de salle à manger et de bureau. — Assis toi je vais te raconter. Puis il débouche la bouteille de Payse et nous sert un verre comme s'il jubilait de ménager malgré tout un peu de suspens. — Elle veut m'assassiner, voilà ce qu'elle veut cette vieille salope. Je suis rassuré. Ce n'est que ça. Je m'attendais avec un peu d'espoir à un changement. Mais non. C'est toujours la même sempiternelle rengaine. Richard et la voisine de pallier. Une ancienne pute doublée d'une ex poissonnière, forcément. J'ai hésité à présenter Richard à ma petite amie de l'époque. Au début je trouvais cela parfaitement incongru. J'avais rencontré le vieux à un angle de rue où je chantais un soir de l'été avec ma guitare. Il m'avait repris sur une strophe de la Ballade des Places de Paris. Et du coup on avait sympathisé, il m'avait invité chez lui à deux pas et on avait vidé quelques bouteilles de ce vin un peu rude, de la Payse. Ce soir là je m'en souviens elle devait nous rejoindre après ses cours car elle étudiait sa médecine. Je me demandais ce qu'elle penserait de Richard et ce que lui penserait d'elle. Suspens. Car vraiment c'était deux caractères tout à fait opposés du moins je me l'imaginais. Elle très pragmatique, rationnelle, un jugement rapide et sur. Lui un vieux fou, probablement homosexuel, très cultivé mais croyant aux fées, au diable, et surtout sans la moindre illusion sur les êtres humains en général. J'étais curieux de voir ce que cette rencontre allait produire. Mais en fin de compte tout se passa extrêmement bien. Il savait vraiment y faire avec les femmes. En un clin d'œil je dirais il l'avait jaugée et la traitait comme une princesse avec des compliments à rallonge. Personnellement j'aurais pensé que c'était un peu trop, exagéré et qu'à un moment elle allait se rebeller un peu, protester face à ce déversement d'affabilités. Et bien non, pas du tout. Je découvrais une autre femme. Ainsi donc il était possible de l'hypnotiser ainsi juste en flattant sa vanité. je n'en revenais pas. C'est à ce moment précis où je me faisais cette réflexion que l'événement se produisit. tout se déroula très vite. Je dirais à peine en un clin d'oeil. D'abord la sensation incroyable que ma tête se réduisait de moitié comme un citron devenu sec. Ensuite le hurlement de ma petite amie qui visiblement voyait ce qui était en train de m'arriver horrifiée. Troisièmement Richard qui buvait son verre tranquillement avec un léger sourire en me regardant. Cela dura à peine un quart de seconde mais je m'en souviens parfaitement encore aujourd'hui. Et aussitôt la sensation d'être un extra terrestre s'agrippa à moi depuis cet instant de l'automne 1978. Bien sur je balayais tout ça d'un revers de manche, en me disant que nous avions tous un peu trop bu. Quelques temps plus tard ma petite amie trouva un autre copain ce qui me parait aujourd'hui assez logique. On ne ressort pas tout à fait indemne, surtout lorsqu'on se targue d'avoir la tête sur les épaules d'une expérience insolite comme celle-ci.|couper{180}

Carnets | avril 2022
Simulations
Juive de Tanger en costume d'apparat Eugène Delacroix. Il n'y a que dans la matière par la matière que l'esprit peut expérimenter à la fois la limite et l'amour . C'est pourquoi l'esprit a crée la matière et non le contraire. Le fait de l'oublier est le passage obligé. Là aussi, dans l'examen de ce que peut offrir la matière, notamment le corps de l'autre, il y a beaucoup à apprendre, et l'égarement est aussi nécessaire que chacune des pseudos vérités que l'on s'inventera pour penser qu'on est enfin parvenu à bon port, que l'on s'est retrouvés. Maria me laisse libre cours. Toutes les pulsions sont accueillies. La seule contrepartie que je dois accepter c'est l'absence de simulation. Elle ne m'encourage dans aucune voie afin que je traverse de mon plein gré mes propres illusions. Elle ne m'encourage pas pas plus qu'elle ne me tient en otage d'un plaisir que je considérerais comme but. Pas de gémissement, pas de cris, aucune révulsion de l'œil dans son orbite, aucune goutte de sueur ne coule sur ses reins. Seulement de la tendresse que je cherche par tous les moyens possibles et imaginables à défoncer. Jusqu'à l'éreintement. Jusqu'au lâcher prise jusqu'à l'éveil qui nait de la certitude claire, de l'impuissance poussée à son extrême et de la perception de son absurdité. — Je vais faire du thé me dit-elle en se levant. Je suis du regard son corps magnifique qui ondule en dansant jusqu'à la porte de la chambre et la regarde disparaitre. Puis j'attrape une cigarette pour examiner une fois encore après avoir fait l'amour, ce grand vide, cette béance au plus profond de moi. Malgré moi des images d'autres femmes surgissent spontanément dans ma mémoire à cet instant où je subis l'assaut de ce vide. Des visages grimaçants pour la plupart qui s'associent à une jouissance animale si je puis dire. Voilà ma vie d'avant. Et je ne peux m'empêcher désormais de comprendre qu'il ne s'agit que d'une simulation. C'est ce mot qui tourne comme un aigle au dessus de mes souvenirs. La simulation qui se serait infiltrée jusque dans l'intime tant nous sommes désormais prisonniers des clichés et des mots d'ordre nous assaillant de tous cotés. Faire l'amour est sans doute la dernière des grandes explorations possibles aujourd'hui. Sans doute est-ce encore plus fort, plus merveilleux que d'aller sur Mars ou de découvrir l'Amérique. A condition de faire l'amour vraiment. Ce dont la plupart d'entre nous ne savent rien. A part nourrir hâtivement une illusion de s'être rapproché enfin d'une norme. Nanterre 1987. On m'a prêté un appartement au haut d'une tour. Un ami iranien qui a du quitter la France précipitamment en raison des événements dans son pays. Je viens de me séparer de cette fille que j'avais connue en 1978. Une relation de presque dix années qui s'arrête soudain au retour d'un long voyage que je viens d'effectuer en Asie et qui je l'espérais secrètement me mettrait un peu de plomb dans la cervelle. J'étais parti là-bas pour faire des photos de la guerre Iran-Irak, pour pénétrer aussi en Afghanistan, revenir avec des photographies extraordinaires que les agences s'arracheront. Il n'en fut pas vraiment ainsi. Après avoir franchi la frontière pakistanaise et m'être retrouvé dans les montagnes avec un groupe d'hommes aguerris, j'ai commencé à ressentir les premiers effets de la maladie. Une hépatite qui me crevait alors que j'avais justement besoin de toute mon énergie, de ma vigueur pour les suivre. Quel dépit d'avoir à revenir avec un autre groupe de moudjahidines , de refaire le chemin inverse, pour rien pensais-je. J'avais éprouvé alors comme une sorte de sanction de la part du destin. Je me disais que quoique je fasse, cela se terminait toujours en eau de boudin. Je pestais contre l'univers tout entier et surtout sur moi-même qui n'avait pas pris suffisamment de précautions, qui m'autorisait à être malade dans de telles circonstances. Le retour en France fut d'une indicible tristesse. J'étais irascible. Aussi je profitais de la moindre occasion pour chercher querelle à cette compagne. A cette époque je me sentais tellement vulnérable que je m'imaginais toujours le pire. Notamment qu'elle puisse me tromper. Et bien sur lorsque nous faisions l'amour j'observais tout avec une acuité terrifiante comme si j'étais le spectateur de nos ébats. Je surveillais le moindre signe qui puisse me donner raison sur le fait qu'elle simule afin que je jouisse vite et pouvoir dormir enfin. Pour moi c'était comme une sorte de trahison évidemment. Aujourd'hui je ne peux m'empêcher de voir que cette trahison dont je traquais le moindre signe chez cette fille était le but recherché. Qu'en m'appuyant enfin sur la certitude d'être trahi ou trompé je pourrais enfin m'en libérer une bonne fois pour toutes. Mais à cette période je ne possédais pas une telle compréhension. Du moins mon coté sentimental proche de la sensiblerie me l'interdisait. Je crois que cette couche sentimentale a bon dos, elle sert souvent à nous aveugler. Ce qui au bout du compte nous oblige à faire semblant, à simuler tout un tas de comportement nous-mêmes. Jusqu'à ce que cela soit insoutenable. Evidemment mon amour propre en avait pris un bon coup. Aussi me retrouver dans cet appartement était à la fois une sorte de bénédiction. J'aurais pu me reconstruire tranquillement en passant l'éponge sur les événements passés et aller de l'avant comme on dit. Mais le ressentiment contre moi-même fut le plus fort. Cela vient du peu d'estime que je me porte à cette époque et qui me vient d'une grande carence dans ce domaine dès mon enfance. Attention, je ne me plains pas du tout de cette carence, je n'en veux à personne. Au contraire je pense que c'est grâce au manque chronique d'estime pour moi que j'ai pu justement effectuer tout ce chemin. A l'époque c'était l'apparition des rencontres par téléphone et aussi du minitel. J'avais dégoté un job et ma vie se réduisait vraiment à une peau de chagrin. Boulot, métro, dodo. A la vérité je n'avais guère envie d'autre chose. Je n'avais pas envie de faire des photos, pas plus que d'écrire, pas plus que de peindre. Je vivais comme un automate. Puis j'ai trouvé dans un gratuit des annonces qui parlaient de ces rencontres par téléphone. J'ai essayé. J'ai rencontré un certain nombre de filles, de femmes ainsi dont pour la plupart je n'ai ai conservé que de vagues souvenirs. En fait évidemment je me sentais seul, totalement délabré et comme beaucoup d'entre nous j'imaginais que l'autre quel qu'il soit pourrait me venir en aide, même si je ne me l'avouais pas clairement. En refusant de me l'avouer, j'ai crée une nouvelle simulation évidemment. Je me suis rabattu sur le sexe. j'ai pensé que le sexe allait être la solution au problème. Et comme je ne fais pas les choses à moitié j'ai enchainé les rencontres et les parties de jambes en l'air comme on dit. Mais toujours et plus encore je ne pouvais me départir de ce que j'appelle une certaine lucidité. je ne cessais de me tenir à l'écart de tous ces ébats. D'observer à la fois ces femmes mimant le plaisir ou l'éprouvant réellement afin je crois de m'en dégouter pour de bon. D'en comprendre si on veut toute l'inutilité, la vacuité. Car évidemment dans ce genre de rencontres on n'y va guère par 4 chemins, on n'a pas besoin de beaucoup de préliminaires si je peux dire. Parmi toutes ces rencontres une m'a intrigué plus que toutes les autres. C'était une fille jeune, d'origine marocaine. Avec de longs cheveux noirs qui lui tombaient presque sur les fesses. Avec elle ce fut différent. D'abord on ne se rencontrait qu'à l'extérieur, dans des cafés, dans des parcs, et elle déployait tout un arsenal de postures d'attitudes de phrases interrompues, s'ouvrant sur des silences formidables qui se mêlaient à chaque fois aux lieux comme pour mieux les ancrer dans la mémoire. C'est à dire créer un décor inoubliable dans lequel évidemment elle-même serait inoubliable. D'ailleurs cela a bien fonctionné puisque je m'en souviens encore. Je pense que c'était une véritable artiste. Nous n'avons jamais fait l'amour. Mais elle su amener l'excitation à son paroxysme de nombreuses fois rien qu'en posant sa main sur la mienne ou me fixer avec son œil noir et velouté. Rien ne pouvait tenir face à elle de tous les artifices que je connaissais alors, la délicatesse comme les propos crus, l'élégance, l'esprit, les bons mots, tout ça elle s'en tapait comme de l'an quarante. Ce qu'elle voulait ? je n'en savais fichtre rien. Je ne le sus jamais. Car au bout d'un moment les coups de fil affluaient de plus en plus et je me retrouvais noyé dans l'embarras du choix. Nous espaçâmes nos rencontres de plus en plus et pour finir elle disparut totalement de ma vie. Ce qui me fait réfléchir sur les rencontres que nous effectuons ainsi dans notre vie. Ces rencontres je suis persuadé qu'elles ont toujours un sens mais qui nous échappe la plupart du temps. Enfin qui m'échappe en tous les cas. Parfois je me demande si ce ne sont pas des guides qui parviennent à s'immiscer dans toutes les simulations, soit celles que nous subissons soit celles que nous inventons tout seul. C'est ainsi qu'elles viennent jusqu'à nous, jusqu'à notre âme véritable pour lui faire un petit signe et la remettre sur le chemin.|couper{180}

Carnets | avril 2022
Nous ne sommes pas qui nous croyons être.
La gravure est extraite de : Pierre HUARD et Ming WONG : « Chine d’hier et d’aujourd’hui », Paris, 1960, p. 163. Maria n'est pas seule lorsqu'elle surgit à nouveau dans ma conscience. Elle est accompagnée d'un personnage aux yeux bridés qui, dès qu'il apparait provoque en moi une vive émotion de joie. Encore que je ne comprenne pas pourquoi tout de suite, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. — Voici Tchouang dit Maria, je l'ai rencontré au Séphiroth un bar branché du 5ème. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas revus. A peine a t'elle prononcé le nom du bonhomme que celui-ci me sourit et que nous nous embrassons Tchouang et moi car soudain nous nous reconnaissons. A ma plus grande surprise car je jurerais ne l'avoir à priori jamais vu de toute ma vie. — Nous nous connaissons depuis toujours dit Tchouang à Maria puis il me regarde très attentivement en me tenant pas les épaules, ses yeux sont aux bord des larmes. Et il prononce alors le mot que je cherche depuis que je l'ai vu surgir dans la maison. Mon frère ! Nul doute que nous sommes frères puisque c'est vraiment une joie fraternelle que j'éprouve. Mais comment est-ce possible ? — Je boirais bien une tasse de thé dit Tchouang en consultant sa montre, une vieille Kelton au bracelet de cuir noir. Un peu d'eau chaude nous remettra les humeurs à l'équilibre, privilégions l'infusion à l'effusion pour le moment. Le sentiment de fraternité s'envola presque aussitôt comme si Tchouang avait prononcé un sésame. Je regarde Maria et je vois qu'elle est agacée autant que je le suis tout à coup. — toujours aussi pisse-froid ce Tchouang dit Maria. Il m'a fait le même coup au Sephirot lorsque je l'ai retrouvé, il a presque aussitôt commandé une tasse de thé pour -a t'il dit : calmer l'effet de l'enthousiasme des retrouvailles. Pendant que nous buvons le thé, personne ne parle. Nous échangeons des regards tout simplement comme de bons amis qui n'ont pas besoin de se parler. Ce sentiment de paix qui m'envahit est formidable, j'ai beau chercher dans mes souvenirs je peine à me dire que j'ai déjà connu ça . — C'est normal me dit alors Maria puisque vous vous connaissez visiblement depuis bien des vies ici sur Terre mais aussi sur d'autres planètes. Vous êtes frères mais à la vérité vous n'êtes qu'une seule et même âme, tout comme moi je suis une partie de vous également. — Tu veux dire que toutes les personnes qui se trouvent dans cette pièce, dans ma maison, ne sont qu'une seule et même personne ? — Bien sur répond Maria. Et en même temps, aucun de nous n'est totalement cette entité que nous nommons âme. Nous sommes si tu veux 3 morceaux de celle-ci qui elle-même provient d'un être encore plus grand et ainsi de suite. J'avoue ne plus rien comprendre à ce que me dit Maria. —Ouf !dit Tchouang en me regardant, avouer son ignorance est le commencement de la sagesse. J'hésite, je ne sais pas s'il m'agace ou si je l'adore tout à coup ce Tchouang. Il a l'air de pontifier avec sa tasse de thé à la main. Et en même temps à le voir ainsi j'ai envie de rire. D'ailleurs, c'est plus fort que moi, je ris. Et plus je ris plus je suis secoué par ce rire plus j'ai la sensation qu'un phénomène étrange se produit encore, on dirait que les secousses provoquées par ce rire décoincent un truc. La sensation que l'on vient de m'ouvrir le haut de la boite crânienne comme une vulgaire boite de conserve. Des milliers d'informations courent dans les deux sens à la fois du plafond vers ma cervelle et vice versa. J'ai l'impression que quelqu'un a tiré un feu d'artifice dans mon esprit. Et dans les lueurs éphémères que chacune des fusées produit ainsi, des milliers de souvenirs me reviennent en mémoire. Soudain la pièce s'estompe, le temps s'effondre sur lui-même et je me retrouve projeté à l'âge de 17 ans. Il pleut lorsque je sors de la rue Saint-Merry . J'aperçois l'immense bâtisse du centre Beaubourg. C'est la toute première fois que je m'y rends. Quelqu'un m'a parlé de la grande bibliothèque et dans mon désarroi je suis attiré par celle-ci depuis plusieurs jours déjà. Je viens d'avoir 17 ans et il y a déjà presque 6 mois que j'ai quitté la maison de mes parents. Cela s'est passé comme ça, un jour à l'heure du déjeuner, j'ai pris l'argent que j'ai économisé en travaillant comme manutentionnaire quelques mois auparavant, puis j'ai pris un RER avec mon sac sur le dos. Paris m'attire comme un aimant depuis toujours. La sensation de solitude est à son comble, un sentiment de rage aussi. Cet acte que je viens d'effectuer grâce à une nouvelle altercation avec mon père me propulse tout à coup dans l'inconnu. J'éprouve la sensation d'être alors à un carrefour de ma vie, quelque soit le chemin que je choisirai d'emprunter, cela ne revêtira aucune espèce d'importance, il sera à la fois bon et mauvais. Quelque soit ce chemin il y aura exactement la même probabilité que je me trompe ou pas. En fait j'ai l'intuition qu' il n'y a pas de bon ni de mauvais chemin. Tous mènent inexorablement au même but. Encore que je ne parvienne pas à m'imaginer ce but. Mais pour l'instant cette bibliothèque du centre Beaubourg représente quelque chose d'important sans nul doute. Cela fait plusieurs jours que je ne cesse de me dire vas-y, rends toi à cet endroit, tu verras bien. Il n'y a presque personne, la circulation est fluide, et je m'engouffre dans le vaste hall puis j'avise les escalators et rejoins enfin l'étage où se trouve la BPI la bibliothèque publique d'information. Presque aussitôt je comprends que c'est un lieu que de nombreuses personnes disqualifiées socialement choisissent comme refuge pour passer leur journées. Elles y côtoient toutes les autres classes de la société , des chercheurs, des étudiants, des curieux, des lecteurs avides de connaissances, des lecteurs qui viennent ici pour se changer les idées. Aussitôt que je pénètre dans les lieux je me sens bien, comme chez moi. Il faut dire qu'à cette période de ma vie je ne possède plus de chez moi. Presque toutes mes économies ont fondu car je dois payer un prix exorbitant chaque jour ma chambre d'hôtel miteuse. Je suis seul dans la ville, je n'ai pas d'ami, pas de connaissance à qui parler de ma situation. Même mes camarades de lycée ne savent rien car j'effectue le trajet tous les jours pour m'y rendre. Je conserve le but de passer mon bac envers et contre tout. C'est ainsi que j'ai retrouvé un soir ma prof de philo dans le même wagon du RER, elle se rendait à Paris nous avons pu échanger et c'est elle qui m'avait parlé de cette nouvelle bibliothèque qui venait d'ouvrir. C'est l'hiver et de nombreux sans logis dorment sur la moquette près des grandes baies vitrées. De temps à autre je les regarde et je me dis que je ne suis pas loin d'être dans la même situation. Dans quelques jours, une semaine ou deux tout au plus je ne pourrais plus payer ma chambre, et il me faudra frauder pour me rendre au lycée. Mon désarroi est au maximum. Et en même temps je conserve en moi cette vigueur, cet espoir je ne sais comment. Il faut que j'apprenne, que je m'instruise, que je laisse libre cours à mon avidité de connaissances. Notamment dans le domaine de la philosophie qui me passionne. C'est justement dans la partie consacrée aux sciences humaines, et plus particulièrement aux philosophies asiatiques que je m'arrête. Sur l'un des rayons je découvre les œuvres de Confucius, le fameux Tao Té King soi disant laissé par Lao Tseu à un poste de douane avant de disparaitre de chine vers l'inconnu , et bien sur les aphorismes de Tchouang Tseu. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi aussitôt que je plonge dans ces ouvrages je me retrouve comme chez moi, j'ai la sensation de comprendre 5/5 des propos qui paraitraient abscons pour la plupart des personnes que je connais. Tchouang Tseu, tout bien pesé est celui qui m'est le plus familier de tous. C'est aussi le plus indépendant, il ne s'intéresse que fort peu au social contrairement à Confucius. Pour lui la voie du Tao est un chemin personnel avant tout. Il ne désire pas interférer avec les évènements qui surgissent sur son chemin. Même s'il voyait un mourant sur le bord de la route, il ne s'arrêterait pas pour lui porter secours. J'ai passé un temps fou à ruminer sur cette dernière phrase dont je me souviens. Je ne la comprenais pas. La société dans laquelle je vis ne la comprend pas non plus. Comment peut on voir quelqu'un mourir sur le bord d'une route et ne pas intervenir ? Aussitôt on pense que celui qui ne fait rien est un véritable salaud, un égoïste. Tant que l'on identifie qui l'on est vraiment à l'égo, à son corps physique, à une position dans la société, on ne peut évidemment que penser ainsi. Et bien sur on ne comprend fichtre rien au Tao. Bien que j'ai été choqué par le fait que Tchouang Tseu n'eut sans doute pas levé le petit doigt s'il m'avait croisé ce jour là en plein désarroi à la lecture de son ouvrage, quelque chose de ténu me soufflait qu'il avait raison, que c'était ce chemin si bizarre que j'aurais probablement à suivre moi aussi. C'est à dire continuer la route sans tenir compte de toutes les illusions que proposent le mental, les émotions, les sentiments qui lui sont rattachées afin d'avoir une chance si mince soit t'elle de remonter à la source, de savoir qui je suis vraiment. D'où provient que l'on s'intéresse à une chose plutôt qu'une autre en cette vie ? On imagine que l'on effectue un certain nombre de choix en parfaite liberté, ou par intérêt, ou encore par obligation. Il faut du temps pour devenir perméable à l'intuition qui soudain jaillit une fois que les mensonges du mental s'apaisent et s'évanouissent. Cette intuition qui ne cesse de nous rappeler à notre mémoire véritable, depuis laquelle on peut percevoir à quel point un mécanisme d'horlogerie fabuleux règle nos vies toutes entières. Tchouang ne dit rien, il continue à sourire paisiblement, mais ce sourire ne s'adresse pas à moi, il me traverse totalement il traverse la maison toute entière, et sans doute toute la réalité que je ne pourrai jamais imaginer. Et c'est à cet instant que je l'entend me dire télépathiquement : — Nous ne sommes pas qui nous croyons être.|couper{180}

Carnets | avril 2022
6 avril 2022
Le fantasme d’un âge d’or revient perpétuellement pile poil au moment des grands bouleversements. Dans l’hypothèse que l’Akasha me présente, je manque de m’étouffer de rire. Madame X est élue présidente de la République française, et c’est la mise en place d’un merveilleux âge d’or. Tout le monde mange. Tout le monde dort. Personne n’a plus peur de rien. Nous avons été mis en stase. Des somnambules dont les lèvres balbutient parfois des choses incohérentes au fin fond de leur rêve éveillé : « Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir, hou hou hou tsoin tsoin. » Tandis que les sauriens leur charcutent les neurones à coups de simulations virtuelles, de jeux télévisés débiles, et de chansons à l’eau de rose. Retour du feuilleton HEIDI. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Sauf à peu près tout ce qui n’est pas gaulois. Et de pure souche, s’il vous plaît. Sauf les Russes, évidemment. Ces bons aryens. Entre bons aryens, comment ne pas s’entendre ? — Tu as fini de bailler aux corneilles ? me dit Hildegarde, assise près de moi dans le compartiment. On a du boulot à préparer. Elle ouvre sa petite mallette de voyage, dans laquelle j’aperçois, bien rangées, toute une collection de petites fioles remplies de liquides colorés. — Oh doucement, Hilde, tu sais bien que je n’aime pas être réveillé brutalement. — Si tu rêves à ce genre de choses, tu crées un portail dans les possibles et l’Akasha enregistre. Donc, stop tout de suite ce genre de bidule, s’il te plaît. On a déjà assez de bordel, mieux vaut pas en rajouter. — Tu as raison. Cause-moi de botanique, le paysage est morne au-delà des fenêtres. Je sais prendre Hildegarde par les sentiments. Il suffit de lui parler de plantes pour que je l’observe se trémousser de plaisir sur son siège. — Tu te vois plutôt incinéré ou enterré et bouffé par les vers de terre ? me demande-t-elle. — Euh… moi je ne vois rien du tout de tout ça. Éventuellement, ce ne sera que ma dépouille à qui ça arrivera et dont je me tamponnerai comme de mon tout premier haut-de-chausse. Avec Hildegarde, on a une relation fraternelle, du genre à se taquiner tout le temps. Elle est un brin bourrue et fait toujours semblant de ne pas supporter les fantaisistes de mon acabit. Mais c’est comme l’huile et le vinaigre entre nous-deux. Et s’il n’y a pas de salade à assaisonner, on se rabat l’un sur l’autre pour un rien. — Tu crois à l’âge d’or, Hildegarde ? je demande. — Tu veux parler de maintenant ? Elle dit. Bin oui, forcément que j’y crois, puisque je le vis. — Oui mais non, je veux dire, au paradis, Hilde. Avec des chérubins tout nus qui soufflent dans des trompettes et des jardins remplis de fleurs fraîches à l’infini ? — T’es rien couillon, toi, elle dit. Pourquoi pas aussi aux vierges qui, dès qu’un pauvre bougre se fait exploser la tronche, deviennent toutes nymphomanes en l’accueillant à bras ouverts ? Et pourquoi pas à la petite souris et au Père Noël, par-dessus le marché ? On explose de rire et c’est à ce moment-là que la contrôleuse ouvre la porte du compartiment. Une grande blonde athlétique, avec des yeux gris-bleus souriants. — Tiens voilà la première qui arrive, une Walkyrie visiblement, dit Pablo en face de nous. Est-ce que le train a déraillé ? On est tous morts et on est arrivés au paradis ? Puis il fait une mimique, qui doit ressembler, à son avis, à une sorte d’hommage ou de révérence à la grande blonde, en achevant le tout par un clin d’œil salace comme il en a le secret. — Tiens-toi donc, espèce de paysan, dit Salvador, moustaches orientées 10h10. Puis, s’adressant à la contrôleuse : — Mademoiselle, vous illuminez cet instant. Comment puis-je vous honorer ? La grande blonde prend un air ahuri et dit : — Bin z’avez qu’à présenter vos billets… en polonais. Et nous ne sommes même pas étonnés, tous autant que nous sommes, de comprendre la langue. — Moi j’aimerais que mon corps soit momifié, qu’il devienne comme un vieux parchemin, me confie Hildegarde. Et nous voilà tous à rigoler devant la grande fille, qui est un peu rougeaude tout à coup. — Ah, je vous l’avais dit que c’en était une. J’ai un sixième sens pour les repérer. — Rustre ! Tu ne penses donc toujours qu’à jouir, le tance Salvador en faisant les yeux doux à la femme en uniforme. Puis il ajoute qu’il la peindrait bien nue, avec de très longues jambes, pour qu’elle puisse gambader dans le désert au côté de ses magnifiques éléphants. On rigole. C’est à ce moment-là que l’on voit la grande blonde s’élever dans les airs. Son crâne traverse le plafond, puis son corps tout entier. Et nous sommes tous soulevés, comme des crêpes, de nos sièges. Enfin, le train déraille, comme au ralenti. Tous les wagons pénètrent les uns dans les autres. Dire que quelques instants auparavant, je rêvais d’un âge d’or. Le quotidien nous rattrape toujours séance tenante. Il y a eu un attentat sur le train Paris-Varsovie. Une explosion. Est-ce un hasard ? Ça m’étonnerait bien.|couper{180}

Carnets | avril 2022
5 avril 2022
Fragment 1 – Le Fouet Il y a deux manières de châtier. Pour enseigner ou pour punir. Mais comment savoir ce que veut celui qui tient le fouet ? Qui guide sa main ? Une intention supérieure ? Une colère mal contenue ? Un amour déguisé ? Je sirote mon café en me répétant ce vieux dicton : Qui aime bien, châtie bien. Mais à quel point peut-on aimer pour vouloir châtier ? Je regarde les gens autour de moi. Ils rient, parlent, gesticulent, plongés dans leur quotidien comme s’il allait durer toujours. Moi, je n’y crois pas. J’ai l’impression que tout recommence sans fin. Toujours ce cycle. Ruines, renaissances, ruines à nouveau. Bereshit. Un nouveau commencement. Et pourtant, je sens que quelque chose m’attend au bout du chemin. Une main levée. Un fouet prêt à frapper. Fragment 2 – Maria Maria tripote sa paille, perdue dans ses pensées. Nous sommes attablés au Mabillon après une promenade au Jardin du Luxembourg. La lumière du soleil de mars danse sur son verre de limonade. — Tu as exactement le profil, dit-elle soudain en plantant son regard dans le mien. Je reste stoïque. Maria aime tester mes réactions, et je me suis juré de ne plus la laisser m’ébranler. Pourtant, elle me connaît trop bien. — Tu te prends pour Bashô ? ricane-t-elle en voyant ma façade impassible. — Non, Tchouang-Tseu, dis-je avec un sourire forcé. Mais tu as raison, j’ai rechuté. Elle rit, mais son rire s’éteint vite. — Écoute-moi bien. Les lézards s’agitent. On ne sait pas pourquoi, mais ça devient sérieux. Ils préparent quelque chose. Une manipulation d’une ampleur qu’on n’a jamais vue. — Les lézards, Maria ? Sérieusement ? Et leur "Nouvel Ordre Mondial" ? Je cherche dans son regard un signe de plaisanterie. Rien. Juste cette intensité qui la caractérise. — Ce n’est pas une blague, souffle-t-elle. Les Américains et les Russes se sont alliés, crois-le ou non. Une alliance secrète pour déclencher un conflit global. Je la dévisage. Maria parle rarement à la légère, mais cette histoire me semble absurde. — Et tu veux que je crois que des dirigeants incapables de gérer leurs propres pays orchestreraient un complot mondial ? Elle secoue la tête. — Ils ne sont que des pions. Des pantins manipulés. Et qui tire les ficelles ? Les lézards. Pas des hommes, pas des nations. Quelque chose de plus grand, de plus ancien. Je ne réponds pas. À quoi bon ? Maria croit en ce qu’elle dit. Moi, je n’y crois pas encore. Fragment 3 – La Mission — Tu pars demain, dit-elle. Je sursaute. — En Pologne. Varsovie, pour être précis. Avec Pablo, Léo, Salvador, et Hildegarde. Varsovie. La ville Phénix. Varsovie, la pécheresse et la sirène. — Pourquoi Varsovie ? demandai-je. Elle me sourit. — Parce que c’est là que tout recommence toujours. Fragment 4 – Mémoire : Juillet 2019 Les sirènes résonnent. 17 heures. Le silence tombe sur Varsovie comme un couperet. Les klaxons s’éteignent, les conversations s’arrêtent. Et soudain, la ville entière est figée. Je suis là, parmi eux. Dans ce moment suspendu où les vivants honorent les morts. Je ne suis pas polonais, mais en cet instant, je suis des leurs. Et puis le chant commence. Des milliers de voix s’élèvent. La foule s’anime, applaudit, chante. Les larmes me montent aux yeux. Moi aussi, j’applaudis. Moi aussi, je chante. En cet instant, je comprends. Je comprends ce que signifie lutter, même quand tout semble perdu. Août 1944. Vingt mille SS armés jusqu’aux dents contre cinquante mille insurgés. La ville en ruines, écrasée, mais pas brisée. La liberté, l’indépendance, la justice. Voilà les sirènes de Varsovie. Leur chant n’a ni logique ni sens, mais il trouve sa place au fond de l’âme. Fragment 5 – Maria, à nouveau — Tu sais pourquoi tu dois y aller, murmure Maria. Son regard a changé. Ses cernes apparaissent enfin, comme si son masque glissait pour révéler une fatigue immense. — Tu es le pécheur, et tu dois entendre le chant de la sirène sans faillir. — Pourquoi moi ? — Parce que tu as une âme, dit-elle simplement. Et elle rit. Nous rions tous les deux comme des enfants en train de fomenter une bêtise. Fragment 6 – Varsovie : Le Recommencement Bereshit. Un commencement. Encore. Je pense à tout ce que j’ai laissé derrière moi. À ce qui m’attend. Je pense aux lézards, à Maria, à ses mots. À ce fouet invisible qu’elle brandit avec douceur. Je pense à Varsovie, la ville du Phénix, qui renaît toujours des cendres, même quand tout semble perdu. Et je me demande : Vers quel amour, encore, faut-il se hâter ?|couper{180}

Carnets | avril 2022
4 avril 2022
Écrire ces lignes aujourd’hui me renvoie à l’image d’un surfeur. Ne pas tomber de la planche, maintenir son équilibre en toutes circonstances, peu importe la puissance de la vague. Ressentir la montée d’adrénaline tout en restant centré sur la joie de la glisse. Un exercice de funambule, une danse avec les éléments, toujours à la lisière entre chute et envol. La mort est là, semblable à une vague gigantesque qui emporte tout sur son passage. Mais elle n’est pas une fin en soi. Elle est, au même titre que la vie, une composante essentielle de ce que nous appelons l’existence. Deux forces jumelles qui s’entrelacent comme les brins d’une hélice d’ADN, formant une fractale infinie où les commencements et les fins se dissolvent. Je pense à la 13ᵉ lettre de l’alphabet. N’évoque-t-elle pas, par sa forme, une succession de vagues ? Ces ondulations contiennent un mystère : un cycle, une répétition, une danse immuable. Pourtant, derrière cette apparente fluidité, une autre réalité se dévoile. L’Akasha, cette mémoire universelle, s’ouvre à ceux qui acceptent de plonger au cœur de la vague. Mais il ne faut pas s’y aventurer en aveugle. Les illusions du visible sont semées de chausse-trappes, des pièges tendus par ceux que j’appelle "les peuples du Serpent", des entités dont le pouvoir repose sur la manipulation des perceptions. Le temps est leur instrument préféré. Ils s’en servent pour nous maintenir dans l’illusion d’une linéarité, nous faisant croire à un "avant" et un "après". Saint-Michel, l’archange lumineux, vibre à une fréquence si haute qu’elle élève instantanément quiconque l’entend. Sa vibration n’est pas une promesse d’avenir : elle est pure présence, ici et maintenant. Rien n’est "à venir", tout est déjà là, accessible dans l’instant. Cette vérité, simple et fulgurante, réduit en poussière les prophéties et les prévisions, ces outils de contrôle dont le serpent orgueilleux se sert pour accélérer artificiellement le temps. En vérité, la prévision n’est qu’un poison lent. Elle crée l’angoisse d’un futur qui n’existe pas. Elle nous empêche de percevoir la danse réelle du temps, celle qui nous relie à l’éternité. Dans l’Akasha, je ne suis pas seul. Nous sommes des milliers, peut-être des millions, à converser simultanément dans ce grand espace sans limites. Hokusai, l’artiste de la Grande Vague, me glisse un clin d’œil complice : — J’en connais un rayon là-dessus, me dit-il. Tu l’as vue, cette hélice dans ma vague ? Je lui rends son sourire. — Un vrai coup de génie, mon frère. Hildegarde de Bingen surgit à son tour, comme elle le fait souvent quand la mort est évoquée. Elle a l’humour mordant de ceux qui savent. — Vous comptez encore longtemps philosopher ? J’ai des mauvaises herbes à arracher dans mon jardin. On éclate de rire. Ce n’est pas du cynisme, juste cette légèreté propre à ceux qui comprennent que le temps, finalement, n’est qu’un jeu. Mais ce jeu peut être effrayant. L’Akasha offre un accès immédiat à tout : les événements, les souvenirs, les symboles. Et, dans le même élan, elle déconstruit notre conception ordinaire du temps. Ce que nous croyons appartenir à une époque ou à une mémoire spécifique est en réalité hors des frontières que nous nous imposons. L’illusion d’un temps linéaire s’effondre, révélant un présent éternel, fractal et illimité. En tant que scribe maya, je pourrais vous enseigner la sagesse du Tonalpohualli, ce calendrier sacré divisé en vingt treizaines, qui honore toutes les divinités sans en oublier aucune. Il n’est pas ancré dans les cycles visibles du Soleil et de la Lune, mais dans une dimension qui dépasse l’ordinaire. Ce n’est pas une nostalgie, c’est une leçon. Une invitation à surfer sur l’éternité plutôt que de se noyer dans l’angoisse du temps qui passe. — Ainsi soit-il, murmure une voix familière. Rappelle-toi la Cène : treize à table, et tout le tutti. Jésus est là, comme souvent. Pas dans une posture de solennité, mais en compagnon de route. Il apparaît et disparaît, toujours entre deux dimensions, jamais totalement fixe. Il me fait sourire, même quand les éléments se déchaînent. Peu à peu, la lumière décline et le son s’éloigne. Saint-Michel se retire dans ses hautes sphères. Nous, simples surfeurs, restons entre la quatrième et la cinquième dimension, à peine capables de percevoir la pointe de l’immensité. Et pourtant, l’infini est là, dans la vague qui monte à l’horizon. Une vague plus gigantesque que jamais, un mur d’eau et de lumière qui semble vouloir tout emporter. Je garde mon équilibre, les pieds bien ancrés sur la planche, prêt à plonger dans l’inconnu. C’est alors qu’une dernière question me traverse : cette quête de précision, ce besoin d’expliquer chaque détail, n’est-elle pas, elle aussi, une forme de poison ? Peut-être faut-il simplement accepter le mystère, rire de l’absurde, et surfer. Je ris, mais mes jambes vacillent. La vague approche, immense et impitoyable. Le temps s’effiloche, les repères s’évanouissent. Alors je prends une grande inspiration et je plonge.|couper{180}

