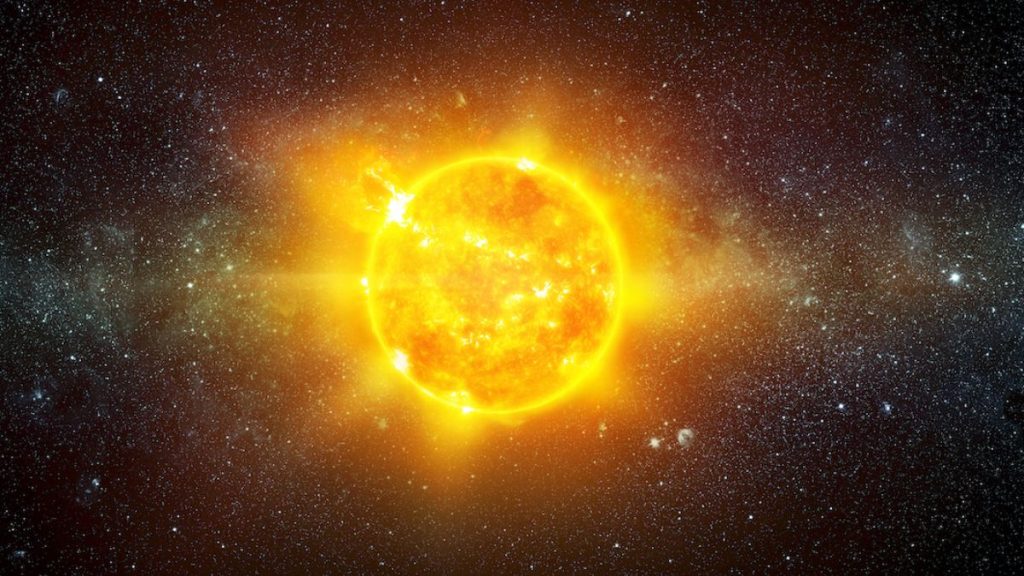21 juin 2025-2
Fait trop chaud, n’arrive pas à dormir et repense à ce livre de Patrice Van Eersel terminé il y a peu : Le soleil est-il conscient ? Paru en avril 2025. La question vient du biologiste britannique Rupert Sheldrake, qui suggère que les champs électromagnétiques pourraient être le pont entre conscience et matière. Van Eersel, l’auteur de La Source noire, a repris cette interrogation dans une enquête de 452 pages. Un journaliste des années Actuel, des années Clés aussi, ou Nouvelles Clefs, c’est selon. Ce titre ne m’a pas quitté. Et c’est peut-être en tournant dans mon lit, cette nuit sans sommeil, que l’idée de cet article a commencé à prendre forme.
Ai marché dans les rues du village ce matin. Mêmes boutiques fermées, à louer, à vendre, même désolation à chaque coin de rue, on finit par s’y habituer. Et au ciel bas et au mont Pilat qu’on entrevoit depuis le fond de la vallée, à travers les fumées d’usine. Mais ce matin, ça me revient, quelque chose clochait. Le silence était trop bruyant. Notifications à répétition qui dégringolaient des façades, des habitacles, des véhicules, moteurs plus ou moins éreintés. Échos d’une vie qui ne se pose jamais. Et ça m’a mis en rogne, c’est-à-dire dans une certaine forme d’énergie.
Me suis dit que le pire qui pouvait nous être arrivé, c’est cette impression de tout savoir et de ne rien savoir de manière simultanée. Nous disposons d’applications en tout genre parmi lesquelles des podomètres qui calculent pour nous le compte de nos pas. Nous savons la vitesse d’une particule. Le temps qu’il reste avant la pluie. Et pourtant ne savons plus faire le plus simple : nous arrêter et écouter.
Le silence ne disparaît pas, nous le recouvrons. Il s’effiloche à force de superpositions. Il s’aplatit ou nous croyons en finir ainsi avec lui. Le silence est devenu tellement insupportable que nous ne voulons plus l’entendre dans nos rues comme dans nos conversations, dans nos monologues. Nous en avons peur désormais. Alors nous le remplaçons. Chiffres, alertes, pixels, playlists. Nous inventons un masque qui nous aveugle et nous effraie. Nous appelons ça vivre. Ou encore la réalité.
Ce que le silence, le masque, la réalité produisent en moi est très étrange. De vieux récits remontent. Ai l’impression de tracer mentalement une issue de secours. La Tartarie, l’Atlantide, la Terre creuse. D’autres encore, plus flous, plus muets. Ces vieux récits n’expliquent rien. C’est une porte de secours ou une mise en abyme. Et au fond de cet abyme il y a quelque chose d’ineffable, mais qu’il faut que je parvienne à suggérer malgré tout. Une forme de vertige. Une blessure qui ne saigne pas. Y verrais plutôt des bouées jetées et qui flottent au loin dans l’eau noire de ces journées. Non pour s’y accrocher, je ne me sens pas naufragé. Mais peut-être pour retrouver la sensation de dériver.
Et c’est là que repense aux Kogis. Ces 16 000 descendants des Tayronas qui vivent dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. Les ai découverts dans un documentaire, ou peut-être un livre, ne sais plus. Ce qui m’a frappé, c’est cette phrase qu’ils nous adressent : ils nous appellent leurs "petits frères". Pas une moquerie. Une main posée sur l’épaule. Ils vivent depuis plus de cinq siècles entre 0 et 5 770 mètres d’altitude, là où nous avons désappris de regarder.
Ce qui me trouble chez eux, c’est cette question qu’ils posent à l’orée d’une forêt : « Comment pouvez-vous entrer sans demander la permission aux maîtres des lieux ? » Et nous restons là, bêtes, sans mots, parce que nous ne savions même plus qu’il y avait des maîtres.
Pense à ça parfois quand pousse une porte. Quand entre quelque part. Est-ce que demande ? Est-ce qu’écoute ? Ou est-ce que fonce, comme si le monde m’attendait ?
Mais ce qui m’intéresse, c’est pas cette opposition facile entre eux qui "savent" et nous qui "ne savons plus". C’est plus simple et plus complexe. Eux mâchent la coca pour rester connectés à la Pachamama, pour être "en permanence dans un état de conscience avancé". Ils utilisent des rituels, des gestes, des mantras. Ils passent par une mythologie sans se poser de questions. Ce que nous ne savons plus faire.
C’est peut-être ça qui me fascine. Nous cherchons tous des portes. Les Kogis les trouvent dans leurs rituels à la coca, dans leurs offrandes aux montagnes qu’ils considèrent comme "le cœur du monde". Moi, les cherche dans mes dérives nocturnes sur l’écran, dans mes obsessions pour l’Atlantide, dans ces synchronicités que note parfois dans un carnet. Le problème c’est pas qu’on a perdu le mythe, c’est qu’on l’a intellectualisé au point de ne plus pouvoir s’y abandonner.
Me souviens de ce que j’ai ressenti en découvrant la théorie de Sheldrake sur la conscience du soleil. Cette petite vibration, ce frisson d’évidence. Comme si quelque chose en moi reconnaissait une vérité sans avoir besoin de preuve. Une équation bien posée, comme une phrase bien dite, nous relie à quelque chose de plus vaste. À cette étrange vibration qu’on appelle encore conscience, faute d’un meilleur mot.
Hier soir, insomnie déjà. Ai regardé dehors. Les fenêtres d’en face étaient éteintes mais pas mortes. Il y avait quelque chose qui respirait encore. Pas les gens. Quelque chose d’autre. Le monde, peut-être. Qui attend. Qui ajuste. Qui respire sans demander la permission.
Me pose souvent cette question : nous sommes tous à la recherche d’interfaces avec le mystère. Les chiffres nous disent que tout est affaire de juste mesure : à 21 % d’oxygène, nous vivons. À 22, tout s’enflamme. À 19, nous nous éteignons. Qui règle cela ? Quel souffle veille à cette équation-là ? Quelle forme de présence ajuste l’équilibre sans demander d’applaudissements ?
C’est peut-être ça que les mythes tentent de nommer. Cette manière humble que nous avons trouvée pour poser la question. Pour désigner sans profaner. Ils sont pas là pour nous endormir, mais pour nous réapprendre à voir sans arracher. À nommer sans posséder. À deviner sans saisir.
Rêver, alors, devient un acte de mémoire. Non la fuite, mais l’appel. L’écoute revenue. Demander la permission. Se taire. S’asseoir. Toucher une pierre comme on touche un front. Sentir qu’elle respire elle aussi, à son rythme. Imaginer que la conscience est pas logée dans nos crânes mais dissoute dans le monde. Que penser n’est qu’une forme de résonance parmi d’autres.
Interfaces With Mystery
Too hot, cant sleep and thinking of this book by Patrice Van Eersel finished not long ago : Is the Sun Conscious ? Published April 2025. The question comes from British biologist Rupert Sheldrake, who suggests electromagnetic fields could be the bridge between consciousness and matter. Van Eersel, author of The Black Source, took up this interrogation in a 452-page inquiry. A journalist from the Actuel years, the Clés years too, or Nouvelles Clefs, depends how you see it. This title hasnt left me. And maybe lying in bed, this sleepless night, the idea for this article began to take shape.
Walked the village streets this morning. Same shuttered shops, for rent, for sale, same desolation at every corner, you get used to it. And the low sky and Mount Pilat glimpsed from the valley floor through factory smoke. But this morning, comes back to me, something was wrong. The silence was too loud. Notifications cascading from facades, from vehicles, from motors more or less worn down. Echoes of a life that never settles. And it made me angry, which is to say put me in a certain form of energy.
Told myself the worst that could have happened to us is this impression of knowing everything and knowing nothing simultaneously. We have applications of every kind including pedometers that count our steps for us. We know the speed of a particle. The time remaining before rain. And yet no longer know how to do the simplest thing : stop and listen.
Silence doesnt disappear, we cover it. It frays from layering. It flattens or we think to finish with it thus. Silence has become so unbearable we no longer want to hear it in our streets as in our conversations, in our monologues. We fear it now. So we replace it. Numbers, alerts, pixels, playlists. We invent a mask that blinds and frightens us. We call this living. Or else reality.
What silence, mask, reality produce in me is very strange. Old stories rise. Have the impression of mentally tracing an escape route. Tartaria, Atlantis, the Hollow Earth. Others still, more vague, more mute. These old stories explain nothing. Its an emergency exit or an abyss. And at the bottom of this abyss there is something ineffable, but that I must manage to suggest despite everything. A form of vertigo. A wound that doesnt bleed. Would see rather bouoys thrown and floating in the distance in the black water of these days. Not to cling to, I dont feel shipwrecked. But perhaps to rediscover the sensation of drifting.
And its there I think of the Kogis. These 16,000 descendants of the Tayronas who live in the Sierra Nevada de Santa Marta, in Colombia. Discovered them in a documentary, or maybe a book, no longer know. What struck me was this phrase they address to us : they call us their little brothers. Not mockery. A hand placed on the shoulder. They have lived for more than five centuries between 0 and 5,770 meters altitude, there where we have unlearned to look.
What troubles me about them is this question they pose at the edge of a forest : How can you enter without asking permission from the masters of the place ? And we remain there, dumb, wordless, because we no longer even knew there were masters.
Think of this sometimes when push a door. When enter somewhere. Do I ask ? Do I listen ? Or do I charge ahead, as if the world were waiting for me ?
But what interests me isnt this easy opposition between them who know and us who no longer know. Its simpler and more complex. They chew coca to stay connected to Pachamama, to be permanently in an advanced state of consciousness. They use rituals, gestures, mantras. They pass through mythology without questioning. What we no longer know how to do.
Maybe thats what fascinates me. We all seek doors. The Kogis find them in their coca rituals, in their offerings to mountains they consider the heart of the world. Me, I seek them in my nocturnal drifts on the screen, in my obsessions with Atlantis, in these synchronicities I sometimes note in a notebook. The problem isnt that we lost myth, its that we intellectualized it to the point of no longer being able to abandon ourselves to it.
Remember what I felt discovering Sheldrakes theory on solar consciousness. This small vibration, this shiver of evidence. As if something in me recognized a truth without needing proof. An equation well posed, like a sentence well said, connects us to something vaster. To this strange vibration we still call consciousness, for lack of a better word.
Last night, insomnia already. Looked outside. The windows across were dark but not dead. There was something still breathing. Not the people. Something else. The world, perhaps. Waiting. Adjusting. Breathing without asking permission.
Often pose this question to myself : we are all searching for interfaces with mystery. Numbers tell us everything is a matter of proper measure : at 21 percent oxygen, we live. At 22, everything ignites. At 19, we extinguish. Who regulates this ? What breath watches over this equation ? What form of presence adjusts the balance without asking for applause ?
Maybe thats what myths attempt to name. This humble manner we found to pose the question. To designate without profaning. Theyre not there to put us to sleep, but to reteach us to see without tearing away. To name without possessing. To divine without seizing.
To dream, then, becomes an act of memory. Not flight, but call. The return of listening. Ask permission. Be silent. Sit down. Touch a stone as you touch a forehead. Feel that it too breathes, at its rhythm. Imagine that consciousness isnt lodged in our skulls but dissolved in the world. That thinking is only one form of resonance among others.