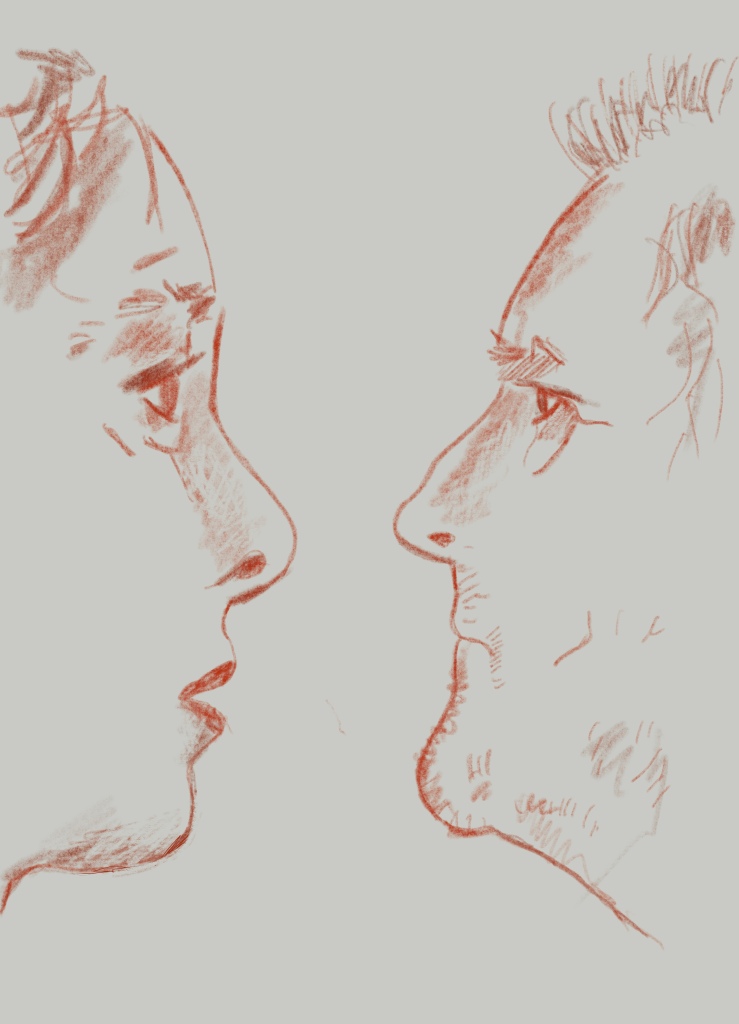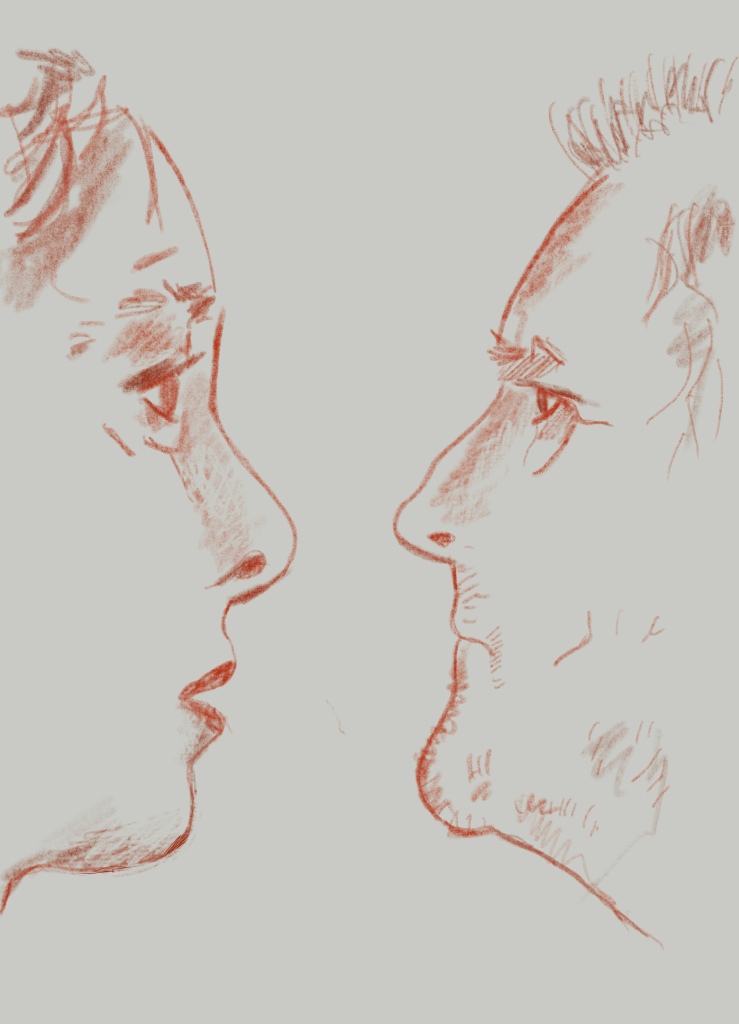06 juin 2023
Ce que les parents nous lèguent dès notre origine. Et ce temps infini de l’enfance, lorsque nous sommes enfants. Et le juste, l’injuste : ce passe-temps. Et si nous nous trompions toujours nous-mêmes, et si adroitement, pour ne pas être aveuglés par la terrible intelligence des choses que nous ne cessons jamais de côtoyer, sans jamais vraiment vouloir les voir en face ?
Nous pensons — ou disons — juste, injuste, pour tenter de justifier une révolte quant à sa légitimité réelle, surtout lorsque surgit tout à coup le doute, ainsi que la mauvaise foi qui l’accompagne de temps en temps. Mais se demande-t-on, en quel honneur, les choses devraient être justes ? Se le demande-t-on vraiment ? Non, bien sûr que non. La notion du juste nous dégueule du cœur et des lèvres comme de la bave, un réflexe pavlovien. Nous disons “c’est injuste” pour un oui, pour un non. Autant de coups d’épée dans l’eau.
Hier soir, repas avec les copains. Premier barbecue de l’été : chipolatas et merguez. Une grande salade de perles pour accompagner, avec — bien sûr — un excellent Côte-du-Rhône, et une délicieuse tropézienne en dessert.
On en vient soudain à parler de l’URSSAF, ce qui, a priori, n’est pas bien bon pour la digestion. Un copain se plaint qu’on lui demande désormais de lister tous les lieux d’exposition où il sévit, qu’il y ait vendu ou pas. Et, évidemment, nous sommes tous d’accord pour trouver cela débile — injuste, en fait.
De là, on passe bien sûr à la réforme des retraites, injuste elle aussi. On parle du corps médical ensuite, puisque deux infirmières à la retraite, assises autour de la table, se réveillent à trois heures chaque matin, obéissant à une horloge biologique façonnée par des années de nuits de garde (royalement rémunérées à huit euros de prime). On évoque le pouvoir d’achat d’une époque révolue, où, à deux, avec des salaires modestes, on pouvait encore s’en sortir — voire vivre assez bien. Injuste aussi, cette stagnation des salaires durant dix ans, dont la raison serait, dit-on, due aux 35 heures.
On parle ainsi d’un tas de choses fâcheuses. Et bien sûr, des maladies, du cancer, de ce nouveau vaccin. Une conversation de vieux. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Ce n’était pas la conversation, l’intérêt : c’était d’être entre copains.
Je repensai soudain à ces vieux films en noir et blanc, évoquant une France plus jeune encore que nous ne l’avions connue. Bourvil, Fernandel, Raimu… Ces films tirés de Pagnol, où les disputes faisaient partie des amitiés, d’une certaine manière très française de communiquer.
Le fait est que nous avons tendance à filer dans une nostalgie désormais. Une nostalgie étrange, celle du “bon vieux temps” dont je nourris quelques doutes quant au fait de l’avoir vraiment connu. Nous ne l’avons connu, la plupart d’entre nous, que par ouï-dire. Il me semble que déjà nos parents disaient la même chose, et nos grands-parents tout autant. Le fameux “c’était mieux avant”.
Mais tout de même… Que l’URSSAF se préoccupe des lieux d’exposition où l’on ne vend rien… Que cet organisme nous demande des comptes d’apothicaire sur du vent… Je me demande dans quelle mesure je dois utiliser le mot répugnant ou celui d’injuste.
Surtout qu’il faut désormais être totalement aveugle pour ne pas voir que tout ce qui est politique est dévoyé par la finance. Qu’il est tout à fait limpide qu’on nous a donné le droit de vote comme un os à des chiens vautrés aux pieds des tables de cet obscène banquet. Que le monde entier sue sang et eau pour qu’une poignée de privilégiés continue à péter dans la soie.
Il y a bien là quelque chose de profondément révoltant. Une injustice flagrante. C’est, du moins, ce que pense l’enfant au plus profond de moi-même.
Alors que l’adulte, exactement comme toutes ces personnes connues jadis dans ce fameux “bon vieux temps”, fabrique une boulette de mie de pain, la triture entre deux doigts, tout en écoutant les doléances qui jaillissent dans la nuit de juin — sans vraiment savoir comment y réagir.
Car dire, encore une fois, que tout cela est injuste, nous le savons. Bien sûr que nous le savons. Cette plainte est devenue un lieu commun. Et c’est peut-être cela, le plus exaspérant : que nous nous sentions obligés, par d’invisibles forces, de nous retrouver dans ces lieux communs — alors que nous pourrions bien en inventer d’autres, si la fatigue, le désespoir, ou une colère vieille comme le monde ne nous submergeait pas.
Ces notions de juste et d’injuste nous entraînent vers une dangereuse nostalgie. Elles y entraînent sans doute l’Europe tout entière. Et il suffirait de pas grand-chose pour aller vers le pire. Le retour des bruits de bottes. Des armes à feu. Des lâchetés comme des bravoures. Des vices et des vertus dictés par une idée du juste et de l’injuste insufflée par des personnages sans vergogne — et qui, même, rient de notre grande naïveté.
L’illustration est un dessin réalisé pour un projet d’affiche de théâtre. La nouvelle pièce écrite par mon épouse sera jouée en novembre prochain. Un thème sur la violence conjugale. La violence, un triste lieu commun aussi…
Post-scriptum
hautVous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | juin 2023
L’invention d’un auteur
Depuis que les hommes ont eu le loisir de se retourner sur ce qu'ils étaient, d'enquêter sur l'origine des gestes qui les commandaient, des paroles qui les liaient, des songes qui les hantaient, il leur est revenu, à l'écart du tumulte, dans les replis de la solitude, de s'inventer eux-mêmes, d'être les auteurs de leur propre destin. L'invention de l'auteur, c'est l'invention de soi. Ce n'est pas seulement l'acte de jeter sur le papier les figures qu'on porte en soi comme une semence incertaine ; c'est, plus rudement, plus gravement, l'effort de desserrer l'étau des forces obscures, sociales, héréditaires, qui nous plient à leur forme et à leur loi. Etre auteur, dans ce sens-là, c'est refuser l'assujettissement silencieux aux histoires déjà racontées, aux rôles déjà distribués. C'est tirer de la mélée confuse des influences et des injonctions un chemin singulier, infime peut-être, mais néanmoins nôtre. C'est, dans les ruines accumulées du passé, retrouver l'impulsion fragile, éphémère, mais entêtée, qui fait que, contre le poids des coutumes, des espérances prêt-à-porter, des peurs communes, on se met debout, on profère sa parole, on trace, même chancelant, une ligne qui ne doit rien à personne. C'est un labeur sans garantie, sans applaudissements assurés, sans même la certitude de n'avoir pas manqué son propos. Mais il n'est pas d'autre grandeur pour qui veut, un jour, ne pas avoir entièrement trahi ce qu'il pressentait, confusément, au fond de lui, avant que le monde, ses urgences, ses ordres, ses mirages, ne viennent tout ensevelir. L'invention de l'auteur, c'est l'exercice quotidien, inlassable, de la vérité, à même l'obscurité, contre la tentation du renoncement, de la reddition, de la complaisance. C'est le travail, infime mais indestructible, par lequel une conscience humaine tente, même à son insu, de demeurer fidèle au peu d'évidence que l'existence lui a confiée.|couper{180}

Carnets | juin 2023
11062023
visage encre : PB Sur la couverture du livre il s’agit d’écrire roman, sur la façade de tel ou tel bâtiment il suffit d’allumer le panneau lumineux caractéristique d’un théâtre, sur le cœur d’épingler l’étoile jaune pour dire juif. La nuit parfois la désignation, désigner un livre, un bâtiment, un être, lui semble être au-dessus de ses forces. Tourner seulement dans cette idée de dégoût. En réarrangeant l’ordre des propositions. Sur la façade de ce bâtiment est écrit Théâtre. Sur le revers de la veste est épinglée l’étoile jaune. Ils se sont dépêchés d’écrire roman en plus petit sur la couverture de ce livre juste sous son titre. La nuit il se heurte à toute désignation. Tout est déjà désigné d’avance. Il n’y a plus rien d’autre à désigner. Le mot Théâtre est inscrit sur le fronton de ce bâtiment, ce juif doit porter une étoile jaune sur le cœur, même s’il ne la montre jamais, et, bien sur cette histoire sera mieux acceptée si on la désigne par le mot roman. Une écriture catatonique qui ne s’adresse qu’à la page blanche pour la noircir. A l'origine il accepte la désignation sans broncher, ne la remet jamais en question. Il faut bien nommer les choses puisque c’est ce qui nous différencie des animaux. Le pouvoir de nommer dont s’emparent certains hommes, puis qui le font peser sur certaines femmes, ou sur d’autres êtres animés. "Nous avons décidé que tu étais un lâche, un incapable, un être nuisible, une pute, un salaud, et il n’y a rien à redire, c’est comme ça." "Évidemment tu as le droit de ne pas être d’accord, essaie pour voir, débat-toi qu’on rigole, proteste à voix haute qu’on t’assomme." Il sera de nouveau ce bleu qui passe le portail de l’école. La nuit il lui arrive encore de se remémorer la scène. Il tient sa valise de la main droite, de l’autre son cartable. Il se sent gauche. Il ne se sent pas à sa place. Sûr que le couperet va tomber au même moment ou il passera le seuil de l’établissement. Le bleu envahit son crâne, tout de lui est déjà bleu avant même d’entendre le mot. S’il pouvait disparaître sous terre, ou bien se réveiller de ce mauvais rêve, mais pour se rendre où ? Y a t’il sur la terre un lieu où il peut échapper une bonne fois pour toutes à la désignation ? Y a t’il un lieu possible sur la terre où l’adjectif n’existe pas encore, n’existe plus ? Y t’il quelque part ici-bas un espace temps dans lequel on peut disparaître enfin dans l’anonymat ? Ne plus être qu’un bâtiment dans la ville, un livre sur une étagère, un être face à des questions sans réponse. De chaque coté de l’allée qui mène au château et à ses dépendances, des gens s’arrêtent de parler pour le regarder franchir le portail de l’établissement. La pension s’est installée là, dans ce château, qui fut jadis réquisitionné par la Gestapo. On y voit un parc suffisamment vaste pour que le regard s’y perde, on y devine des limites confuses, des essences au loin qu’on ne peut identifier. Pour parvenir jusqu’ici le véhicule doit franchir un petit pont, traverser un ruisseau, puis s’arrêter sur un parking près d’un cours de tennis flambant neuf. Le reste du chemin est à faire à pied le sur une route goudronnée en pente. Il n’y a pas à proprement parler de portail. Il y a ces groupes de personnes qui soudain se taisent et les toisent lorsqu’ils parviennent à leur hauteur. Ils forment une haie silencieuse qui débouche vers l’inconnu dont on ne connaît que la couleur pour l’instant, la couleur bleu. Le ciel change, le blanc des nuages se découpe désormais sur le bleu, les plus proches, plus précis dans les contours, plus contrastés que ceux éloignés. Ainsi se fabriquer une profondeur avec quelques observations. Nous partons vers 16h pour arriver à l'heure au spectacle. S. émet la possibilité d'un trafic dense qui me paraît être un prétexte pour partir de la maison plus vite. C'est elle qui conduira, ce qui m'arrange car je pourrai lire sur mon portable la suite de l'article sur Vittorini trouvé sur Cairn. Je me demande ce que pouvait être le parti fasciste italien à l'époque pour que tant d'écrivains y adhèrent. J'imagine que le mot fasciste ne signifiait pas du tout la même chose qu'après guerre. De nos jours combien de jeunes gens adhèrent probablement à des mots qui dans dix, vingt, cinquante ans seront synonymes de dégout pour les êtres à venir qui traverseront l'histoire. Le spectacle a lieu à 17h 30 à la ferme du Vinatier. Une fois sorti du véhicule j'aperçois de loin un groupe de résidents menés par une femme en blouse blanche. Mais je ne m'y attarde pas car je découvre un espace vert à l'opposé, clôturé par un grillage à larges mailles derrière lequel broutent des chèvres. Je n'ai pas envie de rejoindre les gens là-bas tout de suite, je donne comme prétexte un intérêt pour ces animaux parqués, et je sors mon portable de la poche pour bien montrer que je vais faire des photos, que cette décision est prise et qu'elle est irréfutable. Mais S. a déjà reconnu plusieurs personnes devant les bâtiments, elle m'interpelle, "il y a les X et les Y viens je ne veux pas y aller seule". Je serais bien resté quelques minutes de plus. Idéalement jusqu'à l'heure où il faut entrer dans la salle, dans la pénombre, s'installer pour regarder le spectacle. Puis le fait de retrouver des connaissances que nous n'avons pas revues depuis un bon lustre n'est pas si désagréable que ça. Hugo et Gigi fidèles au poste. Ils ne changent pas beaucoup, se ratatinent comme tout le monde, mais peut-être un peu plus au ralenti. Pas mal de copains font partie de la troupe. L'intitulé du spectacle de cabaret m'évoque ce tableau célèbre de Munch, le Cri, et aussi les souvenirs de la dernière exposition où je m'étais rendu cet hiver, ainsi que la déception qui l'accompagne encore. Presque pas de peinture sur les toiles, des choses peintes comme à la va vite, des marrons tristes couleur de merde. Des textes chantés ou lus qui ont tous comme point commun la pauvreté, la misère, l'exploitation de l'homme pauvre par le riche, très affirmé politiquement comme souvent. Mais quelque chose cloche cette fois. La sensation d'assister à une ritournelle dans la ritournelle. Comme une zone de confort, un repli du temps dans lequel on se vautre pour se rassurer de quelque chose encore. Et surtout le final quand tous les acteurs sont alignés en rang d'oignons face au public et gueulent "on ne lâche rien" Quelque chose de factice, une sensation de malaise. Comme si on ressortait des répliques de Top Chef dans les années 70, que l'on s'accrochait à un espoir défunt depuis des décennies. Une sorte de forcing pour réanimer un cadavre. Les fantômes des gilets jaunes passant comme des spectres en transparence. Mais pas que, presque cinquante ans d'enculades politiciennes en filigrane, de De Gaulle à Macron et ma foi toujours rien d'autre que quelques chansons passés de mode, un peu de mobilier urbain dégradé, le ton métallique des JT, la vie qui suit son cours et les baisés comptez-vous. Je veux dire qu'il y aurait de quoi faire aujourd'hui une révolution véritable, mais que tout le monde paie malgré tout rubis sur l'ongle ses impôts en respectant bien les délais par crainte de se voir infligé une majoration automatique. Sauf ceux qui n'en paient pas, soit parce qu'ils n'ont pas de quoi, soit parce qu'ils sont bien plus malins que tous les autres, sans oublier ceux atteints de négligence chronique. Encore que je crois de plus en plus que négligence rime avec résistance. L'émotion à écouter les textes, les chansons, cette vieille émotion qu'on m'extirpe malgré moi, je prends le temps de m'y livrer pieds et poings liés, de retomber comme en enfance, ou dans une jeunesse sublimée par le temps passé. Puis je me révolte, intérieurement je me révolte. Je ne suis plus d'accord pour adhérer à ce genre de messe. La cervelle prend aussitôt le relais, j'observe la position des corps, les mouvements, j'écoute les timbres de voix, j'étudie la mécanique dans le plus petit détail, quelque chose au fond de moi est de glace. "On ne lâche rien", tout à fait d'accord mais pas sur les mêmes choses, et surtout plus avec les mêmes moyens. Il faudrait que ça bouge, que ça bouge à tout péter, à remettre tous les compteurs à zéro. L'Italie et sa littérature provinciale c'était le leitmotiv de Vittorini, de vouloir ouvrir la littérature italienne au monde, notamment à la France. Et c'est une chose bien étrange qu'il reste inconnu de bien des intellectuels sur lesquels je suis tombé. A la rigueur Malaparte on connait, et encore à part La peau pas grand chose d'autre. Mais bien sur les intellectuels est un mot péjoratif. Désormais d'autant plus quand j'observe ceux qui déclarent que la démocratie est passée de mode, que l'urgence est à l'ordre, et que lorsqu'ils parlent d'ordre il s'agit bien évidemment de contraindre à épouser un fantasme, leur propre fantasme. La rupture entre le PCF et Vittorini vient en grande partie de ce malentendu concernant cette notion d' intellectuel sans les années 50 déjà, donc rien de bien nouveau. Ils trouvent toujours un prophète, que ce soit Marx, Staline Freud ou Hitler ça ne les étouffe pas. Etre dans la masse à ses cotés, chuter avec elle quand elle chute, se relever quand elle se relève, Passer de la masse au peuple et du peuple aux gens, à ses voisins de palier, voilà un vrai parcours intellectuel, le reste n'est que du blabla. Je n'aime pas les gens parce qu'ils sont encore beaucoup trop des gens. Les journaux aussi disent les gens, des individus ils n'en parlent qu'en héros, terroristes, victime, disons surtout comme ça les arrange de flatter leurs maîtres, de caresser le bon ton dans le sens du poil. Pas sûr qu'Ernst Jünger, son traité du rebelle notamment n'ait pas été le poison le plus destructif jamais absorbé. Beaucoup trop cérébral, il m'aura surtout enclin à me refugier dans un fantasme de rébellion, justement très intellectuelle. Quand on a encore le temps de penser c'est qu'on n'est pas aussi acculé qu'on le croit ou qu'on le désire. La spontanéité des révoltes, comme la spontanéité d'un geste en peinture, c'est peut-être ce qui se rapproche au plus près du vivant. De se sentir vivant, d'être en vie. Ce qu'on nomme la brutalité de la vie est un point de vue. Et puis soudain : " quel âge as-tu déjà rappelle le moi ? " Et si la révolte était une tentative de retrouver la jeunesse, ou de s'en fabriquer une toute neuve ? Certains vieux prennent des jeunes femmes d'autres attrapent des révoltes au collet. D'autres encore s'en fichent complètement, ils allument leurs télés, ils savent que tout est faux même la vérité. Dans le fond, ce livre, ce tout petit livre qui pourrait bien être le ressort de cet atelier "roman" est l'histoire de la résignation, comment on y entre, comment de ce point de vue on voit le monde, comment le doute soudain s'immisce, comment on en sort ( comment on parvient à s'en échapper, à s'enfuir de la résignation ) Ecrire rend seul, de plus en plus, et au fur et à mesure on peut dire que l'écart se créer par la suppression des qu'est-ce que va penser un tel une telle si j'écris cela. Ce genre d'écriture catatonique est comme un voyage chamanique, une mine qu'on creuse de plus en plus profondément pour parvenir au nerf de l'ombre, à la douleur de plus en plus vive qui fabrique l'ombre. C'est se livrer à une solitude inédite dans laquelle on doit aller jusqu'à se perdre soi-même comme compagnon. C’est dimanche nous partons à pied vers Roussillon effectuer quelques emplettes de fruits et légumes. Nous nous disons il faut marcher, c’est d’ailleurs ce qu’a conseillé à S le toubib. Et pas besoin d’être grand clerc pour saisir que ça s’adresse à moi aussi. Cette lourdeur à porter avec chaque pas sous la chaleur nous fatigue, je dois ralentir pour attendre S. Au retour je vais faire un tour sur Gmail pour voir si la consigne de l’atelier d’écriture est tombée, mais je ne vois que le message de la nouvelle lettre d’info, la date et l’heure du prochain zoom. Toujours pas la possibilité d’y assister ou l’envie. A un moment j’imagine écrire des messages sur le tchat comme proposé, puis ça me ramène illico à l’idée de commenter. Je n’ai rien à échanger, rien à dire, en dehors des moments où j’écris je ne suis plus que du silence, ce qui n’est pas du mutisme bien que l’impossible soit de même nature. Je me suis demandé ce qu’allait bien pouvoir être cette nouvelle proposition et dans quelle mesure le prologue déjà n’avait pas déclenché l’essentiel. Il y a une hésitation entre appliquer ce qui sera proposé et qui dans ce cas sera du domaine ludique en partie et cette pulsion qu’entraîne depuis ce nouveau cycle la présence de ce petit roman. Comme s’il suffisait de tirer doucement sur le fil pour que tout vienne. Un visage connu. Quand peut-on dire que l’on connaît un visage ? Peut-être lorsque le regard se pose sur ce visage, que l’on se sent aspiré tout entier, de fond en comble, dans la quiétude, l’émerveillement. Écrire dans une urgence. Impossible de compter sur l'avenir, de prétendre avoir encore des mots à disposition pour pouvoir le faire. Se dépêcher de noter avant que tout ne s'évanouisse. Écrire panique. Et puis une fois que l'on y est on s'y installe, on n'arrive plus à quitter. Cette difficulté d'imaginer achever un texte quelqu'il soit, de s'achever tout simplement. Allonger au fur et à mesure de la journée ces bribes grappillées, y revenir comme on se gratte une démangeaison. Probable que de tout cela une seule phrase sera à retenir peut-être rien de plus voire rien du tout. Si j'étais journaliste je me serais sûrement penché sérieusement sur l'art du recyclage. Rien de façon intrinsèque est utile ou inutile, il s'agit seulement de connaitre la bonne adresse où expédier. Comme en peinture chaque œuvre trouve une adresse, mais il est vrai aussi qu'il ne faut pas être pressé pour prendre le temps d'éplucher carnets d'adresses et bottins, faire beaucoup de route parfois, exhiber. S'empêcher, s'autoriser, s'en foutre. Des milliers de canevas possibles avec ces trois mots. réecriture, avril 2025 : Il y a d’abord cette volonté obscure et brutale, dans les sociétés humaines, de désigner, de fixer l’être sous des mots qui l’enchaînent : théâtre, roman, juif. Sur la façade, sur la couverture, sur le cœur. Une étiquette, une flétrissure, une assignation d'autant plus redoutable qu'elle se donne pour évidence. Dès l’enfance, il fallut consentir ou bien se taire. Traverser, seul, la haie des regards, passer sous le porche où, jadis, résonnait la botte de la Gestapo. Porter, dans le bleu de l’uniforme scolaire, l’empreinte des humiliations promises. Tout était déjà nommé avant que nous puissions comprendre ce qui était en jeu. Plus tard, il y eut l’école, les journaux, les spectacles : et partout, l’injonction de croire, de communier, de s’émouvoir au signal convenu. Même dans les cabarets militants, sous le vernis de la protestation, transparaissait la résignation massive. L’ordre contre lequel on feint de s’indigner a depuis longtemps triomphé dans les âmes, rendant caduque toute clameur. Mais au fond, écrire ne relève ni de l’indignation ni de l’espoir. C’est une manière de survivre, d’entretenir, contre l’érosion du réel, une résistance sourde, muette. Ce n’est pas un projet, c’est un geste archaïque, instinctif, chamanique. On creuse dans l’ombre, dans l’os de l’ombre, jusqu’à perdre la trace de soi-même. Écrire, c’est consentir à l’isolement radical, c’est se détacher de ce que penseront ceux qui parlent encore, c’est refuser les questions convenues. C’est marcher lentement sous le ciel écrasant de l’été, traînant derrière soi cette lourdeur inexpliquée, espérant seulement, par le mouvement, rattraper quelque chose d'essentiel qui nous fuit. Les révoltes qui s’agitent encore dans les rues, dans les chants, sont déjà recouvertes par la cendre des illusions anciennes. Ceux qui clament « on ne lâche rien » ont déjà abdiqué dans leur chair. Il faudrait tout brûler, tout abolir, recommencer sans témoin. Reste ce peu : la solitude, le silence, le travail infime de creuser dans l’écriture une galerie, une échappée, un abri précaire. Reste l’urgence de fixer un visage, de retenir un éclat, avant qu’il ne se dissolve dans la nuit d'où nous venons. Car il n’y a plus de révolte, plus d’utopie : seulement la tentative obstinée de ne pas mourir tout à fait dans le consentement général. Seulement l’effort de vivre, un peu, encore, à travers les mots.|couper{180}

Carnets | juin 2023
10062023
Ce n’est pas tant le contenu des songes qui importe, ni même leur survivance illusoire au réveil, mais la conscience, ténue, fugitive, qu’il y a eu rêve, qu’il s’est joué quelque chose d’autre, dans l’ombre, avant que la lumière ne vienne balayer les traces. Nous croyons sortir du sommeil, nous croyons écrire, nommer, dresser l’inventaire, mais nous ne faisons que prolonger, dans une couche plus mince, plus fragile, le tissu ancien des rêves. Il n’y a pas d’éveil. Il n’y a pas plus d’éveil que de commencement. Le mot même d'origine suffit à nous effondrer. J'avais dix ans, à peine, qu'un maître, une fois, osa parler du néant premier. Je suis tombé, foudroyé, non par le vide, mais par l'idée, déjà, qu'il pût y avoir un seuil, une brèche, un passage. Ce fut le début de la fuite dans la pensée, dans l'abîme de la conscience. Depuis lors, tout ce qui est m'apparaît, par une évidence intraitable, comme seul, séparé, irréductible. Le lien est accident, la solitude, la règle. Ceux qu'unit le bruit, la liesse ou l'oubli, je ne peux les rejoindre. Reste la lecture, reste l'écriture, brèves reconnaissances de détresses mutuelles. Kafka, Proust, ces fleuves d'insomnie, nous rappellent que l'on ne dresse pas de digues contre le flot, qu'il faut, à défaut d'autre recours, consentir à s'y perdre. L'insomnie est notre état véritable. L'écriture, son geste survivant. Un livre n'est qu'un prodige de lisibilité arraché à l'intraduisible. Que reste-t-il, sinon d'empiler, à même la fatigue, quelques traces, quelques billets, quelques lignes, sans espoir qu'on y revienne, mais par fidélité à ce que l'on n'a pas su abandonner entièrement : l'étrange joie de se savoir vivant encore, même dans la nuit, même pour rien.|couper{180}