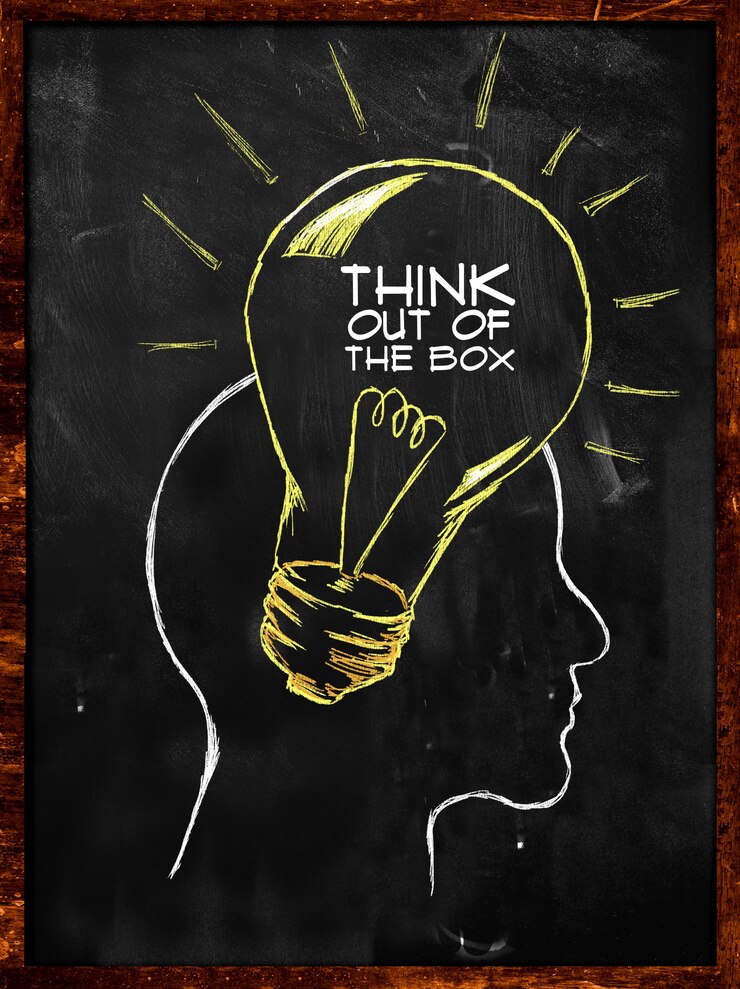Scintilla cogitationis
Dire ne signifie pas forcément s’adresser. Non ideo quod cogitatio dicitur, alicui dicitur. Association soudaine avec les cours de Deleuze à Vincennes. Aucune note. La parole crée la pensée. La parole comme lieu de l’élaboration d’une pensée. Si c’est ainsi, pourquoi avoir besoin d’un auditoire ? Pourquoi ne pas s’en aller parler en plein champ ? Sans doute parce que la présence de l’autre (au sens le plus large) ajoute une intensité. Il est possible que le besoin d’une divinité se manifeste d’autant plus lorsqu’on est seul. La divinité prend le rôle de cette altérité qui produit l’intensité du discours, le frottement qui crée l’étincelle d’une pensée.
Voici un texte qui contient plusieurs noyaux de sens :
-
Dire ne signifie pas forcément s’adresser.
-
Loqui non semper significat ad aliquem loqui.
-
Non ideo quod cogitatio dicitur, alicui dicitur.
-
-
Association soudaine avec les cours de Deleuze à Vincennes.
-
Subita mentis coniunctio cum lectionibus Deleuzii Vincinnensis.
-
-
Aucune note.
-
Nulla nota.
-
-
La parole crée la pensée.
-
Verbum cogitationem gignit.
-
-
La parole comme lieu de l’élaboration d’une pensée.
-
Verbum velut locus in quo cogitatio formatur.
-
-
Si c’est ainsi, pourquoi avoir besoin d’un auditoire ?
-
Si ita est, cur auditor desideratur ?
-
-
Pourquoi ne pas s’en aller parler en plein champ ?
-
Cur non in agrum ire et ibi loqui ?
-
-
Sans doute parce que la présence de l’autre (au sens le plus large) ajoute une intensité.
-
Forsitan quia praesentia alterius, late sumpta, vim addit.
-
-
Il est possible que le besoin d’une divinité se manifeste d’autant plus lorsqu’on est seul.
-
Fieri potest ut solitudo desiderium numinis manifestius efficiat.
-
-
La divinité prend le rôle de cette altérité qui produit l’intensité du discours, le frottement qui crée l’étincelle d’une pensée.
-
Numen personam illius alteritatis assumit quae sermonis vim gignit, attritionem quae scintillam cogitationis parit.
-
Il y a cette inquiétude qui revient parfois, lorsqu’on écrit, lorsqu’on tente d’aller droit au but sans en dire trop, sans trop refermer le poing. Trop de densité en peu de lignes, et l’on craint, non de trahir sa pensée, mais de n’en livrer que l’écorce, trop serrée pour les mains des autres. Le risque n’est pas le rejet, ni même le malentendu, mais une absence — de lecture, d’écho, de présence. Pas de stupeur, pas de tremblement. Calme. Nous ne sommes ni au cirque ni en représentation. Pas même à un concours. C’est une page, rien de plus.
On dit parfois : c’est à prendre ou à laisser. C’est une expression d’un autre âge, née, je crois, chez les marchands du XVe siècle, à l’époque où la négociation n’était pas encore l’art flasque qu’elle est devenue. Une époque où l’on posait ce qu’on avait, comme on jetait le fer sur l’enclume : on ne marchande pas. C’est ça ou rien. Ce n’est pas dit avec violence, mais avec la tranquillité sèche de ceux qui savent ce que vaut une chose, ce qu’elle a coûté.
C’est l’époque, aussi, de François Villon. Celui qui écrivait sur la corde raide, la tête déjà penchée vers le gibet. Une langue aiguisée, nerveuse, drue. Une langue qu’on entend encore, entre deux pavés, les jours de pluie. Il aurait pu dire cette phrase, la graver sur un mur de taverne : c’est à prendre ou à laisser. C’est une phrase de lisière, de fin de route, de gueule ouverte sur le froid.
Et puis, plus tard, Rabelais. À lui, ça ne convenait pas. Il n’en aurait rien fait. Lui n’imposait rien. Il débordait. Il ouvrait, en grand, les portes, les corps, les phrases. Il pétait et il rotait, comme on respire, comme on redonne souffle à une langue française trop vieille déjà, engoncée dans les corsets d’un monde de marchands. Il ne disait pas “ça ou rien”. Il disait : “Et aussi ça, et encore ça, et tiens, ça aussi.” Il ajoutait au monde, là où d’autres le restreignaient.
freepik image