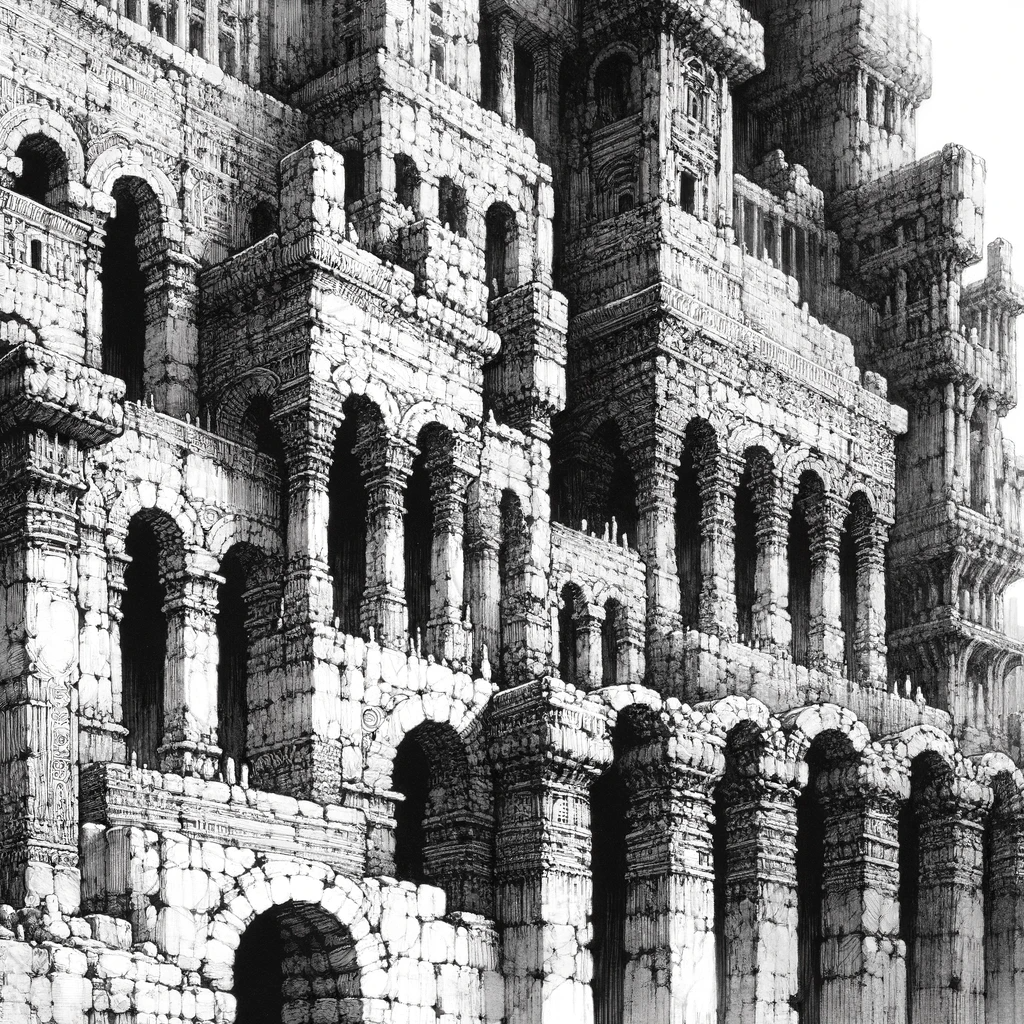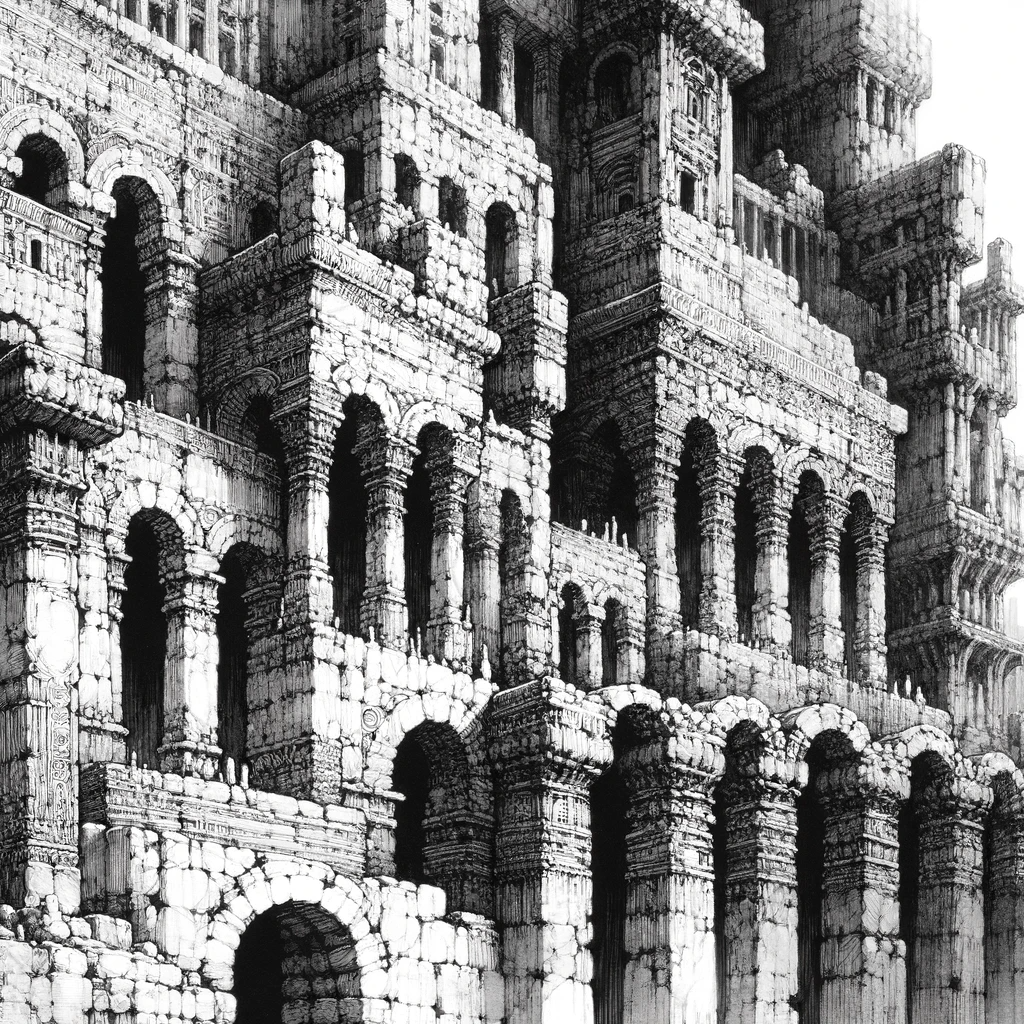13 janvier 2024
Quatre ans après le début de la fin d’un monde
En me levant, la fatigue pèse sur mes épaules et tout de suite, cette pensée me traverse : Je n’en peux déjà plus. C’est comme si je replongeais dans le même cauchemar, malgré tous mes efforts. Mes illusions semblent s’envoler, ne laissant derrière elles qu’une âpreté brutale, peut-être le seul véritable synonyme de ce phénomène que j’appelle vivre. Je réalise presque aussitôt que c’est exagéré, cette idée noire qui me vient dès le matin. Je peine à dissocier le narrateur de ce journal, celui que j’ai créé il y a quatre ans, de l’homme réel qui lui donne vie. Mes lectures, mon penchant pour le romantisme, ou plutôt le romanesque, semblent me dater, me rendre tristement obsolète. C’est un constat amer. Pourtant, au fond de moi, je sais qu’il y a une part de vérité dans ces mots, sinon pourquoi continuerais-je à écrire ? Cette obsession est là, omniprésente, et je dois composer avec elle : je suis fatigué de cette vie, fatigué des mensonges incessants. Je ne parviens plus à distinguer les miens de ceux qui, de plus en plus, semblent m’entourer, m’étouffer. Je ne peux plus ignorer cette accumulation de faux-semblants, elle me confronte chaque jour.
Cette lutte intérieure, c’est ce qui m’a poussé à abandonner la peinture pour l’écriture il y a quatre ans. Dans ma fiction, je pensais pouvoir projeter mes angoisses, mes doutes, trouver une catharsis. Mais aujourd’hui, je me demande si en écrivant, je ne fais pas qu’ajouter des couches à mon propre labyrinthe de mensonges. Peut-être que la fiction n’est qu’une autre manière de me dissimuler, de fuir la réalité crue et désarmante. Peut-être que cette quête d’authenticité n’était qu’une illusion, une autre forme d’autotromperie.
Pourquoi continuer à écrire, alors ? Peut-être parce que, malgré tout, il y a un fil d’authenticité dans cette entreprise. Dans les mots, je trouve parfois des éclats de vérité, des moments de clarté qui me donnent l’impression de toucher quelque chose de réel, même si ce n’est qu’éphémère. Peut-être que c’est dans cette quête incessante, cette lutte pour démêler le vrai du faux, que réside la véritable essence de la création, de mon existence.
Mais à peine ai-je couché ces mots sur le papier, je les trouve ridicules, presque honteux. Je ressens une gêne profonde en me comparant à ceux qui se lèvent chaque jour pour des réalités plus concrètes : travailler, nourrir leurs enfants, faire face à des défis bien réels. Oui, la honte m’envahit, de me complaire dans ces pensées nombrilistes et de songer à les exposer, si jamais je devais publier ces lignes. Sont-ce vraiment mes pensées, celles du narrateur de ce journal, ou celles du personnage de ma fiction ? Je n’en sais plus rien. Ce flou entre moi et mes créations, entre la réalité et l’imaginaire, semble se densifier, me laissant dans un état de confusion. Ai-je perdu le contact avec le monde réel, m’enfermant dans un univers de mots et de réflexions introspectives qui, au final, ne résonnent qu’avec moi-même ? Cette interrogation me hante, me pousse à reconsidérer non seulement ma création, mais aussi ma place dans le monde.
Il me suffit d’ouvrir un journal ou de regarder une émission de télévision pour sentir la vacuité de ces contenus. Une prise de conscience brutale me frappe : je me réveille plus seul et démuni que jamais. J’ai cette impression troublante que le mensonge est général, omniprésent. Peut-être que beaucoup le savent, mais choisissent de s’y accrocher, de le préserver. Ce mensonge est rassurant, moins effrayant que l’idée de changer, de bouleverser l’ordre établi. Cette révélation me pèse, m’isole encore plus dans mes pensées. Je suis pris dans un tourbillon de doutes où ma propre authenticité, celle de mon art, celle de mes mots, tout semble s’effondrer dans un abîme de questions sans réponses.
Aller jusqu’au bout du tragique, c’est ce que notre époque semble refuser, fuir. Autrefois, la tragédie offrait quelque chose, une catharsis, une compréhension plus profonde de la condition humaine peut-être. Aujourd’hui, je sens que nous nous en éloignons, par peur ou par incompréhension. En écrivant ces mots, je réalise mon incapacité à saisir pleinement ce que l’issue tragique nous apportait jadis. C’est comme si, dans notre quête effrénée de bonheur et de confort, nous avions perdu la capacité d’affronter les abîmes, de regarder en face nos propres limites, nos propres fins.
Dans mon art, dans mes écrits, je ressens cette tension. Y a-t-il encore de la place pour le tragique, pour l’exploration des sombres vérités de notre existence ? Ou avons-nous tellement peur de ce que la tragédie révèle sur nous-mêmes que nous préférons nous en détourner ? Chaque touche de pinceau, chaque mot que je pose semble porter cette question. Et pourtant, je n’ai pas de réponse. Peut-être que dans ce refus du tragique, dans cette peur, réside une tragédie en soi – celle de notre incapacité à accepter la totalité de notre condition humaine, dans toute sa complexité et sa finitude.
Aller jusqu’au bout du tragique, c’est ce que notre époque semble refuser. Il y a une peur, une réticence à embrasser ce que la tragédie, dans toute son ampleur, nous offrait autrefois. Je le sens, palpable dans l’air, dans les œuvres d’art contemporaines, dans les conversations quotidiennes. Et pourtant, en cet instant, alors que j’écris ces mots, je suis incapable de nommer précisément ce que l’issue fatale nous apportait. Était-ce une forme de catharsis, une purification, ou quelque chose de plus profond et insondable ?
Et maintenant, face à cette réflexion, que dois-je faire ? Quel courage faut-il pour continuer, pour affronter ces abîmes de pensée ? Parfois, je me sens être le plus faible des hommes, incapable de porter le fardeau de cette quête de vérité. Et puis, presque aussitôt, je ris de moi-même, de cette oscillation constante entre l’exigence d’élévation et de bassesse qui me taraude. Cette dualité, ce conflit interne, semble être le moteur même de ma créativité, et pourtant, elle est aussi ma plus grande source de tourment. Suis-je un artiste à la recherche d’une vérité insaisissable, ou simplement un homme perdu dans le labyrinthe de ses propres pensées ?
Je viens d’écrire ces lignes, et presque aussitôt, je lève les yeux de mon écran pour regarder par la fenêtre. Le monde continue sa course, indifférent à mes doutes et à mes questionnements. Les gens s’affairent, pris dans le tumulte de leur quotidien, se dirigeant, peut-être, vers un abîme inévitable. Et je me dis que, dans le grand schéma des choses, mes pensées ne sont pas plus significatives que la chute d’une feuille morte d’un arbre.
Cette idée m’amuse, d’une certaine manière. Elle me rappelle l’insignifiance de mes tourments face à l’immensité du monde. Fort de cette réflexion, je me lève, prêt à commencer ma journée comme d’habitude. Il y a quelque chose de libérateur à reconnaître sa propre petitesse, à accepter que nos luttes intérieures ne sont que des échos dans un univers bien plus vaste. Je décide de m’appuyer sur cette pensée, de l’utiliser comme un point d’ancrage pour affronter ce que la journée me réserve. Peut-être est-ce là la véritable force, la capacité de sourire face à l’insignifiance de notre propre existence et de continuer malgré tout
Illustration : Détail d’une façade d’un bâtiment dans une cité antédiluvienne.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | janvier 2024
20 janvier 2024
Qu’est-ce que la fin d’un voyage, d’une vie, ou même d’un simple article de blog ? Peut-être un recommencement, une exploration perpétuelle de ce que l’on quitte pour mieux retrouver, différemment. Avec une lucidité amère, l’auteur questionne ce besoin de mettre fin pour toujours redémarrer, d’effacer pour redessiner, sans jamais vraiment savoir.|couper{180}
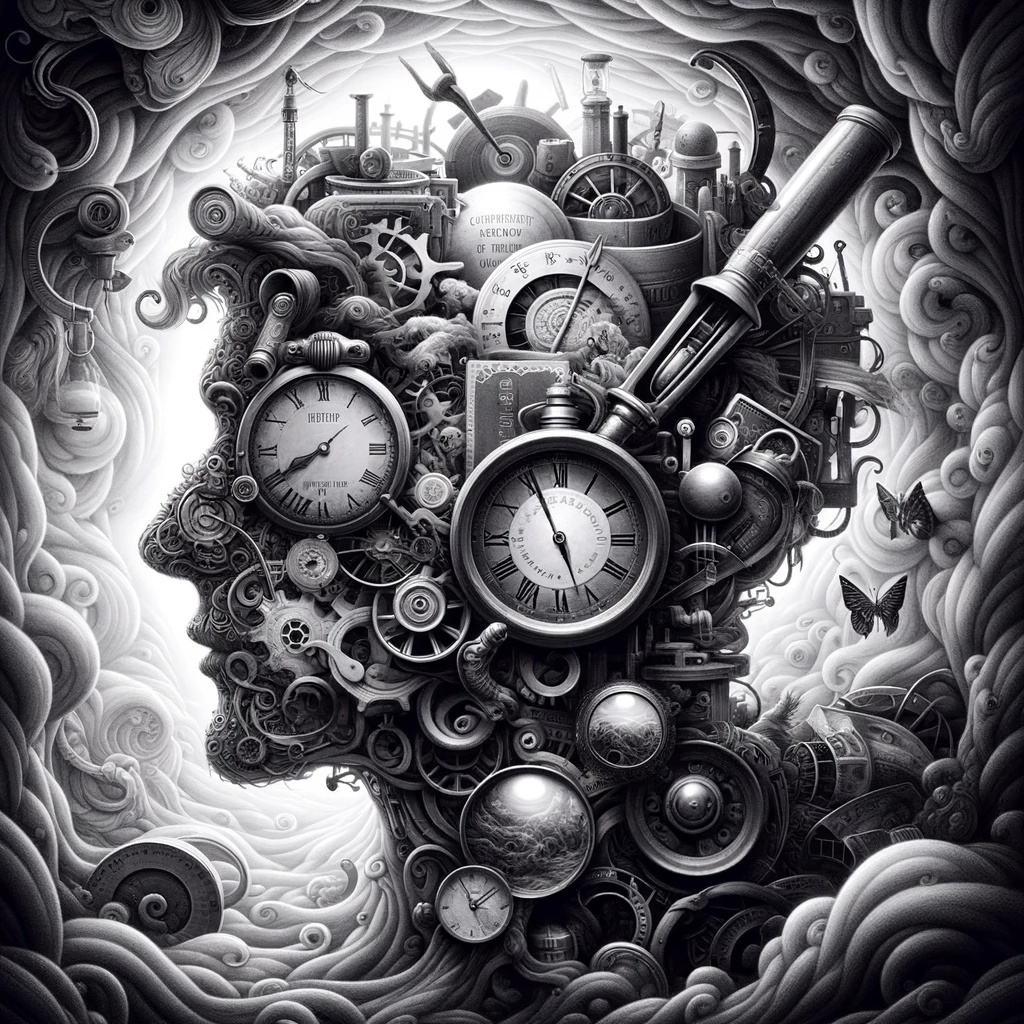
Carnets | janvier 2024
19 janvier 2024
L’idée du voyage dépasse souvent les simples déplacements physiques. Entre les souvenirs flous de lieux visités et les explorations mentales à travers la lecture, notre esprit parcourt plus de territoires qu’aucun corps ne pourrait atteindre. Ce texte explore les notions de vitesse, de pensée et de l’influence des récits qui, réels ou inventés, dessinent nos horizons intérieurs.|couper{180}

Carnets | janvier 2024
18 janvier 2024
Il y a plusieurs façons de prendre les choses, et mon quotidien est un équilibre fragile entre le détachement et l’humour discret. Entre les dédoublements d’assoupissement et les dialogues improbables avec une intelligence artificielle, je m’interroge sur le sens de ces moments suspendus. Entre nostalgie et légèreté, je me perds dans des rêveries d’exploration, cherchant toujours quelque chose d’extraordinaire qui viendrait bouleverser l’ordinaire|couper{180}