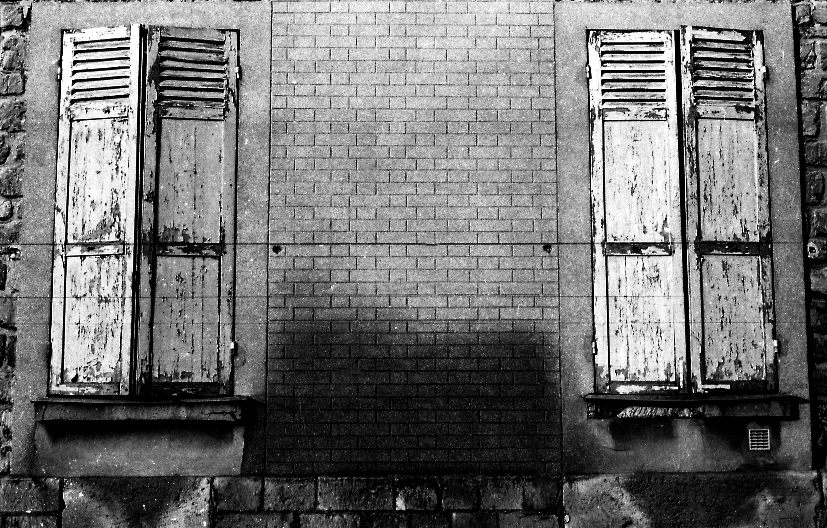19 février 2024
Lu lentement, attentivement cette lettre reçue à intervalles réguliers (hebdomadaire ? mensuelle ?) et je me suis demandé si elle était vraiment hebdomadaire ou mensuelle, quand bien même possible que ce ne soit pas d’une périodicité si classique. Peu à peu, d’une interrogation à l’autre, je me suis rendu compte d’une lacune, d’un oubli, d’une inattention. Peut-être que cette lettre, je ne la lisais pas toujours attentivement, peut-être la survolais-je, en diagonale, et pourquoi pas, peut-être ne la lisais-je pas du tout. Peut-être s’empilait-elle avec l’ensemble monumental de toutes les pièces jointes jamais ouvertes, enfouies dans les profondeurs d’un disque dur d’un de ces Téra gigaoctets, baptisé Data, ou encore disque des données, en accompagnement de celui nommé encore, sans doute de façon désuète : Système.
Il y a de cela quelques semaines, à l’occasion d’un court échange de mails, l’idée de la lettre avait déjà été évoquée. Une lettre d’information, une newsletter. Sorte de passerelle entre les autres et soi, aidant à résumer, grâce à la possibilité de liens bleus hypertextes, une avancée dans l’écriture, la découverte d’auteurs, un blog, une lecture, une série d’événements traversés au quotidien. Le résumé d’une activité qui, pour certains, est trépidante, ce qui est loin d’être le cas de la mienne. D’où le doute sur l’utilité de rédiger une telle lettre. Et puis, j’ai botté en touche, j’ai oublié. Comme toujours, pris dans le jeu sournois des comparaisons, je me suis senti navré de me demander ce que je pourrais bien y mettre. La première chose qui me vient à l’esprit : il n’y aurait pas grand-chose à mettre.
Enfin, rien qui puisse intéresser qui que ce soit, à part moi. Par volonté de discrétion, excès de modestie, timidité (pourquoi irais-je importuner les gens avec une newsletter ?), l’idée a été mise de côté, sous une pile d’autres, dans un recoin de ma cervelle. J’ai continué à progresser au jour le jour, sans trop m’interroger, sauf à la réception d’une nouvelle lettre accompagnant un nouveau mail.
Mais n’est-ce pas un peu ce que je fais chaque matin ? J’écris des lettres, je les publie, elles n’intéressent probablement personne d’autre que moi. Et d’ailleurs, est-ce que je m’y intéresse vraiment ? C’est une sorte de livraison quotidienne, comme on livre une bouteille de lait ou un journal, quelque chose dont j’ai l’impression de me débarrasser. Un job alimentaire, parfois. L’obligation est proche d’être semblable. Pour me sentir plus léger, pour ne rien faire ensuite, ne rien dire, paresser, débarrassé de tout scrupule, savourant cet anonymat, autant que des millions de personnes, j’imagine. J’avais écrit il y a plus d’un demi-siècle que le seul refuge tangible à venir serait cet anonymat. Où en suis-je de cette hypothèse ? De ce point de vue, c’est une assez belle réussite.
Une lettre d’information ne vaut que si l’on se sent impliqué dans une communauté, et j’ai toujours du mal avec cette idée. En fait, je n’accepte pas de croire à la notion de communauté. Peut-être parce que je l’ai espérée autrefois — ou peut-être ai-je seulement inventé cette espérance. Le fait est que l’idée de communauté me désespère par mon incapacité à y appartenir plus de quelques jours, quelques minutes. Une fatigue inouïe a remplacé l’ancienne véhémence. Une torpeur insupportable, jugée inutile, contre laquelle je ne réagis que par instinct, vivement, comme un animal. En fuyant, en me cachant loin de toute communauté. Bien sûr, je sais donner le change pour mes cours, mes stages, et mon urbanité n’est même pas feinte. Si c’est en journée, ça va, mais l’idée d’en faire plus ne me vient pas. Je me complais dans la solitude, ce qui est probablement une autre belle réussite quand je me souviens d’où je suis parti. Les gens qui ne peuvent être seuls sont souvent ennuyeux. C’est le souvenir qui m’en reste.
Essai de texte pour atelier d’écriture. Lecture d’Annie Ernaux, trouvé le même ouvrage en téléchargement. Quelque chose m’attire autant que me gêne ; un aspect clinique, peut-être. Une froideur dans la description, une touche de mépris. En même temps, cela réactive de nombreux souvenirs. Ce premier travail en supermarché, au Grisot de l’Isle Adam. Au rayon lessive, la première année. Lycéen à l’époque, je ne prenais pas ce travail au sérieux, j’observais beaucoup. Et puis cette femme, encore assez jolie, tour à tour caissière et manutentionnaire, une amie de ma mère. Elle voulait être chanteuse. Elle venait boire le café et nous chantait du Michel Sardou avec des larmes aux yeux. On buvait du vin blanc, elle apportait des petits gâteaux. Elle avait une très grande bouche. Elle fumait des blondes qu’elle laissait se consumer presque entièrement dans le cendrier en cristal sur la table basse. Sur le rebord de la tasse et sur le filtre, il y avait des traces de rouge à lèvres. C’était un peu écœurant. Elle avait de vilaines mains.
Façons d’aborder la nourriture.
M., par la façon dont elle sert les convives — ce mouvement qu’elle effectue depuis la casserole vers l’assiette — provoque en moi une réaction épidermique. Comme un rejet. Car c’est avec ce que l’on peut interpréter comme du mépris qu’elle laisse choir de la louche la soupe dans un bol. C’est ce geste, qu’elle affiche ostensiblement, qui trahit son amertume, sa lassitude de femme déçue. Il y a tout ça dans la louche qui va à l’assiette creuse au bol en attente, immobiles sur la table. À l’autre bout de la table, P. place un pouce sur la molette d’un briquet jetable puis par un tic nerveux fait crisser la molette. Une étincelle jaillit, puis s’éteint. Il recommence. La façon de A. de présenter une pomme à L. me la rend soudain bien chaleureuse. Façon bonne pâte. Elle place sa paume sous le fruit, on voit l’axe traverser la Golden comme un rayon de lumière. Tremblotement de pépins. On sait que la chair sera farineuse mais pas trop, un peu sucrée. B. tient sa fourchette comme un maçon sa truelle, elle mange en silence, mastique chaque bouchée, regarde à gauche, à droite, discrètement avant d’avaler, de petites quantités. On perçoit le transit des aliments dans sa gorge, son cou est maigre et plat entre les clavicules. H. porte la nourriture à la bouche comme un paysan au bout d’une fourche. Il incline le buste pour rapprocher la tête de la table, ce qui lui permet d’avaler en trois cuillerées à pot la ration de ragoût que lui sert maman. Puis il prend la serviette, tapote un coin de tissu à la commissure des lèvres, laisse retomber la serviette. Rouge et blanc, Vichy. On peut l’imaginer à table avec les Allemands. C. tend le bras, attrape le plat, se sert, plante la fourchette dans le rôti. Une, deux, trois tranches, sanguinolentes. Puis il laisse à regret la fourchette dans le plat et passe à la cuillère pour se servir du gratin.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | Février 2024
28 février 2024
L’auteur oscille entre les réminiscences de son enfance et ses réflexions sur l’écriture contemporaine. La mémoire, teintée d’une lumière froide, sert de point d’ancrage à des pensées plus vastes sur le rôle du vide dans l’art et la vie. Des souvenirs d’un paquebot rouge dans une salle de bain d’enfance à la découverte de textes oubliés, chaque fragment dévoile un rapport complexe au passé et à l’acte d’écrire.|couper{180}

Carnets | Février 2024
27 février 2024
Qu’est-ce qui a changé en nous pour que ce qui nous semblait extraordinaire hier nous paraisse aujourd’hui si banal ? Un désenchantement progressif, entretenu par des images de plus en plus consommables, semble avoir effacé notre capacité d’émerveillement. Mais ce désir de rêve et d’imagination, lui, reste intact, attendant de retrouver un chemin vers des merveilles oubliées.|couper{180}

Carnets | Février 2024
25 février 2024
De ses débuts en tant qu’élève à son exil forcé en passant par sa relation tumultueuse avec Héloïse, suivez le parcours fascinant d’Abélard, une figure complexe, intellectuelle et profondément humaine|couper{180}