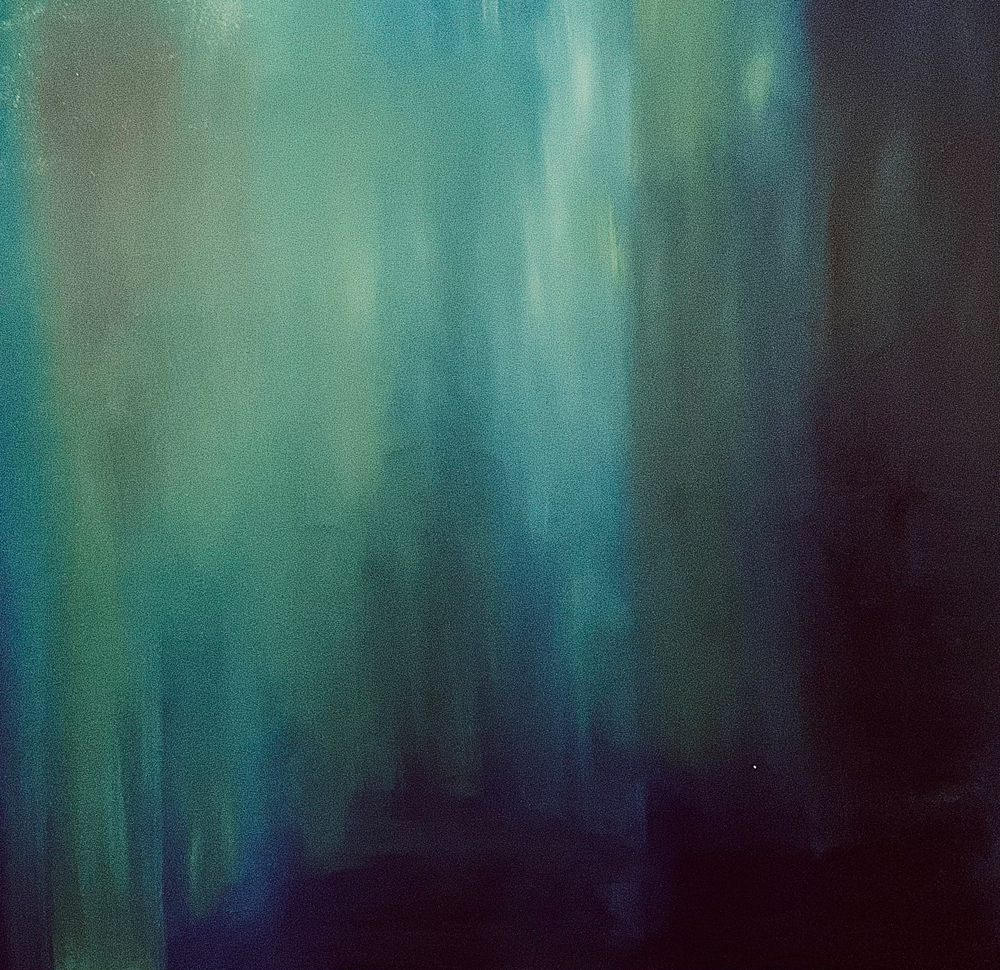19 octobre 2023
L’accord du participe passé employé comme épithète s’accorde en genre et en nombre avec le mot qu’il qualifie. (1906, Grevisse)
Et pourtant...
Ils savaient jouer des coudes jusqu’à l’os. D’où sans doute leur physionomie de manchots.
Assoiffés congénitaux, ils burent sans jamais étancher leur soif.
Ils s’époumonèrent, baroques, grotesques, déformés —
Daumier les aurait croqués avec plus de charité qu’ils n’en avaient eux-mêmes.
Ils avaient vu tant de pays, appris la prudence, la circonspection.
Mais pas la justice.
Les murs étaient délabrés, les tapisseries déchirées, les parquets explosés —
ils y vivaient quand même, presque heureux d’avoir échappé au pire.
Ce qui participe d’un passé, le participe passé —
il est passé où, celui qui participe, en principe ?
Le complément de l’objet —
comme si l’objet seul ne suffisait pas.
Ils se complimentèrent de l’absence de complément,
jusqu’à ce que surgisse l’objet nu.
Parvenir à la phrase simple.
Jon Fosse : mots simples, phrases simples.
Chez lui, la forme passive comme refuge :
les sentiments nous traversent,
nous ne les possédons pas.
Simplicité de l’installation,
espace laissé au lecteur.
Liberté de l’imaginaire.
Il a vécu une vie d’écrivain,
parallèle à l’autre.
Créer. Mentir au besoin.
Un réflexe.
À la marge.
Et dans la marge,
le rouge l’emporte.
On écrit à l’encre violette
et l’on se retrouve marqué de rouge.
Le violet violé par le rouge.
Lecture de prologues sur le blog de F.B.
L’enfance revient sous forme de main lâchée.
Sécurité affective rompue.
Odeur de sous-bois, ennui tressé de peur.
L’ennui d’enfance :
étroitesse et immensité.
On y est piégé sans raison.
On en cherche une.
Naissance de l’imagination.
J’ai pris du retard sur les textes.
Et j’en suis content.
Une résistance neuve, peut-être.
sous-conversation
Il y en a trop.
Des blocs. Des mots. Des notes.
Un désordre peut-être. Ou un ordre qu’on ne voit pas.
La grammaire — oui, ça rassure,
mais ça pique aussi.
Le participe qui ne participe à rien, sauf à la confusion.
Et Fosse —
lui, il a compris.
Ne pas tout dire.
Juste être traversé.
Mais ici, ça bourdonne.
Ça revient. Ça se chevauche.
Rouge. Violet.
Tu veux écrire bien.
Mais toujours cette marque,
dans la marge.
La tienne ?
Et puis cette phrase…
retard sur les textes.
Mais tu souris.
Il y a quelque chose qui revient.
Un souffle ? Une permission ?
note de travail
Ce fragment est un feuilleté de strates.
Grammaire, politique, esthétique, enfance, solitude, lecture.
Une pensée en mosaïque — non pas éparpillée, mais atomisée. Chaque bloc est un miroir.
Le sujet semble chercher une sortie. Une issue vers la simplicité.
La simplicité des phrases.
La simplicité de vivre.
Mais l’écriture est là, compulsive, diffractée. Elle ressasse, elle digresse, elle revient.
Le monde est là : grotesque, injuste, saturé.
Et dans la marge, en rouge, la trace du jugement.
Il y a un aveu discret ici : la violence scolaire intériorisée, l’injonction de bien faire, la douleur du “trop”.
Mais aussi une revanche discrète : dans l’ennui, naît l’imaginaire.
Dans le retard, une joie : “une résistance neuve”.
Ce texte ne cherche pas à plaire. Il respire une fatigue créative, un trop-plein presque libérateur.
Il ne cherche plus la perfection grammaticale.
Il cherche l’échappée.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | octobre 2023
23 octobre 2023
Terrassé. Submergé. Toute cette paperasse, et en prime, une fièvre carabinée. À chaque vacance c’est la même : on se relâche, et paf. La nuit, j’ai fait des comptes en rêve. Des additions, des chiffres qui ne ferment pas l’œil. Ce matin, 39,7. Je tiens à peine debout. Grippe ? Covid ? Pas la force d’aller à la pharmacie. Écrire deux ou trois lignes. Ce sera tout pour aujourd’hui. sous-conversation On voulait juste souffler. Mais ça n’a pas soufflé. Ça a pris. Fièvre, chiffres, vertige. La nuit refait les comptes. Les chiffres courent. Ils crient presque. Le front cogne. On reste là. Couché. Muet. Une seule chose encore possible : deux lignes. Peut-être trois. Le monde entier tient dans ces trois lignes. note de travail Un effondrement somatique. Une saturation. Ce corps qui dit stop. Ce corps qui exige qu’on l’écoute, et pas les formulaires. Il me parle d’une fièvre. Je l’entends comme une révolte. 39,7°C, c’est une protestation chiffrée. Presque une poétique de la température. Le rêve de la nuit est bureaucratique. Il additionne en dormant. Le symptôme est clair : la réalité administrative déborde jusque dans l’inconscient. L’imaginaire colonisé par les comptes. Kafka, dans un lit IKEA. Il m’écrit deux lignes. Ce sont des lignes de vie. Il aurait pu ne pas écrire du tout. Il aurait pu céder. Mais non. Il a écrit. C’est cela que je note : le corps chute, l’écriture reste debout.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
12 octobre 2023
Trajet sans radio. Sans podcast. La route à blanc. Tête vide. Se demander ce qu’on fiche là. Ouvrir la vitre : souffle d’été, goût de feu, persistance des embrasements. Tout continue, comme si de rien n’était. Des jeunes foncent, le A collé au cul. Des camions bariolés, prénoms en néon. Crainte d’un contrôle. Le bouchon avant le rond-point, incompréhensible. Puis soudain, ça roule. 15h à Oullins. Faut refaire le plein. Décidé de rester calme. Le banquier sera peut-être moite. Ne pas faire un geste. Fixer un point. Ses mains. Sa bouche. Que ça pèse. Rester digne. Les impôts : message non lu. Nouvelle lettre, plus sèche. Payez. Coup dans l’abdomen. Urssaf, Trésor Public, la banque. Gauche, droite, crochet. Pas d’arbitre. Juste ce mot d’ordre : qu’on tombe. Quitter le salariat ? Mal vu. On vous cogne. On vous charge. L’écho des conseils : « Prof libérale, tu peux tout déduire. » Oui. Si t’es carré. Si t’aimes la paperasse. Mais toi, t’es le tapin du boulevard. On parle pas du viol. Ni des coups. Ni des quinze tonnes dans la gueule. Ni des insomnies. On dit : t’as de la chance, t’es à ton compte. Merde. Et en même temps, soulagement. Plus rien. Et ça suffit. Prêt à replonger. Dans les ateliers, le don doublé. L’évasion. Le temps passe trop vite. Il fait nuit quand tu sors. Les carrosseries brillent. Une élève a oublié son sac. Son portable dedans. Tu le déposes à l’accueil, tu envoies un mail. Tu l’imagines : chez elle, découvrant l’oubli. Une angoisse de plus. L’inattention, c’est une fuite, bien sûr. Palette d’Anders Zorn. Pas de bleu. Ras la casquette des bleus, des ecchymoses. Place aux terres. À la chair. sous-conversation … sans bruit… sans rien… juste rouler… faire comme si… pas penser… surtout pas penser… ça continue… toujours… le feu dans l’air… et eux qui foncent… qui klaxonnent leur jeunesse… le banquier… les lettres… toujours cette menace sourde… pas de réponse… pas de regard… juste "payez"… tu tiens… tu tiens… mais tu sais que tu vas tomber… et pourtant… tu tiens… un peu… grâce aux autres… à ceux qui viennent… aux élèves… aux visages… aux absences aussi… le sac… oublié… l’angoisse… tu la sens, oui… c’est toi aussi… et la palette… pas de bleu… trop vu… trop subi… tu veux de la terre… du sang discret… du vrai… pas les bleus de la guerre… pas ceux-là… note de travail Le texte commence comme un retrait du monde : plus de radio, plus de son. Mais ce silence n’est pas apaisant. Il est celui de la tension avant le combat. Puis vient le déchaînement — administratif, institutionnel, symbolique. Les lettres non lues, les injonctions, les coups. Ce qui frappe ici, c’est la violence invisible : celle qu’on ne reconnaît pas comme telle. Celle qui ne laisse pas de traces, mais désarticule le sujet. Il y a une rage immense, étouffée sous la dignité. La dignité devient ici une stratégie de survie. Fixer un point. Ne pas céder. Ne pas donner prise. Ne pas hurler. Mais la fissure est là. Dans ce "merde" seul, en italique d’âme. Dans ce basculement qui suit : la réhabilitation par le geste, par l’atelier, par la transmission. Le soulagement tient à peu. À la lumière sur les carrosseries. À une élève qui oublie son sac. C’est cela la beauté du texte : il ne cherche pas à dire qu’on va s’en sortir. Il montre comment on continue. Malgré tout. Même avec l’angoisse. Même avec l’inattention. Et la dernière phrase est sublime. Refus du bleu. Refus des hématomes. Refus du drapeau. Juste les couleurs du corps. De la terre. De ce qui tient encore, quand tout le reste s’effondre.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
11 octobre 2023
Tout concorde. Tout coïncide. À tel point qu’on aurait tort de parler de coïncidence comme d’un hasard étrange. Trop de coïncidences forment une évidence. Mais une évidence, qu’est-ce que c’est, sinon une rustine, elle aussi ? Un petit trou dans le pneu par où s’échappe la raison. Et la raison ? Déjà une rustine. Posée sur une autre fuite. De fuite en fuite, on ramasse des mots. Quand ça semble coïncider, on dit : voilà, c’est ça. On s’en contente. L’essentiel, c’est de contenter l’opinion. De maintenir le statu quoi. Quo vadis, mon gars ? Et malgré tout ça, bizarrement, je vais acheter mon pain. Quelle étrange coïncidence de te croiser. Toi aussi, en train de chercher ta petite monnaie. Comme moi. sous-conversation … coïncidence ?… non… trop… trop bien aligné… trop juste… ça sent la ficelle… ou le leurre… l’évidence… ah… ce mot… encore… comme une rustine… oui… une rustine sur la rustine… et dessous ?… rien… peut-être… des mots… des petits mots… qu’on ramasse comme des miettes… et on fait semblant… on dit que ça suffit… contenter… maintenir… faire tenir… même si ça fuit… surtout si ça fuit… statu quoi… quo vadis… jeu de mots… vieille blague… mais ça sonne vrai, trop vrai… ça claque… et puis… l’image… le pain… la monnaie… toi là… moi là… ridicule et bouleversant à la fois… juste ce moment… cette collision… presque rien… presque tout… note de travail Le texte s’ouvre sur une apparente certitude : tout coïncide. Mais très vite, cette certitude s’effrite. L’auteur expose, sans insister, que toute évidence n’est qu’un cache-misère. Une rustine. Ce mot revient, obsessionnel. Il dit l’inconfort, la fuite, le colmatage. L’impossible solidité de la pensée. Ce que je perçois ici, ce n’est pas un doute, c’est une **conscience du bricolage intérieur**. Une lucidité presque trop vive. Trop blessée. Le langage est suspect, le sens est suspect, la logique elle-même n’est qu’un habillage. L’auteur le sait. Il en joue, doucement. Et pourtant. Il continue à vivre. À aller acheter son pain. Le moment final me bouleverse. Il y a quelqu’un d’autre. Un tu. Un être croisé par hasard — ou plutôt dans une **anti-coïncidence** qui redonne chair à l’évidence. Il ne s’agit plus de raison, de vérité, d’opinion. Il s’agit de reconnaître un autre dans un geste banal. Et ce geste devient le **lieu exact de la faille et de la consolation**. Comme une rustine posée avec tendresse. Peut-être est-ce cela, le soin de soi : ne pas chercher le vrai, mais accepter les coïncidences qu’on fabrique.|couper{180}