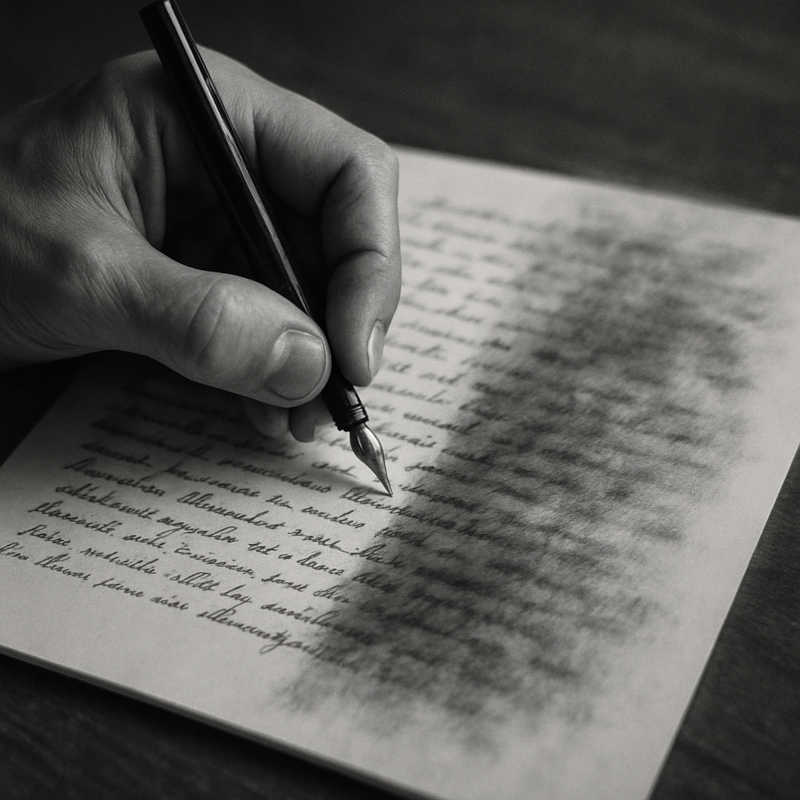L’autofiction
L’autofiction, ainsi qu’on la désigne depuis que Serge Doubrovsky a forgé ce terme en 1977 pour qualifier son propre texte, "Fils", n’est ni une autobiographie, ni une fiction pure. C’est un territoire incertain, bâti sur l’instabilité même des souvenirs et des impressions, un lieu où le langage se risque à des vérités qui n’en sont pas tout à fait. "Autobiographie ? Non. Fiction d’événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage", écrivait Doubrovsky. Ce geste littéraire, qui intrigue et inquiète, c’est la tentative de faire résonner le moi à travers les matériaux bruts de l’existence.
Il y a dans l’autofiction cette volonté de tenir ensemble le moi vécu et le moi rêvé, de les faire cohabiter dans un même geste d’écriture. Contrairement à l’autobiographie, qui prétend à la fidélité du récit, l’autofiction accepte l’ambiguïté, voire la contradiction. C’est une mise en crise du moi narratif, qui se cherche, tâtonne, ose exagérer pour atteindre une intensité d’être que la simple restitution factuelle ne peut offrir. Ainsi font Annie Ernaux, Christine Angot, ou encore Emmanuel Carrère, qui transforment le réel en un matériau malléable, modelé par l’intensité du vécu.
L’autobiographie et la biographie se parent des atours d’une objectivité que l’autofiction, avec une honnêteté crue, dément. Toute écriture de soi est déjà une reconstruction, une mémoire reconfigurée, un passé ressaisi par les mots. L’historien Michel Pastoureau le sait bien : il admet volontiers que l’objectivité historique est une illusion, que la subjectivité imprègne inévitablement tout récit du passé. De même, les prétendues autobiographies et biographies, loin d’être des récits neutres, sont autant d’interprétations où le vécu se tord sous la pression du langage.
Dans l’autofiction, le narrateur se dédouble, il s’examine et s’interroge, prêt à assumer des excès pour cerner au plus près ce qui le traverse. La culpabilité, l’obsession de la reconnaissance, la pureté du geste d’écrire se heurtent à la nécessité d’un retour, d’un écho. Ce moi littéraire est un espace de conflit, une recherche inquiète qui n’aboutit jamais tout à fait mais creuse le réel à coups d’images et de métaphores. Si j’écris pour ne rien attendre, pourquoi guetter alors l’empreinte de mes mots sur les autres ? Cette contradiction-là, qui rend le geste impur, n’est-elle pas au fond le signe même de notre condition humaine ?
L’autofiction, loin d’être une déviance du réel, en est l’extension, sa résonance prolongée. Elle accepte la contamination du souvenir par l’imaginaire, du factuel par l’intime. Elle prend acte de l’impossibilité de saisir un moi pur, intact, et tente plutôt d’en traduire les échos. L’autofiction accepte la torsion comme mode d’expression : ce qui compte, ce n’est pas tant l’exactitude que la vibration sincère, la tentative de rendre compte de ce qui, en soi, résiste à la clarté.
Parce que c’est sans doute la seule manière de témoigner sans trahir. Parce que prétendre à la pureté serait mentir. L’autofiction assume cette impureté foncière de l’écriture, ce mélange de réel et de projection, cette superposition d’un vécu et d’une rêverie. C’est une manière de sauver ce qui reste d’authenticité quand on sait que toute restitution est, déjà, une perte.
L’autofiction n’est pas une affirmation, mais une question. Elle est la possibilité de tenir ensemble la mémoire, la fiction et le doute, de faire entendre, à travers la matière incertaine des mots, ce qui vibre encore quand tout semble voué à l’effacement. Plus honnête que l’autobiographie, elle revendique la fêlure, l’inachèvement, l’impossible pureté de l’écriture de soi.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Lectures
Le Monde Ultime et Absolument Réconfortant
Il fait gris dehors ? Rien de plus réconfortant que notre nouvelle bougie réconfortante au parfum réconfortant de chocolat réconfortant ! Allumez-la pour créer instantanément une ambiance réconfortante dans votre intérieur réconfortant redécoré avec nos coussins réconfortants. Pour compléter ce moment réconfortant, préparez notre recette réconfortante de soupe réconfortante (disponible en kit réconfortant prêt-à-réchauffer). Son goût réconfortant vous apportera un réconfort réconfortant lors de cette soirée réconfortante. Enfilez ensuite votre pyjama réconfortant en tissu réconfortant et installez-vous dans votre canapé réconfortant pour regarder notre série réconfortante spécialement conçue pour être réconfortante, avec des personnages réconfortants et une fin réconfortante. Mais attention ! Votre ancienne vie n’était que semi-réconfortante. Pour atteindre le Niveau Réconfort Ultime™, il vous faut : Notre formation réconfortante en développement personnel réconfortant Nos chaussons réconfortants à mémoire de forme réconfortante Notre abonnement réconfortant à la box mensuelle réconfortante Notre application réconfortante qui vous envoie des notifications réconfortantes Témoignage réconfortant de Jean-Kevin, 34 ans : “Avant, je croyais connaître le réconfort. Mais depuis que j’ai adopté le Mode de Vie Réconfortant™, mon réconfort est tellement plus réconfortant ! Mon thé est réconfortant, mes chaussettes sont réconfortantes, même ma facture d’électricité me semble plus réconfortante !” Ne vous contentez plus d’un réconfort ordinaire. Passez au Réconfort 3.0™. Parce que vous méritez un réconfort qui réconforte votre besoin de réconfort avec une efficacité réconfortante. Le Réconfort n’attend pas. Commandez maintenant et recevez gratuitement notre e-book “Les 50 Nuances de Réconfort” pour rendre chaque aspect de votre vie absolument, totalement, irrémédiablement ultra réconfortant !|couper{180}

Lectures
Comment la comtesse de Ségur m’a pourri la vie
Il m’a fallu longtemps pour comprendre ce que certaines lectures d’enfance avaient fait de moi. Longtemps pour admettre qu’un livre peut agir à retardement, non pas comme un souvenir attendri, mais comme une disposition durable face au monde. Parmi ces lectures, il y a les livres de la Comtesse de Ségur, et en particulier Un bon petit diable. Je les ai lus avec plaisir, avec une forme de jubilation tranquille, sans imaginer qu’ils déposaient en moi quelque chose qui ne se refermerait pas. Ce que j’y ai trouvé, je le formulerais aujourd’hui ainsi : une connivence silencieuse contre le monde des adultes. Non pas une révolte ouverte, ni une haine déclarée, mais une intelligence partagée de leur bêtise, de leur rigidité, de leur suffisance. Les adultes y parlent beaucoup, punissent souvent, moralisent à tout va. Et pourtant, on sent bien que l’autrice ne se tient pas vraiment de leur côté. Elle regarde avec l’enfant, pas au-dessus de lui. Elle ne protège pas. Elle n’explique pas. Elle constate. Cette position est redoutable. Elle n’apprend pas à devenir sage. Elle apprend à devenir lucide. Et la lucidité, lorsqu’elle arrive trop tôt, n’est pas toujours un cadeau facile à porter. Elle oblige à composer. À faire semblant parfois. À parler une langue que l’on comprend très bien, mais que l’on n’habite jamais complètement. À accepter que beaucoup de discours adultes soient moins des paroles que des dispositifs. Je crois que c’est là que la comtesse de Ségur m’a, au sens propre, pourri la vie. Elle m’a rendu incapable d’adhérer franchement. Incapable de croire à la maturité comme valeur suprême. Incapable aussi de mépriser complètement. Elle m’a appris l’hypocrisie non comme vice, mais comme stratégie. Non pas mentir, mais masquer. Non pas contester, mais attendre. Regarder. Tenir. L’institution scolaire, elle, n’y a vu que des livres pour enfants. Une morale apparente. Des punitions, des récompenses, un ordre rétabli. Elle s’est peut-être laissée leurrer. Ou elle a fait semblant. Toujours est-il qu’elle a neutralisé ce qu’il y avait de plus dangereux dans ces textes : la confiance accordée à l’intelligence du lecteur enfant, sans filet, sans commentaire, sans discours surplombant. Avec le temps, je me suis aperçu que cette manière de lire avait façonné ma manière d’écrire. Une écriture sans destination claire, sans public désigné, sans volonté d’enseigner. Une écriture qui suppose une complicité préalable, ou rien. Qui fait le pari que le lecteur saura voir ce qu’il y a à voir, ou qu’il passera son chemin. Une écriture qui ne cherche pas à convaincre, mais à tenir une position légèrement décalée. On pourrait objecter que tout cela paraît dérisoire aujourd’hui. Les enfants et les adolescents lisent désormais des livres bien plus vastes, plus sombres, plus complexes que ceux de mon enfance. Des sagas entières, peuplées de morts, de guerres, de responsabilités écrasantes. Ils traversent des mondes où l’on affronte le mal, où l’on choisit son camp, où l’on apprend à devenir quelqu’un. Mais il me semble que ces lectures, si puissantes soient-elles, relèvent d’un autre régime. Elles accompagnent un passage. Elles racontent une initiation. Elles promettent, d’une manière ou d’une autre, une appartenance future. Les livres de la comtesse de Ségur, eux, ne promettaient rien. Ils n’ouvraient pas sur un monde plus vaste, mais sur un regard plus étroit, plus précis, plus ironique sur le monde tel qu’il est. Ils n’enseignaient pas à grandir, mais à observer. À composer. À survivre dans un univers adulte déjà là, sans croire entièrement à ce qu’il affirme être. La différence n’est pas une question de maturité du contenu, mais de position dans la langue. Ce que j’y ai appris n’était pas de l’ordre de l’aventure, mais de la défiance. Et cela, quelle que soit l’époque, reste une expérience minoritaire. En ce sens, la comtesse de Ségur ne m’a pas transmis une enfance. Elle m’a transmis une distance. Une politesse ironique face au monde adulte. Et cela ne se perd pas. Cela ne se répare pas non plus. Ce n’est pas une plainte. C’est un constat. Certaines lectures ne vous élèvent pas, elles vous déplacent. Et une fois déplacé, on ne revient pas exactement au point de départ. On vit un peu à côté. On parle la langue commune, mais on n’y habite jamais tout à fait. Si c’est cela avoir été pourri, alors je le dois en grande partie à elle. Et je ne suis pas certain, malgré tout, d’avoir envie de m’en plaindre.|couper{180}

Lectures
Moutarde après dîner
Il y a des réflexions qui vous montent au nez avec un temps de retard. On lit une phrase le matin, on croit l’avoir oubliée à midi, et puis, le soir venu, elle pique encore. J’ai croisé ainsi l’idée — que l’on retrouve parfois chez Paul Valéry ou d'autres esprits jaloux de leur pureté — que l’histoire de nos aïeux serait un territoire interdit à la haute littérature, une sorte de facilité pour esprits en mal d’inspiration. Sur le moment, la sentence m'a fait l'effet d'une porte que l'on ferme. On nous suggère, du haut d'un certain piédestal intellectuel, que se pencher sur ses racines serait un exercice « mineur », une nostalgie de notaire dont l'écrivain véritable devrait s'écarter par principe. Certes, l’homme de métier en ferait ses choux gras. Il y chercherait l'anecdote, le décor, la petite émotion bien ficelée pour remplir ses pages. Mais l’homme de l’art, lui ? Le poète ? Bien sûr que non. Le poète ne se rue sur rien. Il ne cherche pas à exploiter un héritage comme une matière première, il essaie d'habiter un silence. Écrire sur ceux qui nous ont précédés n'est pas une manœuvre, c'est une respiration nécessaire pour celui qui refuse de marcher seul dans le vide. C'est ramasser une pierre que les siècles ont polie pour voir si elle a encore quelque chose à nous dire de notre propre chair. On peut trouver cela démodé, ou sans intérêt pour le présent. On peut s'en détourner, et même s'en désabonner. Mais le murmure des anciens reste plus profond que le bruit des sentences. J’ai refermé l’article, j’ai souri à mon fantôme, et j’ai repris ma plume. Il y a des fidélités qui se passent très bien de l’approbation des vivants.|couper{180}