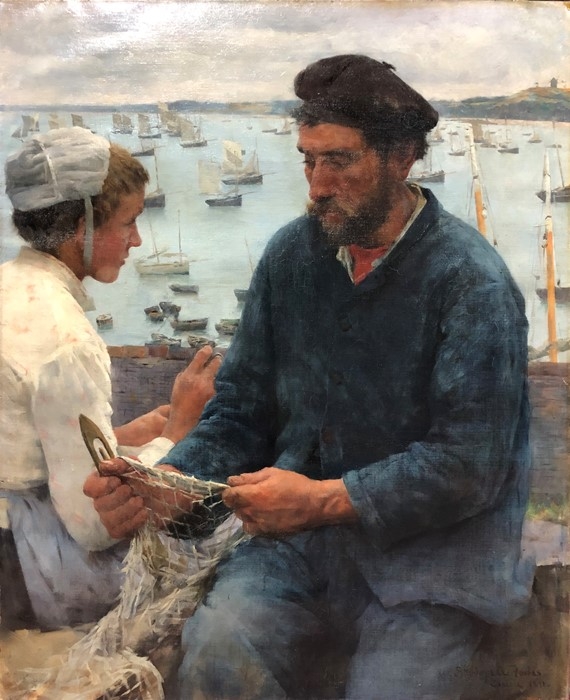03 janvier 2021
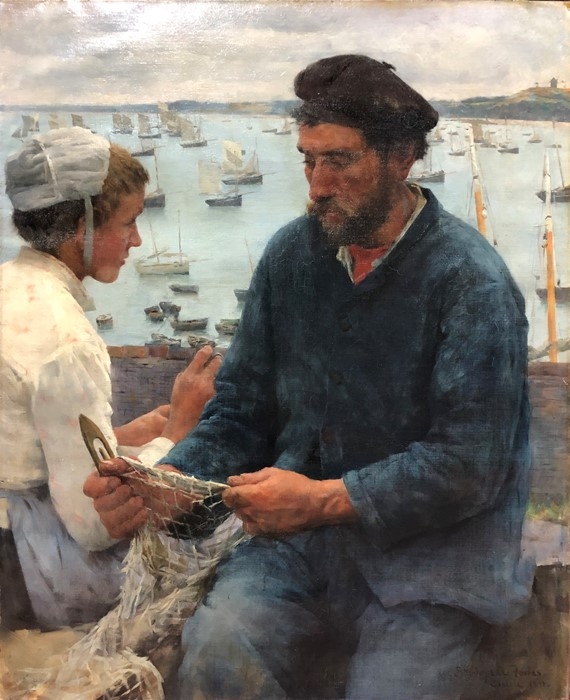
Peut-être que tout tient dans cette idée : rester quelque part, rester en lien.
Se résoudre à devenir une sorte de solide, une cristallisation. Mais au fond, ce n’est pas vraiment une question de choix ou de volonté. Aussi loin que je me souvienne, chaque rencontre avec l’autre m’a toujours inspiré une peur brutale, viscérale. Une peur difficile à définir, mais si vive qu’elle paralysait tout élan naturel. Cette angoisse primaire m’a poussé, sans doute inconsciemment, à me protéger, à dresser des barrières autour de moi. Le cerveau, lui, s’est chargé du reste. Il a créé des schémas de survie, alternant entre des élans d’affection sincère envers certaines personnes proches et des mouvements de rejet tout aussi spontanés. La sincérité, la quête d’authenticité, sont venues plus tard, comme des tentatives d’explication, un moyen de rationaliser ce sentiment profond d’inadaptation. Tout repose sur l’idée qu’on se fait du lien. Je suppose qu’elle peut être envisagée de manière positive ou négative. Chez moi, le négatif l’emporte toujours. Non que j’aie « coupé » consciemment ni systématiquement. Je ne dirais pas cela, car même si les choses se passent mal dans une relation, on peut malgré tout rester en lien.
À de rares exceptions près, les gens font cela. Il y a aussi cette idée de convenance qui dicte de ne pas rester en lien avec certaines personnes — des flirts de jeunesse, des anciens camarades de classe. Face à cette porosité, j’ai toujours rencontré des difficultés. Non pas par esprit de contradiction ou par influence extérieure, mais par un rejet viscéral de ce qui, en moi, aurait pu se figer en quelque chose d’insincère. Je ne supporte pas l’idée de me voir devenir ce que je ne suis pas, de me compromettre avec des attentes sociales ou des convenances qui finiraient par me déformer. Comme si le simple fait de s’y conformer risquait d’abîmer l’être que j’imagine être. Fuir cela, c’est peut-être fuir une fatalité sociale, la compromission qui semble inévitable. Mais en cherchant à rester sincère, une question persiste : qui suis-je vraiment pour en décider ? Quelle légitimité ai-je à décréter ce qui est juste ou ce qui ne l’est pas, même en moi ? Peut-être que cette quête d’authenticité, au fond, n’est qu’une autre illusion, une façade derrière laquelle je me cache. Une façon de fuir, sous prétexte de sincérité, ce que la vie pourrait exiger de moi. Si je n’entretiens pas de liens avec les personnes que j’ai rencontrées dans ma vie, elles n’en ont pourtant jamais totalement disparues. Elles se situent dans ma mémoire et je peux revenir vers les moments passés ensemble autant que je le désire pour les examiner. Peut-être pour comprendre aussi pourquoi nous ne nous voyons plus. Pourquoi nous nous sommes perdus de vue. Ce n’est jamais de la faute à quelqu’un en particulier. C’est la vie qui veut ça, je crois. Et puis sur l’idée que l’on se fait de soi-même aussi. Pour certaines personnes, rester en lien avec les autres c’est aussi rester en lien avec soi-même par un jeu de miroirs utiles. Comme je n’ai jamais eu d’idée de moi-même suffisamment solide et durable, rester en lien n’a peut-être jamais eu d’importance. J’ai vécu de cercles de connaissances en cercles de connaissances, abandonnant ces cercles à chaque fois que j’en pénétrais un nouveau, sans vraiment me poser de question. Cela demande des efforts d’entretenir les relations, d’autant plus si on ne trouve pas de sens à les conserver.
Ce qui m’a toujours effrayé, c’est la cristallisation d’un être dans un rôle déterminé, choisi, « devenir quelqu’un » en toute conscience et s’y accrocher. Je me suis dissimulé cette peur derrière la stupidité que j’attribuais à toutes ces personnes prisonnières de la constance, sans voir que j’étais tout aussi attaché à la constance de ne pas en avoir du tout. Cette ironie masquait un malheur profond, un renoncement définitif très tôt à ce que l’on appelle « la chaleur humaine ».
C’est Roger, le peintre en lettres de l’imprimerie où je travaille, qui a mis le doigt sur le problème. J’ai ri doucement lorsqu’il m’a dit ça pour ne pas montrer qu’il m’avait mis KO. Avec lui non plus je ne suis pas resté en lien, pourtant on s’appréciait vraiment bien. Ça ne m’empêche pas de penser souvent à lui, comme à toutes ces personnes perdues en chemin. J’entretiens une conversation ininterrompue avec chacune d’entre elles, chacun d’entre eux. Avec leurs fantômes comme avec le mien, c’est-à-dire l’homme que j’ai pu être à un moment donné d’une ligne de temps. J’ai essayé parfois d’entretenir les relations, mais d’une façon tellement maladroite, tellement peu convaincante… Mon manque de chaleur humaine va dans les deux sens : je ne peux ni en obtenir ni en donner vraiment. C’est la même chose avec les objectifs que j’ai pu me fixer dans la vie. Le risque d’acquérir une véritable solidité, une existence « réelle » aux yeux des autres, c’est-à-dire quelqu’un sur lequel on peut « compter ». Les objectifs que je me fixe ne peuvent pas plus compter sur moi que je ne peux compter sur eux pour devenir « quelqu’un » que je ne suis pas. Pour être ce que je suis et me tenir à cela, j’ai envoyé valdinguer tout ce à quoi un être humain s’accroche généralement. Le seul objectif que j’ai toujours suivi finalement, c’est de ne pas être en lien, ni avec les gens ni avec les objectifs trop longtemps, pour pouvoir comprendre combien le temps est un mensonge, une illusion. Et peut-être, finalement, que cette obsession est liée à la mort. Ne pas rester en lien pour échapper à la nouvelle de la mort des gens, comme à la mienne inéluctable au bout du compte.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | janvier
28 janvier 2021
Perdre un être cher bouleverse la perception de la réalité. Entre le déni, la colère et l’épuisement, le narrateur décrit une lente dérive vers l’acceptation, rythmée par les gestes répétitifs d’un quotidien qui devient à la fois absurde et apaisant.|couper{180}

Carnets | janvier
25 janvier 2021
Et si l’originalité n’était rien d’autre qu’un retour au familier, redécouvert par inadvertance ? À travers la métaphore de l’épluchure, le narrateur explore les illusions de la nouveauté et la simplicité comme source d’authenticité.|couper{180}

Carnets | janvier
16 janvier 2021
Le narrateur semble être une personne introspective, qui privilégie l’instinct à la réflexion excessive. Il se détache des conventions et des obligations, cherchant à se laisser guider par les sensations et les expériences immédiates. Il paraît à la fois lucide sur son incapacité à échapper aux incertitudes et à l’introspection, mais résolu à vivre intensément malgré tout. Son attitude vis-à-vis du « tu » suggère une recherche d’une connexion authentique avec autrui, sans pression ni jugement.|couper{180}