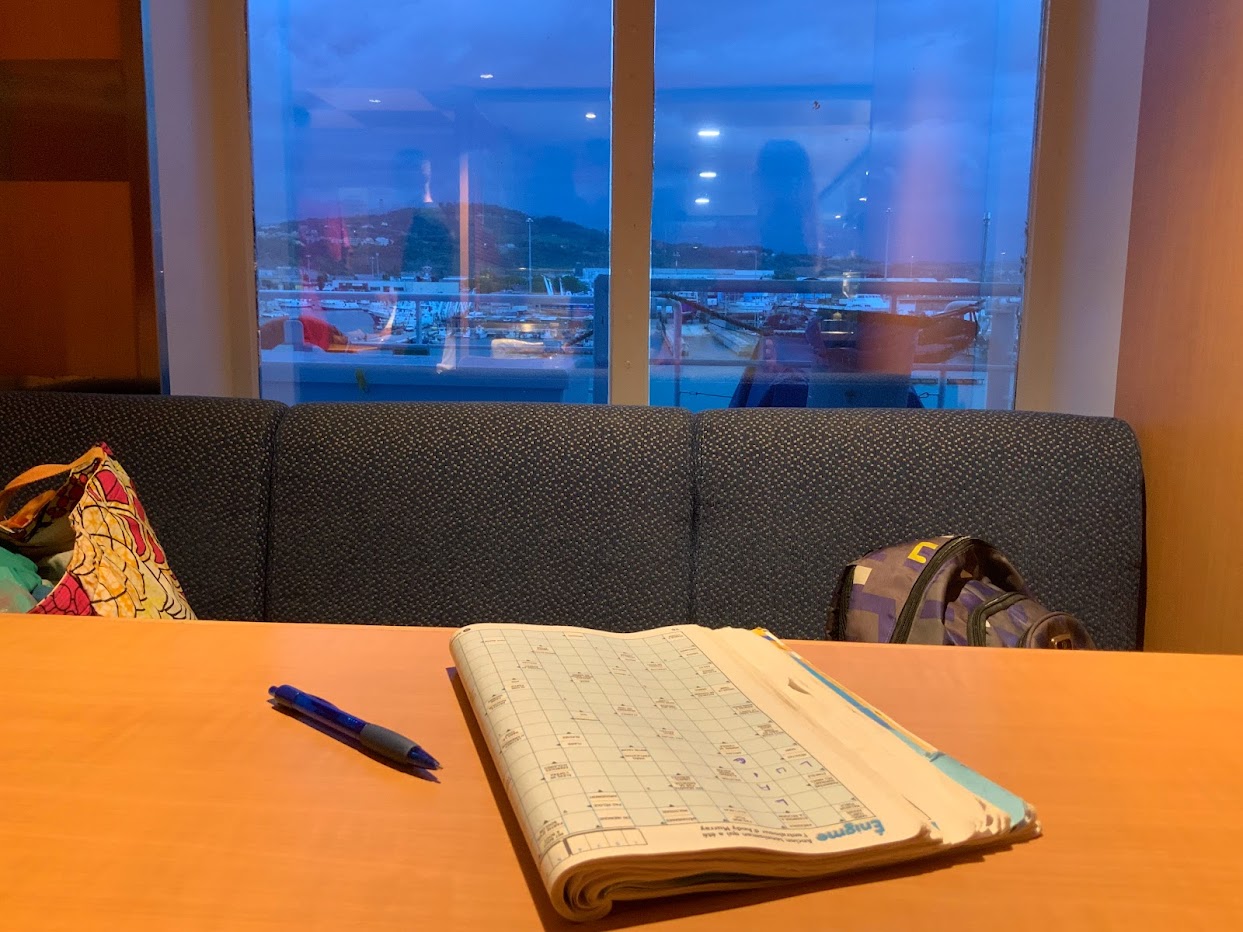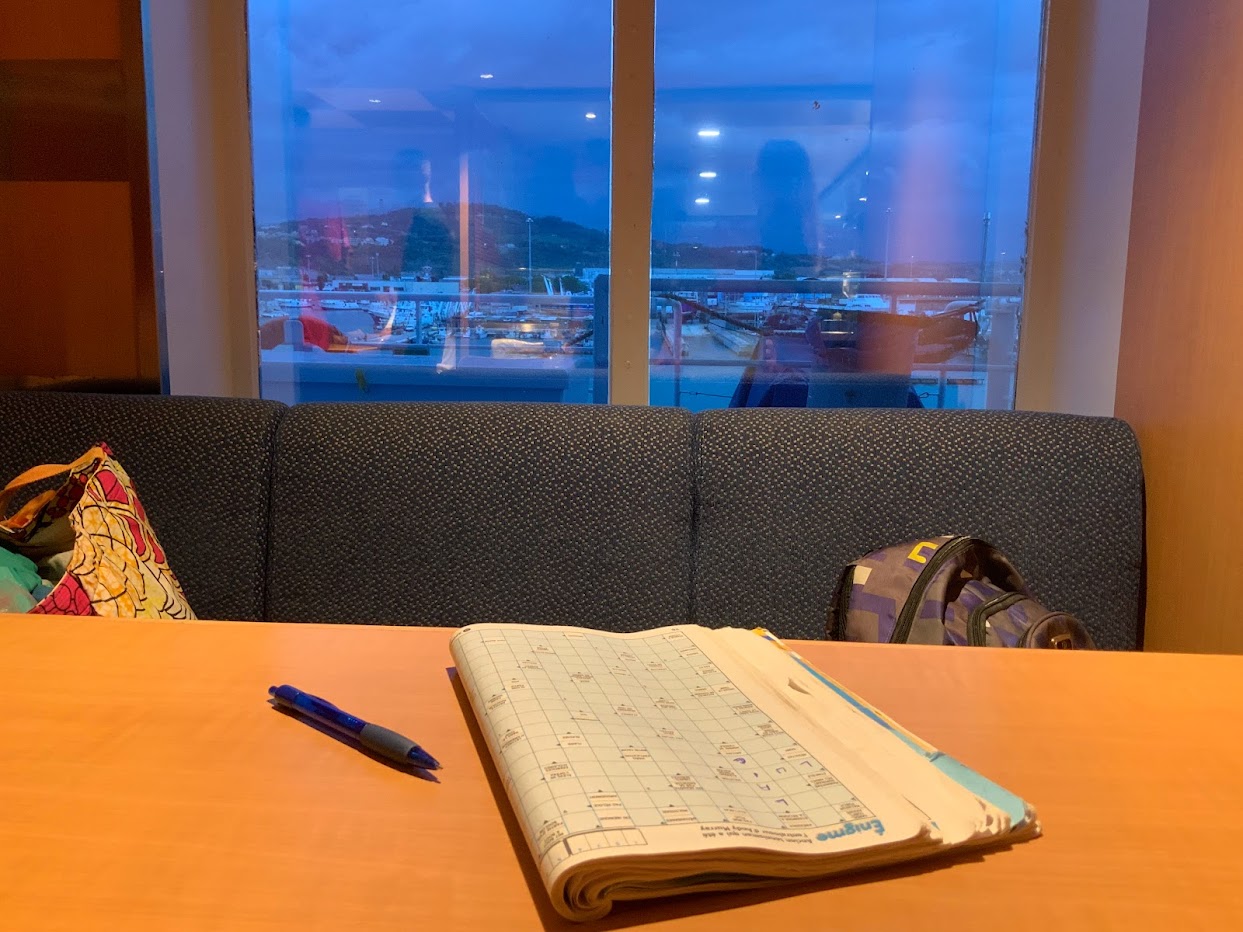02 août 2023
Tout le monde ira jusqu’au bout. Ce qui est, en soi, une forme de consolation, surtout quand on pense à toutes ces choses inachevées qu’on laisse derrière soi. À moins d’avoir passé une vie entière à se contraindre à explorer la définition de l’achevé et de l’inachevé, tentant de traduire ces mots de manière à ce qu’ils résonnent avec une justesse intime. Ces concepts, rarement remis en question, se fondent dans la confusion collective, bruts et convenus, devenant des tourments invisibles, mystérieux. Ils naissent dans l’inconscient, provoquant ce malaise diffus de l’inabouti, de l’inachevé, dont l’origine reste obscure.
Achever quelque chose, n’est-ce pas l’illusion d’en finir avec celle-ci pour s’octroyer le droit de passer à autre chose ? Une idée inculquée dès l’enfance, comme lorsqu’on nous apprend à finir ce qu’il y a dans notre assiette avant de goûter à autre chose. Un principe simple, mais difficile à saisir parfois, surtout chez les enfants ou ceux qui conservent un rapport figé au monde. Ils s’ennuient et croient qu’en passant à autre chose, tout changera. Mais c’est là une erreur : la situation, le monde, ne se transforment pas simplement parce qu’on les abandonne. Le sentiment d’inachevé persiste, s’accroche, nous hante, malgré nos tentatives d’en finir.
Achever, c’est aussi s’autoriser. Se permettre de passer à autre chose. Parfois, cela se fait avec l’aide de quelques prières, déplaçant la responsabilité vers une entité extérieure, inventée pour nous soulager de la culpabilité d’avoir achevé. Une sorte de religion de l’accomplissement, où finir quelque chose permet de s’en libérer sans scrupules.
En finir, c’est parfois tuer la chose elle-même, l’effacer de la surface de notre esprit. On s’en débarrasse, on l’enterre dans un tombeau symbolique – une concession funéraire, quelques enfants, un livre, un projet. Et parfois, c’est à soi-même que l’on s’attaque en achevant. On tue et on se tue à la tâche, simultanément. Et vu de loin, selon l’humeur du moment, cela peut provoquer des larmes ou des rires.
Plus que 14 jours, indique le message en haut de l’écran. Je tente de prendre les choses comme elles viennent, ni en les ignorant, ni en m’en affligeant. Une attitude différente émerge, une curiosité qui pousse à rester attentif, simplement pour l’attention elle-même.
Bien sûr, la destruction d’un blog n’a rien à voir avec la destruction d’une époque ou d’une vie. Ce n’est pas le même type d’achèvement, murmure le bon sens. Mais peut-être que si, après tout. L’achèvement, tel que je le perçois, est rigoureusement semblable pour toute chose dans ce monde. La différence que l’on invente est un baume, destiné à atténuer la peur et à nous donner l’illusion que l’on peut guérir des plaies, tout en continuant notre course folle, confiants qu’un tiers – dieu, l’état, ou le hasard – se chargera du reste.
Ainsi, la responsabilité émerge au détour du texte, comme un fruit mûr au bout de la branche. La patience, si mystérieuse et paisible, n’est pas le produit d’un vouloir, mais d’une nature en soi enfouie qu’on découvre.
D’où vient l’autorité de ce texte ? Celui-ci émerge soudain de la langue, la même langue qui coule en beaucoup, mais qui, ici, emprunte une forme personnelle, jusqu’à surprendre même celui qui l’écrit.
Cette forme ne cherche pas une distinction, une originalité. Elle témoigne d’un mouvement — peut-être encore pris dans une gangue entre justesse et errance — une spirale qui va d’un point atteint quelque part dans l’espace et dans l’esprit vers son origine.
Ce qui importe n’est pas la compréhension intellectuelle d’un tel processus, mais plutôt l’émotion qu’il produit. Un peu comme une pièce de puzzle apportant une satisfaction presque joyeuse à celle ou celui qui la pose à la bonne place avant l’achèvement définitif du jeu. De ce jeu-là — avant même qu’une pensée trouble n’advienne d’espérer un nouveau jeu inédit.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | août 2023
07 août 2023
Sommes-nous conscients de notre propre attention ? Que vaut-elle sans une conscience réflexive qui inclut l’attention dans un vaste mouvement d’observation de soi ? À travers un regard critique sur la lecture, la littérature populaire et classique, et les dynamiques intérieures qui nous habitent, l'auteur nous propose une réflexion singulière et poétique sur l’importance que nous accordons à nos perceptions.|couper{180}

Carnets | août 2023
06 août 2023
Sous la pluie, au réveil d’un matin orageux, se déroule une journée entre méditation silencieuse et gestes du quotidien. Entre la mer qui embrasse la côte et l’espace confiné d’une maison, le narrateur se perd dans des réflexions sur l’absence d’opinion, la mobilité de l’être, et le mystère des îles. Un récit fragmenté où chaque geste devient une pensée, et le silence , des mots.|couper{180}

Carnets | août 2023
05 août 2023
Partir sans carte, guidé par un GPS réglé « sans péages » et découvrir l’Italie en franchissant les Alpes jusqu’à l’Adriatique. De là, une traversée sous la pluie vers la Croatie, avec des marchés d’un autre temps et des réflexions sur l’écriture contemporaine. Entre Balzac, la création d’un nouveau blog et la question de l’effacement des souvenirs, ce voyage devient autant physique qu’introspectif.|couper{180}