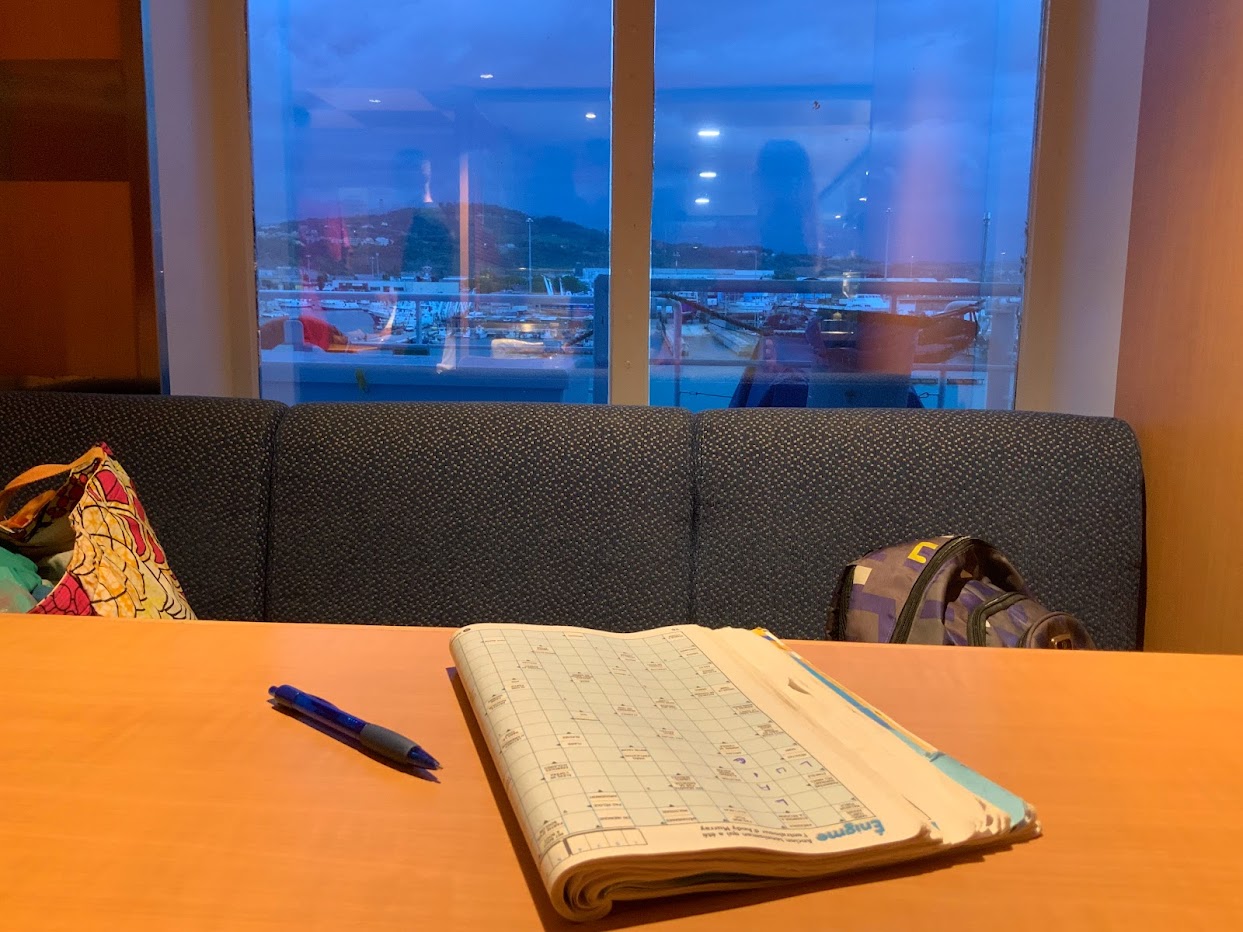07 août 2023
Une attention toujours maintenue à tout ce qui nous entoure vaut-elle quoi que ce soit si l’on n’est pas attentif à cette attention elle-même ? Si l’on ne l’englobe pas dans l’observation, dans l’expérience ? Et si, à un moment ou un autre, on ne se demande pas "pourquoi" ? Pourquoi vouloir rester dans cette attention, dans cette sorte de tension, à recueillir autant d’informations pour finalement les laisser nous traverser sans rien en dire, sans en tirer quoi que ce soit ? Conserver ce fantôme, cet amas nébuleux comme un avare garde son or ? Mais l’avarice est-elle encore un défaut dans cette époque apocalyptique où toutes les valeurs s’inversent ? Comme s’inversent les genres, la géopolitique, les pôles magnétiques, et probablement bien d’autres choses que nous ignorons encore ?
Il est sans doute bénéfique pour les nerfs d’attendre tout comme rien, avec une égale sérénité. L’idée même d’importance que l’on se crée n’est éclairée que par la certitude de disparaître un jour. Si l’on oublie cette certitude quelques instants, la grâce en profite pour nous surprendre. On s’invente alors, de nouveau, une bienveillance, une compassion, de l’amitié, de l’amour.
La vieille baudruche se dégonfle, et l’attention capitule doucement, disparaissant de façon molle, presque confortable. On croit vivre une révélation, on s’imagine être un nouveau Colomb découvrant un monde inédit, un nouvel espoir de vivre autrement. Mais non. Si l’on regarde de plus près, ce n’est qu’une nouvelle illusion, un nouveau bricolage. Un autre labyrinthe où trottine notre ego, cet incorrigible rat blanc. Pourtant, comment ne pas admirer cet égoïsme inventif, toute cette capacité à se leurrer pour repousser encore et encore l’éveil ? N’est-ce pas fascinant ?
Comme un vieil homme assis sur un banc, observant des enfants jouer dehors, on regarde tout cela avec attendrissement. Peut-être est-ce notre dernière illusion, cette émotion finale avant que tout ne se dissipe. Comme un océan d’attendrissement se ruant sur les côtes de notre orgueil et de notre vanité. Il emporte tout dans son reflux et nous devenons cette mousse, cette écume, enfin débarrassée de toute attention, de toute importance, sous un ciel immense où les oiseaux tracent le mot "liberté" en toutes lettres, dans toutes les langues.
Ne disposant pas de 22/11/63 de Stephen King, je me contente de lire Insomnie. J’observe comment l’auteur parvient à tirer de trois fois rien un roman de mille pages. Un vrai métier, et du talent, quoi qu’on en dise. Après tout, ce n’est pas si éloigné de Balzac. Au XIXe siècle, les lecteurs se laissaient happer par la Comédie humaine, ses intrigues et ses personnages. Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose de cet attrait. Si l’on lit encore Balzac, c’est qu’on est soit à l’école, soit dans un atelier d’écriture. Pourtant, bien des gens cultivés et experts dans le champ littéraire ne peuvent ignorer Stephen King, à moins de vouloir maintenir une posture idiote face au monde. King, tout comme Balzac à son époque, est devenu une référence, aujourd’hui révéré par ceux que l’on dit de gauche. Du moins, si l’on sait encore où se situent la gauche et la droite.
Je veux dire aussi que l’inconscient est un véritable continent, encore largement inexploré, malgré les découvertes de la psychologie. Ce n’est pas la raison qui nous guide dans ce monde, surtout si l’on continue à s’accrocher à des repères comme les quatre points cardinaux, dont on a oublié qu’ils ne sont qu’une fiction.
Ainsi, passer de la lecture des Illusions perdues et du Chef-d’œuvre inconnu à Insomnie n’est pas un hasard. Pas plus que le hasard n’a de sens dans la manière dont on s’en sert. Ce n’est ni du vaudou ni du maraboutage. C’est l’inconscient, et c’est de la poésie. En disant cela, je ne révèle rien de choquant, et tout va bien.
L’Adriatique vue depuis Sveta Nedjelia, en Croatie. Tant pis si c’est long. C’est peut-être tout un cheminement d’écriture qu’il faut emprunter pour parvenir au nerf soudain, à ce quelque chose qui a provoqué le mouvement, la marche, le branle. On sent que quelque chose pousse, sans savoir ce que c’est, et on doit même se désintéresser de ce que cela peut être. Jusqu’à ce qu’au détour d’un paragraphe, d’une phrase, d’un mot, on se retrouve soudain nez à nez avec cela.
Il tire de trois fois rien pour en faire mille pages. Ce "trois fois rien", que l’on peut nommer tant de choses que l’on ignore, que l’on veut surtout ignorer. Car on sent très précisément qu’il y loge toute l’étrangeté qui pourrait nous effrayer. Un réel inédit. Cela rejoint cette vieille intuition que rien ne vient pour rien, que cette histoire de hasard ne sert qu’à rassurer les experts. L’analogie est-elle une fiction comme tant d’autres ? Découvrir une similarité dissimulée entre des objets apparemment sans rapport est-elle une maladie ou un jeu ? Peut-être est-ce simplement cette vieille histoire de Jeannot Lapin. Quelqu’un m’a dit hier encore que c’était une posture, que je m’amuse à n’être convaincu de rien. J’y ai repensé en me promenant au bord de la mer. Comment peut-on avoir le toupet de dire une telle chose à quelqu’un que l’on connaît à peine ?
Ces textes sont-ils un miroir qui déclenche ce genre de réaction ? Est-ce que cela m’a agacé, ou blessé ? Pas vraiment. Ce narrateur que l’on confond avec l’auteur, ce narrateur qui ne dit rien de ce qu’il est vraiment… Pourquoi devrait-il répliquer ? Quelle extravagance de s’immiscer ainsi dans le texte !
Ensuite, à quoi bon. À quoi bon engager de telles palabres ? Le narrateur se drape dans son orgueil, toise cet autre personnage—car évidemment, c’est un personnage—et ne dit rien.
Ce qui me rappelle un minuscule évènement sur le bateau Ancône-Split, un matin, à l’ouverture du bar. J’étais parmi les premiers à faire la queue, quand soudain, une jeune fille se glisse juste devant moi. Cela m’agace évidemment. Du coup, je me sens vieux et idiot, projeté dans l’image qu’elle pourrait avoir de moi en manœuvrant ainsi. Alors, je me rapproche du type devant moi, et nous voilà parallèles, elle et moi. Je la toise, elle n’ose pas me regarder. J’insiste, jusqu’à ce qu’elle tourne enfin le visage vers moi. Je ne baisse pas les yeux, je la fixe encore plus intensément. Sa bouche esquisse une grimace, elle détourne son visage. Je continue, implacable. Puis, soudain, je la laisse passer devant moi en me disant : laisse-lui donc le dernier mot, sois charitable. Mais la logique en fut blessée. J’ai dû l’insulter copieusement, mentalement, et lui tirer la langue, pour obtenir satisfaction, comme dans les vieux duels.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | août 2023
06 août 2023
Sous la pluie, au réveil d’un matin orageux, se déroule une journée entre méditation silencieuse et gestes du quotidien. Entre la mer qui embrasse la côte et l’espace confiné d’une maison, le narrateur se perd dans des réflexions sur l’absence d’opinion, la mobilité de l’être, et le mystère des îles. Un récit fragmenté où chaque geste devient une pensée, et le silence , des mots.|couper{180}

Carnets | août 2023
05 août 2023
Partir sans carte, guidé par un GPS réglé « sans péages » et découvrir l’Italie en franchissant les Alpes jusqu’à l’Adriatique. De là, une traversée sous la pluie vers la Croatie, avec des marchés d’un autre temps et des réflexions sur l’écriture contemporaine. Entre Balzac, la création d’un nouveau blog et la question de l’effacement des souvenirs, ce voyage devient autant physique qu’introspectif.|couper{180}

Carnets | août 2023
02 août 2023
Achever pour passer à autre chose : une idée simple, ancrée dans notre éducation, mais qui cache une illusion plus profonde. Ce texte méditatif nous invite à repenser notre rapport à l'achèvement, à l'inachevé et à la patience. Loin d’être une simple quête de contrôle, l’acte d'achever révèle notre incapacité à réellement changer ce qui nous entoure. L'inachevé persiste, et la clé se trouve peut-être dans l’acceptation.|couper{180}