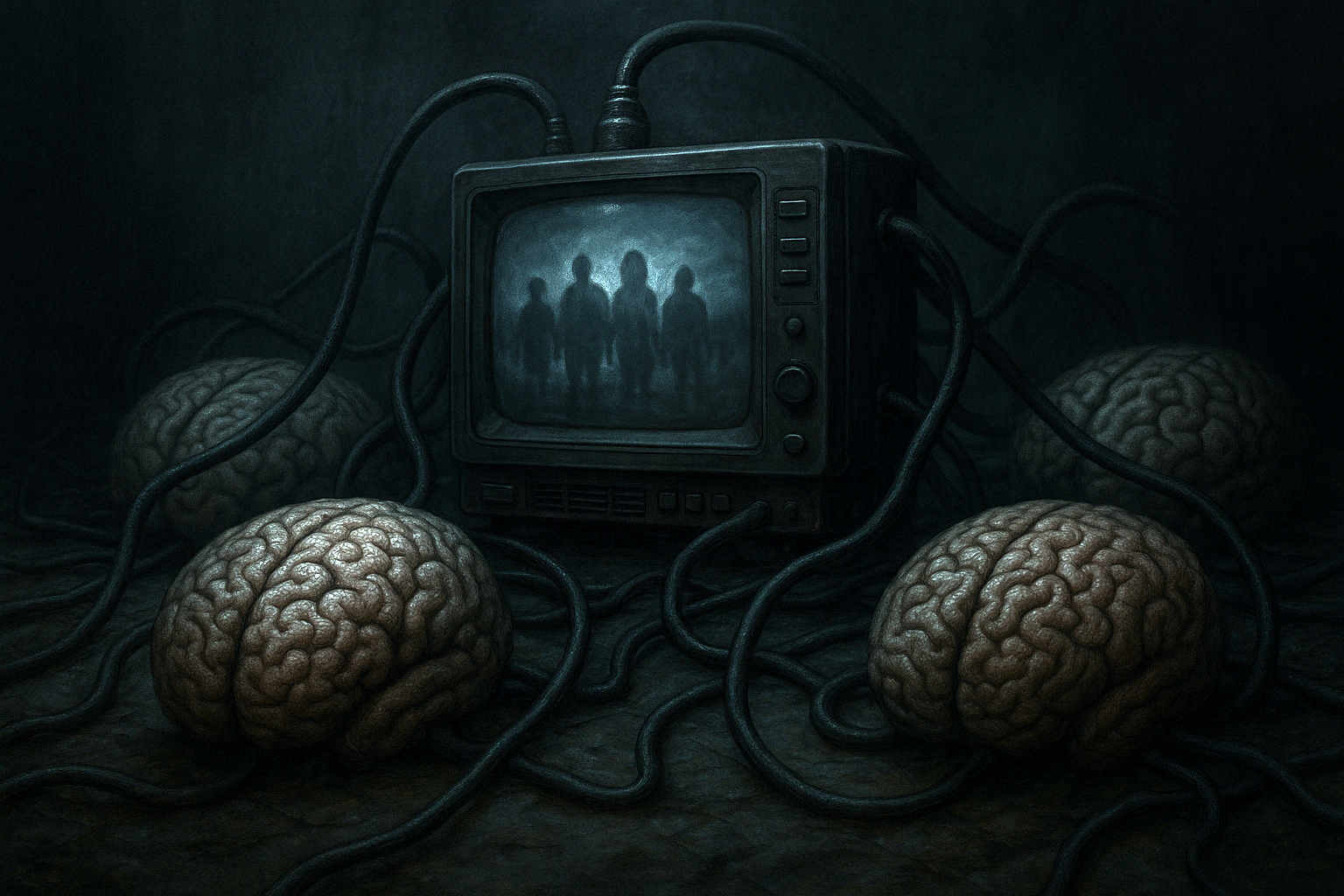l’écran total
Je viens de revoir quelques épisodes de Twin Peaks. Une envie surgie d’un livre de Pacôme Thiellement, Trois essais sur Twin Peaks, titre érudito-systémique. Lecture brève, pas toujours comprise, mais assez pour relancer la machine. La série, la nuit, écran trop grand, volume trop bas. Et ce qui s’installe alors, ce n’est pas tant une histoire qu’une atmosphère. Pas un récit mais une contamination. Quelque chose qui vous rentre par les pores.
Au départ, tout semble simple. Une ville, des pins, des visages. Et puis non. Une lente hystérie s’installe. Ça prend son temps, mais ça s’infiltre. Vous vous retrouvez à trembler sans raison, inquiet pour des personnages qui parlent comme des somnambules et baisent comme des mannequins. Le sexe est là, partout, mais à côté. C’est un rictus, un muscle contracté, jamais un souffle. Une sorte de porno triste. Et propre. Emballé pour l’export.
Ce n’est pas que Twin Peaks soit toxique en soi. C’est que la vision qu’elle propose du monde — et que beaucoup d’autres séries prolongent, de Battlestar Galactica à The OA, en passant par True Detective ou Mr. Robot — est elle-même parasitée. Le bien, le mal, ça se superpose, ça se confond, ça se nie. Rien ne tient, sauf la tension. Une énergie nerveuse qui circule dans les images, dans les dialogues, comme un courant alternatif qui ne veut pas trancher. Le spectateur est piégé entre le soupçon et l’attente. Une sorte de paranoïa modérée. Mais continue.
Alors on regarde. Encore un épisode. Et encore un. Et on se réveille avec cette impression que quelque chose, dans votre cerveau, a été colonisé. Occupé par une manière de penser qui n’est pas la vôtre. Comme un virus qui parlerait anglais avec une syntaxe parfaite. Une beauté stérile, un rêve froid. Le désir y est toujours calibré. Le mal, théâtralisé. Le bien, flou. Il ne reste plus qu’un écran de fumée.
Il faut du temps pour s’en remettre. Pour déprogrammer cette influence. Ce n’est pas un complot. C’est pire : une écriture. Une idéologie douce. Une manière de détourner le regard, de réduire le monde à un affrontement stylisé. Une opéra du chaos. Esthétique, nerveuse, américaine.
Le problème, c’est qu’on s’y habitue. Que le trouble devient familier. Que cette confusion entre simulation et vérité vous paraît à la longue plus réelle que la réalité elle-même. On sort de Twin Peaks comme d’un bain trop chaud. Le monde semble trop sec, trop net. On regrette presque la vapeur, le velouté des voix.
Mais la tête, elle, a pris. Quelque chose a été imprimé. Et même le corps, parfois, s’en souvient. Une fatigue sourde. Une envie d’oublier ce qu’on a vu. Ou peut-être ce qu’on n’a pas voulu voir.
C’est un effet qu’on n’anticipe pas toujours : l’usure invisible du visionnage en rafale. Une fatigue qui ne dit pas son nom, mais qui pèse, désorganise, détruit doucement l’appétit pour l’inattendu. Les plateformes de diffusion en continu, toutes semblables dans leur ergonomie fluide et leur esthétique policée, fonctionnent comme des armes douces de destruction massive des imaginaires singuliers. On croit choisir. On croit explorer. Mais c’est un labyrinthe qui tourne en rond. On navigue d’une héroïne traumatisée à un antihéros abîmé, d’un univers gris bleuté à un autre déjà vu. Le sommeil vient mal. L’esprit ressasse. Et ce qu’on appelait « fiction » finit par ressembler à une interface du monde.
L’imagination, alors, se ratatine. Les histoires ne viennent plus. On se met à penser par bribes de dialogues, à ressentir par images intercalées. On devient personnage secondaire d’un feuilleton global. Une statistique. Un profil de visionnage. Et c’est peut-être ça, la plus grande réussite de la machine : vous déshabituer à vos propres rêves.
Assez souvent, ça m’a frappé : ce gouffre entre l’épisode pilote et la dernière image. On commence par une étincelle, une promesse de complexité, de beauté, d’audace. Puis quelque chose s’effrite. L’idée géniale s’affadit, lentement. Elle perd ses angles, son ardeur, son étrangeté. Comme si cette génialité même, dans l’économie de la série, était vécue comme un danger. Quelque chose qu’il faudrait lisser, encadrer, effacer. Pour que ça tienne sur la durée. Pour que ça se vende. Presque toutes se terminent en eau de boudin — chute molle, envolée stoppée net — comme si on voulait avertir que le génie, ici-bas, finit toujours écrasé. Laminé par une force obscure : un mélange de foutage de gueule, de mépris discret, et de profit maquillé. Une dramaturgie sabotée de l’intérieur. Et nous, à chaque fois, on regarde jusqu’au bout. Comme s’il fallait vérifier l’agonie.
Il y a aussi cette tendance lourde à l’ambiguïté. Devenue norme, presque dogme. C’est à la mode : rien ne doit être tranché, tout doit flotter. L’ambiguïté comme un tapis rouge déroulé à l’inversion des valeurs. Ce qui hier était mal devient aujourd’hui audace, liberté, subversion. Et ce qui était tenu pour bon, sincère, lumineux, passe pour naïf, ringard, suspect. Exactement comme le font ces politiques à la fois correctes et ultra-violentes, ces nouvelles rhétoriques autoritaires qui prennent le masque du bonhomme, du bon enfant, du conseiller bienveillant. C’est le retour du cynisme, mais en version friendly. Les slogans sur les cinq fruits et légumes quotidiens, les injonctions à consommer avec modération, les publicités pour l’auto-contrôle émotionnel — tout ça coexiste avec une brutalité tranquille, normalisée, souriante. Le contraste est écœurant. On est sommés de trouver cela normal. De trouver ça esthétique. De l’aimer, même. Et c’est peut-être là le vrai tour de force : nous faire avaler, sans broncher, ce que nous aurions autrefois vomi d’instinct.
Tout cela participe d’une esthétique de l’effondrement contrôlé. Comme ces séries qui montrent la fin du monde mais cadrée, bien éclairée, presque séduisante. Comme ces cinq femmes envoyées dans l’espace par la firme de Jeff Bezos et qui, de retour sur Terre, posent comme si elles sortaient d’un salon de coiffure. Pas une mèche déplacée, pas un mot de travers. Qui peut encore avaler ça ? Cette mise en scène grotesque d’un exploit devenu vitrine. L’espace comme décor, les femmes comme figurantes de luxe. Pourquoi nous prend-on à ce point pour des imbéciles ? Quel est ce besoin de travestir jusqu’à la grandeur, de tout faire rentrer dans une case narrative, souriante et inoffensive ? C’est comme si l’humanité était devenue son propre storyboard. Et que chaque image devait désormais être approuvée par le marketing. Un monde qui s’effondre, peut-être. Mais avec élégance. Et brushing parfait.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | Atelier
31 mai 2025
Mai s'achève sur un constat bancal. Trop de code, pas assez de mots. Encore moins de couleurs sur la toile. L'équation ne tient pas. Ce qui frappe, c'est cette solitude technique. Personne à qui demander. Alors on cherche, on bricole, on plante, on recommence. Peut-être que l'argent n'explique pas tout. Peut-être que j'aime buter contre les choses, m'y cogner le crâne jusqu'à l'éclatement. Ça vaut pour tout : le bricolage du dimanche, l'administratif qui colle aux doigts comme une mélasse hostile, les recettes ratées, le développement qui résiste, les cartes routières qui mentent, les livres qui refusent l'ordre qu'on voudrait leur imposer. Et derrière cette résistance du monde, cette inertie des choses, plane toujours le fantasme du définitif. Le résultat final, immuable, parfait. Sauf que seule la mort tient ses promesses. Le reste flotte, instable, perpétuellement. Cette instabilité ne m'effraie plus vraiment. Je crois y avoir toujours baigné, comme dans un liquide amniotique qui n'aurait jamais voulu se rompre. Ni joie ni plainte. Juste cet état de fait. Mes rêves de grandeur ? Évaporés ou presque. Grand peintre, grand écrivain, grand photographe, grand quelque chose – tout ça s'est dilué. Pourtant, il suffit parfois de s'illusionner suffisamment pour le devenir, grand. Ça demande une naïveté d'enfant, du premier degré pur. Puis vient l'autre naïveté, celle du second degré, qui surgit après les années de lucidité supposée. C'est elle qui me pousse à écrire exactement ce que je viens d'écrire. May ends on a lopsided assessment. Too much code, not enough words. Even fewer colors on canvas. The equation doesn't hold. What strikes me is this technical solitude. No one to ask. So you search, you tinker, you crash, you start over. Maybe money doesn't explain everything. Maybe I like bumping against things, banging my skull against them until it cracks. This applies to everything : Sunday DIY projects, administrative tasks that stick to your fingers like hostile molasses, failed recipes, resistant development, lying road maps, books that refuse the order you'd like to impose on them. And behind this resistance of the world, this inertia of things, always looms the fantasy of the definitive. The final result, immutable, perfect. Except only death keeps its promises. Everything else floats, unstable, perpetually. This instability doesn't really frighten me anymore. I think I've always bathed in it, like in amniotic fluid that never wanted to break. Neither joy nor complaint. Just this state of fact. My dreams of greatness ? Evaporated or almost. Great painter, great writer, great photographer, great something – all of that has dissolved. Yet sometimes it's enough to delude yourself sufficiently to become it, great. It requires a child's naïveté, pure first degree. Then comes the other naïveté, that of the second degree, which emerges after years of supposed lucidity. It's the one that pushes me to write exactly what I just wrote.|couper{180}
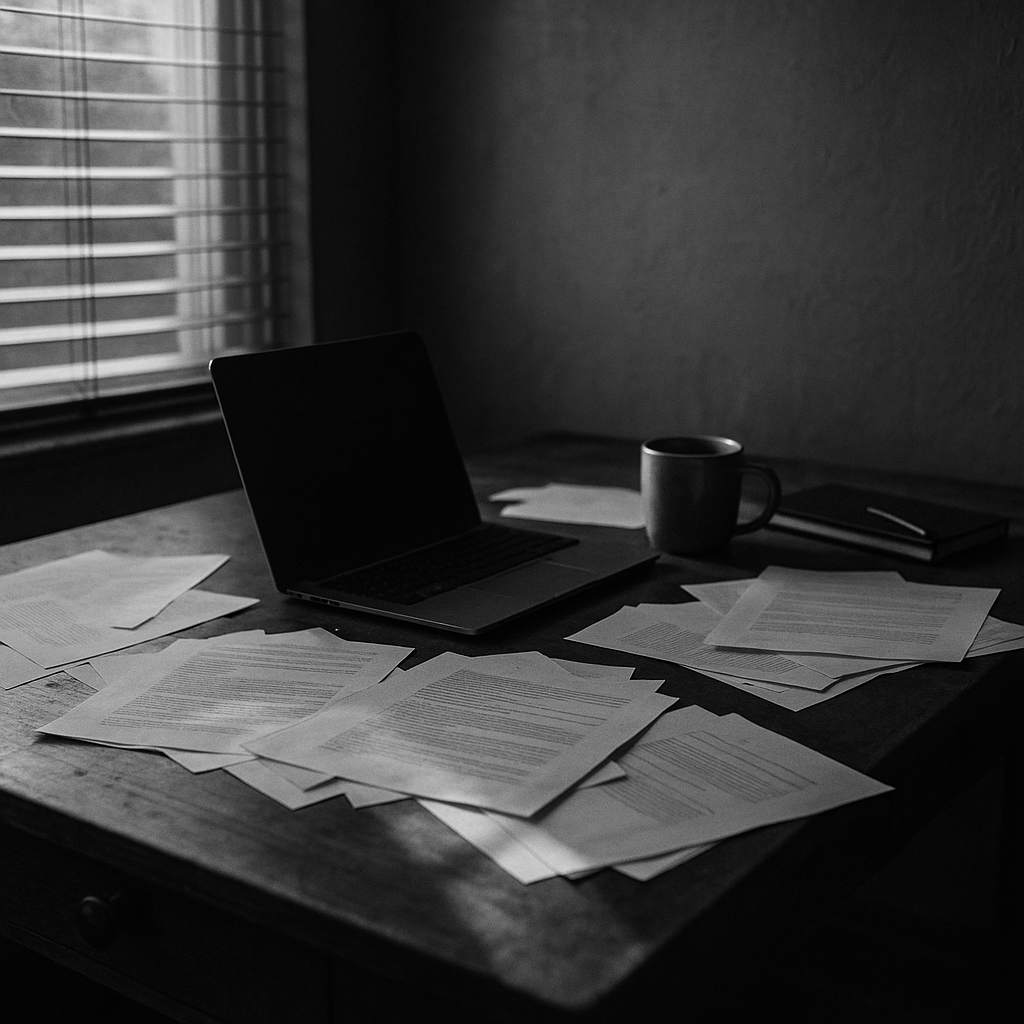
Carnets | Atelier
30 mai 2025
Installer une IA locale. Pourquoi pas. Elle trierait, classerait, rangerait mes dossiers dans un ordre plus logique que celui que j’ai jamais eu. Elle serait discrète, rapide, et sourde au reste du monde. Un petit employé modèle, dans mon HP Pavilion 23 qui fatigue. J’y ai cru. Un peu. J’ai fini par installer Mistral, 4,1 Go, via Ollama. Avant lui, un modèle plus léger, plus bête aussi. Presque analphabète. PHY, peut-être. Il fallait Docker. Il fallait WebUI. Il fallait de la place. J’en manquais. J’ai forcé. Évidemment, ça n’a pas marché comme prévu. Le plan : reprendre mes dossiers Obsidian, leur demander de m’expliquer ce qu’ils faisaient là, trouver un fil, des liens, une cohérence. J’aurais dû me méfier. Chaque outil exigeait un autre outil, comme si tout s’appelait en cascade. Python, GPU, base vectorielle, boucles d’espoir. Je me complique la vie. C’est une habitude. Ou une manière d’organiser ma déception. Elle arrive toujours vite, elle connaît le chemin. Chez moi, elle n’a même pas besoin de frapper. Le pompon : le RAG local. Rien qu’un nom comme ça, déjà, ça sent le problème. Pour faire tourner un script, il fallait une cargaison de dépendances. J’ai tout installé. J’ai tout supprimé. Plus de place. Ce temps que j’y passe, je ne sais pas. C’est beaucoup. C’est sans doute de l’évitement. Mais éviter quoi ? Réussir quelque chose ? Finir ? Ce serait fâcheux. Finir, c’est enterrer. On appelle ça un aboutissement. On met une nappe blanche, un plat chaud, on dit quelques mots, et voilà. Je m’entraîne. C’est un exercice. Une répétition. Pour la suite. Pour ce qui ne se répète pas. La fatigue est là, le reste aussi. Et pourtant, ça continue. Avec moi. Sans moi. Installing a local AI. Why not. It would sort things out, put files in order, make sense of the mess. Quiet, efficient, blind to the world. A small clerk in my old HP Pavilion, wheezing. I believed it. A little. Mistral, 4.1 GB, via Ollama. Before that, a smaller model. Illiterate, almost. PHY, I think. Needed Docker. Needed WebUI. Needed space. I didn’t have it. I forced it. It failed, of course. The idea was simple. Reopen all Obsidian notes. Ask them to explain themselves. Find threads. Patterns. Meaning. Foolish. Every tool needed another tool. Python, GPU, vector base, the whole lot. Hope called hope, called hope again. I must enjoy this. Making it hard. Or just the rhythm : hope, then fall. Fall faster. I know the way. Disappointment does too. She lives here. RAG. Local. Just a script, they said. Before the script, dependencies. Before dependencies, more. Installed. Deleted. No more room. The time I spend. Absurd. I know. A diversion. From what ? Still no clue. From doing something ? From finishing ? That would be worse. Finishing means flowers. Means speeches. A plate of food. The end. So I train. I rehearse. For what won’t rehearse. Fatigue, yes. Disgust too. Still, it goes on. With me. Without me.|couper{180}
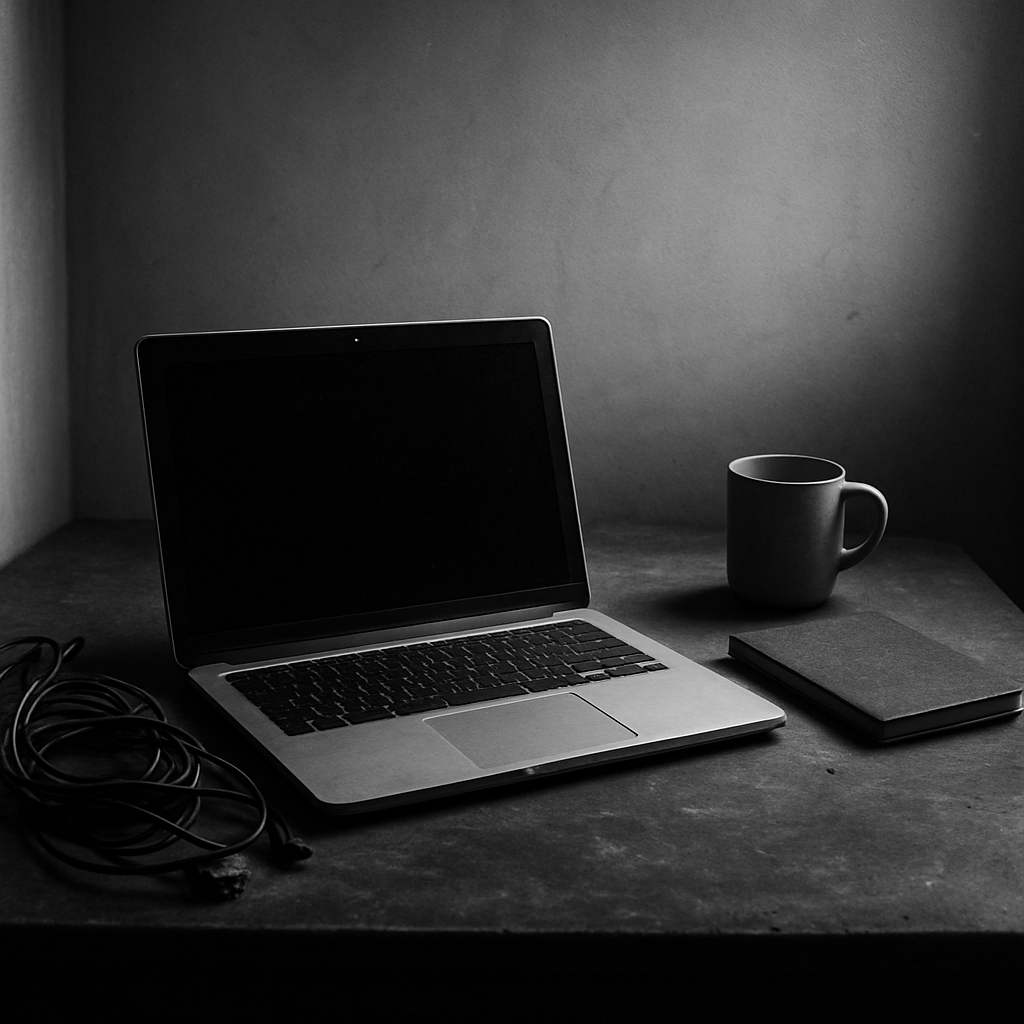
Carnets | Atelier
29 mai 2025
Tais-toi, me dit-elle — non comme un reproche, mais comme si mon silence lui-même bavardait, et ce bavardage ne naissait pas du silence qui est nécessaire. Bien que, ce qui est nécessaire, peut-être, c'est que rien ne soit nécessaire du tout. Puis elle entra. Dans ses bras, des gerbes de fleurs. Des glaïeuls, peut-être. Cela aurait pu être trop — trop éclatant, trop cruel. Tais-toi encore. Écoute — comme il n'y a rien à dire. Et je la désirais en cet instant exactement comme elle était — simple, absolument simple. Si simple que toutes mes complexités superposées, toujours construites pour ne pas la voir, s'effondrèrent. Je la vis. Je m'étais assis sur le lit. Elle trouva un vase quelque part parmi le bric-à-brac et commença à arranger les fleurs. La tâche semblait exiger toute son attention — à tel point que je me demandai : était-elle venue ici par erreur ? Cette visite était-elle faite dans la distraction ? C'était un test, encore — comment dépasser cette possibilité. Qu'elle puisse être si distraite qu'il me faudrait mobiliser toutes les fibres de mon attention seulement pour la suivre, pour la retrouver à nouveau. La lumière s'infiltrait dans la pièce, lentement. Et avec elle, les contours des choses commencèrent à se dissoudre. Ce qui nous entourait ne portait plus de définition — ce n'était ni plaisant ni déplaisant. C'était. Un silence d'un autre ordre — au-delà de ce que j'appelais autrefois silence, qui, je le vois maintenant, n'était que du bruit. Maintenant les fleurs se dressaient dans le vase, le vase sur la table, et c'était tout ce que je pouvais voir dans la pièce. Elle, même elle, avait disparu. Par la fenêtre ouverte montaient et entraient les bruits de la rue. Ils semblaient les seules choses vivantes. Tout ce qui avait été, et tout ce qui viendrait, n'était que silence — un espace blanc entre deux mots. Facing the Simple Be silent, she said to me—not as a reprimand, but as if my silence itself were chattering, and that chatter not born of the silence that is needed. Although, what is needed, perhaps, is that nothing be needed at all. Then she entered. In her arms, sprays of flowers. Gladiolus, perhaps. It could have been too much—too bright, too cruel. Be silent still. Listen— to how there is nothing to say. And I desired her in that moment exactly as she was—simple, utterly simple. So simple that all my layered complexities, always built to unsee her, collapsed. I saw her. I had sat down on the bed. She found a vase somewhere among the bric-a-brac and began to arrange the flowers. The task seemed to demand her full attention—so much so that I wondered : had she come here by mistake ? Was this a visit made in distraction ? It was a test, again—how to surpass that possibility. That she might be so distracted I would need to summon all the fibres of my attention only to follow her, to meet her again. Light seeped into the room, slowly. And with it, the outlines of things began to dissolve. What surrounded us no longer bore definition—it was neither pleasant nor unpleasant. It was. A silence of another order—beyond what I once called silence, which, I now see, was only noise. Now the flowers stood in the vase, the vase upon the table, and that was all I could see in the room. She, even she, had vanished. From the open window the street sounds rose and entered. They seemed the only living things. Everything that had been, and all that would come, was only silence—a white space between two words.|couper{180}