janvier 2025
Carnets | janvier 2025
19 janvier 2025
Le temps file sous les doigts nerveux et précis des Parques. Je ne sais quelle mesure elles jugeront correcte pour, au final, couper le fil de mon existence. Cela se fera, je le sais, machinalement, entre deux bavardages sans conséquence. Tout a commencé dans ma vie par la mythologie, et tout finira probablement dans la mythologie. La mort elle-même sera, pour moi, un échec. Je l’imagine glaciale, ouh ouh ouh, entrant dans la pièce. Alors, et c’est encore là la force de l’espérance, je verrai la vanité de tout ce que j’avais cru être une réussite. Du plus loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé les mythologies. Elles m’ont ouvert un monde. Ce furent d’abord leurs héros qui captèrent mon attention, comme le papier collant attire les mouches au plafond. Je ne savais pas qu’ils n’étaient pas réels. Et même lorsque l’on a tenté de m’en convaincre, je n’ai abdiqué qu’en apparence. Ils étaient tellement humains. Comment auraient-ils pu ne pas exister ? Plus que mes voisins, plus que les adultes anonymes croisés au quotidien, eux avaient une vie brûlante. Puis le temps a passé. Mon regard a dérivé, quittant les figures héroïques pour s’attacher aux paysages qu’ils habitaient, ces lieux où ils vivaient, se battaient, aimaient, déchantaient. La Grèce, pour moi, fut longtemps un lieu purement mythologique. Ce n’est que des années plus tard que j’ai pu poser mes pieds sur cette terre. En ai-je été émerveillé ? Déçu ? Je ne sais pas. À mon arrivée à Athènes, mon esprit était saturé de préoccupations triviales : trouver l’hôtel, m’orienter dans cette ville inconnue, gérer l’immédiat. Cela écrasait mes velléités de rêveur patenté. L’Acropole n’a pas été un choc. Ce fut ailleurs, devant une assiette de souvlakis dans une ruelle sombre, que je ressentis un étrange malaise. À chaque classe sa catégorie de malaise, non ? Ce n’était pas la première fois que ce sentiment me traversait, mais ce fut peut-être la première fois qu’il me saisit avec une telle clarté. Ce "malaise" me confrontait à ma propre ombre, comme une question tapie depuis toujours dans l’obscurité. Elle jaillit soudain de mon crâne, comme Athéna toute armée, me défiant de lui répondre. C’est là qu’intervient mon dibbouk. Ce mot, cette figure, je l’ai empruntée pour nommer mon site, mais aussi pour nommer cette part de moi. Le dibbouk, personnage issu de la mythologie juive, est mon double d’écriture. Une voix d’altérité, celle qui dialogue avec mes ombres et parfois avec mes clartés. Maupassant avait son Horla, Gogol son nez et son manteau, Dostoïevski son double souterrain, cheminant entre profondeur et altitude. Ces figures, finalement, nous parlent d’un même héritage : cette lutte intérieure entre ce que nous sommes et ce que nous craignons de devenir. Hier, je suis resté longtemps à contempler des paysages d’hiver, filmés par un homme. Son appareil photo devait être de grande qualité, car chaque détail semblait presque irréel. Les noirs, visqueux et profonds comme de l’encre d’imprimerie, s’opposaient aux blancs qui frôlaient la surexposition sans jamais s’y abandonner totalement. Une harmonie troublante se dégageait de ces contrastes. Ce n’était pas juste une image, c’était une sensation. Une texture presque tactile. À travers l’écran, je sentais l’air glacé, le silence qui enveloppe ces paysages d’hiver, le crissement lointain d’une semelle ou la succion d’une botte s’arrachant à la boue. En regardant ces images, j’ai ressenti un lien avec cet homme derrière la caméra. Pas besoin de le connaître, mais une certitude silencieuse : il avait vu quelque chose qui nous ressemblait. Ce silence, ce vide apparent entre les arbres nus, portait en lui une densité. Je n’avais pas besoin de voir son visage. À travers son regard, je voyais le mien. Cet homme, je l’imagine marchant dans le froid, attendant immobile pour saisir l’instant parfait. Était-ce un effort pour lui ? Peut-être pas. Mais pour moi, l’ensemble de ses gestes – charger son appareil, enfiler son blouson, sortir – était l’expression d’une volonté presque héroïque. Un geste à la fois minuscule et mythologique. Cela m’a rappelé les matins glacés où l’on s’entasse dans les trains de banlieue, les RER, ces paysages qui défilent au-delà des vitres embuées. L’héroïsme est là, dans l’interstice entre l’envie de sortir et la lutte contre toutes les excuses intérieures. Je me suis vu marcher encore et encore, sur une autre berge, longeant un autre fleuve. J’ai ressenti cet appel et, presque aussitôt, l’hésitation : trop froid, trop loin, trop inutile. Ce combat silencieux, entre l’élan et la paralysie, est peut-être la plus grande épreuve. L’effort n’est pas dans le geste lui-même, mais dans tout ce qui précède, tout ce qui l’empêche. Le dibbouk, dans mon esprit, applaudissait doucement. Avec ce geste mesuré, presque moqueur, on aurait dit qu’il félicitait un enfant pour une évidence qu’il venait de découvrir. — "Le sacré s’est enfui, bien sûr," dit-il en allumant une cigarette, dégoûté. Écœuré. Mais toi, tu sembles dire que tu ne t’enfuis pas. Et pourtant regarde : tu restes là, les pieds dans la boue, comme tout le monde. Parce que tu attends, toi aussi. Tu ne sais pas quoi, mais tu attends. Un signe, un souffle, une voix, quelque chose pour te dire : je suis encore là. Même dans cette fange. Et en attendant, tu continues d’écrire. Comme si ça pouvait changer quoi que ce soit." Pour le coup, rien à ajouter. Je garde le silence.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
18 janvier 2025
Nous avons le goût de nos dégoûts. Et sommes capables d’à peu près tout au nom de la distinction. Une dame, l’autre soir, a qualifié mon tableau favori de vulgaire. Je n’ai rien dit. Son pull orange vif faisait déjà tout le travail. Nous attendrons que l’endroit devienne convenable. Une phrase entendue, peut-être dans l’une des enquêtes sociologiques de Pierre Bourdieu. À Beaubourg, sans doute. Elle remonte d'un vieux cauchemar de cette nuit. Les tapis roulants. Le prix d’entrée. Les collections permanentes, les temporaires, et, au sommet, le lunch sur la terrasse. On aperçoit les gargouilles de la Tour Saint-Jacques. Elles nous toisent, mais c’est nous, en bas, qui sommes grotesques. Le pot aux roses. Que tout repose sur un malentendu, un malentendu de taille. Un chiffre au sens de code, de secret, de dissimulé. C'est du chinois. Et toi, comment tu réagis ? Tu t’énerves, tu rigoles, tu casses tout. Ou bien tu restes là, bras ballants, collé contre le tronc. La tête dodeline légèrement, puis dévale, vesse de loup écrabouillée par un talon aiguille. Une éjaculation de fumée grise sort par les trous de nez. Si Garett nous la fait à l'envers, on gardera un chien de sa chienne à son endroit. Tu aimerais entendre le bruit des vagues, du ressac. Mais tout ce que tu entends, ce sont les mots des autres, leur va-et-vient, leurs jugements qui montent et descendent. On ne s’entend déjà pas soi-même avec soi-même, alors s’entendre avec les autres, vous pensez. Et cette autre, une dame bien comme il faut en apparence : "Moi monsieur, je suis anarchiste, non seulement je vous emmerde, mais j'emmerde la Terre toute entière et particulièrement les promoteurs, les défenseurs de la vignette Crit'Air !" (si possible en roulant les r). Et là on entendrait la chanson de Dutronc : C'était un petit jardin Qui sentait bon le Métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin Mais un jour près du jardin Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton. L'implosion aura-t-elle lieu à une heure précise ? Bien qu'on n'en sache encore pas le jour. Peut-être a-t-elle déjà eu lieu. Tout est désormais question d'espace et de temps. Nous sommes tous morts, certains se sont inventé un paradis, d'autres un enfer, les hésitants un purgatoire, un no man's land. David Lynch est mort, bon. Il était né un 20 janvier, moi le 29... ça fait peur. JANVIER. Et alors. Il est mort. Paix à son âme. Que peut-on dire de plus qui ne soit pas totalement obscène. Tous ces charognards qui profitent des morts célèbres m'exaspèrent. D'ailleurs "mort célèbre", c'est illogique. La mort a pour vocation la remise à niveau, le plein d'huile, et nettoyer le pare-brise. De quoi ? Y a presque plus un insecte volant la nuit. Donc oui, des gens célèbres, des vivants, perdent la vie. Comme tout un tas de gens, en fait. Notamment à Gaza, en Ukraine, en Russie, à Vienne, et aussi dans un ou deux taudis à deux pas de chez moi. Moi-même, je ne suis plus très sûr d'être vivant. Peut-être que tout est une farce. On meurt. Le rideau retombe, de l'autre côté on allume un clope et tout continue comme avant.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
17 janvier 2025
Il n’y a rien. Pas d’idée, pas de phrase. Juste le vide. Je regarde l’écran, la fenêtre. Il fait nuit. J’attends. Rien ne bouge. Les mots ne viennent pas. Je cherche, je force un peu, mais tout reste bloqué. Chaque fois que je commence une phrase dans ma tête, elle s’efface. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Ce ne sera pas la dernière. Et chaque fois, le doute revient. Stupeur et tremblements. Je me demande si ça reviendra, si je vais pouvoir continuer. Aller, un peu de drama, histoire d’exalter mes globules sanguins slaves. Mais je reste. Je connais la musique. J’attends encore un peu. Je pose une phrase. "Il n’y a rien." Voilà la phrase. Elle flotte. Elle baigne comme un vieux mégôt dans une flaque de café froid. Je la regarde. Elle ne s’enfonce pas sous la surface. Elle surnage. Ça pourrait être une île. Une autre arrive. Elles ne se répondent pas vraiment. Ce sont des îles isolées, le début d’un archipel, ou ce qu’il reste d’un continent englouti. Je les observe. D’autres affleurent de ce prétendu néant. Elles s’accrochent l’une à l’autre. Le vide recule un peu. Tout commence comme ça. Pas avec des idées claires. Pas avec des mots précis. Seulement avec un geste. Celui d’écrire une phrase, même si elle vacille. Puis une autre. C’est tout. Le rien, on le fuit. On le prend pour une impasse. Mais ce n’est pas ça. C’est un espace. Un endroit où quelque chose peut naître. Il ne faut pas le forcer. Juste rester. Laisser les mots venir. Je pense à Beckett. "Fail again. Fail better." Ce n’est pas une leçon. C’est une méthode. Recommencer. Accepter que rien ne soit parfait. Écrire mal. Écrire quand même. Perec fait ça aussi. Il regarde les objets, les gestes simples, ce qui ne semble pas compter. Il commence par rien. Et ce rien devient quelque chose. Les jours comme aujourd’hui, je fais pareil. Je n’attends pas l’inspiration. Je ne cherche pas la phrase juste. J’avance dans le brouillard. Je pose des mots. Ils ne me paraissent pas bons. Tant pis. Ce n’est pas important. Ce qui compte, c’est qu’ils soient là. Qu’un acte soit posé. Au bout d’un moment, ça change. Rien de spectaculaire. Ce n’est pas rapide. Ce n’est pas extraordinaire. Il faut évacuer cette idée d’extraordinaire, je crois. La chasser, plisser un peu les yeux. Quelque chose bouge. Les phrases s’alignent. Comme les déchets que l’on voit flotter dans un bassin. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que les choses qui se ressemblent s’assemblent. Il faut des heures à ne rien faire, des jours, des années, peut-être une vie entière pour voir ça. Les choses s’assemblent par nature. Les phrases aussi. Elles trouvent leur rythme. Elles poussent. Je ne sais pas comment ça arrive. Ça vient juste parce que je décide de résister à la résistance. Je regarde le texte. Il tient debout. Pas comme je l’aurais voulu. Pas comme je l’avais imaginé. Mais il est là. Je pose une phrase. Il n’y a rien. Et cette fois, je sais que c’est faux.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
16 janvier 2025
Entre ignorance assumée et absurdité ordinaire|couper{180}

Carnets | janvier 2025
15 janvier 2025
Plus je m'enfonce plus j'ai l'impression de me défaire de nombreuses peaux. A la façon d'une animalville perdue aux confins du cosmos, à sentir toute la puissance d'une frontière qui ne cesse de repousser ceux qui s'y aventurent. Le reflux est lié à la peur de disparaître de perdre conscience. Mais la conscience est l'unique chose, par malheur ou par bonheur, qui ne disparaît pas. ( reférence à Etoiles mourantes, Ayerdhal-Dunyach)|couper{180}

Carnets | janvier 2025
14 janvier 2025
Dialogue entre le narrateur et le dibbouk C’est en vain qu’au Parnasse un téméraire auteur Pense de l’art des vers atteindre la hauteur. S’il ne sent point du Ciel l’influence secrète, Si son astre en naissant ne l’a formé poète, Dans son génie étroit il est toujours captif ; Pour lui Phébus est sourd, et Pégase est rétif. (Le narrateur est seul, plongé dans ses pensées après une lecture de Villon et de Boileau. Le dibbouk, silhouette troublante et moqueuse, apparaît à la limite de l’ombre.) Narrateur : Lecture de Villon, puis de Boileau. Leur langue me parle comme si elle venait d’un temps où j’étais encore entier, encore ouvert. Et voilà que je pleure, de grosses larmes qui roulent sur mes joues vieillies. Elles sont là, non pas comme une faiblesse, mais comme une force douce. Comme des haleurs, et qui tirent, oui, un souffle qui me tire vers le fond de moi-même, là où tout commence. Dibbouk : (Surgissant, une redingote râpée sur les épaules, un mouchoir douteux à la main.) Eh bien, te voilà ! En plein drame poétique, avec des larmes et tout le reste. Tu as l’air fin. Prends donc ce mouchoir, qu’on évite au moins la mare sur le parquet. Narrateur : (Le regarde, sans colère, presque amusé.) Te moquer, toujours. Mais je sais ce que tu veux. Tu espères m’arracher à cet instant. Tu voudrais que je me justifie, que je me défende. Peut-être même que je me mette en colère. Dibbouk : (Il ricane, tendant le mouchoir à bout de bras.) La colère ? Mais ce serait un cadeau ! Au moins ce serait vivant. Regarde-toi, avec tes grandes phrases sur l’haleur. Tu sais que si tu rajoutes un "b", ça fait hableur, non ? Une belle posture pour un homme en larmes. Narrateur : (Un silence. Puis il répond, doucement.) Hableur, peut-être. Si c’est ce que tu veux voir. Mais pour moi, c’est haleur. Pas une posture, juste un effort, partagé avec tous ceux qui tirent le poids de leur vie le long du fleuve. Je ne suis pas seul. Nous sommes tous dans cette file, et je prends ma place. Dibbouk : (S’approchant, moqueur mais un peu troublé.) Et tu trouves ça glorieux, cet effort ? Tirer, tirer encore, avec la corde qui te scie l’épaule ? Tu ne cherches même pas à t’échapper ? Tu crois vraiment que ça suffit, ce tirage collectif ? Narrateur : (Souriant, presque tendre.) Oui, ça suffit. Parce que ce n’est pas une question de gloire ou d’arrivée. Je ne tire pas pour atteindre un port. Je tire parce que c’est ce qui donne un sens. Parce que dans cette haleur, il y a une chaleur, un souffle. Et ce souffle, c’est la vie. Dibbouk : (Il recule légèrement, mais son ironie revient, comme une défense.) Tu es vraiment prêt à te contenter de ça ? Pas de feu, pas de sublime, juste ce pas après l’autre, cette corde qui avance le long du fleuve ? Allons, avoue que ça te ronge un peu. Narrateur : (Le regarde droit dans les yeux, avec une douceur ferme.) Non. Ce n’est pas une fuite, ni une résignation. C’est un choix. Je ne veux pas fuir cette sensation, je veux m’y plonger. Être haleur, c’est accepter d’être en lien avec les autres, avec ce fleuve qui nous traverse tous. Même toi, tu es lié à cette file, malgré toi. Dibbouk : (Silencieux un instant, comme décontenancé. Puis il murmure, presque pour lui-même.) Haleur, hableur… Peut-être qu’il n’y a pas tant de différence. Narrateur : (Se tourne vers l’horizon, les yeux fixés sur le mouvement du fleuve.) Tu verras. Peut-être qu’un jour, toi aussi, tu sentiras ce souffle. Pas besoin de le comprendre, ni de l’expliquer. Juste le vivre, comme une corde tendue qui chante sous l’effort. (Le dibbouk s’éloigne, marmonnant, pendant que le narrateur reste là, calme, respirant l’air humide du fleuve.)|couper{180}

Carnets | janvier 2025
13 janvier 2025
Dans le mot résistif, il y a quelque chose de plus actif que dans le simple fait de résister. Il est acceptable, dans ce cas, de dire que je suis plus résistif que résistant. C'est peut-être une discipline yogique : la résistance active. D'ailleurs, je ne m'éparpille pas, focalisé sur l'action de résister sans même me demander à quoi ou contre quoi. On dirait bien que seule la résistance mérite une attention soutenue. C'est comme dire non par réflexe. À partir du moment où l'intonation ressemblerait un tant soit peu à une question : Non ! Ce pourrait être amusant si je n'avais pas déjà l'âme usée jusqu'à la corde. J'ai lu, ou plutôt feuilleté, quelques ouvrages parmi lesquels François 1er de Didier Le Fur et les essais sur les artistes de la Renaissance de Walter Horacio Pater. J'ai même fait traduire à l'IA un ouvrage complet de l'anglais vers le français pour ne pas avoir à l'acheter. Évidemment, ce sont deux visions que l'on pourrait penser opposées : entre froideur et lyrisme, ce qui correspond à ce vieil antagonisme qui loge depuis toujours en moi. J'ai effectué quelques analogies entre le fait que le père de Pater soit né à New York, qu'il ait éprouvé, à un moment de sa vie, l'envie de venir s'installer en Angleterre et qu'il soit mort alors que l'auteur n'avait que deux ans. D'où, peut-être, une légende familiale qu'il aurait tissée autour de la notion de l'éternel retour, d'une Renaissance hypothétique, et donc l'inclination lyrique qui en découle. H.P. Lovecraft, lui, perd son père à huit ans. Faut-il voir une sorte d'affinité entre Pater et Lovecraft à ce sujet ? Et aussi dans le fait que cette époque victorienne, étendue outre-Atlantique, ait causé autant de contradictions chez l'un comme chez l'autre ? Le fait que Swinburne et les préraphaélites aient attiré Pater un temps, puis qu'il s'en soit sans doute éloigné, correspondrait peut-être à la prise de conscience d'une stupidité. Mais laquelle ? La sienne, celle de son époque ? Elles le sont toutes : la stupidité de l'esprit victorien, tout autant que le contre-pouvoir, tout aussi stupide au bout du compte. Ainsi avance donc l'histoire et l'art, en crabe, par cercles concentriques. La stupidité serait à la fois source d'une force centripète et centrifuge. Là où les préraphaélites cherchaient un réalisme intransigeant et une pureté artistique, Pater développe une philosophie plus hédoniste. Il représente une transition entre le préraphaélisme et l'esthétisme britannique. Il prolonge certains aspects de l'art préraphaélite tout en développant une approche plus personnelle et philosophique. Il s'intéresse davantage à la sensation et à la jouissance esthétique qu'au réalisme prôné par les préraphaélites. Sa position peut être vue comme une évolution du préraphaélisme vers une philosophie plus sensuelle et subjective, dépassant les principes initiaux du mouvement pour développer une esthétique plus personnelle et contemplative. J'ai retrouvé, dans un coin de la bibliothèque, un Ruskin sur les maîtres anciens que je ne me souvenais pas avoir lu. Ce que je remarque aussi, c'est cette attirance, depuis plusieurs années, pour le XIXᵉ siècle, peut-être même avant la naissance de la révolution industrielle. D'ailleurs, nous vivons dans une maison bâtie en 1850. Peut-être quelques fantômes rôdent-ils encore et viennent lire par-dessus mon épaule. À ceux-là, je n'ai pas le cœur tant que ça à dire non. Il me semble parfois que je ne suis qu'un fantôme parmi d'autres. C'est aussi se poser la question d'installer une lettre d'information, une newsletter. Je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. Là encore, le non domine. Entre le peut-être et le et si, le non tranche. Ce qui, dans un certain sens, est un confort, et dans un autre, la pénibilité de reconnaître qu'il s'agit précisément d'un confort. Le mot ridicule s'estompe par moments pour être remplacé par stupidité. Conserver le courage d'être stupide n'est pas une chose facile. C'est résistif. Je n'ai pas beaucoup avancé sur la refonte du site. Mais je maîtrise de mieux en mieux les boucles dans SPIP et me suis lancé dans Grid sur CSS, histoire de changer un peu de point de vue. J'ai aussi viré Uikit et une grande partie de ce qui était en Flexbox.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
10 janvier 2025
J'ai toujours un moment dans la journée, la plupart du temps le soir avant le souper, où il faut que je dise n'importe quoi. Il y a quelque chose d'autodestructeur en moi, une envie de détruire ce que les hommes les plus riches du monde ont fait de moi. Et bien sûr, pour cela, j'utilise l'ancien Twitter. X.com est mon défouloir du soir. Cela me procure un vertige, une dose d'adrénaline, et au bout du compte un sentiment mêlé d'angoisse et de ridicule. Je crois que je suis un homme profondément ridicule. Je le crois comme on croit à Dieu, au Père Noël, à la Terre quand elle se met à être désespérément plate, et aussi que des martiens nous observent, chacun de nous, à la jumelle. En fait, la réalité est que je suis la réincarnation fortuite d'un derviche tourneur. Je ne m'en plains pas ni ne m'en réjouis, c'est simplement comme ça. Ce matin, j’ai reçu un email d’une autrice qui écrit de magnifiques poèmes sur son blog. Elle m’a confié que l’un de mes derniers articles l’avait frappée en plein cœur. J’ai été touché en retour par ses mots, et cela m’a rappelé pourquoi j’écris. Je me suis demandé si je devais la citer ou mentionner son blog ici. Est-ce maladroit de le faire ? Est-ce que cela pourrait sembler trop intrusif ? Finalement, j’ai choisi de ne pas la citer ici pour ne pas être intrusif et par superstition, espére qu'elle renouvelera son geste. Recevoir ce type de retour, c’est comme voir une fleur s'ouvrir encore une fois avant qu'elle ne se referme à jamais. Ce qui commence par un vertige solitaire trouve parfois un réceptacle, quelqu’un qui entre dans cette danse et en comprend le rythme. C’est rare, mais quand cela arrive, cela redonne tout son sens à cette manie bizarre d’écrire. Et pourtant, il faut quand même que j'essaie de réunir quelques idées qui aient un peu de sens, de temps à autre. Ne serait-ce que pour me rappeler à quel point le sens ne cesse de m'échapper de plus en plus. Peut-être que je devrais m’y résoudre. Acheter un kilo de gros sel, et tenter, comme dans l'enfance, d’attraper cet oiseau par la queue. Croisé mon voisin de droite ce matin. Un ancien ingénieur à la retraite qui a monté seul une imprimante 3D en kit venue de Chine. Rien que pour cela, il mérite tout mon respect. On s’est souhaité la bonne année. Ce genre d’échange où tout se confond dans un ballet feutré de courbettes à peine amorcées et de politesses ça finit par ressembler à une poésie (presque) involontaire : — Bonjour comment allez-vous , comment ça va, Bonne année ! — Bonjour comment ça va, ça va bien ? Meilleurs vœux ! On s’est souri, chacun reprenant sa route, comme si ce petit rituel suffisait à valider une nouvelle année de non relation qui commence. Peut-être que le sens, finalement, se trouve là aussi : dans ces petits gestes mécaniques, ces gènes pudiques répétitives qui, contre toute attente, forment avec le sable et l'eau le ciment qui tient les choses ensemble. Et puis, il y a ces moments où tout semble se délier. S. part demain à Lyon, puis elle prendra le train pour Paris de bonne heure dimanche. Devant moi s’ouvre une semaine encore floue : gouffre ou sinécure, je ne sais pas encore le tour qu’elle prendra. Il paraît que le froid revient à la charge dimanche. Il faut que je pense à remplacer la bonbonne de gaz à l’atelier. c'est pas grand chose, aller à la station service et lacher encore une carte bleue. petit geste de rien du tout mais qui, dans l'immédiat, paraît plus tangible que le reste. Parce que le sens est aussi là, dans cette bonbonne qui doit être changée, dans le froid qui s’annonce, dans ces petits repères concrets qui jalonnent les jours.|couper{180}
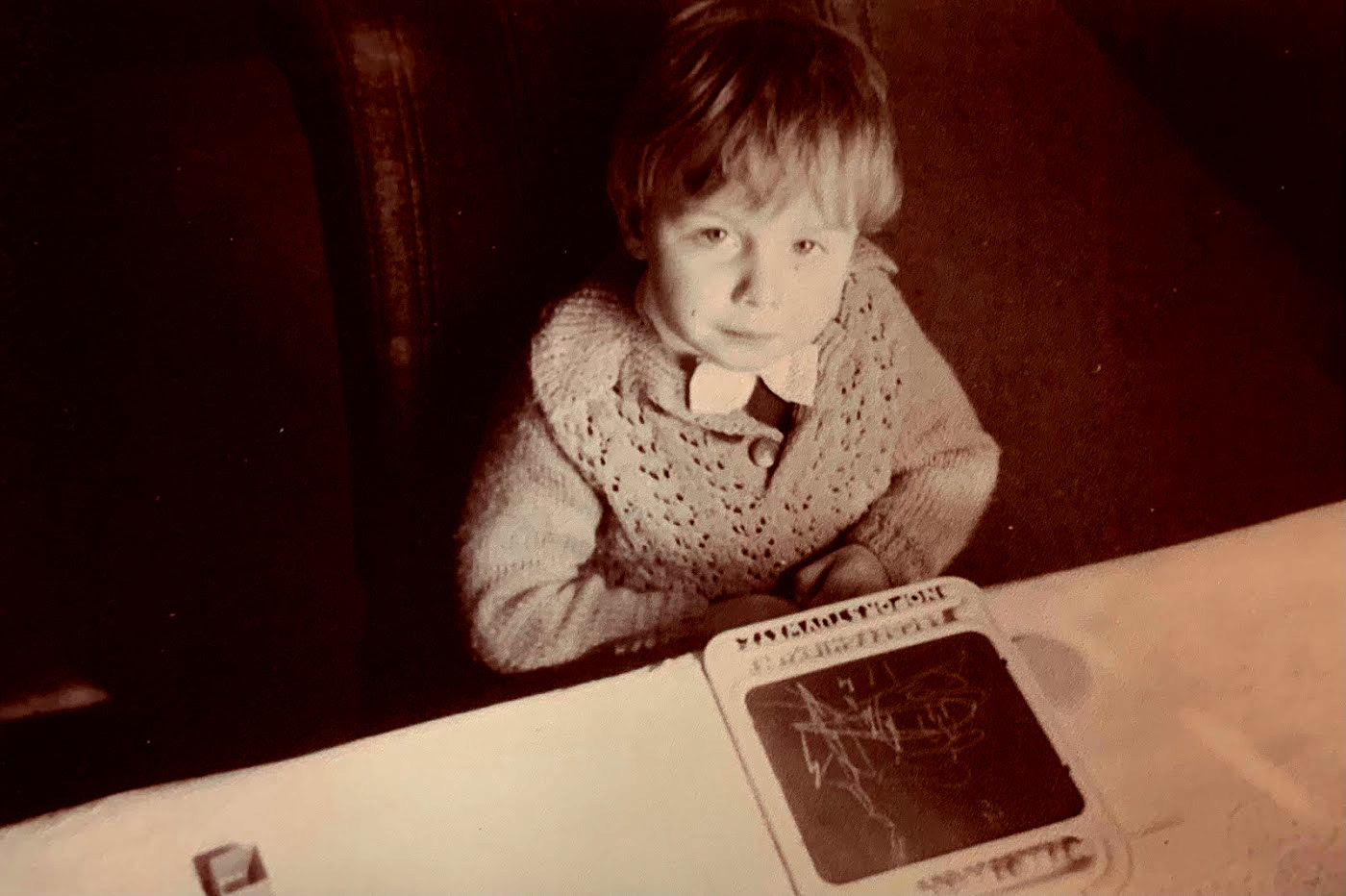
Carnets | janvier 2025
9 janvier 2025
Reprise des cours aujourd'hui. La chatte ne vient plus dans l'atelier. Elle qui, l’année dernière, dormait sur une chaise, parfaitement immobile, indifférente aux discussions, aux rires, aux éclats de voix,. Elle a trouvé un petit coin tranquille dans la remise. Je ne sais pas si c’est le bruit, ou cette tension dans l’air que tout le monde semble ressentir sans jamais la nommer. Une tension qui pèse dans chaque recoin, même dans les lieux où elle n’a rien à faire : un cours de peinture, une réunion associative, un coin de coworking. Peut-être que nous non plus, nous ne savons plus où aller. Les tiers lieux, autrefois, avaient un sens. Ils n’étaient pas des refuges ou des parenthèses, mais des bastions. Des lieux où les gens se rassemblaient non pas pour oublier le monde, mais pour le changer. Des bars populaires où l’on décidait des grèves, des mutuelles où l’on organisait la solidarité face aux accidents de la vie, des coopératives où l’on apprenait à se passer de ceux qui nous exploitaient. Ces lieux sentaient la sueur, le tabac froid, le café bon marché. Ils n’avaient rien de design ou d’inspirant. Mais ils vibraient d’une colère qui n’avait rien de stérile. Une colère qui, transformée en action, devenait une force collective. Aujourd’hui, quand je vois un attroupement, j’ai peur. Pas peur qu’il se passe quelque chose de grave, mais peur que ce soit pire : qu’il ne se passe rien. Que cet attroupement ne soit qu’un simulacre, une mise en scène vide de sens. Les attroupements d’aujourd’hui ne se forment pas autour de chats écrasés, mais autour d’idées polies jusqu’à en devenir inoffensives. La charité, par exemple. Cette charité qui donne à certains le sentiment d’être des sauveurs et aux autres celui d’être des objets de pitié. Ou encore ces initiatives de coworking, où chacun travaille pour soi dans une illusion de collectif. Ou alors ce sont des prétextes à vociférer, à danser sur les cadavres, à célébrer à peu près tout et n'importe quoi et dans le même temps cracher sur son contraire. Peut-être que j’ai peur parce que je me reconnais dans cette bande d’individualistes forcenés. Parce que moi aussi, je me cache sans doute à ma façon derrière des mots. Et sans doute est-ce pire puisque je le fais tout à fait lucidement. La chute des tiers lieux, celle qui a commencé dans les années 1980, n’est pas seulement une histoire de désindustrialisation ou de politiques néolibérales. C’est une histoire de fracture. Dire que j'ai embrassé des inconnus un certain mois de mai 1981... ça me fait drôle d'y repenser. À mesure que les usines fermaient et que les quartiers ouvriers perdaient leur cohésion, l’État a trouvé une nouvelle stratégie : déléguer. Sous prétexte de subventions, il a transformé les espaces collectifs en lieux de gestion des problèmes sociaux. Les associations ont pris le relais des services publics, mais sous des conditions strictes, avec des moyens dérisoires. C’est là que tout a basculé. Les tiers lieux sont devenus des espaces de charité et de gestion, et non plus des lieux d’émancipation. Dans les associations où j’ai enseigné, je l’ai vu de mes propres yeux. La résistance à payer, même une cotisation dérisoire. Cette idée que tout doit être gratuit, que tout est dû, mais que rien ne doit engager. Un professeur de peinture, là-bas, gagne moins qu’une femme de ménage à l’heure. Ce n’est pas une plainte. C’est un fait. Et c’est un fait qui dit tout. Quand le confinement de 2020 a interdit les rassemblements, j’ai pensé que quelque chose venait de mourir pour de bon. Pendant des mois, il était interdit de se voir, de se parler, même maladroitement. On a fermé les portes des espaces qui existaient encore, fragiles et imparfaits. Quand elles ont rouvert, ce n’était plus pareil. Dans mes cours de peinture, je vois ces tensions remonter à la surface. Les élèves arrivent avec leurs pinceaux, leurs toiles, leur silence. Ils veulent peindre, échapper un moment aux fractures du quotidien. Mais à chaque cours, ou presque, quelque chose explose. Une remarque, un soupir, une frustration. Je me souviens de cette élève, un jour. Elle s’est arrêtée au milieu de son tableau et a dit, presque en riant : « Ma zone de confort, c’est ça. Ce désespoir. » Le vent s’est levé juste après. L’auvent a claqué avec une force qui semblait répondre à sa phrase. Personne n’a bougé. On est restés là, figés, comme si quelque chose venait de nous traverser. Et la chatte, elle, n’est jamais revenue. Les tiers lieux manquent. Pas les espaces qu’on appelle ainsi aujourd’hui, avec leurs brochures bien léchées et leurs hashtags de campagne. Mais les vrais, ceux qui donnaient un cadre aux tensions, un sens à la colère. Sans eux, tout flotte. La violence surgit dans les endroits les plus improbables : dans un cours de peinture, dans une file d’attente, dans un regard qui s’attarde trop longtemps. Parfois, je me dis que je dramatise. Que tout ça n’est qu’un reflet de mes propres frustrations, de mes propres peurs. Mais quand je vois ces attroupements, ces silences, ces éclats, je ne peux m’empêcher de penser qu’il nous manque quelque chose. Quelque chose qui ressemblait à ces lieux où l’on pouvait tout poser sur la table, sans crainte. Ces lieux où l’on pouvait être humain, pleinement, sans performance ni masque.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
8 janvier 2025
Il y a des jours où l'on a l'impression de ne rien faire. Où les heures s'étirent comme ces jeans stretch qui ne vous avertissent pas que vous sombrez dans l'obésité. Et soudain, l’élastique pète, le pantalon tombe, et on se retrouve cul nul, les mains en croix, tentant d’imiter la feuille de vigne. On se retrouve à poil devant son propre néant, sa propre absurdité. Etrange, peinture huile 2010 Hier, j’ai codé. Toute la journée, absorbé, avalé par le temps comme l’enfant du tableau de Goya. Chronos n’est pas cruel : il est indifférent. Des lignes de code, comme on taille des pierres. Sauf que je n'ai pas l'abnégation d'un bâtisseur de cathédrale. On voudrait savoir toujours ce qu'on fait, quel résultat, pour quand, évidemment pour le plus vite possible. Pour hier ou avant-hier. Alors que ces gars-là, pensaient-ils au temps, à 100, 200, 300 ans après eux ? Avaient-ils seulement le temps d’y penser, l’envie ? Nul ne le sait. Et moi, je travaille dans l’urgence, sous la pression silencieuse d’un monde qui exige des résultats immédiats. Chaque ligne de code ressemble davantage à une pierre posée à la hâte qu’à un bloc sculpté pour l’éternité. Alors, hier, je me suis dit que j’étais un vieux nul, que ma vie était gâchée. Que le temps n’offre aucune rédemption aux salauds qui s’égarent. Et puis cette impression perpétuelle de ne pas être fini. D’être "fini à la pisse". Ce n’est pas de la tristesse qui en découle, mais de la rage. Une rage brutale, dirigée contre moi-même. Et ce que je découvre, c’est que même cette rage ne m’appartient pas vraiment. Elle est un programme, une routine écrite par le système qui m’entoure. Ce système, capitaliste, s’insinue jusque dans mes neurones, mes globules rouges et blancs, mon ADN. Alors vient la question pavlovienne : comment s’en sortir ? Ce "comment" est une boîte noire. Dès que je l’ouvre, surgit une foule. Des noms tirés de ma mémoire, de l’actualité, des figures suspectes et nocives, incapables d’aider. Je le sais : personne ne m’aidera. Mais je continue à entretenir cette pensée, comme on nourrit un animal de compagnie. Peut-être pour ne pas affronter cette certitude effrayante : être irrémédiablement seul. Et il y a eu cette vidéo. Une interview de Sylvie Ferré. Je ne savais pas qui elle était. Mon ignorance m’a frappé comme une gifle. Ce n’était pas seulement une inconnue. C’était un gouffre qui s’ouvrait sous mes pieds, un rappel brutal de tout ce que je ne sais pas, de tout ce que je ne saurais jamais. J’ai pensé à ces listes infinies de livres que je n’ai pas lus, à ces auteurs qui disparaissent dans les marges de mon esprit, jamais explorés. À quoi bon coder, écrire, créer, si les gouffres restent si vastes ? Peut-être est-ce pour cela que je me suis intéressé à la poésie informatique de Philippe Bootz. Une envie de sortir du sens, d’abandonner la quête de la signification pour ne garder que l’émotion. Pure. Indéfinie. Est-ce une fuite ? Un effacement de moi-même dans des lignes abstraites ? Je n’en sais rien. Je sais seulement que ce dégoût que je ressens envers moi-même m’oblige à m’éloigner du monde. Je ne peux que lui renvoyer ce que je porte en moi. Hier, dans la lumière froide d’un écran, j’ai créé des fiches dans Obsidian pour consigner tout cela. Comme si écrire pouvait réduire ce que je ressens. Comme si, au bord du gouffre, les mots pouvaient construire un pont, branlant mais suffisant pour s’engager de quelques pas de plus dans la jungle épaisse, moite, dangereuse de soi-même, sans guide ni carte ni boussole. Plus je rentre au fond de moi-même, plus j'ai l'impression de pénétrer dans un bâtiment délabré, une ruine. Sauf que dans le tâtonnement, mes mains effleurent parfois des aspérités sur les parois, une sorte d'écriture antédiluvienne. Et là, me revient cette pensée qui m'avait entraîné dans une folle aventure : l’écriture d’un feuilleton, au jour le jour, sur un ancien blog. Celle de ce type qui découvre peu à peu qu'il est une créature extraterrestre de la pire espèce, venue passer des vacances sur la planète Terre. Tu parles de vacances.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
6 janvier 2025
Peinture : Gérard Garouste Le savoir, c’est très bien. Mais désormais, il semble accessible à profusion, partout, tout le temps. Ce qui ne change pas, ce sont les rivalités qu’il suscite. Les vénérations absurdes. Les jalousies. C’est aussi pour ça que je recule devant des expressions comme : "Tu sais", "Moi, je sais", "Comment ? Mais tu ne sais pas ça ?". Elles m’agacent. Elles me fatiguent. F.B., lui, avance. Il s’est lancé dans une entreprise folle : décrypter les carnets de Lovecraft, ces deux lignes quotidiennes, sèches et laconiques autour de quoi il recrée toute une vie et toute une époque en parallèle de la notre 1925-2025. Je regarde ses vidéos, hypnotisé. Lovecraft écrivait peu à chaque fois, mais chaque jour dans ces commonplace books. Deux lignes par jour la plupart du temps. Moi, j’écris beaucoup, souvent pour rien. Je ne dispose pas de la faculté de concision, qui nécessite celle du tri, du rangement, propre à une certaine rigidité d'esprit. Ce qui n'empèche pas le "vouloir écrire" l'aspect obsessif ( j'ai vu qu'on pouvait désormais remplacer obsessionnel par obsessif ) Je repense à ce que disait Daniel Oster, à propos de la façon dont Apollinaire a inventé son nom. Un nom comme un Non. Un refus craché au monde. Combien de fois ai-je rêvé de m’allonger sous un chêne, attendre que les choses invisibles m’appellent par mon vrai nom ? Mais rien n’est venu. Juste quelques cacas d’oiseau. Alors je me fabrique un couvre-chef de brindilles, la tête haute. Lefol, Lepitre tu portes bien ton nom ! crient encore les gamins en riant. Mais moi, je continue d'avancer je suis César, Jésus, ou Saint Jean-Baptiste transpercé de flèches. PORC-ÉPIQUE ensanglanté. Peut-être que c’est ça, écrire : une navigation entre les brindilles et les livres, les épines , la candeur, la lucidité, le silence et le trop-plein. Peut-être que c’est dire non, à chaque fois, tout en cherchant dans ce chaos la vérité d’une seule ligne. Quelque chose qui tienne, donne l'illusion de l'unité, jusqu’au lendemain. À la fin de la journée, au début d’une autre, j’ai toujours l’impression de sortir d’un rêve. Comme d’une vidéo, d’une lecture, d’une séance d’écriture. Un tout petit moment de lucidité, extrêmement douloureux. Comme une agrafe plantée dans le pouce. Ça ne dure pas. Presque aussitôt, après être remonté à la surface, je m’enfonce à nouveau : un somnambulisme obligé pour supporter la déliquescence générale de l’époque.|couper{180}

Carnets | janvier 2025
5 janvier 2024
Je sombre. Une ardoise dégringole du toit , glisse en zigzag, en nuances de gris : aile de pigeon, pierre ponce, volcanique, anthracite. Guidé par une étrange désinvolture, fruit de l’apprentissage des répétitions. Ces jours peu glorieux que nous traversons, accablés. Ces jours où le plus petit prétexte suffit pour ne pas se réjouir. De rien. Tout au contraire : psalmodier intérieurement une plainte, en boucle. Une volonté. Celle de sombrer. Plus profondément encore. Apnée. Une image facile. Elle remonte à la surface comme une bulle : le plongeur du film Le Grand Bleu. Mais moi, je suis encore là. Pas dans l’eau, non. Dans le désert. Ce mirage : cet horizon qui recule à mesure que l’on avance vers lui. L’inatteignable. Le dibbouk dort sur le fauteuil crapaud. Son ronflement est régulier, tenace, obstiné. Il a retiré ses godasses, et j’ai vu ses chaussettes trouées, son gros orteil à l’ongle recourbé, comme une griffe d’animal. Une bouffée de compassion a bien failli me tomber dessus. Mais j’ai ouvert mon parapluie juste à temps. Vieux salaud ! Vieille bourrique ! J’ai pensé si fort qu’il a entrouvert une paupière. Puis il a ouvert sa bouche édentée, a baillé. Ses coudes ont pris appui, il a redressé son tronc et sa tête et, après un instant, il a articulé lentement : « Pe-tit con-nard. » Chaque syllabe frappait comme un marteau. J’ai détourné le regard. Ma chatte m’a appris ça la semaine dernière. Ou peut-être que je ne l’ai compris que récemment. Les bébés, les chattes, les loups ne s’accrochent pas au regard. Pas tous les bébés. Mais la plupart des chattes et des loups, oui. J’ai lu Les Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Bien. Mais c’est de la littérature. Et je me demande si ce que je fourre dans ce mot, « littérature », n’est pas la même chose que Monique Pinçon-Charlot fourre dans le mot « riche ». Nous fourrons. Nous avons besoin de ça, de cette manie du fourrage. On y enfouit tout ce qui passe, tout ce qui traîne, tout ce qui nous gêne. Au bout du compte, ce n’est qu’une collection de charentaises confortables. Un fourre-tout. Mais ça donne l’illusion d’avoir quelque chose, pour ne pas se retrouver avec rien. Passé une grande partie de la nuit à m'amuser sur trois phrases accompagnées de java script, de css. Puis au matin j'ai tout effacé. C'est l'histoire de ma vie en trois mots. Un brouillon qu'on ne cesse pas de biffer. – Tu pourrais m'appeler par mon petit nom geint le dibbouk. Etre un peu aimable ... – Ta gueule ! un peu plus tard... Je sombre. Ardoise qui chute, dégringole, se fracasse. Nuances de gris. Pierre ponce, aile de pigeon, volcanique, anthracite. Une palette de cendres. Rien d’autre. Le goût de rien. L’apathie d’une pierre. Je descends, c'est de tout façon une répétition. Une rengaine. Une lassitude qui s’étire, interminable. Ces jours écrasants, plombés. Ces jours où tout devient prétexte à ne pas se réjouir. Pas une seule raison valable, et pourtant… sombrer. Creuser. Toujours plus bas. Apnée. L’image est facile. Une bulle qui remonte mollement à la surface, dégonflée. Le plongeur du Grand Bleu, oui, mais il n’y a pas d’eau ici. Juste du sable. Le désert. Cet horizon qui te ment en pleine gueule, qui te fait croire qu’il est là alors qu’il est toujours plus loin. Une blague. Un mirage. L’inatteignable. Le dibbouk dort sur le fauteuil crapaud. Il ronfle comme un moteur grippé, régulier, implacable. Il a jeté ses godasses dans un coin, et ses chaussettes, trouées aux talons, laissent voir la crasse. Un ongle noir, épais comme une griffe d’animal. Ce spectacle m’a filé la nausée. Un instant. Peut-être une once de pitié. Mais non. J’ai ouvert mon parapluie avant que ça me tombe dessus. Pas aujourd’hui. Vieil enfoiré. Je pensais si fort qu’il a fini par bouger. Un œil s’est entrouvert. Puis il a baillé, une bouche vide comme une tombe. Il s’est redressé, lentement, poussant sur ses coudes. Puis il m’a balancé : « Pe-tit con-nard. » Chaque syllabe était une gifle. Je n’ai rien répondu. Rien. J’ai tourné la tête, comme ma chatte me l’a appris la semaine dernière. Oui, ma chatte. Elle détourne le regard. Les bébés aussi, parfois. Les loups, souvent. Instinct de survie : ne jamais affronter les regards inutiles. Et puis, Ishiguro. Les Vestiges du jour. Un bon livre, sans doute. Mais ça reste de la littérature. Je dis « littérature » comme Monique Pinçon-Charlot dit « riche ». Un mot fourre-tout. On y jette ce qu’on ne sait pas nommer autrement. On fourre, on remplit, on meuble. Ça donne l’impression d’avoir quelque chose, n’importe quoi, au lieu de rien. Des pantoufles bien usées dans un sac troué. Voilà tout. Je lis Claro. Tous les diamants du ciel. C’est une écriture qui brille, qui scintille, qui jette des éclats à chaque phrase. Il y a là un petit miracle. À chaque foutue phrase, oui. Et c’est agaçant. Parce que trop de miracle tue le miracle. Parce qu’à force de s’émerveiller, on se lasse. Parce que tu aurais aimé faire pareil ?... Le bouquin me tombe des mains. Pas la tête à la religion, pas aujourd’hui. Je l'ai vu y a pas longtemps ( toujours le même ) il parle de poésie désormais. Je crois que la poésie c'est une autre histoire. La performance flirt rapidement avec le ridicule en poésie. Je n'ai absolument rien contre le ridicule. Et puis, autre chose. Concernant la littérature Je vois les coutures. Le fil. Les ficelles. Je les vois chez moi, évidemment, comment ne pas les voir ? C’est mon travail, mon chantier, mon fatras d’imperfections. Mais chez Claro ? Là où je m’attendais à une fluidité parfaite, une absence de traces, de grincements ? Là où je m’attendais à oublier l’artifice ? C’est comme découvrir le câblage derrière une scène de magie. Le fil qui soutient le miracle. Et une fois que tu le vois, impossible de ne plus le voir. Tout tombe en morceaux. Ce qu’il me reste de tout ça, c’est une impression mi-figue mi-raisin. Un goût de déception douce-amère. Une idée de performance, surtout. Voilà ce que c’est : un exercice, un tour de force. Une manière de dire : « Regardez comme c’est bien fait, comme c’est brillant. » Et cette idée me déserte. Elle me fuit. Elle s’efface un peu plus chaque jour, me laissant avec un vide abyssal. Et si je ne peux même plus espérer performer, alors quoi ? Si même cet espoir – cet espoir dérisoire, fragile, de faire quelque chose de juste, de puissant, d’inévitable – s’effondre, alors que me reste-t-il ? Rien. Pas même la peau sur les os. Juste une vieille peau, usée, bonne à jeter. Il y a dans la littérature – et je commence seulement à le comprendre – une sorte de caste. ( à moins que j'ai la berlue ) Rien de nouveau, évidemment. Mais les évidences, quand elles frappent, c’est toujours elles qui surprennent le plus. Parce qu’elles ne se contentent pas d’être là, non : elles se déplacent. Elles glissent. Elles se cachent, et puis, un jour, elles éclatent au grand jour. Et ce déplacement du curseur, c’est justement le fascinant : la manière dont l'évidence peut mener aussi bien à la catastrophe qu'à l'émerveillement. N'est-ce pas finalement la même chose ? Je le vois, ce curseur. Il glisse lentement, presque imperceptiblement. Entre le "dedans" et le "dehors". Entre ceux qui appartiennent à ce cercle feutré qu’on appelle la littérature – ses réseaux, ses connivences, ses clins d’œil – et ceux qui restent sur le seuil, à regarder. Un déplacement minuscule, mais aux conséquences énormes. Parce que ce curseur ne se contente pas de délimiter, il tranche. Il exclut, il choisit. Et si tu le vois trop tard, il t’a déjà renvoyé dans l’ombre. C’est peut-être ça, la littérature : un jeu d’équilibres, une tension entre la caste et l’ouverture, entre le sublime et le grotesque. Un mouvement perpétuel, une oscillation entre ce qui illumine et ce qui consume. La catastrophe ou l’extraordinaire. Rien au milieu. – C'est vraiment pas clair ton histoire dit le dibbouk , t'as besoin de raconter ta vie, tu peux pas foutre un peu la paix aux gens ? Il veut arrondir les angles il me fait un sourire édenté. Ecoeurant.|couper{180}
