juillet 2024
Carnets | juillet 2024
18 juillet 2024
« Le jour où vous cesserez de vouloir démontrer quelque chose, en espérant que ce jour advienne, c’est tout le malheur que je vous souhaite. Revenez me voir. » Il m’avait dit ça en expulsant lentement la bouffée d’une cigarette. La spirale de fumée, en s’élevant, semblait refléter la profondeur de cette réflexion. Pour dissimuler mon malaise face au silence pesant, je consultai ma montre. « Il est l’heure, » dis-je d’une voix effroyablement enfantine, celle qui me trahit toujours lorsque je me sens plus bas que terre. L’homme de lettres, perdu dans sa contemplation de l’extérieur, ne sembla même pas m’entendre. Il ne tourna pas la tête. Quelque chose était clos. Timidement, mais avec irritation, je tentai de suivre son regard, de percer moi aussi l’opacité des vitres poussiéreuses de la pièce où il m’avait reçu dix minutes auparavant. Tout était flou. Mon regard ne parvenait pas à traverser cette opacité, et j’imaginais sans peine l’écart entre nous. Lui, l’homme de lettres, plissant légèrement les paupières, avait accès à tout l’extérieur, le grand dehors, le monde. Il y voyait des choses qui m’étaient invisibles, et c’était terrifiant de penser qu’elles pourraient le rester indéfiniment. Des choses inatteignables, innommables, dont l’absence me manquerait affreusement. J’en ressentais déjà la douleur physique. Je me tortillai maladroitement sur ma chaise, puis me mis d’un coup sur mes deux jambes, balbutiai un au revoir et ne reçus qu’un adieu en retour. Vous pouvez être un des plus grands acteurs de votre génération, et être un con achevé dans la vie, dit le petit jeune homme. Tout ça pourquoi ? Parce que l’acteur l’avait à cet instant oublié. Il avait fait tout ce déplacement depuis Aubervilliers vers Les Halles et repris encore une correspondance pour se retrouver à l’heure au théâtre à République. Il était arrivé en nage, sa chemise collant désagréablement le bas de son dos, son sac en bandoulière, un de ces vieux sacs photo avec des protections intérieures en mousse, objet désuet des années 80. Il avait insisté pour qu’on le laisse passer. « Mais puisque je vous dis que j’ai rendez-vous avec monsieur F.H. C’est pour un reportage, oui. » Il était arrivé pile au moment où Andrzej Żuławski engueulait C.L. puis F.H lui-même. Le visage de l’acteur était devenu blanc, presque fondant comme de la cire sous l’effet de la chaleur. La sueur. Les éclats de voix. Le maquillage dégoulinait. Ce n’était certainement pas le bon moment pour lui rappeler leur rendez-vous. Mais il le fit tout de même. L’acteur ne le regarda même pas, le laissa planté là dans l’étroit couloir, à la porte de la loge derrière laquelle il venait de disparaître. C’était terminé, définitivement, il le comprit. Depuis, le jeune homme ne loupait pas une occasion pour dire à qui voulait bien l’entendre, ou pas : « Vous pouvez être un des plus grands acteurs de votre génération, et être un con fini dans la vie de tous les jours. » On le toisait un instant comme si on voulait ajouter quelque chose, puis on reprenait le cours de ses pensées. Tout le monde oubliait si facilement, sauf lui, le petit jeune homme. Sa rancune était tenace. « Tu devrais lui apporter des fleurs, des roses rouges n’est-ce pas ? » « Mais si elle est aveugle, quelle importance ? Et même, on pourrait choisir des fleurs moins coûteuses, on ne roule pas sur l’or tout de même. Mais Arletty, ce n’est pas rien ni tous les jours qu’on irait sonner à la porte avec un bouquet. » Sur la boîte aux lettres, c’était écrit madame Bathiat rue Rémusat. Ce n’était plus elle qui ouvrait mais une jeune fille aveugle, elle aussi. Sans doute une artiste de l’association des artistes aveugles du faubourg Saint-Martin. « Moi, je suis une fleur du faubourg, » ajoutait-elle toujours avec malice. « Surtout une belle saleté de collabo, » avait dit R. en se remémorant. « Arrête-donc tes bêtises, est-ce que tu y étais, en quoi tout ça te regarderait ? Un portrait de Céline à côté de Soehring le boche – ah l’amour, quel métier d’enfer. » Des petits pas menus, une autre artiste aveugle. « Des chrysanthèmes, comme c’est aimable à vous, un peu précoce mais bien gentil tout de même. Madame Arletty dort. Si vous voulez, laissez votre carte et repassez demain ou un autre jour. » Mille fois je me suis imaginé la maison du poète, le voyage en car jusqu’à Omonville-la-Petite. Madame Blaisot, notre professeur de français, aurait certainement porté sa robe beige, son imper clair et son écharpe rouge. Il pleut souvent dans la Manche. Ce jour-là, je n’ai pas pu effectuer le voyage, j’étais alité, ma santé fragile au tout début de l’adolescence. Ma mère avait téléphoné à la dernière minute. « Désolé, il ne pourra pas venir, » et elle avait raccroché. J’en avais été vraiment peiné et cette peine s’était immédiatement transformée en quinte de toux et curieusement en cette rêverie : effectuer le voyage vers Prévert par mes propres moyens, notamment à travers le recueil « Paroles » que je chérissais particulièrement. J’étais à Nantes sur un pont à Brest dans des ruines, les bombes, les cris la guerre , la chanteuse Barbara, avec les joues et le front giflés de pluie, sur l’ air de Göttingen ou bien j’entendais le petit bruit de l’œuf dur que l’on brise sur un comptoir d’étain et qui sert le cœur de l’homme qui a faim. À 10h, le car a dû s’arrêter pour faire une pause et j’ai sorti mon sandwich, j’ai cassé la croûte avec tous les autres. Il y avait de l’eau et du sirop dans ma gourde. Ce sont les autres qui m’ont raconté la suite. Madame Blaisot nous a même enregistré toute la rencontre sur un magnétophone. On faisait un journal radiophonique à l’époque. On avait aussi vu Kessel, enfin là non plus je n’avais pas pu venir, j’étais encore malade ce jour-là.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
17 juillet 2024
Plus je lis, plus j’éprouve de difficultés à écrire. L’envie se heurte à un mur infranchissable, un mur que je construis moi-même, de mes propres mains, avec mes propres moyens et surtout mes lacunes. Cela paraîtra enfantin à la plupart des gens que je fréquente. Pour eux, cette souffrance n’a aucun sens. Ils diraient : « Tu ferais mieux de peindre. » Et ils auraient raison. Après tout, je m’interroge peu sur la nécessité d’écrire, cette même nécessité qui m’ordonne de lui obéir, d’une manière si servile que cela me dégoûte rien que d’y penser. Plus je lis, plus je mesure cet écart étrange entre l’envie qui me presse d’écrire – souvent des choses insignifiantes – et ce que pourrait être, si je faisais encore de nombreux efforts, des efforts surhumains, la véritable littérature. Et là se présente le choix : en rire ou en pleurer. Plus je lis, plus j’ai conscience que je lis mal, que j’ai toujours si mal lu. Que la lecture ne m’a jamais servi qu’à la façon d’un miroir avantageux. Et désormais, apercevoir ce reflet m’est devenu insupportable. Il y a sans doute du désir, mais tellement terni par l’envie, la jalousie, l’idée du manque, d’une pauvreté voire même d’une misère qui resterait collée à qui je suis, indécrottable. Plus je lis, plus je décortique lentement les phrases, les paragraphes, les pages entières avec une lenteur anachronique. Comme si cette nécessité de prendre tout le temps possible pour lire une page m’était imposée comme sanction pour avoir osé jadis lire tout et n’importe quoi dans une fulgurance, un appétit d’ogre, ou d’aventurier cupide et imbécile. Plus je lis, plus je vois à quel point je suis éloigné du moindre amour, de l’amour véritable, simple, authentique, et ce depuis toujours, comme si tout devait m’être adressé et que je n’adresse presque jamais rien, résidant dans une maladresse propre à l’égocentrisme des petits enfants. Plus je lis, plus je me rends compte que je ne sais pas plus lire que je n’ai su aimer qui que ce soit, pas même moi. Je me rends compte que j’ai toujours été si loin du compte, incapable de déchiffrer les signes, tant ceux provenant d’autrui que ceux émanant de moi vers les autres. Plus je lis, plus je me complais à m’en vouloir de mes inaptitudes, plus je sombre dans le ridicule, le grotesque de tout cela. Et paradoxalement, plus j’ai l’étrange sensation que cela me fait du bien. Plus je lis, plus je ressens ce besoin de prendre tout le temps possible, de vouloir atteindre une sorte de plénitude du temps par la lecture et l’écriture. Mais cette quête est floue, indéfinissable, comme si je ne savais pas vraiment ce que je désirais atteindre. Est-ce le moment présent, l’éternité, ou simplement une illusion de contrôle sur le temps qui m’échappe ? Tout cela semble sans intérêt, une démonstration, une exhibition. J’ai découvert Christian Garcin par l’intermédiaire de F.B. (proposition n° 17) et j’ai lu hier soir jusqu’à tard dans la nuit « Les vies multiples de Jeremiah Reynolds ». Le sujet est fascinant, l’histoire et l’intrigue captivantes, et la manière dont elle est documentée me laisse sans voix. Aujourd’hui, j’écris ces lignes le 7 juillet, à 7h du matin. Je n’arrive pas à accepter l’idée que l’extrême-droite puisse remporter les élections législatives. Ici, la candidate du Front Populaire s’est retirée, nous laissant face au RN et à Renaissance. Une comédie répétitive, ordinaire des élections de tout acabit. C’est étrange d’imaginer la relecture de ce passage, qui ne sera publié que le 18 juillet. À ce moment-là, les jeux seront faits, ou tragiquement, une sensation prévisible d’accablement me saisira à la lecture des résultats ce soir-là.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
16 juillet 2024
exercice d’écriture #12, trois blocs paragraphes, trois traversées, avec comme enjeu à la fois la totalité d’une ville, en quelques traits, et l’espace entre les trois, est-ce que ça ne fait pas une autre totalité aussi, ou un commencement de quelque chose qui pourrait apparaître ainsi, c’est à dire un autre point de vue sur ce qu’est la totalité de quoique ce soit. L’arrivée à Santa Lucia une nuit d’hiver et, après une brève déambulation, flirter avec l’idée d’emprunter la Ferrovia, à cette heure tardive peu encombrée de voyageurs, en bordure de lagune assaillie mollement par les vaporetti quasi vides. Au loin, il est possible d’apercevoir par-dessus les canaux des silhouettes peu nombreuses et, plus loin mais pas tant que ça quand même, la ville presque entièrement endormie, voire morte. Il suffit qu’il ait un peu plu juste avant pour que le pétrichor mêlé à la chancissure vous attrape le nez, et d’aller quérir dans le charroi de sensations troubles que ça procure, une vague trace d’iode. C’est tout de même les congés, on n’ose dire vacances. Marcher est plus sûr, et le plaisir d’avancer ainsi par-dessus les gondoles ornées de leurs proues servant l’équilibre dans l’asymétrie, leurs couleurs noires ayant mis fin à toute esclandre et autre rivalité, présences flottantes à peine chuitantes, bâchées à quai. Et soudain, d’entendre résonner son propre pas sur les pavés. Omniprésence de la mer à l’assaut de la pierre, partout, lenteur palpable d’un magistral désastre, l’enfoncement d’une ville dans la nuit comme dans l’eau noire qui l’entoure, la digère déjà. La progression s’effectue à pas mesurés, avec en tâche de fond la très vague adresse d’un hôtel près de la galerie où Zoran Music expose de façon permanente ses dessins et peintures souvenirs de Dachau pour la plupart. L’arrivée à Belgrade par la route n’offre guère que de grands terrains vagues, barres d’immeubles sans grâce. On sent que quelque chose s’est retiré mais pas complètement encore. Tout comme si l’on s’enfonçait à quelques encablures à peine du centre-ville de Prague, on tomberait irrémédiablement sur ces pensions tenues par des matrones et des ruffians qui, en d’autres temps, vendaient père et mère pour une pincée de sel, un bol de farine. On trouvera aussi ces magasins mal achalandés, aux vitrines sales, sans le moindre effort de réclame, comme on en trouve aussi à la Havane. C’est comme la traversée d’un mauvais rêve qui ne débouche que sur d’autres mauvais rêves, avec de temps en temps un âne rouge qui flotte, un ange et une jument verte, et par-delà la perspective atmosphérique, embrumée, des ponts au-dessus de la Vltava, le bouchon de champagne qui pète la nuit de la Saint-Sylvestre sur le pont Charles. Les badauds ahuris frappent du pied et des mains, les musiciens font les pitres pour obtenir 30 couronnes tchèques, à peine de quoi pour un café. Et le lendemain, miracle de l’administration ou de la voirie, pas un seul papier gras, tout est propre, sans tâche, vierge pour recommencer une nouvelle journée. La traversée des villes que l’on ne connaît guère que par l’odeur de leurs gares, celle de San Sebastián avec l’Urumea qui charrie toute une invisible pourriture la nuit et qui remonte sur ses berges, colonise les bancs publics, s’incarne en lie humaine qui soudain se dresse et demande l’aumône. La gare de Pontoise, les lundis matins notamment, sent le tabac froid, l’après-rasage, le crissement de craie sur le tableau noir. Pas loin de là, passe l’Oise et ses nappes de gazole, ses cadavres de bouteilles vides, ses chatons mort-nés. L’arrivée par le petit sentier qui longe la voie ferrée entre Parmain et Valmondois, à la gare de poupées où l’on prend le TER, qui s’arrête à toute gare, procurant ainsi une première version de l’interminable. Au début, parce qu’ensuite on se crée un emploi du temps très vite à renifler les voyageurs, à s’inventer leurs vies, à lire des romans, à défaut de pouvoir en écrire. Gare de Lyon, en voilà une de gare, près de Bercy qui avant n’était qu’un regroupement de maisons basses, des entrepôts viticoles, du temps où l’ouvrier buvait ses 5 litres sans sourciller, avant le grand chambardement, le grand remembrement, avant quand il y avait encore des haies, quand on ne les avait pas encore réinventées à grands renforts d’eurêka pédants. La traversée d’une vie entière ainsi en train, par la route, à pied, à cheval, en voiture, très rarement en avion ou en mulet. Dommage, ce serait bien de prendre le temps, d’emprunter les routes de traverse, les sentiers buissonniers, le chemin Stevenson ou Benjamin, sans qu’on nous oppose la frontière, la norme, la sécurité, le meilleur confort utilisateur.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
15 juillet 2024
L’emploi du participe présent permet d’éviter celui de la subordonnée relative. Je déjeune écoutant les commentaires radiophoniques tartinant, beurrant une biscotte sur l’autre comme il se doit pour ne pas la briser. Nous sommes aujourd’hui le 1er juillet, l’air est un peu frais à l’extérieur, le soleil se lève, à 9h j’irai décrocher l’exposition de S. Du mal à distinguer l’émotion qui l’emporte, de la colère ou de la tristesse. Un mélange. Il faut que j’écrive pour me calmer. Que je m’intéresse à quelque chose de difficile. La grammaire de Joëlle Gardes Tamine par exemple. Tout ce qui se dit de la grammaire ici m’est un écueil, me ramène à ma propre imbécillité dans une salle de classe. Seule la rage alors provoquant la reprise peut y faire quelque chose, comme s’accrocher, décrypter à la loupe chaque mot, chaque proposition, jusqu’à ce qu’une impression de clarté s’en suive ou rien. La déclinaison est absente en français- encore faut-il savoir le latin ou l’allemand pour en comprendre l’usage et ce que ça impacte sur la fonction du nom, celui ds êtres et des choses, nous qui n’avons que deux genres, masculin ou féminin pour évoquer le monde. La légende de Sainte Eulalie 842, plus ancien poème écrit en français. La Cantilène de sainte Eulalie (IXe siècle) Version originale Adaptation en français moderne Buona pulcella fut Eulalia Bel avret corps, bellezour anima. Voldrent la veintre li Deo inimis, Voldrent la faire diavle servir. Il non eskoltet les mal conseillers, In figure de colomb volat a ciel. Tuit oram que por nos degnet preier Qued avrisset de nos Christus mercit, Post la mort, et a lui nos laist venir. Par souve clementia. Bonne pucelle fut Eulalie Bel avait le corps, plus belle l’âme. Voulurent la vaincre les ennemis de Dieu, Voulurent la faire diable servir. Elle n’écoute les mauvais conseillers, Sous forme de colombe vola au ciel. Tous prions que pour nous daigne prier Que de nous Christ ait merci, Après la mort, et à lui nous laisse venir. Par sa clémence. Souvent, à lire l’ancien français, la viande dans quoi j’habite s’émeut, retrouve de la tendreté envers elle-même et les êtres et les choses, la viande se souvient bien mieux que l’esprit. Et peut-être aussi ces vieilles paroles attrapées au vol dans la campagne, et qu’aucune haie,-elles ont toutes été abattues au nom du rendement- ne conserve plus, la viande les garde t’elle entre ses nerfs ses fibres sa lymphe son sang le patois et l’accentuation de certains mots, les expressions exprimées comme un jus exprimé de fruit Comment cela est-il possible que quelqu’un, quelque chose d’autre que moi se souvienne en moi de la langue et la trouve, la retrouve, devenue soudain si familière si présente, c’est une question depuis toujours. l’ordre des mots ( autre ouvrage de JGT) d’un abord pas facile non plus. Une aridité dont je ne sais si elle provient de l’ouvrage ou de moi-même. Il y a la faute qui vient de l’ignorance et puis de l’inattention, mais c’est la même chose. avons-nous encore le droit d’être inattentifs ?|couper{180}

Carnets | juillet 2024
14 juillet 2024
Exercice, proposition 11 cycle été T.L. D’après Histoire de C.S la fête s’achèvera tard dans la nuit, mais nous là on retraverse le pont, levant les yeux au ciel, lune et nuages, moiteur, nous elle et moi, cette fille blonde, C’est comment ton nom déjà, été 1975, When a Man Loves a Woman, trois accords à la gratte, tout ce tumulte de sueur et de parfum, le soir après avoir charrié les plaques de plomb des autos tamponneuses avec les gitans, Reins en compote, guiboles qui flagellent, descend on y va, j’ai envie elle a dit, vers le camping de l’autre côté de l’Aumance, à Saint-Amant, la tente est là, la fente de la porte plus noire que la nuit, dégage, pas ce soir, suis crevé, on se verra un autre jour, mais t’as quoi, qu’est-ce que je t’ai fait, rien de tout ça, tout en silence plutôt, je n’ai sans doute même pas dit à voix haute tout ce que je pense à cet instant précis, tout est dans ma tête, ma bouche est close, silence, l’instant de la faire entrer dans la tente, de faire ce que font tous les gamins de façon maladroite je cherche le mot mais c’est ça en fin de compte, merdique ou dégueulasse, mettre une fin à la période naïve, se hâter de mettre le mot fin, s’il pleuvait ce serait bien, ça réglerait le problème, elle s’en irait sûrement, c’est comme ça qu’elles font, les filles n’aiment pas salir leurs robes blanches, pas pour rien en tout cas, et à ce moment c’est sûr je la retiendrais sûrement, j’oserais me montrer vulnérable, mais là non je suffoque, barre-toi allez, fais pas suer, je le hurlerais bien, mais il fait déjà suffisamment chaud comme ça, non et au bout du compte c’est peut-être moi qui partirais, après tout Villevendret est à quoi, 15 kilomètres, en Solex, c’est pas si loin, et au moins je n’aurais rien à dire, juste je te laisse la tente si tu veux, moi je pars, ciao sans un mot de plus, et voilà, et je partirais pour de bon, comme je fais tout le temps, le ressort se tend se tend se compresse et d’un seul coup le diable sort de la boîte, fais-le, réfléchis pas, ne tergiverse pas, enfourche le Solex et tire-toi, il est là contre un tronc, il y a encore assez d’essence, et sinon marcher à côté s’il est à sec, pas grave, elle a dû comprendre, elle m’a fait un petit signe de la main, demain vers 18h je serai là, elle rit, c’est agaçant, on se verra, tu travailles demain comme aujourd’hui, oui voilà je serai là comme tous les jours précédents d’août cette année-là à glaner quelques ronds avec les forains, à jouer de la gratte Be-bop-a-Lula entre deux blancs limés bus cul sec, trois bagarres avortées, et tu seras encore en robe blanche, ce qui te donnera un air sale je le sais déjà, ou à moi, va savoir, qui déjà en pensée chevauche mon cheval noir pétaradant sans même jeter un regard en arrière, comme dans les westerns, John Wayne avec les femmes, Ona Munson Betty Field, Joan Blondell, Paulette Goddard, Joan Crawford Mauryn O’Hara sans omettre le regard droit la tête haute, le balai dans l’cul, la fraîcheur de l’air est arrivée de suite à la sortie de Saint-Amant, en bifurquant en direction d’Epineuil, le bruit du moteur se répercute sur les murs de pierre du grand domaine où il y a tout au bout un château, mais je ne sais pas le nom, je m’en fous, elle m’a entraîné déjà dans un autre château, il ne peut pas y avoir d’autre château aussi beau, en plus pas cette fille là, une autre, en robe blanche aussi on a marché longtemps ce jour là que je ne savais pas que le silence pouvait être aussi parlant, à ne rien savoir se dire, et qu’aurions-nous pu dire qui mettent en mot la campagne, le chemin blanc, les bruits des haies, la clameur d’une poule d’eau, le croassement des grenouilles, c’aurait toujours été bien pauvre, le silence donne au moins le change, l’impression d’être riche, un potentiel la route est assez droite entre le bas de Vallon et Chazemais, un long ruban d’asphalte qui court par mont et par vaux, de temps en temps j’attrape le levier du bloc moteur que je tire en arrière pour faire patiner, impression d’avancer un peu plus vite, mais c’est une illusion, à mi-côte obligé de descendre et de marcher à côté, silence, une légère brise descend la vallée, je marche contre le vent, le hameau est encore loin, la ferme des grands-parents, celle de pauvre type, le tueur d’oisillons, avec son vieux cou strié de sillons rubiconds, sa gueule de vieille tortue, fi de garc’ si tu les dégommes point mon ptit gars c’est toutes tes c’rises qui y passeront, ou tes fraises, ou je ne sais quoi, mon dieu toute cette violence qui serait prête à nous faire tuer n’importe quoi sous un grand ciel gris ici sur la colline, aucune femme ne le supporterait deux minutes, c’est ce que l’on dit de pauvre type, c’est aussi pour ça qu’on l’appelle comme ça, les gens en couple, ceux qui sont civilisés, ils s’entretuent en sourdine ceux-là à grands coups de qu’est-ce tu fais, à quoi que tu penses, tu viens dormir, mais qu’est-ce tu fiches, la route est longue et tant mieux, arrivé en haut de la côte je remets les gaz, la marche m’a fait un bien fou, je suis lessivé, demain faut que j’y retourne pour l’après-midi, on change les plaques abîmées, et y a encore bal, vers 19-20h la fête repartira|couper{180}

Carnets | juillet 2024
13 juillet 2024
Exercice d’écriture 10 « la main qui écrit tous les présents » à partir des Géorgiques de Claude Simon « Suivre la linéarité par laquelle on se l’approprie » Le 16 juillet 1969, un mercredi. Il est sur les routes. Au mur de la salle à manger, sa photographie trône, une image en noir et blanc dans un joli cadre doré. Un enfant blond aux cheveux longs, on dirait une petite fille. Derrière, des arbres, peut-être à Saint-Bonnet, dans la forêt de Tronçais, vieille réserve de Colbert avec ses arbres multicentenaires. Par qui cette photo a-t-elle été prise ? On ne le sait pas. Il travaille pour une entreprise de couverture bitumineuse. Parfois, il dit où il va, parfois non. Auxerre un jour, Saint-Jean-Pied-de-Port un autre. Il est souvent absent, jamais là sauf les fins de semaine. Il prend des cours aux Arts et Métiers à Paris, des cours du soir. Il veut aller plus loin, plus haut. La fusée Apollo 11 s’arrache du sol dans un panache de flammes blanches et de fumées sombres. Il ne verra pas le lancement en direct, il l’écoute peut-être à la radio dans sa voiture, une Ami 8 flambant neuve, sortie des chaînes en mars. Apollo 11 diminue à vue d’œil. Ce n’est pas encore la télé en couleur. Dans la pièce, des chaises alignées, beaucoup de monde. Il est un peu avec nous par l’entremise de la photo au mur. L’arrière-grand-père, lui, est à sa table de cuisine, préférant ses mots croisés. Les conneries des Américains, dit-il, ne l’intéressent guère. Il n’y croit pas, le dit quand tout le monde se lève pour partir. Le temps qu’il fait en ce lundi 8 septembre 1969 est difficile à se rappeler. On devrait noter toutes les informations climatiques chaque jour, car plus de cinquante ans plus tard, l’intelligence artificielle ne nous donnera que des données génériques. Climat océanique dégradé, influencé par l’Atlantique mais avec des caractéristiques continentales. Hivers frais, étés doux. Températures moyennes annuelles entre 10°C et 12°C. Les mois les plus chauds, juillet et août. Les plus froids, janvier et février. Précipitations homogènes sur l’année, environ 600-650 mm. Septembre : températures moyennes entre 12°C et 22°C, possibilité de belles journées ensoleillées. Début de la chute des feuilles. Brouillards matinaux possibles, surtout à l’automne, orages en fin d’été. Ces informations sont générales et ne reflètent pas nécessairement les conditions spécifiques du 8 septembre 1969 à Parmain. Pour des données précises, il faudrait consulter des archives météorologiques officielles. Nous déménageons en région parisienne. L’Allier, c’était trop loin, ça le crevait. Il nous trouve une nouvelle maison. Albin Chalandon, ministre de l’équipement, lance un concours international de la maison individuelle cette année-là. Un petit pavillon de banlieue flambant neuf, un muret entourant un jardinet, une allée de graviers, quelques tilleuls. Mais ça n’a plus rien à voir. Devant la maison, de l’autre côté d’un chemin de terre, l’Oise, très large à cet endroit, avec des péniches laissant des taches mordorées de gas-oil. Il a terminé un cycle de cours du soir. Il travaille d’arrache-pied, mais il peut rentrer l’Ami 8 dans le jardin. Le crissement des pneus sur les graviers, les lueurs des phares au plafond de la chambre. Un soir, il rentre plus tôt, content, encense le nom de Chaban Delmas, disant que peut-être on va enfin sortir de la chienlit de l’année dernière. Les affaires reprennent, il vient d’être promu chef des ventes. En 1974, nous déménageons encore, toujours à Parmain, cette fois dans un virage en tête d’épingle. Le choc pétrolier affecte la couverture bitumineuse, qui périclite. Il est remercié après quinze ans de bons et loyaux services. Il se retrouve face à des psychologues avec des taches noires sur du papier blanc. Malgré les cours du soir aux Arts et Métiers, il n’a pas les diplômes adéquats. Avec des jeunes gens qui le regardent avec compassion, il se sent vieux à 39 ans. De 1976 à 1986, il ne voit pas son fils aîné. Un infarctus. Un chien, un boxer. Une maison à Limeil-Brévannes, près de Servon en Seine-et-Marne, où il travaille comme directeur commercial. Ses gars l’adorent, c’est ce qu’il dit souvent. Hors de la maison, il est un caïd, un battant. En 1987, à 52 ans, il atteint son objectif. Une belle maison, un 4×4, une chienne boxer qui passe ses week-ends dans le lit conjugal. Il ne cherche pas vraiment à savoir où est son fils aîné, ni ce qu’il fait. Photographe à Paris, est-ce un métier ? En 2003, on le retrouve au cimetière de Valenton. Des gens passent pour lui serrer la main. Son fils aîné est à côté de lui, ça lui fait du bien. Il est venu avec sa nouvelle compagne de Lyon – les Lyonnais, ce qu’il leur manque c’est d’être Parisiens. Le cadet est là, mais c’est tellement normal qu’il ne le relève pas. Il ne supporte pas la vision du cercueil en flammes sur la vidéo. Le type des pompes funèbres lui pose une main sur l’épaule, il la repousse et sort fumer. Il décide de revendre les 4×4 prévus pour un exil à la Réunion, s’achète une vieille Ford Mustang d’occasion, met en place un emploi du temps strict, embauche une femme de ménage. En 2013, cancer du pancréas. Opération. Quand on lui parle de chimio, il s’effondre. Pas de cachets, pas de traitement. Il reste avec la chienne sur son lit, regardant Canal+ et lisant des romans policiers jusqu’à la fin. La femme de ménage le trouve un matin de février, affalé de tout son long. Les pompiers l’emmènent. Son fils aîné, alerté, fait le voyage depuis Lyon, mais au dernier moment, renonce à se rendre à son chevet. Le 15 février, il décède seul à l’hôpital de Créteil.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
12 juillet 2024
C’est-à-dire que c’est la même chose tous les jours, à douze heures pétantes, le bruit des assiettes sur le carrelage de la table de la cuisine, les verres, les fourchettes et les couteaux – une routine immuable – les ronds en bois gravés chacun à son nom, enserrant les serviettes qu’on a roulées consciencieusement la veille, il faut briser cette routine, c’est devenu une telle évidence : sans prévenir, il faut de toute urgence s’enfuir, aller si possible dans le sens opposé, se retenir au moins de parvenir comme si de rien n’était – pour une fois – dans la pièce à l’heure prévue, il y a eu quelques prémisses, quelques coups de semonce, de subtils avertissements, les quelques minutes de retard sont déjà de petites victoires, on imagine, on espère, on souhaite non seulement les reproduire, mais en plus gagner du terrain, alors on garde l’ouïe aux aguets, les chaises que l’on tire pour s’asseoir, les éclats assourdis d’une conversation parmi les plus banales qui soient, et le concert des couvercles de poêles, de casseroles, du faitout qu’on lève et qu’on repose sur la grille des fourneaux, avec en outre l’horrible tic-tac de la pendule accrochée au mur, et ce quelle que soit la saison, l’année, durant des années, toute une vie, l’évidence tombe comme un couperet, ce n’est pas possible de continuer, ça ne va plus, le silence à certains moments est devenu tellement intolérable qu’on ne le tolère plus, alors on le comble comme on peut, j’écoute tout en descendant les marches de l’escalier, déjà le bruit de la mastication, la voix hésitante de mon jeune frère – il a toujours cette manière de parler comme s’il cherche ses mots – la remarque coupante de la mère pour lui clouer le bec, la respiration gênée par l’emphysème du père, le bruit du pain que l’on rompt, la mastication si particulière que font les mâchoires à l’assaut d’un morceau de fromage pâteux, de brie, de camembert, et soudain, je ne sais vraiment pas ce qui m’arrive, c’est si soudain, une sorte de coup de tête, je dis : « Ça ne vous dérange pas, tout ça, ça ne vous gêne pas, que vous baffriez comme ça tous les midis à cette table de la cuisine, à ne rien vous dire d’intéressant sauf des banalités, ça ne vous dégoûte pas, le monde tout autour, la guerre, l’argent, l’exploitation des petits par les gros, tout ce dégueulis politique ça ne vous débecte vraiment pas, vous allez vous resservir encore de la daube, vous êtes sûrs, des pommes de terre baignant dans leur jus, de l’agneau bien gras et juteux, tout ce vin blanc bande de salauds, ça ne vous rend pas dingo ? » et je vois à cet instant qu’ils me toisent, qu’ils font bien attention cette fois à l’amorce de ma tirade, qu’ils font bien gaffe de ne rien vouloir entendre, qu’il vaut mieux pas, qu’ils font coussi-coussa comme si tout cela est normal, rien de plus normal qu’un gamin de quinze ans s’amène dans la cuisine à midi et pique sa petite crise existentielle, se revendique communiste, et pourquoi pas anarchiste, quoi de plus normal à cet âge-là, à moins que ce ne soient des vers, dans ce cas où donc ai-je flanqué le vermifuge, le bromure, quand ça n’excède pas les limites, disons quand ça n’empiète pas sur la sacrosainte quiétude du foyer, on a bien le droit de manger en paix tout de même, manquerait plus qu’un morveux nous vienne faire la morale, un branleur pareil, qui ne connaît rien à la vie, qui n’a jamais travaillé, qui ne connaît rien encore ni du chagrin ni de la peine, et nourri, logé, blanchi par-dessus le marché, rendez-vous donc compte, faites vos comptes, j’additionne toutes les années perdues et je retranche mes rêves, mes espérances, il ne me reste en face de moi dans l’encadrure de cette putain de porte qu’un sale petit con boutonneux, avec sa gueule enfarinée et qui viendrait là nous faire la leçon, à nous ses parents, à moi sa mère, à moi son père, c’est un comble non, si t’es pas content tu dégages mon petit vieux, tu prends tes cliques et tes claques, tu te tires, tu débarrasses le plancher, non mais qui c’est qui m’a donné un petit connard pareil, le frère reprend l’expression c’est marrant, il rit, petit connard, le père se lève, il met un temps pour remettre ses pantoufles, je vois bien qu’il se gourre de pied, ça l’énerve encore un peu plus, dehors qu’il écume, du vent, du balai, je ne veux plus jamais te voir, sors de ma maison et ne reviens jamais, quand tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, que tu seras un homme on verra, en attendant, démerde-toi donc, barre-toi, casse-toi, et de joindre le geste à la parole, de m’attraper par le colbac et de me tirer vers la porte d’entrée, me voici dehors pieds nus, ça ne va pas la tête, je rentre aussi sec, je grimpe quatre à quatre les marches de l’escalier, j’attrape le sac tube, je mets ce que je peux dedans, mais je ne sais pas quoi vraiment, mes chaussures à mes pieds ça oui, il le faut en tous cas, les fameuses Clarks qu’ils détestent parce que ça fait gauchiste, je redescends, état second, je vole presque, j’ouvre la porte et je ressors cette fois de mon propre chef, alors qu’on espérait certainement me voir calmé, repentant, docile, je pars la route qui descend vers la gare – c’est l’automne, je note, les couleurs des feuillages sont belles – je me vide la tête comme je peux pour ne plus penser à rien d’autre qu’aux belles couleurs de l’automne cette année-là, je fouille dans mes poches, j’ai pas lourd, quelques francs pas plus, je commence à m’inquiéter, c’est normal, pourquoi ce serait normal de s’inquiéter d’avoir quelques francs seulement dans les poches, ça m’agace, j’accélère le pas, en réajustant sur l’épaule la lanière coupante de mon sac tube, je vais prendre le RER, arriver dans le centre-ville, gare de Lyon, bonne idée, ensuite je marcherai dans la ville jusqu’à ce que je tombe de fatigue, que la fatigue se confonde avec le calme, et ensuite, on verra.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
11 juillet 2024
Scène : Un bureau encombré, avec une lampe de bureau allumée. Le narrateur , assis à une table, regarde son écran d’ordinateur, perplexe. le narrateur : (avec un soupir, parlant à voix haute) Grande difficulté à répondre aux commentaires. C’est arrivé progressivement. Avant, je répondais volontiers, sans trop réfléchir. Mais maintenant… non, je ne peux plus. Je suis retourné voir sur le site du TL. J’ai vu. J’ai vu les commentaires laissés sans réponse. Ça me chiffonne. Mais je suis bloqué, je ne peux pas répondre. Pas bloqué par un bug du site, non, bloqué par une étrange volonté de ne pas trouver quoi répondre. (pause) Je pourrais me contenter d’un merci. Ce serait déjà ça. Ce serait poli. Mais même un merci m’échappe, comme une bulle de savon qui éclate avant que je ne puisse la saisir. (regard fixe, replongé dans ses souvenirs) Dire merci à la dame, au monsieur. Déjà enfant, je résistais à cet automatisme. Ce n’était pas facile, et surtout pas bien vu. Merci, merci, merci. Merci automatique, merci sans âme. Merci qui n’est pas le mien. Peut-être que la racine de ce blocage se trouve dans cette histoire de permission. Comme en informatique, quand tu veux modifier un bout de code et que le système te dit : « Ah ben non, t’as pas les permissions. » Il faut alors faire un Chmod ou un Chown pour régler le problème. Mais ici, il n’y a pas de commande magique. (soupir) Les mots sont des clés, des portes vers des mondes cachés. Kabbalistes de l’ombre, nous jouons avec les lettres, les inversions, les significations. Chaque commentaire est un golem, façonné d’argile, porteur de vie ou de silence. (pause) Je regarde les commentaires, j’en suis toujours étonné, surpris. C’est comme une petite déflagration, quand j’ouvre ma boîte mail et que je vois « X ou Y vous a adressé un commentaire. » (pause, regard interrogateur) Je ne sais jamais l’intention de l’autre. Est-ce que c’est si important de savoir l’intention de l’autre ? Sans doute que oui, pour moi, c’est important. Si l’autre n’a pas une intention claire, tout est alors possible, c’est ce que je me dis. Faut s’attendre au pire plutôt qu’à rien. Une habitude à prendre. Bien sûr, je n’en veux à personne de m’adresser des commentaires. J’éprouve même une trouble satisfaction à les lire. Trouble parce que je ne sais jamais si c’est un commentaire pour prouver que j’ai été lu, ou bien un commentaire qui vient directement du cœur. Ça peut aussi être un commentaire destiné aux algorithmes désormais plus qu’à moi-même. Aujourd’hui, c’est difficile de le savoir. (pause) Tellement que je préfère m’abstenir d’y répondre de plus en plus. Ce qui ne manque pas de creuser un écart. Un écart de plus en plus grand, plus profond, entre les gens qui font des commentaires et moi qui ne sais pas comment prendre leurs commentaires. L’écart ainsi créé par le fait de laisser en plan toute réponse, me permet une sorte de travail sur moi-même. Je me rends bien compte de ça. (regard pensif, plus intense) Je voudrais simplement écrire, publier. Je voudrais faire ça jour après jour et ne plus répondre à aucun commentaire, c’est-à-dire solidifier un choix. Le rendre comme du granit. Très dur. Ça me fait du bien, je crois. Je ne pense pas que ce soit de la méchanceté. Je pense plutôt que je me suis recroquevillé si loin à l’intérieur de moi-même que le commentaire ressemble à une fourchette à escargot qui cherche à m’attraper pour me manger. Quelque chose de ce genre-là. En fait, j’ai une peur bleue des commentaires, et encore plus de la moindre réponse qui pourrait sortir de ma coquille si je n’étais pas devenu sur ce point d’une vigilance terrible. (silence lourd, puis un soupir profond) Les mots, les lettres, les chiffres, tous des signes. Des portes vers l’infini. Comment répondre à l’infini ? Peut-être que dans le silence, je trouverai la réponse. Peut-être qu’en écoutant les échos des lettres, je trouverai la paix. (regard lointain, puis un sourire léger) Oui, peut-être que le silence est la réponse.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
10 juillet 2024
Le front, symbole de l’affrontement, devient main tendue par une étrange alchimie de la langue et de l’esprit humain. La métamorphose de ce terme si martial en un geste de paix et de soutien peut sembler paradoxale, mais elle illustre bien la plasticité des mots et leur capacité à embrasser des sens multiples. Conjugaison. J’affronte l’adversité, la confusion derrière les fronts. Tu affrontes le 15 du mois, dès le 5. Il ou elle affronte vaillamment les ravages du temps en oubliant régulièrement l’Histoire, drôle ou tragique, surtout sa chute. Nous affrontons les éléments. Le canard est déchaîné, les poulets ont des caries, l’œuf à Milan est aussi pourri qu’au pied de la muraille de Chine. Vous affrontez la concurrence, concoctez des stratégies, des crocs-en-jambe, des croche-pieds et des croche-pattes. Ils ou elles affrontent la bêtise ambiante. Cela fait des années. Toute une vie ne fait pas tant d’années que ça. Avec un peu de chance, une élégance mathématique, une coquetterie de poule, (petit gloussement de dinde à cet instant précis), plus d’un demi-siècle. Et 10 de der. Mais comment ne pas se frapper le front tout seul en disant : « Reste à ta place de front, ne te prends pas, surtout pas, pour ce que tu n’es pas. » Un pied de nez. Farce à deux côtés. Janus. Les fronts s’affrontent. Tauromachie. Les matadors n’ont pas de costumes de lumière. Ce ne sont d’ailleurs que de sombres individus, d’une banalité arendtienne, de droite à gauche, en passant par le centre (centre droit, centre gauche, y a-t-il un centre centre ?) Bref, un ensemble constitué de deux fronts, la balle au centre, le revolver sur la tempe. Prendre alors les jambes à son cou. Courir vers la sortie. Traverser des galeries, des couloirs, des corridors, se réveiller par l’exercice de la fuite, de l’exode. Derrière cette mascarade (musique dramatique), les gros pleins de soupe, de méchanceté crasse, d’égoïsme, d’une perversité sans merci, ni bonjour ni merde, ni « veux-tu biger mon cul ». La compassion, c’est pour les improductifs, les travailleurs sociaux. Et puis attention, si tu es éboueur ou standardiste, ne sois pas désagréable, souris, même la mauvaise humeur ne te sera plus accordée. Elle revient désormais aux puissants, aux riches, aux menteurs, aux violeurs. écrit le 28/06/2024 planifié pour le 10/07/2024|couper{180}

Carnets | juillet 2024
09 juillet 2024
J’écris ce soir du 27 juin, à publier le 9 juillet. Cette pause dans notre série d’exercices d’écriture quotidienne, qui doit normalement durer 40 jours, est une sorte de récréation. F. se félicite de notre participation magistrale avec un email : 600 textes déjà en à peine 8 jours. Je suis dans mon bureau à l’étage, la fenêtre ouverte sur la cour. Les martinets, ces oiseaux fous qui ne cessent jamais de voler, poussent leurs cris stridents. Je réfléchis aux bruits de la maison. S. vient d’assister à quelques minutes d’un débat politique télévisé. Un triste spectacle où aucun des prétendants n’a de carrure politique véritable. Ce ne sont que de pathétiques histrions agitant des propos sans teneur pour divertir ou inquiéter le peuple, ce qui revient au même. De mon côté, j’ai préféré me plonger dans la lecture d’un livre de J.P Dubois. Il débute par une méditation sur la pluie et la montée des eaux, évoquant on peut l’imaginer , l’origine des larmes. Il y a quelques jours, par hasard, je suis tombé sur la vidéo d’une médium. Elle parlait des fuites d’eau dans les maisons, suggérant que des esprits malheureux pourraient en être la cause. Ces présences pourraient même provoquer une irascibilité soudaine chez les habitants. Est-ce l’esprit d’un ancien propriétaire de la maison ? Je ne sais pas pourquoi j’en ai parlé à M. Elle connaît cette femme capable d’arrêter le feu et l’eau, et même de chasser les fantômes. Je lui ai dit qu’il faudrait qu’elles viennent un mardi, quand S. monte à C. pour voir sa mère. Je doute que S. soit aussi intéressée que moi par les exorcismes. Non, j’en suis certain, cela l’effraie beaucoup trop. En Haute-Saône, des inondations aussi, les eaux envahissent les maisons, les rivières débordent. Je songe à tous les morts de 14-18, à ceux de la dernière guerre, à tous les massacres perpétrés au nom de quoi -on ne le sait même plus. Je pense aux morts pas contents d’assister éternellement à la même pièce de théâtre, et qui pleurent, se lamentent, sont à l’origine de cette montée des eaux générale. Cet homme qui tue un père déjà mort. Dans le livre de J.P Dubois, ça me rappelle quelque chose, un acharnement pathétique. Un acharnement dont j’ai pu moi aussi être responsable, faire les frais. Mais quel lien avec la situation actuelle, je ne le sais pas. Impression fugitive : soit on veut tuer ce qui est déjà mort et enterré, soit on veut revivre ce qui n’est jamais venu à l’existant. En mettant bout à bout ces éléments, j’essaie de leur donner un sens. Peut-être qu’il n’y en a pas. Après tout, c’est juste un exercice d’écriture que je fais tout seul dans mon coin. Illustration : image d’un dessin automatique d’André Masson. une série de dessins qui m’inspire le contenu du programme de la rentrée prochaine à R. si je suis retenu. j’ajoute ici un extrait concernant les dessins automatiques d’André Masson rédigé par lui-même : « […] Devant ce qui précède, plus d’un lecteur sera enclin à penser : mais c’est de l’automatisme, la manifestation de l’inconscient. Point. Car il n’est pas un de ces dessins dont je ne puisse expliquer le symbolisme. Il me serait même facile de discerner pour la plupart d’entre eux une origine. Dans l’un, le souvenir d’un entretien amical sur Bachofen, dans tel autre une variation sur l’horreur du sol où le plumage est pris ; plus loin les fruits d’une méditation sur les emblèmes — à travers l’histoire des hommes — des idées d’envol et de chute, ou bien l’écho d’une conversation à bâtons rompus sur des singularités érotiques, mêlé à des considérations sur l’attirance du gouffre et l’amour des hauteurs. Bref, les résultats d’une culture, et d’un commerce. […] Il y a plus. La tentative d’une expression de l’inconscient par le truchement du dessin, à l’origine du surréalisme, tendait au document psychiatrique, sans souci esthétique. A tel point qu’il n’était pas nécessaire de savoir, paraît-il, dessiner et encore moins de savoir peindre. Vers 1930, un tournant, comme on le sait : il fut souhaitable de renouer avec l’académisme. Est-il nécessaire de dire que ce ne fut jamais mon penchant (du moins, je l’espère). Au contraire, je crois bien que, pour la capture qui nous occupe, ce n’est pas la maladresse enfantine ou le graphisme idiot du désœuvrement que j’envierai ; et encore moins des minuties d’épileur morose, mais la libre virtuosité d’un Goya ou la longue expérience d’un Hokusaï. […] » André Masson, Vingt-deux dessins sur le thème du désir, éd. Fourbis, 1992, pp. 10-11.|couper{180}
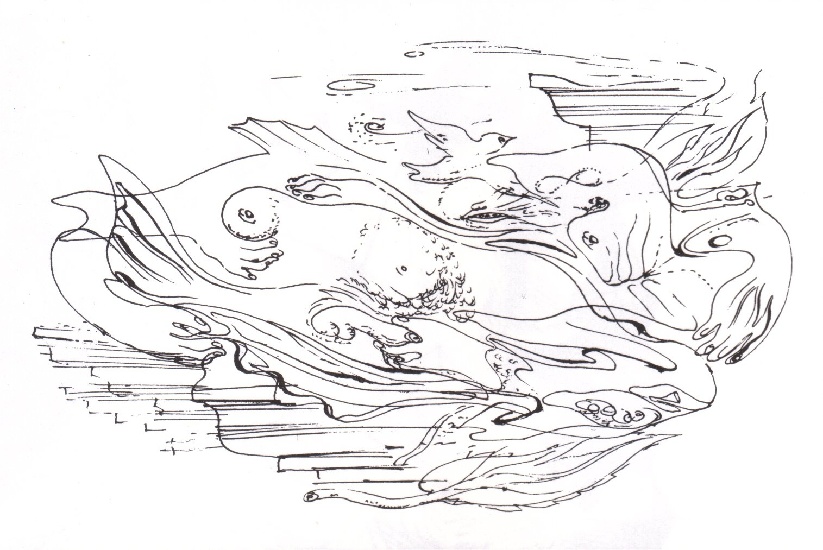
Carnets | juillet 2024
08 juillet 2024
Note : La fiction naît d’une nécessité, d’une intuition non choisie, d’une image non soluble (F.B). Je pense au sucre. À mon taux de sucre. Il faut que je lève le pied sur le sucre. Ce qui me ramène au mot sarkara (alors que visiblement, j’ai dû m’en éloigner depuis un sacré moment, ou bien, si je lui accorde une certaine autonomie, il s’est éloigné tout seul de moi – j’ai déjà noté que ça arrive bien plus souvent qu’on l’imagine). Donc, sarkara (que c’est doux à dire, à prononcer, on dirait du miel – sarkara), mot hindou (on peut aussi dire indou) – car bien des choses viennent des Indes, pas toujours les meilleures. Remarque : on dit hindou pour tout ce qui concerne l’Inde appelée aussi « civilisation brahmanique », alors qu’on dit « peau-rouge » ou sauvage pour tout ce qui touche de près ou de loin les Indiens d’Amérique (oui, celle du Sud aussi) – vieille civilisation sortie du ventre de la Terre, selon les dires Hopi – qui ne surent écrire que fort tardivement, et encore parce qu’on les aura contraints à le faire – on ne sait ni comment ni pourquoi. Pourquoi on les nomme ainsi, ni pourquoi ils ne sont pas restés sous terre bien au frais ou au chaud. Mais là n’est pas le propos. Enfin, je ne le pensais pas jusqu’à ce que le propos lui-même retire son chapeau et le replace sur son faît, la partie la plus relevée de sa forme relativement tassée de propos, ou encore son chef, son crâne d’œuf, puis me tire sa révérence et la langue par-dessus le marché. Trop vite. Cocher, ralenti tes chevaux. Personne ne suit. Même pas moi. Reprenons. Il y a les chambres et il y a des issues, il y a toujours une issue. Ma mission en tant que client mystère, dépêché par le grand organisme s’intitulant assez pompeusement Guide de la Piaule à prix modique Tout confort – Récupérable ou commandable dans toute bonne librairie, broché, 2,50 francs, honnêtement ça vaut le coup, moi-même l’ai acheté pour que ça cesse de me turlupiner de ne pas l’avoir. Reprenons, ai-je dit. Il y a cette chambre, celle qui essaie de disparaître sitôt que je prononce en moi-même le mot. Je ne cherche pas à la rattraper, je ne suis pas comme ça. Et en plus, à la course, je suis souvent battu, je n’ai aucune endurance pour quelque course que ce soit. Je me contente de faire seulement les courses une fois tous les quinze jours. Un point c’est tout. Reprenons encore, soyons patient. Dans cette chambre, je m’allonge sur le lit et les yeux mi-clos, je regarde comme on peut regarder de cette façon, le plafond. Ce n’est pas la chapelle Sixtine. Mais presque. Les tâches créent des figures aléatoires. Aléatoire est une destination peu connue des gens d’ici. Allègrement, ils se suivent tous à la queue leu leu de peur de se perdre, de s’égarer. La raison en est, j’ai fini par le penser, le coût prohibitif du stationnement. On ne peut plus s’égarer sans dépenser des fortunes dans les parcmètres. Continuons encore. Le plafond de la chambre qui s’évanouit presque de mon souvenir ressemble à quelque chose à cause de toutes les tâches brunâtres provoquées par : la nicotine, les fuites d’eau du voisin du dessus, d’autres éléments plus pernicieux encore comme l’utilisation de matériaux bon marché provoquant des déflagrations dans la continuité temporelle des plâtres et des salpêtres. Sans oublier les résultats débiles provoqués par la Chandeleur, puisque j’avais retenu que la chambre était non seulement tout confort mais aussi gaz à tous les étages. Ne lâchons pas l’affaire, battons le fer pendant qu’il est sans défense. Ce plafond était semblable à un cosmos. Je pouvais y plonger mon regard mi-clos, m’y enfouir, et disparaître par moments, sans qu’au retour de cette étrange autohypnose je ne susse où je m’étais rendu, quelle nouvelle défaite j’avais encore subie car, le retour à la réalité laissait toujours mon corps endolori, fourbu, vidé de toute calorie, et bien sûr de tout son suc. J’étais mou comme une chique pour résumer les faits. Hélas, rien que d’y repenser à nouveau, je sens mes forces me trahir (saletés). Je me demande si j’en aurais encore quelques-unes de suffisamment fidèles pour me permettre de me rendre au but. Le problème, c’est que j’ai perdu dans cette aventure le sens du terrain, de l’équipe, je ne sais plus de quel bord je suis, ni si je joue au foot ou au rugby. Le but de tout ça est un essai à transformer dans un premier temps.|couper{180}

Carnets | juillet 2024
07 juillet 2024
Le 26 juin, j’écris ce qui sera en ligne le 7 juillet. L’écart temporel s’allonge, et c’est bien ainsi, comme une machine à explorer le temps. Ce matin, j’ai relu le J.300, écrit dans le passé, alors que je suis aujourd’hui dans le J.309. Mais avais-je la certitude, en écrivant ce J.300, que je pourrais le relire neuf jours plus tard ? Pas du tout. Cette sensation est étrange. Ce que l’on peut faire avec le temps. Le perdre souvent, ou en gagner, surtout en apparence. À moins que ce ne soit une de ces erreurs logiques dont j’ai l’habitude. Plus j’observe froidement les choses, plus je découvre des couches à éplucher en moi-même. Une montagne d’épluchures, toujours la même énigme de l’oignon. Mais je ne me lamente pas. Aujourd’hui, j’essaie d’ajouter une nouvelle couche via le bloc. Rester groupé, compact. C’est agréable de ressentir cette petite excitation due à l’écriture quotidienne. Tous les sites fonctionnent, ronronnent. J’ai passé beaucoup de temps sur celui créé avec Indexhibit, pour finalement comprendre que je peux faire bien mieux avec Spip. Juste une question d’architecture : à quoi sert ceci, cela, prendre le temps d’examiner chaque détail. Comprendre comment mettre en valeur le vide. Je suis retourné un peu sur Ubuweb et j’ai aussi recherché les sites de Js. Je suis tombé sur cette phrase : « chaque c’était, en tête de chaque paragraphe, ira harponner à rebours un des éléments de l’ancienne vie salariée, la vie moderne des bureaux d’aujourd’hui, et leur informatique ». Hier, en allant à pied à la mutuelle avec mon devis dentaire à la main, j’écoutais J.R. déclamer un poème sur l’épuisement des noms de rue de Paris. Le lendemain, je cherche à retrouver la structure des phrases, mais ne me souviens de presque rien. Je tombe sur cette citation de Raymond Queneau : « Le Paris que vous aimâtes n’est pas celui que nous aimons et nous nous dirigerons sans hâte vers celui que nous oublierons ». Puis Jacques Roubaud : « Le Paris où nous marchons N’est pas celui où nous marchâmes Et nous avançons sans flamme Vers celui que nous laisserons ». Je reprends mon monologue intérieur. Mais qu’ont-ils fait de ma ville, disait déjà ma mère. Aujourd’hui, je dis qu’il n’y a plus que des banques, des agences d’assurances, des magasins d’habillement, partout dans les grandes villes. Je ne m’en lamente pas. En ville, je n’y vais presque jamais, ni à la campagne. Je ne vais jamais bien loin. La plupart du temps, je reste là, à écrire le jour même ce qui sera publié plus tard. L’aspect répétitif d’un « c’est l’heure », d’un « c’était », sorte de litanie, m’occupera toute la matinée. À 10h, je serai de permanence, la dernière, normalement je n’aurais pas dû, je remplace. Je m’en réjouis presque, persuadé d’avance d’être tranquille, de ne voir personne.|couper{180}

