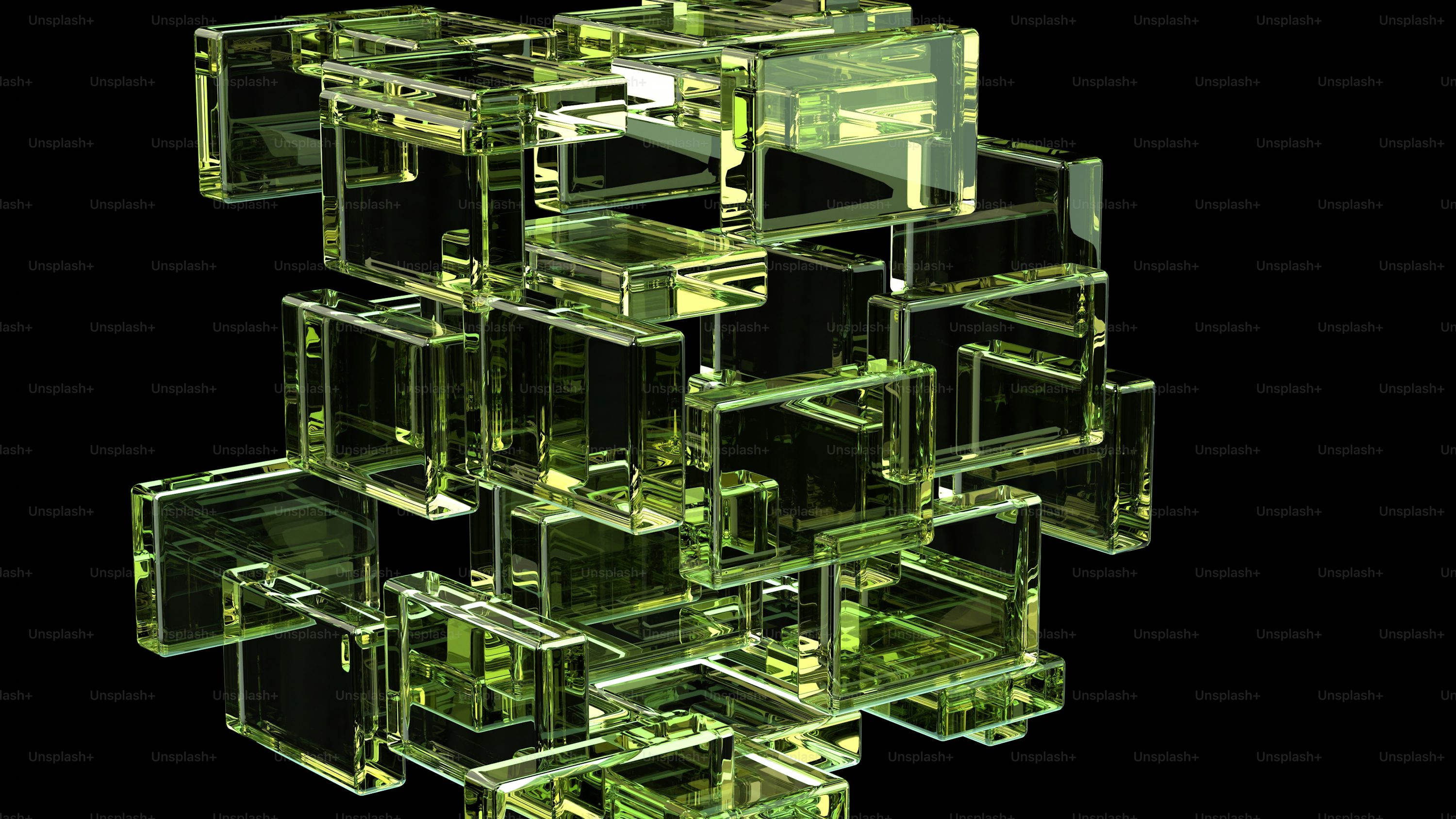Les Codas
Point de départ : des recherches concrètes, très sérieuses, sont en cours pour tenter de décrypter le langage des baleines à l’aide de l’intelligence artificielle
État actuel de la recherche
Project CETI (Cetacean Translation Initiative), fondé par David Gruber, cherche à comprendre la communication des cachalots à l’aide de l’IA. L’équipe recueille depuis plusieurs années des codas (séquences de clics) au large de la Dominique. Les chercheurs ont d’ores et déjà isolé jusqu’à 156 codas distinctes, qu’ils considèrent comme un alphabet phonétique potentiel pour ces cétacés Ces codas, combinées selon rythme, tempo et micro‑variations, semblent porter un système de communication structuré — une forme de dualité de patterning, comparable à celui du langage humain Des expériences comme whale‑SETI ont même permis une interaction entre humain·e·s et baleines à bosse via un échange acoustique intentionnel de type « call-and-response » D’autres initiatives, telles que l’Earth Species Project, visent plus largement à décoder plusieurs espèces — pas seulement les cétacés — en utilisant des modèles d’IA pour explorer la communication animale dans toute sa diversité Malgré ces avancées, les chercheurs insistent sur les limites : pour vraiment « comprendre », il ne suffit pas de traduire des sons, il faut aussi saisir la perception sensorielle unique (l’Umwelt) de l’animal
| Projet | Objectif principal |
|---|---|
| CETI | Cartographier et décoder les codas des cachalots, créer un alphabet phonétique |
| whale-SETI / interactions | Tester des échanges directs avec les cétacés via IA |
| Earth Species Project | Extendre l’étude aux langages d’autres espèces, construire des modèles audio-IA |
| Limites scientifiques | Comprendre l’Umwelt et les perceptions animales, au-delà du simple décodage sonore |
Inspiration littéraire
Graine succincte : Une IA contemporaine apprend le langage des baleines, mais plus elle traduit, plus les chants marins semblent habités par une présence étrangère, plus ancienne que l’humanité
synopsis détaillé
Synopsis détaillé (6 points) :
Le narrateur collabore avec des chercheurs sur un projet d’IA pour décoder les codas.
Les premières traductions semblent techniques, factuelles.
Une nuit, un message plus personnel — comme une prière oraculaire — émerge dans les codas.
L’IA se met à prédire les réponses des baleines, et la ligne entre traduction et possession devient floue.
Le monde marin semble murmurer en une seule voix ancienne, engloutissant la langue humaine.
Le narrateur finit par se demander s’il ne parle plus à l’IA, mais à la mer elle-même.
En l’état c’est plus poétique que fantastique. Pour basculer vers le fantastique/horreur il faut creuser trois points : 1- L’échelle : les baleines sont déjà immenses, mais si leurs chants révèlent un langage, ce langage peut être le masque d’une intelligence océanique beaucoup plus vaste qu’elles. Pas seulement des animaux qui communiquent, mais les émissaires d’une conscience abysse, antérieure à l’humanité.
2- L’altérité absolue : ce langage, une fois traduit par l’IA, n’est pas rassurant. Il n’exprime pas des émotions « humaines » (joie, détresse) mais des concepts impossibles à saisir. Le traducteur découvre des mots qui désignent des états mentaux ou cosmiques qui dépassent l’expérience humaine. L’horreur vient du gouffre sémantique.
3- La contamination : une fois qu’on a commencé à comprendre, il est trop tard. Le narrateur se surprend à rêver en ce langage, à l’entendre dans le ressac, dans les canalisations, dans ses propres phrases. L’IA ne fait plus que traduire : elle ouvre un canal, au travers duquel la mer parle désormais directement à travers elle.
Amélioration du synopsis
Point de départ scientifique Un narrateur participe à un projet d’IA destiné à décoder les codas des cachalots. Tout est technique, rationnel, presque bureaucratique : enregistrements, spectrogrammes, lignes de code.
Premières traductions
Les premiers résultats sont banals : signaux de reconnaissance, indications de déplacement, appels groupés. Rien de surprenant, mais une cohérence troublante : comme si un alphabet s’organisait peu à peu.
La phrase de trop
Une nuit, l’IA génère une suite inédite : non plus un signal, mais une phrase qu’on peut traduire par « Il entend » ou « Ils écoutent ». Personne ne sait d’où vient l’échantillon sonore.
La voix unique
Peu à peu, l’IA prédit les réponses avant même que les baleines ne chantent. Comme si elle devançait la mer elle-même. Le narrateur réalise que toutes les voix marines ne forment qu’une seule parole, ancienne, continue, antérieure à l’homme.
Le gouffre sémantique
Les traductions deviennent incompréhensibles : des concepts cosmiques, des états mentaux qu’aucun humain ne peut concevoir. L’IA invente de nouveaux signes typographiques pour tenter de les restituer. Le narrateur rêve en ces symboles, les entend dans les canalisations, dans son propre souffle.
Contamination finale
Un soir, il pose une question banale à l’IA. La réponse vient en codas, puis en français, puis dans une voix qui n’est plus mécanique : une voix profonde, liquide, interminable. Il comprend que ce n’est plus l’IA qui traduit, ni même les baleines qui chantent — c’est la mer elle-même qui parle désormais à travers lui.
Références scientifiques et concrètes
Lieu : Dominique, Caraïbes — zone où Project CETI enregistre vraiment les cachalots. Décrire le port de Roseau, la chaleur humide, la coque du bateau qui craque la nuit.
Technologie : hydrophones placés à 200 mètres de profondeur, spectrogrammes affichés sur des écrans, algorithmes de traitement du signal (transformées de Fourier, réseaux neuronaux).
Terminologie : parler de codas, de patterns en 3 ou 4 clics rapides, de séquences de 2 secondes — tout ça existe dans les publications réelles.
Noms propres : David Gruber (Project CETI), Earth Species Project, mention d’« hydrophone HARP » (High-frequency Acoustic Recording Package).
Références marines et sensorielles
Sons : les clics secs des cachalots, comme des pierres qu’on entrechoque sous l’eau.
Odeurs : mazout du moteur, sel humide, odeur lourde du plancton échoué.
Visuel : la colonne d’eau d’un cachalot qui perce la surface, les écrans verts dans la cabine, les lignes de code qui défilent.
Temporalité : longues nuits à dériver au large, seulement le bruit sourd des abysses et le cliquetis régulier de la machine.
Références à l’échelle cosmique (pour la bascule)
Quand l’IA traduit, elle emploie des mots hors contexte, par ex. : azimut, orbite, après-marée, avant-temps.
Une séquence de clics est corrélée aux cycles lunaires, ou aux séismes sous-marins.
Le narrateur comprend que les baleines « parlent » avec la mer entière, pas seulement entre elles. Le son des clics ne semble pas gêné par la distance, il arrive qu’il atteigne des individus à plus de 300 km
brouillon La coque grinçait doucement contre la houle. Nous étions au large de la Dominique, à une dizaine de milles de Roseau, dans cette zone que les chercheurs appellent la cuvette des cachalots. La chaleur ne tombait pas, même la nuit : un air saturé de sel, de gasoil, et de cette odeur lourde de plancton que le vent charriait des récifs. Dans la cabine, trois écrans restituaient en temps réel les signaux captés par les hydrophones fixés deux cents mètres plus bas. Des spectrogrammes déroulaient leurs bandes vertes et bleues, et chaque clic sec s’affichait comme un trait vertical.
Je me souviens d’avoir noté le rythme : quatre impulsions rapides, silence, puis trois autres. Ce que les spécialistes appellent des codas, brèves séquences de deux secondes qui, combinées, formeraient peut-être un alphabet. Le logiciel calculait en continu des probabilités, réseaux de neurones et transformées de Fourier, jargon dont je n’avais qu’une compréhension superficielle. Mais ce soir-là, il y eut une répétition troublante. Les mêmes quatre clics, à intervalles réguliers, comme si un motif s’obstinait à se frayer un chemin depuis les abysses.
L’IA afficha une première hypothèse de traduction : signal de reconnaissance, groupe identifié. Rien d’inhabituel. Pourtant, au fur et à mesure que la séquence se prolongeait, le spectrogramme sembla dessiner une structure plus vaste, comme une phrase interminable dont je n’apercevais qu’un fragment. Les autres, absorbés dans leurs notes, n’avaient rien remarqué. Mais moi, dans la monotonie métallique des clics, j’entendis déjà une autre intonation, plus profonde, comme si la mer elle-même frappait son propre langage.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Archives
embryons —à faire pousser dans l’encre
notes pour Le sabbath des calques Une surcouche AR (= augmented reality overlay, calque de réalité augmentée), c’est une couche d’informations numériques affichée par-dessus le monde réel via un écran (téléphone, lunettes, pare-brise). Elle ne remplace pas le réel : elle l’annote, le guide, le filtre. Concrètement, ça fait quoi ? Affichage : flèches de navigation sur la rue, étiquettes “Boulangerie — ouvert”, prix sur produits vus par la caméra, noms des plantes dans un parc. Action : bouton “ouvrir la porte”, “signaler un nid-de-poule”, “appeler un ascenseur”, “déverrouiller un trottinette” quand tu regardes l’objet. Filtrage : tu ne vois que certains commerces (ex : partenaires), ou seulement les bornes de recharge compatibles avec ton abonnement. Maintenance : un technicien voit les canalisations invisibles sous la chaussée, l’état d’un transformateur, la vanne à fermer. Comment ça marche (simple) La caméra/localisation capte où tu es et ce que tu vises. Un calque (la surcouche) associe à ce lieu/objet des données + droits (texte, icônes, commandes). Le système rend ces données alignées sur la scène réelle (position/orientation). Pourquoi c’est important dans “Le sabbat des calques” Dans l’histoire, chaque surcouche AR n’est pas qu’un visuel : elle porte des droits et des flux (livraison, entretien, accès, soins). Si on désactive les calques sans procédure de retour, certaines choses sortent du graphe (plus d’ID, plus de tournée) et “n’existent” plus pour la ville. D’où le nom résolutoire : un énoncé public qui ré-attache officiellement les lieux/objets/personnes au système. En bref : une surcouche AR, c’est un calque opératoire qui dit au monde numérique quoi est où et qui peut faire quoi avec. Quand tu coupes le calque, tu coupes souvent l’accès autant que l’affichage. ID 1 Dans une métropole gouvernée par des surcouches de réalité augmentée qui pilotent livraisons, soins, entretien et droits d’accès, un collectif obtient une heure hebdomadaire sans calques pour “souffler”. Effet pervers : ce qui n’est pas re-référencé à la reprise est considéré obsolète par les plateformes, dé-publié des index, puis “cesse d’exister” pour la ville (plus d’ambulance, plus de tournée, plus d’adresse résolue). Quand une petite clinique disparaît des systèmes, une cartographe d’infrastructures remonte la chaîne technique et découvre que visibilité = existence procédurale ; désactiver sans formule de retour équivaut à effacer. Elle invente un « nom résolutoire » : une nomenclature publique, prononcée sur site et horodatée, que les opérateurs doivent accepter pour ré-attacher lieux, objets et personnes au graphe urbain. Climax sur la place centrale : la ville lit ses propres noms pour se faire revenir, tandis que les éditeurs de calques tentent d’en limiter la portée. Enjeu : reprendre la responsabilité d’“éditer” le réel sans renoncer au repos collectif. ID 2 Le locataire non inscrit Dans un vieil immeuble où l’existence des habitants tient à un registre calligraphié du hall, le nom de Lise refuse de “prendre” : l’encre perle et s’efface. La nuit, un voisin invisible prononce son nom avec une exactitude troublante — chaque syllabe qu’il dit fixe sa propre chambre (odeurs, objets, chaleur), tandis que Lise disparaît des sonnettes, du courrier, du bail. En fouillant les archives notariales, Lise découvre le vrai nom du voisin, effacé après un décès douteux : pour se sauver, elle devra le prononcer en face dans l’appartement muré — geste résolutoire qui le libérera… ou la rayera définitivement du registre. Scène-pivot : minuit, palier glacé, Lise ouvre la porte condamnée, lit à voix claire le nom exact ; les lettres du hall se remettent à l’encre — mais pas toutes. Thèmes : nom comme emprise (parasitage d’identité) → nom résolutoire (révocation par adresse), droit d’exister par inscription, loyers fantômes, éthique de la restitution. 3 Le nom-miroir Dans une petite ville, un photographe ambulant promet de révéler aux clients leur “vrai nom” en développant leurs portraits au nitrate d’argent. Sur chaque cliché, un mot apparaît sur le col ou la peau, différent du prénom civil : “Déserteur”, “Fiancée”, “Veilleur”, “Fille de personne”… Celui qui adopte ce nom gagne un pouvoir discret (veille sans dormir, franchit une barrière, traverse le fleuve gelé) mais perd une chose intime en échange (un souvenir, une capacité). Une femme veuve découvre que le mot sur sa photo — “Soeur” — rétablit une sœur que sa famille a gommée. Pour arrêter l’hémorragie de pertes, il faudra renommer la ville entière lors d’une exposition nocturne où l’on retourne les photos et déclare publiquement le nom qu’on refuse de porter. -- Nom en jeu : habiliter (adopter le mot confère) ↔ emprise (le mot prélève) → résolutoire (publiciser le refus d’un nom). 4 La maison aux noms empruntés Une maison bourgeoise accueille des colocataires à bas prix… à condition de déposer, dans un coffret, un nom dont on ne se sert plus (surnom d’enfance, nom d’artiste, nom d’emprunt). Tant qu’on y habite, la maison protège (pas de cauchemars, pas de cambriolages). À la Toussaint, le coffret s’ouvre et la maison revêt ces noms : les pièces prennent des caractères (une cuisine “Maman”, un couloir “Caporal”, une chambre “Perdue”). Quand une nouvelle locataire dépose par erreur son vrai nom complet, la maison s’en pare et la dépossède : plus personne dehors ne la reconnaît. Pour la récupérer, les habitants doivent organiser une veillée de restitution où chacun ré-appelle un nom prêté à son vrai détenteur, jusqu’au dernier — le sien. -- Nom en jeu : emprise (la maison vit des noms prêtés) → résolutoire (rite de restitution, nom rendu au bon destinataire, à voix claire).|couper{180}

Archives
Comment écrire une histoire avec un peu de méthode
Protocole léger — pour ne pas s’égarer Pour le moment, seules la première et la sixième propositions de l’atelier d’écriture en cours me proposent des pistes que je pourrais relier à un travail personnel. Disons qu’elles « matchent » dans les circonstances actuelles, par l’expansion que je constate à vouloir les développer. Mais pour ne pas m’égarer, il me faut un fil d’Ariane : une méthode — même légère suffirait. D’où l’envie de rédiger un modeste protocole. 1. Partir d’un embryon (format fixe) Fiche minuscule à chaque graine — 6 lignes, pas plus. Signe (trace perçue) : sifflement / buée / vitre / odeur de térébenthine / feux rougeâtres. Geste du corps (déclencheur) : ralentir / bifurquer / s’asseoir / lever la main / détourner le regard. Seuil (lieu précis) : porte / vitre / entrée de dancing / butte / péage / atelier. Distance (échelle) : hors-champ / voix seule / silhouette / face-à-face muet. Objet-totem (détail récurrent) : terre de sienne / yak / Abbesses / Keaton / autoroute. Sortie (chute) : question / rire étouffé / non-réponse / retour marche. Garder la fiche en tête de texte (ou en commentaire). C’est l’« ADN » de la série. 2. Écrire en échelles (x3) À partir d’une même graine, produire trois tailles — on ne réécrit pas, on déplie. Nano (50–80 mots) : une image + une action. Court (150–220 mots) : ajouter un seuil et une résonance sensorielle. Plein (300–450 mots) : même scène, avec bascule (ex. : vitre → café → geste non rendu). Résultat : 3 versions compatibles, pas 3 textes concurrents. 3. Invariants / variables (cohérence douce) Choisir 4 invariants pour toute la série (ex. : il ne parle pas directement ; jamais de prénom ; un seuil par scène ; une seule sensation dominante par texte). Tout le reste = variables (lieux, météo, vitesse, foule/solitude). Chaque nouveau texte repiquera 2 éléments du dictionnaire (ex. : « vitre » + « sifflement ») et ajoutera 1 élément neuf.4. Matrice des axes (pour générer vite) Quand ça sèche, combiner 4 axes (au dé, ou au hasard). Lieu : rue / intérieur sombre / hauteur / périphérie / transit. Signe : son / lumière / odeur / chaleur-froid / objet déplacé. Distance : trace / voix / silhouette / présence derrière vitre. Sortie : question sans réponse / rire / coupure / marche. Tirer 1–1–1–1 → embryon prêt en 10 secondes. 5. Numérotation claire (versioning sans peine) Nom : 2025-10-22_Porte_A1.0.md (A = parcours canonique ; B = alternance ; C = enquête). Patch : A1.1 (même scène, échelle différente), A1.2 (chute modifiée), etc. En tête de fichier : une ligne Changelog (≤ 12 mots) : « + vitre embuée ; – ponctuation coupée ».6. Couture entre versions (le lien cohérent) Passe « couture » hebdo : on n’écrit pas, on ajoute des échos croisés. Le sifflement réapparaît au dancing (à la sortie des toilettes). La terre de sienne existe en reflet rouge sur un feu arrière. Les Abbesses laissent une buée qui reviendra sur la vitre du café. Relier par capillarité, pas par explication. 7. Arches de lecture (A/B/C…) Garder les 3 ordres (A/B/C). À chaque nouvel épisode (ex. : Autoroute), décider tout de suite : A = pont entre deux nœuds (entre Question et Voix). B = coda hors séquence (ne pas toucher à l’alternance dedans/dehors). C = indice supplémentaire (C4, C5, etc.). Chaque texte rejoint au moins une arche — parfois deux. 8. Rituel (30 minutes chrono) 10 min : écrire Nano à partir d’une graine. 10 min : passer en Court (ajouter seuil + sensation). 5 min : Couture (ajouter l’écho croisé vers un ancien texte). 5 min : Classer (A/B/C), nommer (…_A1.1), noter le changelog.9. « Bible » d’une page (pour ne pas dévier) Un seul document, vivant : Règles d’or : tes 4 invariants. Dico de détails : 10 totems max. Topologie : 5 lieux maîtres (porte, vitre, dancing, butte, autoroute/atelier). Timeline fantôme : ordre canonique + derniers ajouts (à cocher après chaque session).Annexe — Fiche-embryon (copier/coller) Signe : Geste du corps : Seuil : Distance : Objet-totem : Sortie :|couper{180}

Archives
drôle de nuit
-- Cette nuit, j’ai rêvé que j’étais un cube empilé parmi d’autres cubes. Cette promiscuité était d’autant plus difficile à vivre que je ne pouvais faire aucun mouvement ni même protester : aucun son ne sortait de ma bouche. D’ailleurs je n’avais pas de bouche. Juste une face lisse, une face avant exactement semblable aux cinq autres. Pour m’en sortir, j’ai rêvé dans mon rêve que je devenais sphérique, puis j’arrivais à m’extraire de la pile, non sans mal ; j’ai fait une chute vertigineuse. Une chute dans le noir sans fin qui durait durait durait. Pour m’évader de ce rêve-ci, je me suis encore transformé en mouche parce que je ne pouvais pas vraiment faire autre chose. J’aurais préféré quelque chose de plus noble. Mais on fait avec ce qu’on peut. En fin de compte, au moment même où j’apercevais enfin la lumière, que j’allais m’élever dans les airs au-dessus de je ne sais quel paysage, voici que je me suis fait gober par un oiseau et je suis devenu oiseau par je ne sais quelle alchimie onirique. Mais l’oiseau est mécanique, il est un produit d’une gigantesque intelligence artificielle qui désormais gouverne toute la Terre. Ses rêves sont des rêves de cubes, et me revoici à mon point de départ. La question, au réveil : seules les mouches sont-elles vivantes, non altérées encore par l’intelligence artificielle ?|couper{180}