Auteurs littéraires
articles associés
histoire de l’imaginaire
Vrais noms, vrais pouvoirs
Vernor Vinge, du « vrai nom » aux Zones de pensée : une SF de procédures et de limites qui outille nos identités, nos vitesses et nos garde-fous.|couper{180}

histoire de l’imaginaire
Nommer comme responsabilité
Le Guin déplace la littérature spéculative vers l’éthique du langage : nommer engage. De l’Ekumen à Terremer, ses mondes relient, équilibrent et durent.|couper{180}

Carnets | Atelier
03 novembre 2025
Où l’on tente de circonscrire l’insaisissable. Peut-on classer Steiner ? La question elle-même trahit une mentalité de bibliothécaire, cette manie d’étiqueter ce qui, par nature, fuit la catégorie. Je pense à ce mot de Valéry : « Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable. » Steiner, lui, choisit délibérément l’inutilisable — c’est-à-dire le complexe, le contradictoire, le profond. « Je suis un sioniste le matin, un antisioniste l’après-midi. » Cette phrase n’est pas une boutade. C’est une profession de foi méthodologique. Elle dit : je refuse de m’installer dans une identité politique. Elle dit : je préfère la lucidité douloureuse à l’appartenance confortable. Elle dit aussi, peut-être, que toute pensée véritable est un exil — et que toute terre promise est aussi une terre maudite. Mon archiviste en prend un bon coup sur le carafon, mais en même temps ne s'y est-il pas préparé expressément ? Lui, George Steiner, défend la haute culture — non comme un privilège, mais comme un droit. Il exige l’exigence. Il veut que le plus grand nombre accède à ce qui n’a jamais été conçu pour le grand nombre. Position intenable ? Sans doute. Mais toute position tenable n’est-elle pas, par définition, une position médiocre ? Je me souviens de cette phrase, lue dans Réelles présences : « La culture n’a pas sauvé de la barbarie. Elle doit pourtant être notre seul recours. » Voilà le noyau steinerien : un pessimisme actif. Un courage mêlé de désespoir. Une foi sans illusion. Et pour revenir encore à l'idée d'Europe : Steiner aime l’Europe de Dante, de Goethe, de Proust — cette Europe des chefs-d’œuvre. Mais il n’oublie pas l’Europe d’Auschwitz, cette Europe des charniers. Comment concilier les deux ? Il ne le fait pas. Il les garde ensemble, douloureusement, comme on garde une cicatrice qui ne se ferme pas. « L’Europe est ma langue maternelle, mais une langue maternelle qui a commis des crimes contre l’humanité. » Penser avec Steiner, ou comme lui, ou se découvrir des affinités avec sa pensée, c’est accepter de vivre avec des contradictions qui ne se résoudront jamais. C’est habiter un château de Barbe-Bleue où chaque porte ouverte révèle à la fois un trésor et un cadavre. Cependant Steiner me rappelle quelque chose que j'ai ces derniers temps tendance à oublier : à ne pas avoir peur des positions intenables. À cultiver le doute comme une vertu. À aimer les questions plus que les réponses. Je note cette phrase, que je viens d’écrire et qu’il n’a peut-être jamais dite, mais qu’il aurait pu signer : « La pensée commence là où finit l’appartenance. » Et cette habitude de vivre avec des contradictions, ne serait-ce pas là, justement, la marque d’une pensée talmudiste sans Dieu ? Steiner pense en talmudiste sécularisé, cette habitude de gloser le commentaire, de déplier le texte à l’infini, de chercher non la conclusion mais l’ouverture — c’est la méthode des yeshivas, sécularisée, transposée dans le champ de la culture occidentale. Je me souviens de cette phrase, lue quelque part dans « Maîtres et disciples » : « Tout grand texte est un midrash en puissance. Il ne se referme jamais. Il attend le commentaire qui le prolongera, le contredira, le fécondera. » Steiner ne commente pas la Torah, mais il commente Homère, Dante, Shakespeare, Kafka — avec la même ferveur, la même minutie, le même refus de clore le sens. Demain, je relirai Le Transport de A.H., ce texte vertigineux où Steiner imagine Hitler réfugié en Amazonie. Texte insoutenable, nécessaire. Comme toute son œuvre. Nous avons gouté la potée ce dimanche au déjeuner, j'avais pris soin de la faire réchauffer au four le matin même. Dans le fond les saucisses étaient en trop, ou bien elles n'étaient pas pertinentes, il eut fallu prendre de la morteau plutôt que de la toulousaine. Le lard fumé est amplement suffisant. A noter le dégoût que m'inspire la viande, ou plutôt non, c'est plus compliqué que cela, une part profonde, enfouie la désire, me fait saliver, tandis qu'une autre, antagoniste, plus raisonnée sans doute ou délicate ou sensible la réfute. En fin d'après-midi je relis les textes que j'ai placés à la publication ce jour. La photographie de ce char anglais dans les rues de Tallinn , je m'interroge encore sur la raison pour laquelle j'ai choisi cette image, et je pense au terme de kairos utilisé par les grecs anciens — ce moment de grâce où le temps n’est plus chronologique, mais opportun, où tout s’assemble sans effort apparent. Ce n’est pas du hasard. C’est la convergence de tout un travail souterrain, d'une attention, d'une préparation, la tension d'un ressort et tout à coup le trop plein qui prend la forme d'un lâcher-prise.|couper{180}

histoire de l’imaginaire
L’Imaginaire du Bouc Émissaire : comment la confusion judaïté/sionisme dévore nos récits collectifs
L’Imaginaire du Bouc Émissaire : comment la confusion judaïté/sionisme dévore nos récits collectifs « Aux sources mythologiques de l’antisémitisme contemporain » Illustration : Lithographie pour la Légende du Juif errant, de Gustave Doré.Bnf, Les Essentiels Ouverture : La métamorphose des vieux démons L’imaginaire n’est pas seulement le domaine des anges et des chimères ; il abrite aussi nos démons les plus anciens. Aujourd’hui, en France, nous assistons à une métamorphose inquiétante : le vieux fantasme du « juif errant » se recycle en « sioniste mondialiste ». Les mêmes peurs, les mêmes haines, revêtent des habits neufs. Cet article ne parlera pas de géopolitique, mais de mythologies – de ces récits qui, comme l’écrivait George Steiner, « en disent plus long sur ceux qui les portent que sur ceux qu’ils prétendent décrire ». La question n’est pas de savoir si l’on est « pour » ou « contre » Israël, mais pourquoi l’imaginaire collectif français a besoin, aujourd’hui encore, d’une figure sacrificielle. Pourquoi le juif – ou son avatar moderne, le « sioniste » – reste-t-il le réceptacle de nos angoisses identitaires ? I. L’imaginaire antisémite, une constante anthropologique Le juif, dans l’imaginaire occidental, incarne une figure de l’entre-deux. Au Moyen Âge, il était celui qui n’était ni tout à fait d’ici, ni tout à fait d’ailleurs – suspecté de double allégeance, de pratiques occultes, de pouvoirs cachés. Aujourd’hui, la structure narrative persiste : on lui reproche d’être « trop français » ou « pas assez français », « trop loyal » ou « trop cosmopolite ». Cette plasticité mythologique est frappante. Hier, on accusait les juifs de boire le sang des enfants chrétiens ; aujourd’hui, on leur prête le contrôle des médias et de la finance mondiale. La forme change, mais le fond demeure : l’attribution de pouvoirs occultes et disproportionnés. Comme l’écrit l’historien Léon Poliakov dans Le Mythe aryen (1971), « l’antisémitisme est un fantasme qui se nourrit de lui-même ». La confusion entre judaïté et sionisme s’inscrit dans cette longue tradition. Elle opère un transfert de sacralité : de la religion à la politique. Le « peuple déicide » devient l’« État colonial » ; la faute théologique se mue en faute politique. Mais la structure narrative reste identique : celle du bouc émissaire chargé de tous les péchés du monde. II. La confusion judaïté/sionisme, nouveau visage d’un vieux récit Steiner, dans Dans le château de Barbe-Bleue (1971), posait cette question fondamentale : « Comment la culture allemande, si raffinée, a-t-elle pu produire la barbarie nazie ? » Aujourd’hui, nous pourrions demander : comment la France des Lumières, patrie des droits de l’homme, peut-elle laisser resurgir ces vieux démons ? La réponse réside peut-être dans la fonction psychique de l’imaginaire antisémite. Dans toute société, il existe un besoin anthropologique de désigner un « mauvais objet » – un responsable des maux du monde. Hier, la peste était provoquée par les juifs ; aujourd’hui, l’impérialisme est incarné par les « sionistes ». La même externalisation de l’angoisse, le même refus de la complexité. Le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur la lutte contre le racisme (2023) le confirme : les actes antisémites ont augmenté de 40 % en France, souvent sous couvert d’antisionisme radical. Mais comme le rappelle l’essayiste Pierre Birnbaum dans « Géographie de l’espoir » (2004), « l’antisionisme n’est souvent que l’habillage moderne d’une vieille haine ». III. Steiner, lecteur des imaginaires toxiques Steiner nous offre une clé pour décrypter ces mécanismes. Dans « Réelles présences » (1991), il écrit : « La culture n’a pas sauvé de la barbarie. On peut lire Goethe le matin et torturer l’après-midi. » Cette terrible lucidité éclaire notre époque : l’éducation ne vaccine pas contre les mythologies haineuses. L’éthique steinerienne de la lecture complexe nous invite à décrypter les sous-textes, les implicites, les non-dits. À questionner les mots : que signifie vraiment « antisionisme » quand il sert à justifier des agressions contre des enfants juifs ? Que cache le vocable « sioniste » quand il est brandi comme une insulte ? Steiner, dans son fameux entretien à France 3 (2002), résumait son ambivalence : « Je suis sioniste le matin, anti-sioniste l’après-midi. » Cette position inconfortable – souvent incomprise – est pourtant la seule tenable face à la simplification mortifère. Elle refuse l’assignation identitaire, revendique le droit à la complexité. IV. Contre-imaginaires : comment réécrire le récit ? Face à ces imaginaires toxiques, la littérature et la philosophie nous offrent des contre-récits. De Patrick Modiano, hanté par les traces de l’Occupation, à Jonathan Littell et « Les Bienveillantes » (2006), qui explore la banalité du mal, les écrivains nous rappellent que la complexité humaine résiste à toutes les simplifications. Steiner, dans « Passions impunies » (1997), défendait un « imaginaire de la nuance » – une capacité à habiter les contradictions, à refuser les identités imposées. Cet imaginaire-là est peut-être notre seule planche de salut. Il nous apprend à dire « et » plutôt que « ou », à accepter que l’on puisse être plusieurs choses à la fois : juif et français, critique d’Israël et opposant à l’antisémitisme, universaliste et attaché à ses racines. Le travail des associations comme le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) ou SOS Racisme montre que ce combat n’est pas perdu. Leur rapport annuel sur l’antisémitisme (2024) documente autant la montée des actes haineux que les résistances citoyennes. Conclusion : L’imaginaire comme champ de bataille L’antisémitisme n’est pas une opinion politique parmi d’autres ; c’est une maladie de l’imaginaire collectif. Comme toutes les pathologies imaginaires, elle se nourrit de peurs, simplifie le complexe, et offre des boucs émissaires plutôt que des solutions. Dans notre rubrique dédiée à l’imaginaire, il fallait donc lui faire une place – non pour lui donner droit de cité, mais pour montrer comment, à l’ère des réseaux sociaux et de l’information instantanée, les vieux démons apprennent à se recycler. Face à eux, notre arme n’est pas la censure, mais une imagination plus riche, plus complexe, plus humaine. Celle qui, comme l’écrivait Steiner, « sait douter d’elle-même ». Après avoir exploré l’imaginaire anthropophage de la SF latino-américaine, nous découvrons ainsi une autre forme de dévoration : celle qui consume la raison au profit des vieux mythes. La suite de cette enquête nous mènera peut-être vers d’autres pathologies de l’imaginaire contemporain. Car, comme le rappelait Steiner, « là où l’on brûle les livres, on finit par brûler les hommes ». Sources citées : STEINER, George. Dans le château de Barbe-Bleue (1971) STEINER, George. Réelles présences (1991) STEINER, George. Passions impunies (1997) POLIAKOV, Léon. Le Mythe aryen (1971) BIRNBAUM, Pierre. Géographie de l’espoir (2004) LITTEL, Jonathan. Les Bienveillantes (2006) Rapport CNCDH 2023 sur la lutte contre le racisme Rapport du CRIF sur l’antisémitisme (2024)|couper{180}

Carnets | Atelier
29 octobre 2025
Je ne dors toujours pas. Il est bientôt trois heures. J’ai pu ôter mon pansement. Toujours aucune douleur, ça cicatrise bien. Néanmoins il faut s’abstenir de porter des charges lourdes. J’ai lu, une bonne partie de la soirée et de la nuit, quelques livres de Gustave Le Rouge. Je pense à FB, plongé de son côté, probablement au même moment, dans la vie de Lovecraft, 1925, à moins qu’il ne soit dans celle de Balzac, de Rabelais. Chacun faisant comme il peut pour échapper à l’imminence d’une catastrophe que nous pressentons tous. Et, à côté de tout cela, le rouleau compresseur du quotidien. Cette réalité implacable du temps qui passe. Sur les cinq cent quatre-vingt-dix euros gagnés au cours des trois derniers mois, cent vingt-six iront à l’URSSAF. Regarder froidement les faits. Information lue par hasard — qu’au mois de novembre deux mille vingt-six — les découverts autorisés seront soumis au même régime que les crédits à la consommation. C’est-à-dire que de nombreuses personnes, ne gagnant guère plus que le salaire minimum, se verront refuser ce pseudo-crédit : un pas de plus vers la paupérisation en France. Ce chaos, ces peurs que l’on ne cesse de nous brandir, ces sempiternelles diversions : quelles fonctions ont-elles, vraiment ? Tout cela, apparemment, ne semble avoir aucun sens. Pour ma part, je crois que cet immense théâtre de guignol montre à quel point le système est malade ; à cet instant il devient véritablement plus dangereux, réellement prêt à tout, à tous nous tuer au besoin pour se survivre à lui-même. Ce qui fait que j’ai retardé le moment de remonter au grenier pour descendre les cartons de livres paternels ; en fin de compte, j’ai décidé de scanner un par un les ISBN et de les refourguer sur des plateformes de vente d’occasion. Je n’ai plus le temps de lire des policiers, j’ai tellement d’autres livres à lire encore. Et puis j’ai peur qu’à la fin tout cela s’abîme. Le froid s’est déjà logé là-haut et j’ai bien peur que l’humidité n’arrive d’ici peu. S. s’est fait vacciner contre la grippe. Ses analyses reçues hier sont bonnes. C’est de mon côté que ça se corse. J’ai envoyé celles-ci à M. par l’entremise de l’espace Santé. Qu’on sache tout de moi à travers ces divers espaces — finance, santé, littérature — quelle importance. Je n’ai pas, de moi-même, une si haute idée d’importance pour que la peur me vienne d’être à découvert, pas en très bonne santé, vieux et un peu plus mauvais qu’hier. En cela, ce que je pense ou dis n’a guère d’importance dans l’immédiat, c’est juste un témoignage comme un autre de la vie de notre temps. Pansement d’urgence pour remplacer les flipbooks défaillants. Mais il faudra revenir dans les boucles SPIP, car les compilations, si elles restituent bien les articles par rubrique et mots-clés, conservent toujours le titre « carnet / mois ». Ce qui ne va pas pour les rubriques Lectures, Fictions, etc. Création d'un .htaccess spécial dans le dossier JS pour débloquer turn.js. Étudié le lecteur de flux RSS Feedly et commencé à créer ma liste de sites suivis, en fait celle qui existe déjà dans les favoris du navigateur. J’ai réussi à bricoler un outil de conversion via les fichiers de TC récupérés sur son Git. Reste à étudier le problème des fréquences, qui semble dépendre de mon usage. En fait, je ne me pose pas la question de combien de fois je vais visiter tel ou tel site dans une journée, une semaine, un mois. Ce sont de nouvelles questions inédites. Et, comme telles, certainement plus intéressantes en soi que toute réponse à leur apporter. Repris aussi deux textes sur la littérature de SF en Chine et en Inde dans Histoire de l’imaginaire. Ajouté une réflexion dans la rubrique Fictions/archives/Instituteur. En tirant parti de ma lecture de Le Rouge. C’est après coup, en me demandant soudain pourquoi Le Rouge, que j’ai compris ce lien avec mon arrière-grand-père. illustration île de la Platière, Saint-Pierre-de-Boeuf|couper{180}

Carnets | Atelier
27 octobre 2025
À partir d’un document trouvé sur le net : Gertrude Stein on Punctuation signé Kenneth Goldsmith. Poursuivre une réflexion sur la ponctuation. J’hésite entre deux titres encore. Arrêter sans interrompre. Économie de la respiration. Le point selon Gertrude Stein : arrêter sans interrompre Chez Gertrude Stein, le point n’est pas un signal de fin mais un organe. Il n’indique pas « ça s’arrête ici », il permet plutôt au mouvement de continuer après une prise d’appui nette. C’est une différence de nature : là où beaucoup de signes servent l’économie du lecteur, le point, lui, sert l’énergie de la phrase. Dans ses conférences américaines, Stein explique que le besoin de going on — d’écrire sans s’interrompre — l’a conduite à éprouver chaque marque pour ce qu’elle fait au flux. Le point a gagné parce qu’il autorise la pause sans imposer le repos, une bascule franche qui clarifie la poussée au lieu de la diluer. On pourrait imaginer la phrase comme une marche en terrain accidenté : la virgule nivelle et tient la main ; le point plante un bâton dans le sol, prend l’appui, et relance. Ce renversement explique son aversion pour les signes « serviles » — son mot est dur, mais précis. La virgule, chez elle, sert d’abord une gestion assistée du souffle. Elle aide, donc elle affaiblit : on délègue à une petite prothèse typographique ce que la construction devrait faire sentir d’elle-même. Le point, à l’inverse, ne materne pas, il décide. Il ne « fait pas joli », il ne simule pas la nuance ; il tranche pour rendre à la syntaxe sa responsabilité. La conséquence stylistique est claire : plus la phrase se complexifie, plus le point devient un allié, parce qu’il oblige l’auteur à prendre position sur la structure, et le lecteur à se savoir en train de traverser un relief. Si l’on aime vraiment les longues périodes, dit Stein en substance, on préfère démêler que couper le nœud : le point marque le moment où l’on a vraiment démêlé. Ce n’est pas une morale de l’austérité pour l’austérité. Chez Stein, le point finit par acquérir une « vie propre ». Il n’est plus seulement un arrêt nécessaire ; il devient une force qui compose. Dans certains textes tardifs, la ponctuation pose ses jalons comme un motif rythmique indépendant, installant une logique de coupes qui n’obéit plus au seul découpage narratif. On n’est pas loin d’une prosodie : le point articule des blocs d’attention. Il ne sert pas la « clôture », il sert la forme — au sens où la forme est ce qui distribue la tension et gouverne la durée. C’est pourquoi, paradoxalement, l’usage radical du point n’éteint pas la durée, il l’invente : chaque arrêt permet que « ça reparte » en sachant mieux ce que l’on porte. En creux, ce parti pris fait apparaître l’ambiguïté du point-virgule et du deux-points. On peut les pousser du côté du point — gestes de décision — ou les laisser glisser vers la virgule — gestes d’assistance. Stein tranche : sous leurs airs imposants, ils restent de nature comma, plus décoratifs que structurants. Autrement dit, ils risquent de produire de la nuance en prêt-à-porter, sans nous obliger à faire le travail d’architecture. Le point, lui, oblige. C’est sa rugosité — et sa vertu. Les guillemets de distance ou l’exclamation spectaculaire, pour Stein, déplacent le sens hors de la phrase ; la virgule déplace l’effort ; le point, au contraire, recentre l’un et l’autre là où ils doivent se résoudre : dans la syntaxe. Qu’est-ce que cela change pour nous, aujourd’hui, dans l’écriture courante ? D’abord, de cesser de craindre l’arrêt net. Un point trop tôt n’est pas un échec si l’on a formulé un vrai nœud d’idée : il devient la condition d’une reprise plus exacte. Ensuite, d’accepter que la clarté n’est pas la multiplication de petites béquilles mais la netteté des décisions. Une page révisée « au point » n’est pas une page courte ; c’est une page où chaque unité d’énonciation est assumée comme telle. Enfin, de voir le point comme un test d’attention : si l’on ne parvient pas à placer un point, c’est souvent que la phrase n’a pas décidé ce qu’elle voulait faire — décrire, relier, conclure, renverser — et qu’on lui demande de tout faire à la fois. Le geste steinien n’ordonne pas de bannir la virgule ; il nous apprend ce qu’elle coûte. À chaque virgule insérée pour « aider », demander : est-ce une articulation logique indispensable ou un palliatif qui empêche la phrase de tenir par elle-même ? À chaque point posé, vérifier : relance-t-il vraiment ou sert-il d’écran de fumée à une idée qui n’ose pas se formuler ? En ce sens, le point est moins un signe de ponctuation qu’un instrument de responsabilité. Arrêter sans interrompre, c’est accepter que le sens naisse d’un enchaînement de décisions visibles, non d’un ruissellement d’effets. Et c’est rendre au lecteur non pas la facilité, mais l’attention : cette manière de marcher dans la phrase en sentant, sous le pied, la fermeté du terrain. Maintenant, il faut que je parle de la différence entre écrire pour le numérique et écrire pour l’objet-livre. Je ne me dis jamais, avant d’écrire, si je veux écrire pour le numérique ou faire un livre. Je ne pense pas à ça. Mais je suis plus attentif, ces derniers temps, à un dilemme qui pointe : écrire en me laissant porter par ce qui vient au moment où j’écris — appelons ça le hasard de l’écriture — ou bien élaborer une stratégie plus orientée « article ». Je dis rarement « article », je dis « texte » pour tout : il y a là une résistance. C’est-à-dire que ça ne me plaît pas de saucissonner l’écriture. Il y a surtout le mot « écriture ». Celui-ci, tant que je ne l’ouvre pas en deux, tout va bien ; c’est sans doute le seul à ne pas ouvrir. Pour le reste, me concentrer sur les poissons-pilotes — articles, textes, billets, rubriques, collections — sert à apprivoiser le format et à poser quelques rambardes de sécurité, afin de ne pas me laisser distraire de l’essentiel : l’économie de respiration. L’écriture est ma ligne de flottaison ; la tenir me rend plus présent aux miens. Tension descendue à 10. L’année passée, à la même période, j’étais à 16–17. En discutant avec l’infirmière, elle me dit que c’est plutôt pas mal d’avoir une tension basse ; il faut juste faire attention à l’essoufflement, prendre son temps pour gravir un escalier, pour se relever d’un siège… Mon Dieu, tout ce qu’il faut bricoler pour tenir, j’ai dit, elle s’est marrée. Je termine ici, avec cette histoire de tension qui descend et de marche à gravir sans bravade : écrire pour l’écran m’a appris la même chose que l’infirmière m’a rappelée ce matin, une économie de respiration. Des points comme des paliers, des virgules comme de courts soupirs, pas de signes qui crient pour donner l’illusion de courir plus vite que le sang. On tient mieux en posant l’appui puis en relançant, et ce que je bricole pour rester debout — me lever en trois temps, monter les escaliers sans me prouver quoi que ce soit — ressemble beaucoup à ce que je demande à mes phrases : décider, reprendre souffle, continuer. illustration Escaliers, Escher|couper{180}

Lectures
Lire La Mécanique des femmes aujourd’hui
J’ai appris, avec l’âge, que certains livres ne se lisent pas seulement avec les yeux mais avec la pièce où l’on se trouve. La lumière, la chaise, le téléphone en veille, le bruit de la rue. {La Mécanique des femmes} appartient à cette catégorie-là : on ne l’ouvre pas innocemment, et l’époque, qui a déplacé la censure du dehors vers le dedans, vient s’asseoir à côté de vous au moment où vous tournez la première page. On ne vous interdit rien ; on vous observe lire. La surveillance est incorporée, presque courtoise. Elle ne confisque pas le livre, elle ajuste votre respiration. Très tôt d’ailleurs, le texte se cabre par une réplique nue, sans glose : — Tu ne penses jamais à la mort ? Ce n’est pas une thèse, c’est une voix. Elle sidère, puis installe le régime de lecture : on n’est pas seul avec un « il », il y a d’autres timbres dans la pièce. On dit volontiers que le texte « objectifie » les femmes. Il y a de quoi. Le regard y est frontal, parfois cruel, et les corps sont décrits comme des surfaces de contact — ce qui, pour une lecture solitaire, active aussitôt le tribunal intime. Mais le livre ne se laisse pas résumer à cette seule accusation. Il avance par fragments, en dérapages de voix, et ce montage fissure la souveraineté du « je ». À mesure qu’on progresse, l’instance qui parle se trouble : confessions qui se contredisent, souvenirs sans preuves, phrases ramassées au couteau dans des bars, des chambres anonymes, des parkings d’après-minuit. La question cesse d’être « que dit-il des femmes ? » pour devenir « qui parle, ici, et à quel titre ? ». C’est le premier déplacement nécessaire aujourd’hui : lire non pas un dogme, mais un dispositif. Ce dispositif se voit dans l’{inventaire} — cette façon de nommer, d’aligner, de classer. L’énumération donne l’illusion d’une vérité sans artifice, mais c’est une mise en coupe du réel : — Crapaud enculé, vieille salope, perte blanche, pipi, bite… (…) Autour de nous, la chambre est une enveloppe fœtale. Nommer, ici, c’est cadrer. Et cadrer, c’est décider de ce qui entre et de ce qui sort du champ (on peut convoquer Mulvey sans slogan : qui cadre, pour qui, avec quel pouvoir d’identification). L’indignation pure — utile, morale, parfois nécessaire — rate pourtant quelque chose si elle s’arrête à la coupe. Car le montage laisse passer des voix féminines. Elles ne sont ni sages ni pédagogiques. Elles sont triviales, insolentes, vulgaires parfois ; elles racontent la fatigue, la faim, la jouissance comme on parle d’une heure perdue sur le périphérique. — Je ne suis pourtant pas très belle, mais les hommes me choisissent plus souvent que d’autres que je trouve dix fois mieux que moi. Pas « la Femme » majuscule : une économie concrète des regards, dite à la première personne. (Cixous peut aider à penser ce surgissement : des paroles féminines apparaissent dans un cadre tenu par un homme et déplacent les places sans effacer l’architecture.) On me dira que c’est encore l’homme qui cadre, que c’est lui qui choisit la coupe, la focale, la phrase finale. C’est exact. Et c’est précisément là que le second déplacement, celui de notre époque, opère : qui tient la lecture ? Dans un club, sur une scène, quand des actrices disent ces fragments et les poussent jusque dans la respiration, le livre bascule. Le texte ne change pas d’un mot ; c’est la prise en charge qui se déplace. Les mêmes phrases, prononcées par une femme, cessent d’être un inventaire du regard masculin pour devenir une scène de réappropriation : un « on m’a dite » retourné en « je me dis ». La page n’excuse rien ; elle déplace. Et ce déplacement a aujourd’hui plus de sens que n’importe quel label d’acceptabilité. Reste la lecture solitaire, la plus risquée, celle qui compte. Elle se fait sans médiation, sans contexte institutionnel, sans préface qui rassure. C’est là que travaille la censure intérieure : non un bâillon, mais une suite de scrupules. Est-ce que je peux trouver ça fort tout en refusant la violence du point de vue ? Est-ce que je dois refermer le livre pour ne pas « cautionner » ? La bonne foi moderne aime les réponses nettes, les colonnes « pour/contre ». La littérature, pas toujours. Ce livre vous met à l’épreuve non parce qu’il demande l’adhésion, mais parce qu’il oblige à tenir deux gestes en même temps : reconnaître l’angle mort du regard et reconnaître la puissance du document brut. Une phrase-couteau le montre : Excite-toi sur elles tant que tu veux, mais ton foutre est pour moi. Adresse, pouvoir, contrat : le centre de gravité se déplace — assez pour changer l’écoute. Il faut aussi se souvenir d’une autre chose : Calaferte a longtemps écrit contre la façade, contre les bienséances éditoriales. On peut refuser sa manière tout en admettant que sa phrase, lorsqu’elle tranche, vise l’endroit où l’époque colle du vernis. Notre époque n’est pas plus morale que celle d’hier ; elle est plus procédurière. Elle réclame des avertissements, des cadres, des dispositifs d’alerte. Cela peut protéger. Cela peut aussi asphyxier. On ne sortira pas de cette tension en triant les bibliothèques à coups d’étiquettes. On en sort, parfois, en lisant à deux niveaux : niveau 1, l’analyse du regard (qui parle, d’où, sur qui) ; niveau 2, l’écoute des phrases qui échappent au programme de celui qui parle. Ce double foyer devient évident devant un tableau scénique : Elle est courbée sur l’escalier de pierre qu’elle lave à grandes eaux… l’homme la regarde fixement… l’eau de rinçage est propre. Corps, geste, regard : matériau idéal pour distinguer ce que le cadre impose et ce que la scène fait fuir. Je ne dis pas que cela « suffit ». Je dis que, pour une lectrice d’aujourd’hui, l’épreuve est peut-être ailleurs : non dans l’acceptation ou le rejet, mais dans la maîtrise de l’oscillation. Lire en sachant que l’injustice de l’angle est réelle. Lire en sachant que la phrase, parfois, la traverse et la met à nu. On peut se tenir sur cette crête. Ce n’est pas confortable. Cela l’est d’autant moins que les réseaux demandent des postures complètes, des verdicts de 240 caractères. Le livre résiste à ce format. Il n’offre pas de position stable plus de deux pages d’affilée. Alors, que faire de cette lecture au présent ? Deux gestes, encore. Le premier : contextualiser sans neutraliser. Rappeler que l’écriture est un montage, souligner ce qui, dans la forme, fracture l’autorité du narrateur, ouvrir la porte aux répliques féminines — sur scène, en club, dans des contre-essais. Le second : assumer le tête-à-tête. Accepter d’être seule, seul, avec ce livre, et d’entendre ne serait-ce qu’une fois la lampe grésiller au-dessus de la page. C’est dans cette solitude que l’on mesure si l’on est sommé de se taire par le vieux censeur extérieur (on l’entend encore, il est sonore, daté) ou par le nouveau censeur intérieur, plus subtil, qui demande : « es-tu sûre de vouloir penser ça ? ». La question n’est pas honteuse. Elle est même saine. Ce qui serait dommage, c’est qu’elle tienne lieu de réponse. On peut, je crois, tenir la note juste : reconnaître l’asymétrie du regard et refuser l’objectivation comme horizon ; et, dans le même mouvement, lire le livre comme un terrain de voix où des femmes existent, parlent, jurent, transigent, se protègent, se perdent. Quand ces voix passent par des bouches féminines — actrices, lectrices publiques, critiques — le texte se reconfigure. Quand elles passent par votre lecture silencieuse, c’est vous qui tenez la balance : vous pesez l’angle, vous pesez la langue, et vous décidez si la phrase a gagné le droit de rester. Il n’y a pas de méthode miracle, seulement des conditions : une pièce, une lampe, du temps, et la volonté de ne pas réduire le risque à un slogan. {La Mécanique des femmes} n’est pas un protocole de bonne conduite. C’est un test. Il ne dit pas ce que doivent être les femmes. Il montre, brutalement, ce que la langue peut faire quand elle désire, déteste, écoute, et perd le contrôle. Notre époque, qui voudrait des textes irréprochables, oublie parfois que la littérature d’importance ne s’excuse pas. Elle demande des lectures responsables. Au fond, la vraie question — celle que la petite censure en chacun n’aime pas — est simple : que vous a fait ce livre, ici et maintenant ? Si la réponse n’entre pas dans une case, tant mieux : c’est le signe qu’il reste du monde dans la page. Bio normalisée {{Louis Calaferte}} (Turin, 1928 – Dijon, 1994), écrivain français (romans, théâtre, carnets). Débuts remarqués avec {Requiem des innocents} (1952) ; {Septentrion} (1963) frappé d’interdiction à la vente puis réédité dans les années 1980 ; {La Mécanique des femmes} (1992) cristallise une réception clivante. Dramaturge ({Les Miettes}, {Un riche, trois pauvres}), diariste (série des {Carnets}). Grand Prix national des lettres (1992). Éditions : Gallimard, Denoël ; poches chez Folio. Œuvre régulièrement lue et montée. Cixous, Hélène. « Le Rire de la Méduse ». L’Arc, no 61, 1975, p. 39-54. Cixous, Hélène. « The Laugh of the Medusa ». Signs : Journal of Women in Culture and Society, vol. 1, no 4, 1976, p. 875-893. Cixous, Hélène & Catherine Clément. La Jeune Née. 1975. (Pour une trad. angl. accessible : The Newly Born Woman, University of Minnesota Press, 1986.)|couper{180}

Carnets | Atelier
23 octobre 2025
Adorno s’amuse à regarder les signes de ponctuation comme des petites figures avec une tête et un caractère : le point d’exclamation qui lève le doigt, le point-virgule moustachu, les guillemets qui se lèchent les babines. Pour lui, ce ne sont pas que des outils de grammaire, mais des gestes qui règlent la respiration du texte, presque comme des indications musicales. Comma = demi-cadence, point = cadence parfaite : la phrase rejoue de la musique sans le dire. Il taille un costard aux points d’exclamation : jadis élan, aujourd’hui posture d’autorité — du bruit typographique qui essaie d’imposer l’emphase de l’extérieur. Les avant-gardes en ont abusé, signe d’une envie d’effet plus que d’un véritable travail de la langue. Le tiret (le vrai, pas le gadget suspensif) marque la cassure utile : il accepte la discontinuité quand deux idées se regardent sans vraiment se toucher. Theodor Storm en a fait un art discret ; ses tirets sont des rides qui creusent le récit et ouvrent une distance. Il défend le point-virgule — oui, ce grand malade : sa disparition signale qu’on ne sait plus tenir une période ample, articulée, respirant large. À force de tout couper court, la prose capitule devant le simple “constat” et perd sa capacité critique. Côté parenthèses : mieux vaut des tirets pour intégrer le digressif sans l’exiler ; mais il pardonne à Proust ses vraies parenthèses, parce que, chez lui, l’incise devient fleuve — il faut des digues solides pour que l’édifice ne déborde pas. Les guillemets ironiques ? À proscrire : juger un mot “à distance” en le mettant entre crochets typographiques, c’est refuser de faire le boulot dans la phrase elle-même. Et les points de suspension en mode ambiance… typiquement le cache-misère d’une profondeur supposée. Conclusion d’Adorno : on ne gagne jamais complètement avec la ponctuation — règles trop raides d’un côté, caprices expressifs de l’autre. Alors on vise l’ascèse : mieux vaut trop peu que trop, mais intentionnel à chaque signe, comme un musicien qui sait quand oser la dissonance Bruce Andrews soutient que lire Gertrude Stein, c’est lâcher l’idée que les mots “représentent” : la langue agit directement, par sons et rythmes, en détraquant grammaire, récit et expression de soi. La lecture devient une expérience physique et immédiate qui nous désoriente, fissure l’ego et remplace l’analyse distante par une contagion sensorielle. La “présence” naît de micro-chocs matériels des mots : on se fait littéralement prothèse du texte, emporté par ses accélérations. Plutôt qu’expliquer ou contextualiser, il faut accueillir cette énergie — plaisir, surprise, excitation — comme une pratique de transformation du lecteur.|couper{180}

Carnets | creative writing
Décrire le lieu, Gracq et Bergounioux
Comment proposer la description d' un même lieu par différents personnages dans une fiction. D'une façon ambitieuse il pensa immédiatement à Julien Gracq , ou plutôt Louis Poirier Agrégé d’histoire-géographie. Œil de géographe : relief, hydrographie, expositions, axes. Les lieux sont pensés en structures, pas en décors. Echelle, cadrage. Il zoome et dézoome avec méthode : plan d’ensemble, lignes de force , points d’appui. Exemple : Un balcon en forêt construit l’Ardenne par crêtes, vallons, brumes, postes, puis replis. Géologie et hydrologie : Le terrain prime : affleurements, talwegs, méandres, nappes de brouillard, vents dominants. Les Eaux étroites est une leçon d’hydrologie intime sur l’Èvre, rive après rive, seuil après seuil. Toponymie et axes. Noms précis, directions, continuités. La Forme d’une ville arpente Nantes par rues, quais, ponts, pentes, et montre comment un tissu urbain impose ses trajectoires au corps. Atmosphère comme système : Météo, lumière, acoustique et odeurs forment un régime continu. Chez lui, un front de brouillard ou un contre-jour modifient la lisibilité d’un site comme le ferait un changement de carte. Syntaxe topographique : Périodes longues, appositions, reprises anaphoriques. La phrase dessine le plan : d’abord l’armature, puis les détails, puis la bascule sensible. Effet d’onde qui “contourne” l’objet avant de le saisir. Seuils et lisières Ports, bordures d’eau, franges forestières, talus, presqu’îles. Le “lieu” naît au contact des milieux. La Presqu’île et Le Rivage des Syrtes travaillent la tension entre terre et eau, connu et indécis. Réel et imaginaire raccordés Orsenna ou les Syrtes sont fictifs mais régis par des lois physiques crédibles. L’imaginaire garde une cohérence géographique, d’où la puissance d’immersion. Mémoire des formes : Le temps sédimente le site. La Forme d’une ville superpose âges urbains, démolitions, survivances. Le paysage devient palimpseste lisible. Poétique sans flou. Lexique exact, images parcimonieuses et orientées. Le lyrisme sert la lisibilité du relief, jamais l’inverse. Références rapides Ville : La Forme d’une ville (Nantes). Forêt/relief : Un balcon en forêt (Ardennes). Cours d’eau : Les Eaux étroites (Èvre). Littoral et seuils : La Presqu’île. Géographie imaginaire crédible : Le Rivage des Syrtes. Le Rivage des Syrtes Un jeune aristocrate d’Orsenna, Aldo, est nommé « observateur » sur le rivage des Syrtes, frontière maritime face au lointain Farghestan, ennemi officiel mais endormi depuis trois siècles. Il découvre un État décadent qui a fait de l’attente sa politique : flottes désarmées, fortins en ruine, traités tabous. Aimanté par la mer interdite et par une grande dame de la cité, il franchit peu à peu les limites : patrouilles plus loin que la ligne fixée, exploration d’îles et de passes, interrogation des archives et des secrets d’État. Cette curiosité devient transgression ; un geste symbolique relance le jeu stratégique et provoque l’engrenage. Les signaux se rallument, les ports s’animent, les escadres sortent : la « veille » bascule en guerre. Roman d’atmosphère et de seuils, Le Rivage des Syrtes décrit la fin d’un monde figé, happé par le désir d’éprouver le réel. Thèmes centraux : fascination du dehors, fatalité historique, politique de l’évitement, géographie comme destin. Style : phrases longues, cartographie précise, métaphores de brumes, d’eaux et de lisières qui rendent perceptible la carte d’un empire au moment où il se réveille. réflexion : métaphore de l'écriture Correspondances clés Attente stratégique → gestation du texte, temps de veille avant la première phrase. Rivage/zone interdite → page blanche, seuil où l’on hésite. Cartes, passes, vents → plan, structure, contraintes formelles. Archives et secrets d’État → notes, lectures, matériaux enfouis. Décadence d’empire → formes usées qu’il faut dépasser. Transgression d’Aldo → acte d’écriture qui franchit le tabou initial. Signal rallumé, flotte qui sort → mise en mouvement du récit après l’incipit. Brume, brouillage des lignes → indétermination productive du brouillon. Lisières et seuils → transitions, changements de focalisation ou de temps. Surveillance du poste → relecture et vigilance stylistique. Geste minuscule qui déclenche la guerre → phrase pivot qui engage tout le livre. Bilan Le roman modélise l’écriture comme passage du report à l’engagement, avec la géographie pour diagramme des choix poétiques. La forme d'une ville Un récit-essai de déambulation et de mémoire sur Nantes. Gracq y cartographie une ville vécue plutôt que décrite : axes, pentes, quais, ponts, passages, faubourgs. Il superpose les couches du temps (ville d’enfance, ville d’études, ville transformée) et montre comment la topographie, la toponymie et les circulations fabriquent des souvenirs. La Loire et l’Erdre (comblées, détournées, franchies) servent de moteurs de perception ; les démolitions et réaménagements modifient l’orientation intime. Le livre mêle géographie sensible, palimpseste urbain, littérature et rêves de lecteur surréaliste. Idée centrale : « la forme d’une ville » change, mais imprime au corps un plan secret qui persiste, d’où la mélancolie précise du retour. Méditation : Métaphore opératoire de l’acte d’écrire et de réécrire. Correspondances précises Déambulation urbaine → exploration mentale du matériau. Axes, pentes, quais → plan, architecture du texte, lignes directrices. Passages, ponts, carrefours → transitions, changements de focalisation, nœuds narratifs. Toponymie → lexique choisi, noms propres comme balises sémantiques. Rivières déplacées/comblées → versions successives, coupes, déplacements de paragraphes. Faubourgs et lisières → marges du projet, digressions contrôlées. Palimpseste urbain → mémoire des brouillons, strates d’écriture conservées-supprimées. Ruptures du tissu (démolitions) → renoncements formels, ablations stylistiques. Orientations corporelles (monter/descendre, rive gauche/droite) → rythmes phrastiques, périodisation des chapitres. Ville d’enfance vs ville présente → tension entre première impulsion et mise au net. Regarder, revenir, comparer → relecture, montage, critique interne. Bilan La forme d’une ville propose un modèle : écrire, c’est cartographier des strates, tracer des trajets, poser des noms, puis accepter que la carte change et réoriente le texte à chaque retour. Repères clés : Cadre : Nantes, rives et quais, passages, quartiers d’étude et de transit. Geste : marche, repérage, retour, comparaison des âges de la ville. Méthode : regard de géographe + mémoire personnelle + lexique exact. Thèmes : palimpseste, orientation, disparition, survie des noms, puissance des seuils. Effet : un atlas intime où l’espace refaçonne la mémoire et inversement. Immédiatement Pierre Bergounioux après Gracq ( dans son esprit et à propos de ressemblances ) Points communs Enseignant de formation, écrivant “à côté” du métier. Ancrage provincial fort qui structure l’œuvre. Sens géologique du paysage et de ses lignes de force. Écriture de la marche, de l’arpentage, des seuils et des reprises. Différences nettes Gracq (Louis Poirier) : imaginaire souverain, géographies littorales et frontières, décors transposés ou fictifs mais crédibles, lyrisme ample et continu. Bergounioux : Massif central et Corrèze, histoire sociale et dépossession, vocabulaire minéralogique/entomologique, carnets et enquêtes, cadence analytique plus sèche. Rapport au temps : Gracq travaille l’attente et le mythe ; Bergounioux la stratification mémoire-classe-technique. Dispositifs : romans d’atmosphère et essais de ville chez Gracq ; courts récits + “Carnets de notes” et atelier de métal chez Bergounioux. Conclusion Même “méthode du lieu” par savoir du terrain. Deux visées : le mythe géographique (Gracq) vs la radiographie historico-matérielle (Bergounioux).|couper{180}
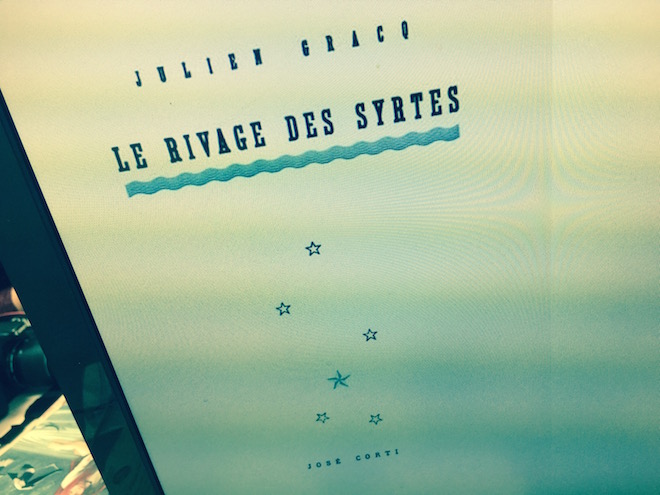
Lectures
Balzac et ses huissiers
C’est une silhouette qu’on imagine à l’angle d’une porte. Un homme en noir, papier plié, formule au présent. L’huissier, dans la vie de Balzac, n’est pas un personnage secondaire. C’est un marque-page. Il vient, il repart, il revient. Il n’interrompt pas l’œuvre, il l’ordonne. La dette est la métrique. Le recouvrement, la ponctuation. Et tout s’ensuit. Avant le roman, la fabrique. Balzac, tenté par l’intégration verticale, s’essaie éditeur, puis imprimeur, puis fondeur. Presses achetées, caractères, atelier rue des Marais-Saint-Germain, aujourd’hui rue Visconti. Les chiffres se mettent à clignoter. Entre 1826 et 1828, l’imprimerie et la fonderie sont liquidées. Le passif s’installe. Selon les notices de la BnF, on parle d’un ordre de grandeur à 60 000 francs pour 1828. D’autres récapitulatifs poussent jusqu’à 100 000 francs en cumulant les lignes (variation fréquente selon sources et périmètres). Quoi qu’il en soit, la scène est plantée : écrire pour payer les intérêts. Écrire vite. Écrire beaucoup. Écrire malgré l’huissier qui sonne. Un peu d’opulence visible, une crédibilité à maintenir. Rue Cassini, Balzac compose la réussite : étoffes, pendules, bibliothèques. C’est un appartement-argument, qui suggère l’abondance face aux partenaires, aux amis, aux créanciers parfois. Pendant qu’il agence la pièce, les relances continuent, la dette reste mobile. La maison sert d’écran et d’atelier. C’est là que s’installent des habitudes : filtrer, différer, déplacer, livrer la nuit ce qu’on a promis le jour. (On peut guetter ici la naissance d’un tempo balzacien : livraison de feuilletons, acomptes, nouvelles avances, nouveaux délais, même boucle.) Les biographies et dossiers muséaux recoupent ce montage de décor et d’arriérés. Mars 1835, nouveau dispositif. Balzac loue un second logement au 13, rue des Batailles, village de Chaillot, sous le nom de « veuve Durand ». On n’entre qu’avec un mot de passe ; il faut traverser des pièces vides, puis un corridor, avant le cabinet de travail aux murs matelassés. Architecture anti-saisie, anti-importuns, anti-huissier. Littérairement, c’est déjà une scène : antichambre, seuils successifs, filtrage. On reconnaît le mécanisme dans certains intérieurs de La Comédie humaine. Le mot de passe lui-même circule dans les souvenirs et brochures (la « veuve Durand » comme sésame), attesté par des sources anciennes relayées par la bibliographie muséale. Avril 1836, collision. Poursuivi, Balzac est arrêté à la rue Cassini et brièvement incarcéré par la Garde nationale ; l’épisode tient moins à un créancier particulier qu’au cumul des obligations civiques et financières qui convergent, mais il fixe la sensation d’un siège permanent. C’est une note de bas de page devenue rythme. Il sort vite. Il doit encore payer. Il réorganise. En 1837, Balzac s’installe « aux Jardies », Sèvres. Idée simple : mettre Paris et ses recouvrements à distance, tout en jouant la plus-value foncière. Lotir, vendre, respirer. Il loge le jardinier Pierre Brouette dans la petite maison visible aujourd’hui, lui habite une demeure plus cossue désormais disparue. Projet rationnel, réalité capricieuse. Les huissiers ne franchissent pas mieux ce périmètre que les précédents ; ils patientent, contournent, reviennent. On écrit la nuit. On promet pour la fin du mois. On rallume la cafetière. Puis Passy, 47, rue Raynouard. La maison a deux issues : Raynouard en haut, Berton en bas. Balzac signe « Monsieur de Breugnol » (par la gouvernante Louise Breugniol). Là encore, l’architecture répond à la procédure : deux portes contre une sommation, un alias contre une assignation. On travaille au rez-de-jardin, on descend par la rue Berton si la cloche persiste. C’est la période la plus productive : la dette devient cadence, la cadence baptise l’œuvre. L’édition Furne (« La Comédie humaine » réunie) fournit de l’oxygène et des contraintes. Le traité laisse à Balzac l’ordre et la distribution, mais l’exécution réelle est chaotique. Livraisons hebdomadaires, volumes 1842-1848, corrections incessantes, retards d’impression. C’est un amortisseur : avances, échéances, visibilité. Pas une délivrance. Les huissiers n’entrent pas dans le colophon, mais l’ordre des volumes ressemble beaucoup à un calendrier de paiements. Ce n’est pas de la cavalerie, c’est de la méthode. Alias et prête-noms. « Veuve Durand » à la rue des Batailles, « Monsieur de Breugnol » à Passy : l’identité-écran retarde l’identification par les études d’huissiers, filtre au portier, laisse travailler. Doubles issues. Rue des Batailles : succession de seuils. Passy : deux portes opposées. L’espace sert à gagner du temps. Le temps sert à livrer. La livraison sert à payer l’acompte. Multiplication d’adresses. Garder Cassini en même temps que Batailles, puis glisser vers Jardies, puis Passy ; toujours un sas, toujours un repli. C’est une géographie de défense. Faire patienter la dette. Acomptes d’éditeurs, prêts d’amis, avances, étalements ; on produit des feuillets comme on fabrique des échéances. La correspondance, les biographies économiques et les relevés muséaux convergent sur ce « temps convertible ». Dans La Comédie humaine, l’huissier n’est jamais loin du notaire, du banquier, du commissaire-priseur ; il tient la poignée de la porte. Le droit devient littéralisme : billet, protêt, cession, saisie, ces gestes écrits qui déplacent des meubles et des vies. On parle souvent de l’obsession économique de Balzac ; on peut la décrire plus simplement : tout commence quand un papier entre dans une chambre. César Birotteau, les Maisons Nucingen, le cousin Pons : que vaut un salon sans quittance, un honneur sans échéance ? Or la biographie et l’œuvre font système. La double issue de Passy, c’est un chapitre en devenir ; le mot de passe de la rue des Batailles, un dispositif dramatique ; l’incarcération de 1836, un signal bref du réel qui cogne. La fiction réassemble et redistribue. L’huissier, muse négative, règle le débit de la phrase : injonction, délai, mainlevée. On lit parfois Balzac en pure sociologie. C’est utile, mais insuffisant pour saisir un geste d’atelier : le montage financier devient montage narratif. La promesse d’un éditeur, c’est un chapitre promis. La pénalité d’un retard, c’est une relance d’intrigue. La dette, moteur éthique et mécanique : elle force à voir comment les papiers administrent les corps, comment le langage du droit se fait dialogue, comment une main sur une poignée peut valoir plus qu’une proclamation. L’huissier, en somme, impose la forme : on écrit avec l’ennemi dans l’escalier. On reconnaît aussi chez Balzac une esthétique du seuil : l’antichambre, l’escalier de service, la loge, le corridor. Ces lieux qui retardent et orientent, très concrets dans les domiciles réels, se transposent avec exactitude. À Passy, descendre la rue Berton, c’est une ruse. Dans les romans, franchir trois portes avant d’atteindre un cabinet, c’est un suspense pratique. Rien n’est décoratif : la topographie est une procédure. Je me suis demandé si cet article tiendrait debout et pourquoi ? Parce que l’histoire des poursuites fournit plus qu’un contexte : une grammaire. On y trouve des sujets (créanciers), des verbes (signifier, saisir, assigner), des compléments (meubles, loyers, créances), et surtout une temporalité : délais, termes, prorogations. Balzac a vécu cette grammaire à même les murs. Il l’a recyclée en syntaxe romanesque. La Comédie humaine, lue depuis la porte d’entrée, devient un immense répertoire de situations procédurales : qui entre, avec quel papier, dans quelle pièce, sous quel nom. Il ne s’agit pas de réduire l’écrivain à son dossier comptable, mais de prendre acte d’une évidence matérielle : sans la pression des échéances, sans la nécessité de convertir le temps en pages et les pages en acomptes, l’architecture de l’œuvre serait autre. L’huissier, en bord de champ, enregistre le tempo. Dans une version purement héroïque, tout commence par la vocation et finit par les chefs-d’œuvre. Dans la version matérielle, plus exacte et plus utile, tout commence par une imprimerie mal calibrée et finit par une maison à deux sorties. Entre les deux, un homme qui écrit la nuit, signe sous alias, déplace ses meubles, répond à des épreuves, ajuste des volumes, et devance tant bien que mal l’homme en noir. La littérature, ici, ne couvre pas la dette ; elle la transforme. Sources : CCFr / BnF, “Fonds Impressions de Balzac (1825-1828)” : faillite des entreprises d’édition/imprimerie, estimation du passif 1828 ≈ 60 000 fr. BnF, “Balzac en 30 dates” : brevet d’imprimeur (1826), liquidation 1828, rappel d’un cumul de dettes parfois chiffré plus haut (≈ 100 000 fr. en récapitulatif). Essentiels Maison de Balzac (Paris Musées), “Historique de l’édition Furne” : calendrier 1842-1848, clauses, retards, rôle de Balzac dans la fabrication. Maison de Balzac BnF, “Édition Houssiaux / Furne (notice Essentiels)” : 17 vol. illustrés 1842-1848, suivi étroit par Balzac. Maison de Balzac, “Paradoxes du musée littéraire” : alias et adresses (veuve Durand rue des Batailles ; « Monsieur de Breugnol » à Passy). Maison de Balzac Wikipedia FR, “Honoré de Balzac – Les demeures” : rue des Batailles, mot de passe, arrestation du 27 avril 1836 à la rue Cassini ; maison de Passy à deux issues et alias « Breugnol ». (Synthèse récente, à croiser avec sources muséales.) Wikipédia Archive.org, Pro domo : la maison de Balzac : mention de la « veuve Durand » comme sésame à la rue des Batailles. Internet Archive Maison des Jardies (site officiel, dossier de visite PDF + page Histoire) : installation de Balzac en 1837, projet de lotissement, maison du jardinier (Pierre Brouette), contexte Sèvres. History of Information : expérience d’imprimeur (1826), brève et ruineuse. (Ressource secondaire utile pour l’amorçage chronologique.) R. Bouvier, “Balzac, homme d’affaires”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, JSTOR : éclairages économiques (train de vie, dettes fin 1847, rue Fortunée). L'illustration Nota méthode. Les montants varient selon périmètres (dettes professionnelles vs cumul de dettes et frais). Je signale la plage et privilégie les notices BnF et muséales pour les repères datés.|couper{180}

Lectures
Correspondance Mallarmé-Whistler
Livre de correspondance mais monté comme un récit, ce volume reconstruit les dix années où Stéphane Mallarmé et James McNeill Whistler deviennent l’un pour l’autre ce que la fin d’un siècle invente de plus tenace : une amitié d’atelier, de lettres brèves, de rendez-vous manqués, d’affaires juridiques qui consomment des journées entières et de gestes d’art qui comptent plus que le reste, et c’est la force du montage de Carl Paul Barbier : accumuler, classer, annoter, mais sans gommer l’accroc des timbres, les orthographes vacillantes, la vitesse de la carte pneumatique, l’énergie qui passe entre la rue de Rome, la rue du Bac, Valvins, Londres, les gares, les salles d’audience, les librairies qui vendent peu, et l’atelier où tout recommence le soir venu . On commence par la table matérielle : des planches, un frontispice où Whistler mord le cuivre pour fixer Mallarmé, un Avant-propos qui promet l’exactitude et le refus de lisser les curiosités de langue du peintre, un Appendice qui reproduit en français le « Ten O’Clock », puis les Provenances et l’Index : c’est un livre d’archives qui assume sa fabrique, mais qui se lit comme la chronique serrée d’une fraternité esthétique . Le nœud se fait en 1887-1888 : Monet en tiers discret, Café de la Paix, déjeuner à trois, et l’accord tombé net : Mallarmé traduira la conférence de Whistler, ce Ten O’Clock qui affirme l’autonomie du fait pictural, l’art pour l’art, le refus de la morale illustrative et du récit plaqué sur l’image ; à partir de là, les cartes filent, les rendez-vous s’aimantent, Dujardin s’occupe de l’édition, Gillot et Wason pour les questions d’imprimeur et d’épreuves, Vielé-Griffin vient prêter sa compétence bilingue, on travaille jusque tard un samedi pour tenir la date : scène d’atelier à quatre mains, où la prose de Mallarmé cherche l’équivalent de l’attaque whistlérienne, où l’on hésite, où l’auteur retourne sur ses ambiguïtés, demande d’arrêter les presses, d’ajuster telle nuance, puis signe : c’est une page essentielle du livre parce qu’on y voit la traduction comme lieu même de l’amitié — on se lit pour se rectifier, on s’admire pour mieux couper — et parce que la diffusion restera cette affaire paradoxale : silence poli des grands journaux, circulation sûre chez les initiés, Italie, Bruxelles, cercles symbolistes, avec la querelle sourde sur « la clarté » française face à ce dandysme d’outre-Manche . Sitôt dit, autre séquence qui donne sa texture romanesque à l’ensemble : l’affaire Sheridan Ford et The Gentle Art of Making Enemies, Whistler qui se bat pour bloquer une édition pirate, l’avocat Sir George Lewis côté Londres, puis Beurdeley et Ratier côté Paris, Mallarmé qui conseille et relaie, la saisie obtenue en Belgique, on tente d’empêcher l’impression à Paris, les nuits trop pleines d’« allers-retours » : ce que la correspondance retient, ce n’est pas seulement le dossier, c’est la façon de s’en parler, l’humour, la dureté, l’entêtement, et ce qu’une telle bataille révèle : la gestion moderne d’une œuvre, son image publique, la part de publicité que Whistler sait manier, l’ombre courte des maisons d’édition et des revues ; l’amitié, ici, c’est aussi une compétence qu’on partage, une énergie à tenir la ligne esthétique jusque dans les tribunaux . 1892 condense une autre lueur : Vers et Prose sort chez Perrin, Whistler trouve « le petit livre charmant », Mallarmé lui réserve l’exemplaire Japon avec un distique bravache qui mesure la fraternité dans l’aiguille de la lithographie, et la fabrique matérielle de l’ouvrage est documentée jusqu’aux feuilles, aux heures de corrections, aux papiers Chine, Hollande, Japon : un savouré de chiffres qui, chez Barbier, fait raisonner la prose avec le plomb des ateliers ; c’est tout Mallarmé : la page, son air, ses blancs, et la gravure de Whistler venant comme une signature partagée, l’« à mon Mallarmé » au crayon : l’amitié a sa matérialité, sa monnaie d’épreuves, sa circulation d’images, et le livre en garde la cadence exacte . Le milieu des années 1890 bascule vers les complications : santé, deuils, rumeurs, procès interminables — l’affaire Eden qui mènera jusqu’à la Cour d’appel de Paris fin 1897 — et l’on voit comment Mallarmé se met au service tactique du peintre, lettres à Dujardin, visites à l’avocat, messages aux Présidents, cartes qui appellent à « ce tact Mallarmé infaillible », pendant que Whistler est cloué au lit d’un hôtel, rhume, puis grippe, dans l’attente d’une audience reportée : la prose s’échauffe, « je vous écris, cela devient Poésie », et c’est tout le drôle de ce livre : la poésie sort des contraintes, de la police des couloirs, des « conclusions de l’Avocat Général » qu’on lit à l’heure du dîner ; à la fin de novembre, décembre, on s’organise, on cale le rendez-vous rue du Bac, on partage les nouvelles, on tient ferme le cap du procès, et c’est un hiver français à deux : visites au Louvre où Julie Manet se souviendra d’un bouton couleur cassis, salons du mardi, portrait de Geneviève montré, donné, choisi dans une pile d’épreuves — l’atelier circule au milieu de la ville, le livre fait entendre sa rumeur de pas, de fièvre, d’art vu de près . Dans les lettres qui suivent, une page suspendue : Whistler veuf, Mallarmé qui répond avec une simplicité droite, refusant d’isoler l’ami de la présence de celle qui fut « le bonheur », rappelant Valvins, la maison, la dernière feuille qui tombe, et promettant de revenir à Paris pour « les trompettes » du procès : un ton d’extrême pudeur, l’évidence d’un lien qui tient mieux que les dates ; l’éditeur a laissé ce tremblement intact, c’est là que la correspondance devient récit, et c’est pour cela qu’on la lit : pas pour le pittoresque fin-de-siècle, mais pour la tenue d’un langage de fidélité qui n’a pas besoin d’emphase . Le dernier chapitre de leur proximité s’écrit en 1898 : invitations à l’atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs, Renoir au menu des conversations, dîners qui prolongent la lumière, Vanderbilt posé puis achevé, une journée d’août à Valvins, fêtes le lundi, au revoir de saison, et puis chacun retourne à sa ville, ses portraits, ses textes, ses soucis ; on sait la date butée, septembre, la fin de Mallarmé, si proche, que le livre ne dramatise pas, préférant aux grands nœuds tragiques l’enchaînement des gestes courts : « venez, voyez, dînons, demain à midi, pardonnez-moi de ne pas vous rencontrer à mi-chemin » ; la modernité de ce duo est là : l’art se fabrique dans une géographie réduite à quelques rues, à des cartes portées en une heure, à des épreuves qu’on signe et redistribue, et dans cette compacité la pensée du poème et de la peinture s’aiguise ; la correspondance, comme forme, devient l’espace de travail même . Entre ces pôles, Barbier insère des seconds rôles décisifs : Duret, Mirbeau, Huysmans, Moore, Heinemann, Pennell, Whibley, Berthe Morisot, Méry Laurent, et ce réseau explique comment les idées du « Ten O’Clock » se débrouillent en France, par cercles, comment elle rencontrent les réserves : question de clarté, d’humeur nationale, de presse qui traîne, de librairie qui n’insiste pas ; on voit aussi la fabrication d’une image publique, les toasts, un dîner d’hommage où Mallarmé remercie d’une voix familiale, la critique de la vie « mise en musique » qu’un correspondant lit dans ses pages, et ces minuscules transferts : sucre d’orge, prévenances, cartes de visite, dont le livre garde trace, comme s’il fallait faire droit aux choses infimes qui maintiennent les liens quand la grande machine du monde devient fatigante . Reste l’appareil : Barbier l’écrit net dans son Avant-propos — il ne corrige pas Whistler, garde jusqu’aux « curiosités orthographiques », et s’il semble parfois donner au peintre « le beau rôle », c’est que les lettres l’imposent, et parce qu’aussi, côté français, la bibliographie sur Mallarmé abonde quand l’Américain a besoin d’un surcroît de contextes ; le pari est d’ailleurs réussi : on sort du livre avec un Whistler plus proche, drôle, félin, obstiné, et un Mallarmé plus concret, tacticien et disponible, logicien des moindres détails matériels du livre et de l’image, sans renoncer à sa souveraine économie de parole . Résumer : une histoire d’alliance entre deux souverainetés — la phrase et la touche — dont la scène première est une traduction, dont la scène seconde est un livre de poèmes accompagné d’une gravure, dont la scène troisième est un tribunal, et entre les scènes des couloirs, des salons, des musées, des petites villes où on rentre fermer la maison, l’air d’automne qui passe, le bouton « cassis » sur l’épaule d’une jeune fille qui copie au Louvre, les « trompettes » d’un procès qui n’achève rien, la page qui prend, au jour le jour, le relais de la conversation : la correspondance dit cela, exactement : comment l’art, pour tenir, a besoin de cette trame têtue d’attention, de disponibilité, de logistique et d’élégance, et comment, dans l’Europe 1888-1898, deux noms la tissent au présent, Mallarmé et Whistler, jusqu’à la dernière poignée de main, jusqu’au dernier « à demain », et ce « pardon de ne pas vous rencontrer à mi-chemin » qui sonne comme la formule même de l’amitié, quand l’art vous occupe à plein et que le monde, lui, ne cède pas .|couper{180}

Lectures
La page comme aventure — lire Damase pour réapprendre à voir
La page comme aventure — lire Damase pour réapprendre à voir On ouvre ce livre et la table devient atelier. Pas un traité de plus sur la poésie, pas un musée de curiosités d’avant-garde. Damase prend un objet que l’on croit acquis, la page, et il la rend de nouveau incertaine. Il remonte à Mallarmé, au Coup de dés de 1897, non pour sacraliser un moment, mais pour décrire un basculement dont nous vivons encore les ondes. La page cesse d’être couloir rectiligne. Elle devient scène, plan, partition. Les blancs prennent la place de la ponctuation. Les corps typographiques hiérarchisent la voix. La lecture s’effectue par bonds, par blocs, par diagonales. Et tout à coup notre manière d’écrire à l’ordinateur, nos fichiers exportés en PDF, nos billets de blog et affiches, sont rattrapés par ce geste ancien qui les regarde déjà. Ce qui frappe d’abord, c’est l’allure d’inventaire très concret que propose Damase. Il n’érige pas Mallarmé en monolithe. Il montre un point de départ, un dispositif pensé comme tel — la page comme unité — et suit ses reprises, ses bifurcations. Segalen, Apollinaire, Claudel. Puis le grand dépliant de Cendrars avec Delaunay, où texte et couleur se répondent sur une longue bande qu’on déploie. Les futuristes qui s’attaquent à l’« harmonie » de la page et la renversent au profit de vitesses et d’angles. Dada et ses simultanéités, plusieurs voix à la fois, plusieurs lignes qui cohabitent. La publicité et l’affiche qui se saisissent des lettres comme formes, choc de tailles et de poids, lisibilité comme stratégie. Puis De Stijl, le Bauhaus, Tschichold : retour de la règle, des grilles, de la clarté fonctionnelle, non contre la modernité, mais pour lui donner des moyens stables. L’avant-garde n’abolit pas la lisibilité, elle la redistribue. Le livre avance par paliers. On quitte vite l’idée confortable d’une littérature qui resterait dans ses colonnes tandis que l’art occuperait la couleur et la forme. Klee, Braque, Picasso font entrer la lettre dans la peinture. Les typographes traitent la page comme architecture. Les poètes testent des mises en page non linéaires qui demandent un autre corps du lecteur. La main qui tient, qui plie, qui tourne. Les yeux qui comparent, pèsent, reviennent. Et quand Damase revient en arrière vers les manuscrits médiévaux ou la calligraphie, ce n’est pas pour noyer l’histoire dans l’érudition. C’est pour montrer que l’articulation signe/image/page n’a jamais cessé d’être une question d’outil et de regard, pas d’ornement. La révolution de Mallarmé n’arrive pas ex nihilo. Elle cristallise des tensions longues, puis elle les rend productives. On lit Damase et on pense à nos propres pages. Le placeur que nous sommes tous devenus, avec nos logiciels, nos modèles par défaut, nos marges normalisées. On s’aperçoit que beaucoup de nos choix ne sont pas neutres. Taille de caractère, interlignage, gras, italiques, espace avant un titre, quantité de blanc avant un paragraphe clé. Ce sont des décisions d’écriture. Les blancs peuvent devenir opératoires, non décoratifs. Les différences de corps, des accents narratifs. Le livre le dit sans prescription doctrinale. Il préfère l’exemple, la généalogie, la main qui montre : regarde ici, là ça bascule, là ça s’est tenté, là ça a tenu. Ce déplacement a une conséquence plus forte qu’il n’y paraît. La page cesse d’être simple véhicule du texte. Elle devient une part du sens. Ce que Mallarmé indiquait par la distribution des blancs, d’autres l’ont poussé vers la simultanéité, la couleur, l’assemblage avec l’image, la cartographie de lecture. Le roman, rappelle Damase, resta longtemps conservateur, attaché au pavé gris XIXe, au confort de l’œil. La publicité, elle, a su plus vite investir la page comme plan de forces. Résultat paradoxal : pour comprendre nos journaux, nos écrans, notre flux d’images et de textes, il faut passer par cette archéologie de la page littéraire. Il y a une éthique de l’ordonnance qui n’est pas moins importante que le style. La page impose une responsabilité. Ce n’est pas un manuel, pourtant on sort de cette lecture avec des gestes en poche. Par exemple : élargir les marges pour faire respirer une séquence dense, puis resserrer pour imposer un tunnel de lecture. Jouer le dialogue de deux corps, l’un pour l’ossature, l’autre pour l’attaque. Confier à la ponctuation une part du rythme, mais accepter qu’une ligne blanche serve de césure plus nette qu’un point. Doser l’italique comme voix intérieure plutôt que simple emphase. Faire de la page une unité, non un réservoir illimité de lignes. Et quand on revient à Un coup de dés, on comprend que le hasard n’est pas dehors comme désordre. Il est dans la tension entre règle typographique et liberté d’ordonnance. S’il y a hasard, il se voit parce que la règle est exposée. Lire Damase, c’est aussi rencontrer une histoire des échecs. Le lettrisme, avec sa promesse de tout refonder depuis la lettre, fascinant sur le papier, souvent stérile dans ses effets. Des manifestes où la page est annoncée comme champ total, mais sans faire système. Cette honnêteté fait du bien. Tout ne se vaut pas. Tout ne marche pas. Ce qui fonctionne tient par un équilibre fin entre expérimentation et lisibilité, entre intensité visuelle et chemin du lecteur. Tschichold, Moholy-Nagy, Lissitzky ne sont pas là comme icônes froides. Ils servent à mesurer ce que le texte gagne quand quelqu’un prend au sérieux la relation des éléments sur la page. Même les exemples venus de la pub ne sont pas là pour faire peur. Ils éclairent ce que la littérature a parfois renoncé à exploiter. Quel intérêt aujourd’hui, où nous lisons surtout sur écran, où les formats se recomposent selon la taille de nos téléphones, où la page au sens physique vacille. Justement. La page numérique n’a pas aboli la page. Elle en a déployé la variabilité. Les principes évoqués par Damase valent au moment où l’on conçoit une maquette responsive, où l’on décide de la hauteur des interlignes, des espaces avant et après, du contraste entre un bloc de citation et le fil narratif. Ils valent pour un EPUB comme pour un PDF. Et ils permettent d’interroger des habitudes prises par confort. Pourquoi tant de gris uniforme. Pourquoi cette fatigue à la lecture longue. Parce que la page, réduite à un tuyau, ne joue plus son rôle d’espace. Le ton du livre reste sobre. Pas de grand geste de revendication. Un fil clair, des exemples choisis, des convergences mises en lumière. On peut y entrer par la poésie, par l’histoire de l’art, par le graphisme. On peut aussi y entrer d’un point de vue très pragmatique : que puis-je modifier dès ce soir dans ma manière d’écrire et de mettre en page pour rendre visible ce qui compte. Le livre propose sans injonction. Il ne s’achève pas sur un modèle à imiter, mais sur un appel : refaire de la page un lieu d’invention, et pas seulement de transport. Si l’on cherche des raisons de lire, en voici trois. D’abord, on lit mieux Mallarmé et tout ce qui s’est joué autour. On comprend que la modernité formelle n’est pas caprice, mais méthode. Ensuite, on gagne une lucidité neuve sur nos outils : l’éditeur de texte n’est pas un accident, il est une grammaire en action. Enfin, on reçoit l’autorisation d’essayer. Essayer quoi. Deux corps qui dialoguent. Une hiérarchie de titres qui parle au lieu d’orner. Une ponctuation qui s’allège parce que les blancs prennent le relais. Des blocs qui se répondent à la page plutôt que de défiler sans horizon. On referme Damase avec l’envie de rouvrir des livres. De reprendre Un coup de dés, non pour l’exercer en légende, mais pour y voir la logique d’espace qui le soutient. De déplier la Prose du Transsibérien et sentir comment la couleur porte le texte. De regarder une affiche de Lissitzky et d’y lire une leçon d’économie et de force. Et surtout, on revient à nos pages à nous. On redresse une marge. On déplace un titre. On ose un blanc plus large avant une phrase dont on attend l’effet. On prend conscience que la page, loin d’être un fond neutre, est l’un des lieux où s’écrit la pensée. À partir de là, le livre de Damase n’est plus un ouvrage d’histoire. Il devient un outil. Un rappel que lire et écrire se décident aussi là où l’encre ne dit rien : dans l’air qui tient entre les lignes.|couper{180}
