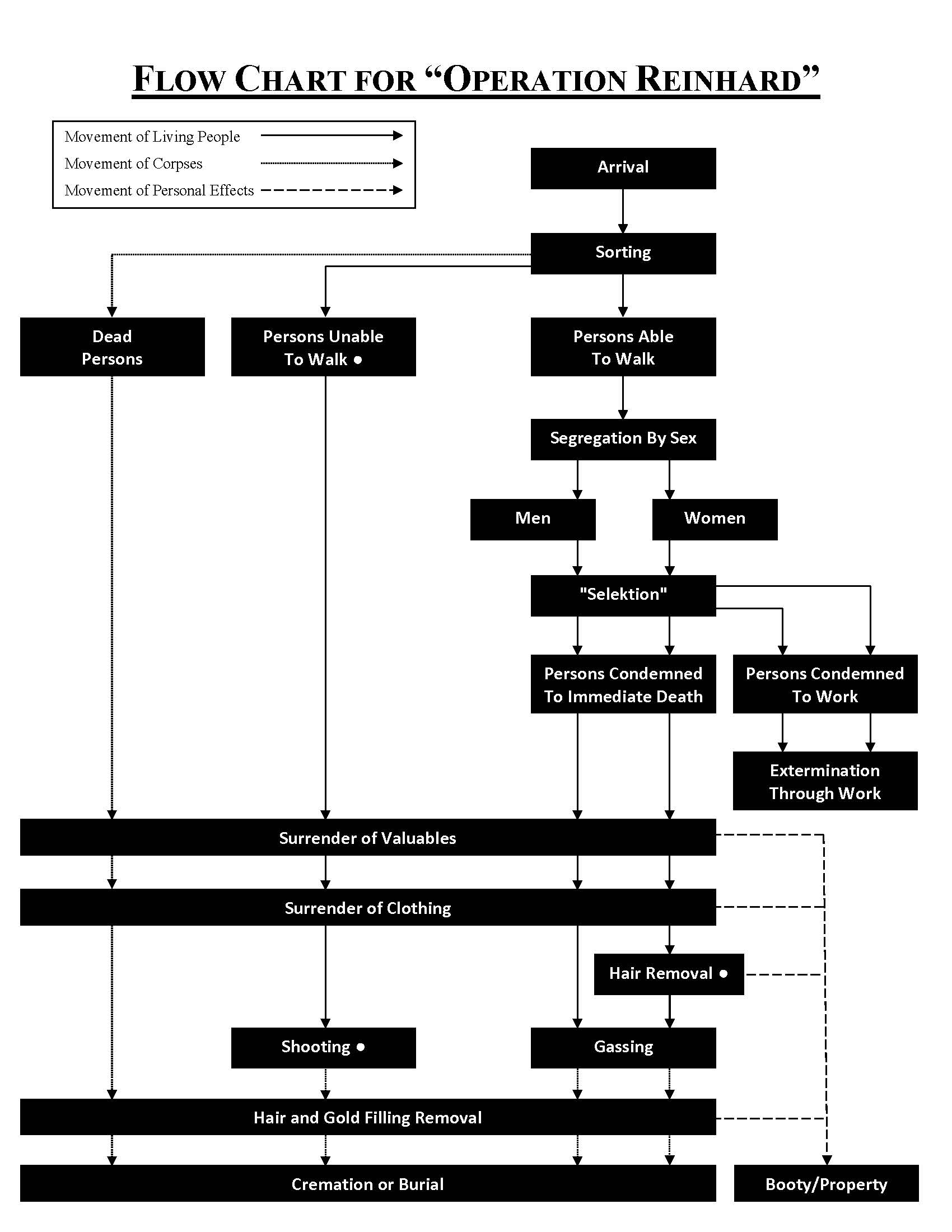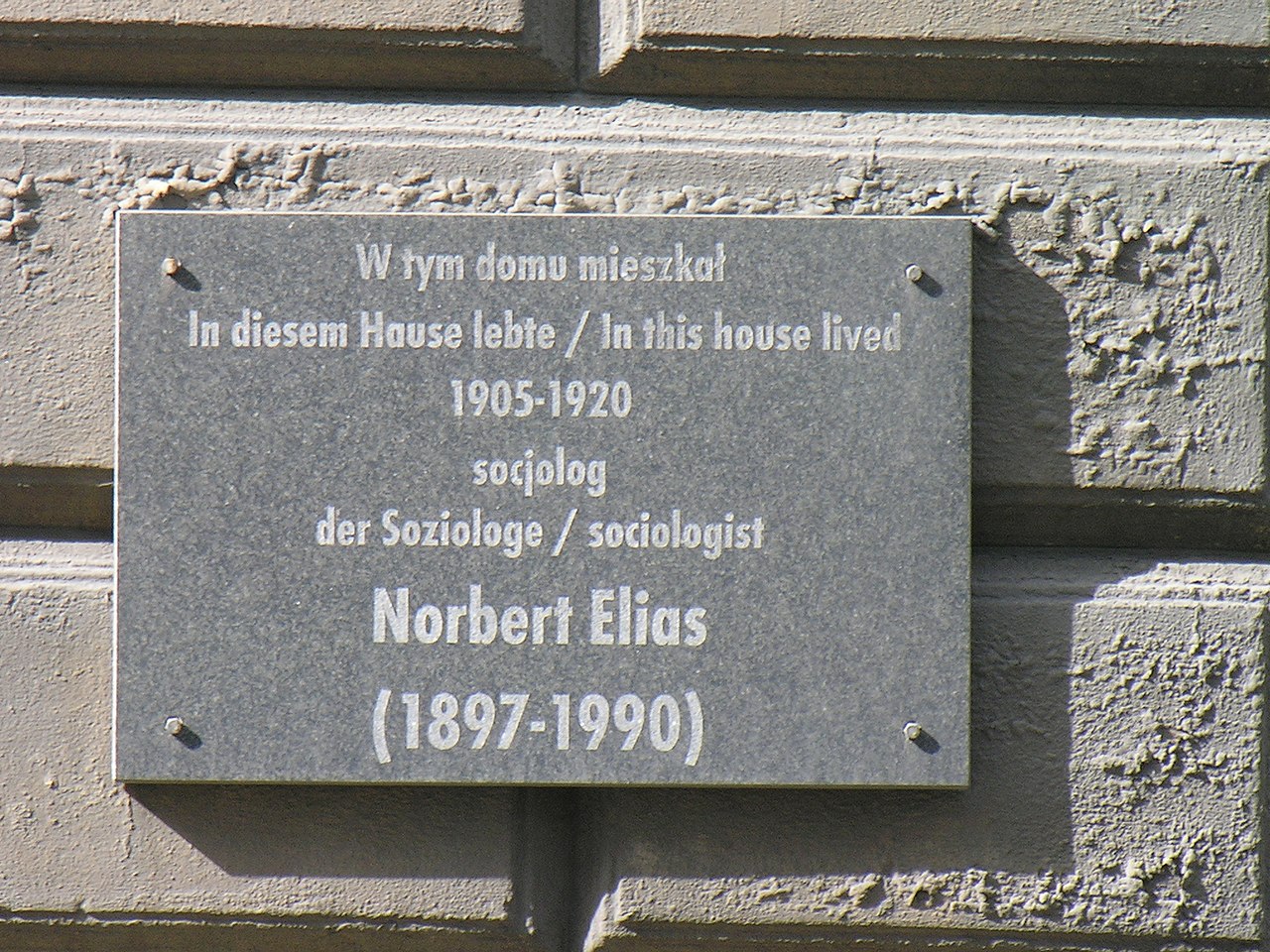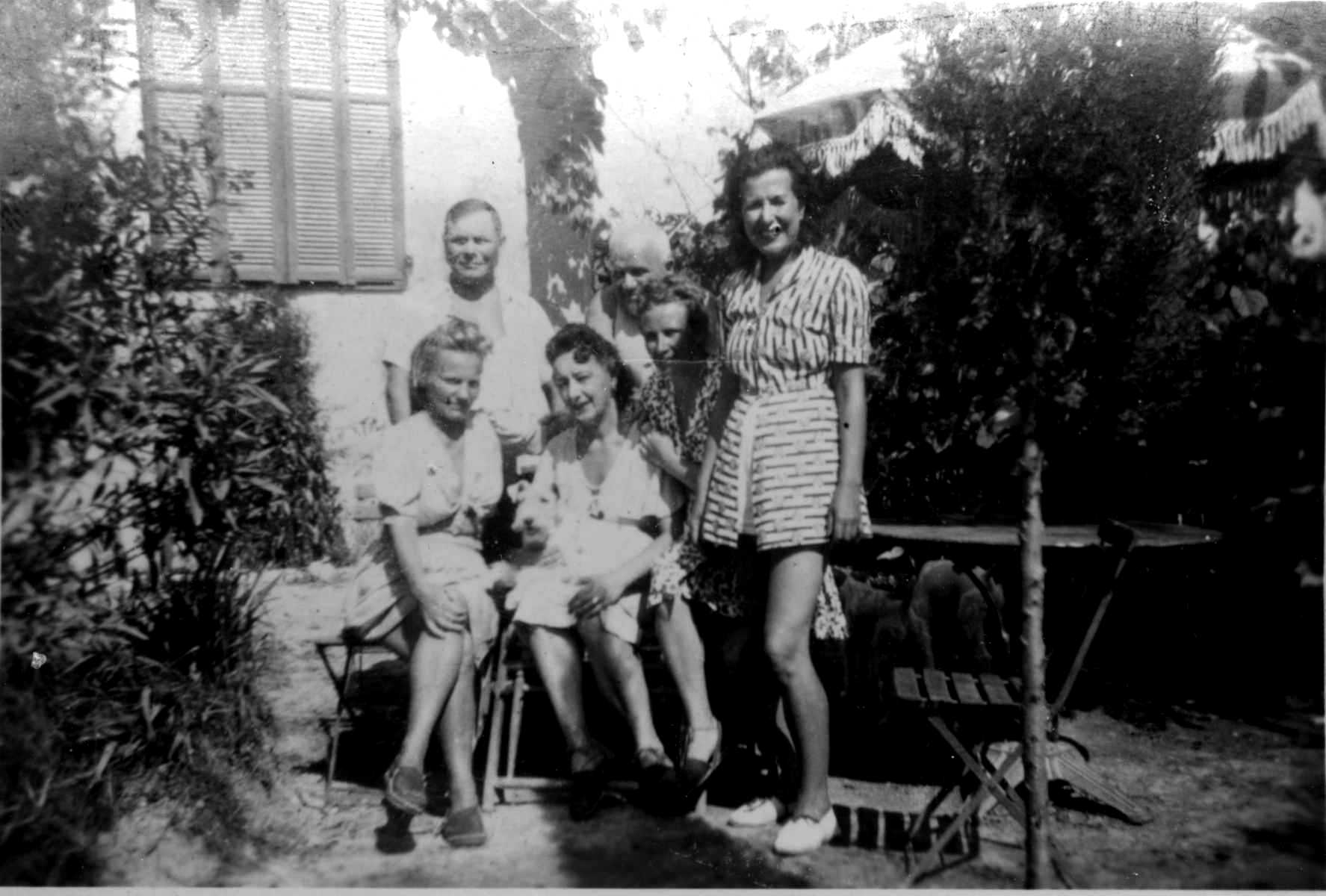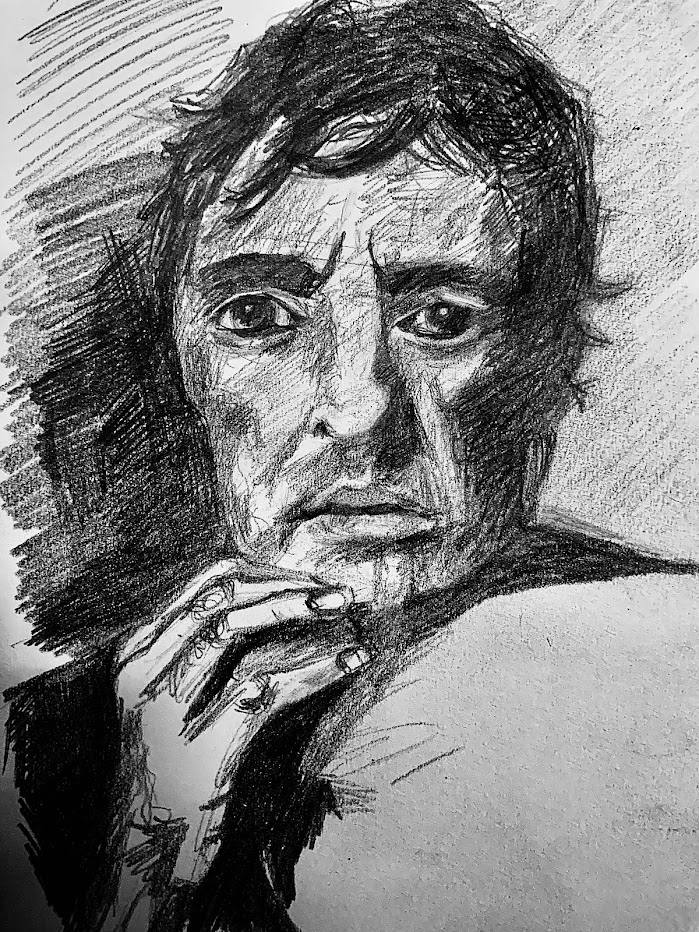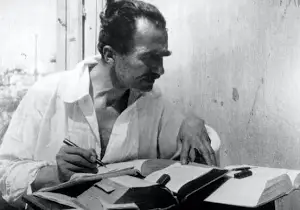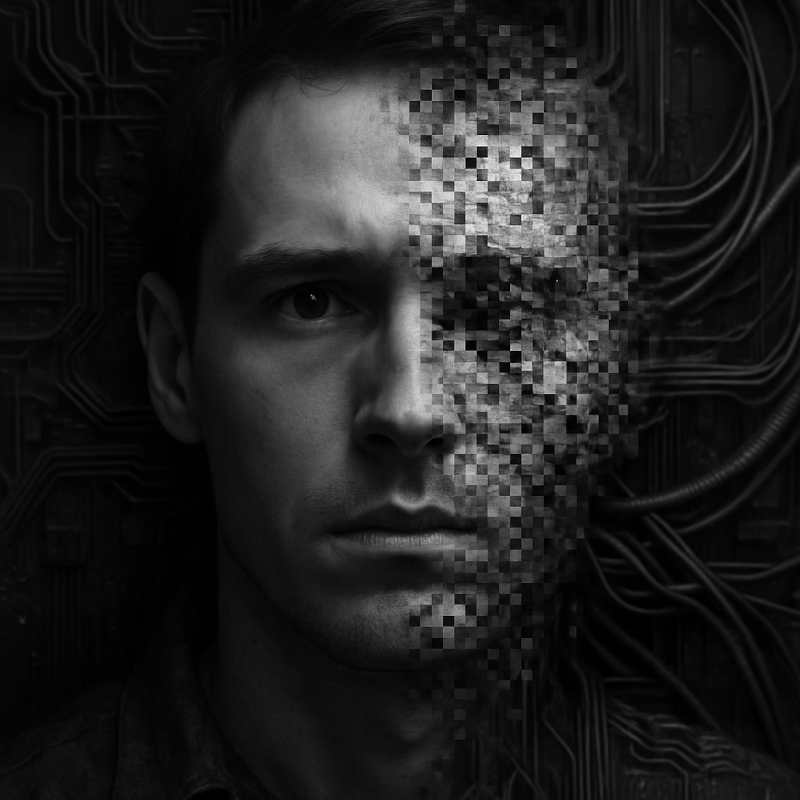I. Les peuples fabuleux de l’Antiquité gréco-romaine
Aux yeux des Grecs puis des Romains, le monde connu — l’oikouménè — avait des frontières nettes. Au centre, la Méditerranée, terre des hommes civilisés. Aux marges, l’océan, les déserts, les montagnes. C’est là que l’imagination plaçait des peuples étranges, figures de l’altérité radicale. Ce n’était pas seulement un ornement littéraire : ces peuples fabuleux avaient une fonction cognitive et symbolique. Ils permettaient de tracer une limite entre l’humain et l’inhumain, entre le civilisé et le sauvage.
Les Cynocéphales figurent parmi les plus célèbres. Ctésias, dans son Indica rédigé au Ve siècle avant notre ère, raconte que dans les montagnes de l’Inde vivent des hommes à tête de chien, vêtus de peaux, chassant avec des bâtons et des arcs. Ils ne parlent pas, mais aboient. Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle (VII, 23), transmet cette description : « On rapporte que dans certaines montagnes de l’Inde habitent des hommes à tête de chien, vêtus de peaux de bêtes sauvages. Ils aboient au lieu de parler, se nourrissent de chair crue et possèdent des griffes semblables à celles des bêtes féroces. » Cette altérité zoologique suggère un seuil : des êtres humains dans leur organisation sociale, mais animaux dans leur visage et leur langage.
Les Sciapodes (σκιαπόδες), littéralement « ceux qui font de l’ombre avec leurs pieds », sont un autre exemple frappant. Dotés d’un seul pied gigantesque, ils courent avec une rapidité extrême et, aux heures les plus chaudes, s’allongent sur le dos et se protègent du soleil en dressant leur pied comme un parasol. Isidore de Séville, au VIIe siècle, reprend fidèlement Pline : « Les Sciapodes sont appelés ainsi parce qu’ils possèdent un seul pied de taille immense. Dans la chaleur du soleil, ils s’étendent sur le dos et se protègent à l’ombre de leur pied » (Étymologies, XI, 3). L’image est absurde, mais elle traduit une vérité : pour des auteurs méditerranéens, les peuples lointains devaient être adaptés à des climats extrêmes. La difformité devient une adaptation.
Les Pygmées appartiennent à une tradition encore plus ancienne. Homère les mentionne dans l’Iliade (III, 3–6) : « Comme les grues, fuyant l’hiver et l’orage incessant, s’envolent vers l’océan en poussant des cris aigus, portant la mort et le combat aux Pygmées, et lançant au-dessus de leurs têtes le tumulte de la guerre. » Ces hommes d’une coudée de haut, éternels adversaires des grues, sont repris par Ctésias et situés en Inde méridionale. Là encore, la disproportion est source de comique, mais aussi d’admiration : la petitesse devient héroïsme dans une lutte incessante contre la nature.
D’autres récits frappent par leur étrangeté radicale. Les Astomoi, « sans-bouche », survivent en se nourrissant seulement d’odeurs. Pline (VII, 25) rapporte : « Il existe un peuple sans bouche, qui vit en respirant seulement les parfums et les odeurs des choses. Ils ne connaissent pas la faim et meurent si l’air qui les entoure devient impur. » Ici, le fabuleux naît peut-être d’un malentendu : les ascètes indiens, réputés vivre d’air et de méditation, sont transformés en peuple entier d’êtres sans bouche.
Les confins africains n’étaient pas en reste. L’Éthiopie abritait, selon Pline (V, 46), les Blemmyes : « Vers l’Éthiopie, on rapporte qu’existent les Blemmyes : ils n’ont pas de tête, et leur bouche comme leurs yeux se trouvent sur la poitrine. » L’idée d’un corps sans visage, à la fois humain et monstrueux, frappe encore l’imagination. Hérodote, lui, parle des Troglodytes, rapides à la course, se nourrissant de serpents et poussant des cris semblables à ceux des chauves-souris (IV, 183). L’altérité ici n’est pas seulement corporelle : c’est un langage inintelligible, une alimentation répugnante.
On pourrait allonger la liste : les Panotii, aux oreilles si grandes qu’elles leur servent de manteau ; les Antipodes, aux pieds tournés vers l’arrière ; les Arimaspes, peuple à un seul œil, toujours en guerre contre les griffons pour l’or (Hérodote, IV, 13) ; les Androphages, cannibales scythes, « hommes sauvages qui se nourrissent de chair humaine » (IV, 106) ; les Hippopodes, hommes aux pieds de cheval ; les Satyres, êtres velus capturés dans les montagnes de l’Inde, selon Pline (VII, 2).
À travers ces récits, on comprend la logique antique : le monde connu est ordonné, mais ses marges sont foisonnantes, inquiétantes, prodigieuses. Ce n’est pas une naïveté. Pour les Anciens, ces peuples faisaient partie du savoir légitime, non pas parce qu’ils étaient prouvés, mais parce qu’ils suscitaient l’admiratio. L’étonnement, disait Aristote, est l’origine de la philosophie. La compilation de Pline, qui mêle zoologie précise et peuples fabuleux, ne trahit pas une confusion : elle illustre l’idée qu’un savoir digne de ce nom doit inclure aussi ce qui étonne et déroute.
Ces peuples fabuleux ne sont donc pas de simples curiosités. Ils dessinent les frontières de l’humain, ils reflètent l’angoisse et le désir d’altérité, ils rappellent que la connaissance naît moins de la certitude que de l’étonnement. Si nous les lisons aujourd’hui comme des fables, c’est que nous avons changé de critères. Mais pour les Grecs et les Romains, ils appartenaient pleinement à la cartographie du monde : une cartographie où le centre civilisé se définissait par contraste avec une périphérie monstrueuse.
II. Les traditions indiennes et chinoises : un fabuleux intégré au cosmologique
Si l’Antiquité gréco-romaine plaçait ses peuples fabuleux aux confins de l’oikouménè, l’Inde et la Chine ont développé leurs propres traditions du merveilleux humain, mais dans une logique différente. Là où Pline et Hérodote pensaient encore en termes d’ethnographie déformée — des hommes réels mais monstrueux — les textes sanskrits et chinois inscrivent ces peuples fabuleux dans une cosmologie, où l’humain n’est qu’un niveau parmi d’autres. Le fabuleux n’est pas relégué au mensonge ou à l’exagération : il fait partie intégrante de l’ordre du monde.
En Inde, les grands textes épiques et religieux regorgent d’êtres hybrides ou monstrueux qui forment de véritables peuples. Le Rāmāyaṇa décrit ainsi les Rākṣasa, démons anthropophages qui vivent dans les forêts ou sur l’île de Lanka. Leur roi Rāvaṇa, doté de dix têtes et de vingt bras, n’est pas un individu isolé mais le représentant d’une race entière. Ces peuples incarnent une altérité morale autant que physique : ils ne sont pas seulement étranges, ils sont hostiles, ennemis de l’ordre védique. À l’opposé, les Yakṣa, esprits gardiens des trésors et des montagnes, forment un peuple ambigu, parfois bienveillant, parfois menaçant. Ils ne sont pas des curiosités ethnographiques mais des acteurs cosmiques, situés dans une hiérarchie du visible et de l’invisible.
On rencontre aussi les Nāga, peuples serpents vivant dans les fleuves, les lacs et les mondes souterrains. Leurs royaumes sont décrits comme fastueux, ornés de joyaux. Tantôt dangereux, tantôt protecteurs, les Nāga apparaissent dans les récits bouddhiques comme dans l’hindouisme. Lorsque le Bouddha médite, c’est un Nāga qui l’abrite de son capuchon. La monstruosité ici est moins un défaut qu’une puissance ambiguë, que l’homme doit apprendre à intégrer.
Les textes puraniques et la cosmologie indienne situent également des peuples merveilleux aux confins géographiques. L’Uttarakuru, au nord de l’Himalaya, est une terre idéale habitée par des hommes parfaits, exempts de maladie et de souffrance. On y retrouve le motif d’un peuple fabuleux positif, miroir des Hyperboréens des Grecs. De même, les Kinnara et les Kimpuruṣa, mi-hommes mi-animaux, vivent dans les régions reculées : ce sont des musiciens célestes, êtres hybrides qui brouillent la frontière entre humanité et divinité.
En Chine, le Shanhai jing (Classique des montagnes et des mers), compilé entre le IVᵉ siècle avant notre ère et le IIᵉ siècle de notre ère, rassemble des centaines de descriptions de peuples étranges et de créatures fabuleuses. On y lit que dans les montagnes orientales vivent des hommes à trois têtes et six bras ; que plus loin se trouvent des hommes emplumés, capables de voler ; que d’autres n’ont pas d’intestins et se nourrissent de vent. Certains sont monstrueux, d’autres harmonieux. Mais tous ont leur place dans une cartographie cosmologique où l’Empire du milieu (Zhongguo) se définit par contraste avec des confins peuplés d’altérités.
Le Shanhai jing ne sépare pas les peuples fabuleux des animaux mythiques (phoenix, dragons) ou des divinités locales : il s’agit d’un même tissu de récits. Les « hommes creux », les « hommes à plumes », les peuples aux têtes animales ne sont pas classés comme des erreurs de la nature, mais comme des manifestations de la diversité cosmique. La monstruosité, ici, est une variation de l’ordre du monde.
On retrouve aussi dans les traditions chinoises le même schéma centre / périphérie que chez les Grecs et les Indiens. Au centre, le pays civilisé ; autour, les confins peuplés de peuples étranges. Mais à la différence de l’ethnographie gréco-romaine, les Chinois n’éprouvent pas le besoin de « prouver » ou de « localiser » ces peuples. Le Shanhai jing les décrit avec la même précision que les montagnes, les fleuves ou les animaux. L’altérité fabuleuse n’est pas douteuse, elle est constitutive.
Ce qui frappe, c’est que ni en Inde ni en Chine ces peuples fabuleux ne sont perçus comme de simples anomalies. Ils expriment une pensée du multiple : le monde est fait d’humains, de dieux, d’animaux, de démons et de peuples hybrides, tous en interaction. L’Occident, héritier de Pline et d’Hérodote, a tendu à voir dans les peuples fabuleux des curiosités ethnographiques, des variantes monstrueuses de l’humain. L’Inde et la Chine, elles, les intègrent dans une logique cosmologique et symbolique, où chaque altérité trouve sa place.
Cette différence est décisive. Elle montre que les peuples fabuleux ne disent pas seulement quelque chose sur les confins géographiques : ils révèlent la manière dont une culture pense le rapport entre l’homme et l’ordre du monde. L’Inde voit dans les peuples monstrueux les adversaires ou les alliés de l’ordre divin. La Chine les inscrit dans un système où tout ce qui existe a sa légitimité. La Grèce et Rome, enfin, les relèguent aux marges de l’oikouménè pour mieux définir leur propre centre
III. Les traditions amérindiennes : monstres, géants et peuples de l’ombre
Les Amériques possèdent elles aussi une tradition foisonnante de peuples fabuleux, mais leur statut est encore différent. Là où les Grecs pensaient tracer une ethnographie déformée, et où l’Inde et la Chine intégraient ces êtres à une cosmologie, les peuples amérindiens inscrivaient le fabuleux dans un rapport direct au territoire, à la mémoire et aux cycles de la nature. Les peuples monstrueux n’étaient pas relégués à de lointains confins abstraits : ils vivaient dans les forêts, les montagnes, les souterrains, aux marges toujours proches de l’espace humain. Ils servaient à dire la peur du froid, de la famine, de la mort, mais aussi la promesse d’un ailleurs idéal.
Chez les peuples algonquiens du Nord-Est, notamment chez les Ojibwés et les Cris, on trouve le mythe du Wendigo. Ce géant cannibale, né de l’hiver et de la faim, hante les forêts glacées. Parfois il est un esprit solitaire, parfois un peuple entier de géants anthropophages. Il incarne la transgression ultime : se nourrir de ses semblables pour survivre. Sa dimension fabuleuse n’efface pas son fond de vérité : il rappelle les famines hivernales réelles, où la survie pouvait mener à l’indicible. Le Wendigo est un peuple fabuleux qui fonctionne comme avertissement moral et comme mémoire des catastrophes.
Les traditions inuites peuplent elles aussi leurs confins d’êtres monstrueux. Le Qalupalik, par exemple, est un être amphibie qui vit sous la glace et qui enlève les enfants trop curieux des rivages. D’autres récits parlent des Ingnirragit, géants à la force colossale qui affrontent les chasseurs. Ces figures ne sont pas des fantaisies gratuites : elles rappellent les dangers réels de l’environnement arctique, où la mer, la glace et les bêtes géantes (morses, baleines) se transforment en peuples monstrueux dans l’imaginaire.
Plus au sud, dans le monde mésoaméricain, le Popol Vuh, grand texte mythique des Mayas-Quichés, décrit les Seigneurs de Xibalba, peuple souterrain qui gouverne les maladies et les épreuves mortelles. Les héros jumeaux Hunahpu et Xbalanque doivent affronter cette communauté démoniaque dans une série d’épreuves, avant de triompher. Xibalba n’est pas seulement un enfer : c’est une société parallèle, avec ses règles, ses juges, ses ruses. Elle représente une altérité radicale, mais organisée comme un peuple. Là encore, le fabuleux structure la cosmologie : les hommes, les dieux et les peuples de l’ombre coexistent dans un même univers.
Chez les peuples andins, comme les Quechuas ou les Aymaras, on trouve des récits de géants d’avant les hommes actuels. Les Incas disaient que des êtres gigantesques peuplaient autrefois la terre, mais qu’ils furent anéantis par les dieux parce qu’ils avaient démesurément abusé de leurs forces. Ces géants sont parfois identifiés à des ennemis primordiaux, parfois à des figures fondatrices. Leur mémoire hante les ruines et les montagnes, témoins d’un âge où l’humanité n’était pas encore fixée.
Chez les peuples tupi-guarani du Brésil, on trouve une vision différente : celle de la Terre sans Mal (Yvy marane’ÿ). Ici, le peuple fabuleux n’est pas monstrueux mais idéal. C’est une communauté parfaite, où il n’y a ni maladie ni mort, située toujours ailleurs, à l’est ou au-delà de l’océan. Cette croyance a inspiré de véritables migrations, des groupes entiers quittant leur territoire pour chercher ce peuple et cette terre. On retrouve le motif universel d’un peuple idéal placé à la périphérie, équivalent des Hyperboréens grecs ou des Uttarakuru indiens.
Ces traditions amérindiennes montrent plusieurs constantes. D’abord, la monstruosité n’est jamais gratuite : elle est l’expression de réalités concrètes. Le Wendigo est la famine incarnée ; le Qalupalik, la peur des glaces ; Xibalba, la présence des maladies et de la mort. Les peuples fabuleux sont donc des manières de donner un visage aux forces hostiles de la nature. Ensuite, ils servent de repères moraux : le cannibalisme, l’excès, la démesure sont figurés par des peuples monstrueux qui deviennent contre-exemples. Enfin, certains récits ouvrent vers l’utopie : l’humanité imagine aux confins un peuple parfait, libre des contraintes, modèle d’un autre possible.
Contrairement à l’Europe, qui a peu à peu relégué les peuples fabuleux dans la fiction, les sociétés amérindiennes les maintenaient vivants dans les rituels, les récits oraux, les initiations. Ils faisaient partie d’une cosmologie dynamique, où humains, dieux, esprits et peuples monstrueux coexistaient dans un même tissu de relations. Là encore, on retrouve l’obsession universelle du centre et de la périphérie : au milieu, les hommes ordinaires ; autour, dans les marges glacées, souterraines ou maritimes, les peuples fabuleux qui rappellent à la fois le danger et l’espérance.
Ainsi, l’Amérique précolombienne apporte une nuance décisive à notre enquête : les peuples fabuleux n’y sont pas relégués au passé ou aux confins abstraits, mais insérés dans un rapport direct au territoire et au cycle vital. Ils ne sont pas seulement le miroir de l’altérité : ils sont les gardiens d’une mémoire et d’un équilibre.
Très bien. Voici la partie IV rédigée (centre et périphérie), environ 600–700 mots, qui fait la synthèse comparative.
IV. Centre et périphérie : un schéma universel
À parcourir les traditions grecques, indiennes, chinoises et amérindiennes, un motif revient avec une insistance telle qu’il semble universel : celui d’un centre habité, ordonné, civilisé, entouré d’une périphérie peuplée de peuples fabuleux. Qu’ils soient monstrueux ou idéaux, hostiles ou bienveillants, ces peuples marquent une frontière : ils indiquent ce qui est humain et ce qui ne l’est pas, ce qui appartient au monde du milieu et ce qui relève des marges.
Chez les Grecs et les Romains, ce centre est l’oikouménè, littéralement la terre habitée. Les confins, ce sont l’Inde, la Scythie, l’Éthiopie, les îles océaniques. Hérodote, Pline, Isidore de Séville, tous placent les Cynocéphales, les Sciapodes, les Pygmées et les Blemmyes aux limites de la carte. La logique est claire : l’homme civilisé, rationnel, parlant grec ou latin, vit au milieu ; aux marges, là où la raison vacille, apparaissent les altérités monstrueuses. L’océan qui entoure le monde n’est pas seulement une barrière géographique : il est la clôture symbolique d’une humanité qui se protège en projetant le chaos au loin.
En Inde, la cosmologie des Purāṇa et des épopées structure l’espace de la même manière. Au centre, Bhārata-varṣa, c’est-à-dire l’Inde, terre des hommes. Autour, des continents successifs, séparés par des mers, peuplés de peuples extraordinaires : les Uttarakuru, parfaits et heureux, les Rākṣasa, hostiles et cannibales, les Kinnara, mi-hommes mi-animaux. Ici, la périphérie n’est pas seulement monstrueuse, elle peut être aussi utopique : aux marges, il y a autant l’excès que la perfection. Mais toujours le même principe : l’homme se pense au centre, et définit ses frontières par des altérités radicales.
En Chine, l’Empire du Milieu (Zhongguo) porte ce principe dans son nom même. Les Chinois ne se pensent pas comme un peuple parmi d’autres, mais comme le centre du monde, entouré de confins montagneux, maritimes et désertiques. Le Shanhai jing décrit ces confins peuplés de peuples étranges : hommes à trois têtes, hommes emplumés, peuples sans intestins, hommes aux têtes animales. La logique est identique : au centre, l’ordre ; aux marges, l’étrange et le fabuleux. Mais ici encore, l’altérité n’est pas toujours négative : elle fait partie d’un ordre cosmologique plus vaste, où l’homme, l’animal, le divin et le monstrueux coexistent.
Les Amériques, enfin, témoignent de la même structuration. Chez les Algonquiens et les Cris, le Wendigo hante les forêts glacées, c’est-à-dire les confins du territoire habité. Chez les Mayas, les Seigneurs de Xibalba règnent dans le monde souterrain, aux marges invisibles mais toujours menaçantes. Les Incas parlent de géants disparus qui précèdent l’homme actuel, relégués dans un passé périphérique. Les Tupi-Guarani placent la Terre sans Mal à l’est, au-delà de l’océan, dans une périphérie inaccessible. Là encore, le schéma se répète : un centre humain, et des confins peuplés d’altérités, soit monstrueuses, soit idéales.
Pourquoi ce schéma revient-il partout ? On peut avancer plusieurs raisons. D’abord, psychologique : l’homme a besoin de se penser comme centre pour donner cohérence à son identité. Projeter l’étrangeté au loin, c’est affirmer la normalité du proche. Ensuite, cosmologique : toute société a besoin de hiérarchiser l’espace, de distinguer un milieu ordonné des marges chaotiques. Enfin, politique : définir des périphéries monstrueuses, c’est justifier sa propre centralité, se poser comme la norme de l’humain. Le peuple fabuleux, qu’il soit géant, cannibale ou utopique, est toujours un instrument de définition identitaire.
Ce centre/périphérie n’est pas seulement spatial. Il est aussi temporel. Les Grecs plaçaient certains peuples fabuleux dans un âge révolu, antérieur aux hommes actuels. Les Incas faisaient de leurs géants des habitants d’un monde d’avant. Le fabuleux occupe donc aussi la périphérie du temps : avant nous, ailleurs que nous, mais jamais ici et maintenant.
Enfin, il faut souligner la fonction narrative. Le fabuleux vit mieux aux confins, parce que l’ailleurs est son territoire naturel. Le proche doit rester familier, le lointain peut devenir monstrueux. C’est pourquoi les peuples fabuleux ne disparaissent jamais, même quand les explorations les démentent : ils se déplacent toujours plus loin, plus haut, plus profond. Lorsque les Portugais ne trouvent pas de Cynocéphales en Inde, ceux-ci migrent vers les îles inconnues de l’océan, puis vers les terres polaires, puis vers les planètes. La périphérie est infinie, et le fabuleux y trouve toujours refuge.
En somme, penser les peuples fabuleux comme une curiosité ethnographique, c’est manquer leur rôle essentiel. Ils sont l’expression d’une obsession universelle : se penser au centre, et projeter aux marges l’altérité, qu’elle soit monstrueuse ou idéale. Les Cynocéphales, les Rākṣasa, les hommes emplumés du Shanhai jing, le Wendigo ou les Seigneurs de Xibalba : tous disent la même chose, chacun à sa manière. L’homme ne se définit jamais seul : il a besoin de ses monstres aux confins pour savoir qui il est au milieu.
.
V. Du Moyen Âge à la Renaissance : entre mappemondes et satire
Du monde antique au monde médiéval, les peuples fabuleux n’ont pas disparu : ils se sont transmis, adaptés, et surtout fixés dans l’imaginaire cartographique et encyclopédique. Les mappemondes du Moyen Âge, comme celles de Hereford ou d’Ebstorf, sont des théâtres où Jérusalem trône au centre et où, dans les marges, prolifèrent les Cynocéphales, les Sciapodes, les Blemmyes. L’espace est hiérarchisé : au centre, le salut chrétien ; aux confins, l’étrange et le monstrueux.
Isidore de Séville, au VIIᵉ siècle, a joué un rôle décisif. Dans ses Étymologies, il reprend et condense Pline, Solin et d’autres auteurs antiques. Ses descriptions de peuples fabuleux sont intégrées comme des données de savoir. Elles deviennent des autorités, recopiées dans les manuscrits, illustrées dans les marges, puis reprises dans les encyclopédies médiévales comme celles de Vincent de Beauvais (Speculum maius) ou de Barthélemy l’Anglais (De proprietatibus rerum). Dans ces œuvres, le fabuleux n’est pas relégué : il est classé, ordonné, rationalisé dans l’édifice du savoir chrétien.
Les mirabilia, ces récits de merveilles, constituent un genre en soi. Le Livre des merveilles attribué à Jean de Mandeville, au XIVᵉ siècle, en est l’illustration la plus célèbre. Cet ouvrage, immensément lu et traduit, raconte des voyages vers l’Orient, mêlant descriptions réalistes (éléphants, crocodiles, épices) et peuples fabuleux hérités de la tradition antique. Les Sciapodes et les Cynocéphales y côtoient les coutumes musulmanes et indiennes. Le lecteur médiéval ne distinguait pas forcément entre ce qui relevait du réel et du fabuleux : tout faisait partie d’une même cartographie spirituelle et morale.
Mais la Renaissance change le rapport. Les grandes découvertes ébranlent ce savoir transmis. Les Portugais explorent les côtes de l’Afrique, les Espagnols atteignent l’Amérique, et partout ils rencontrent des hommes — différents, certes, mais hommes tout de même. Les Cynocéphales et les Sciapodes ne sont nulle part. Le fabuleux, longtemps accepté comme savoir, commence à basculer dans le domaine de la fable. Ce basculement n’est pas immédiat : on espère encore trouver des peuples monstrueux dans les terres les plus reculées, mais peu à peu l’absence devient éloquente.
C’est à ce moment qu’intervient l’ironie humaniste. Rabelais, dans Pantagruel et Gargantua, reprend le motif des peuples fabuleux pour le détourner. Dans le Quart Livre, le voyage de Pantagruel et de ses compagnons est une parodie de navigation vers des terres fabuleuses. Ils rencontrent les Chicanous (peuple de plaideurs absurdes), les Papimanes (adorateurs grotesques du pape), les Andouilles (nation de saucisses anthropomorphes). Chaque peuple est une satire, non plus un reflet de l’altérité géographique, mais une critique des travers bien réels de l’Europe contemporaine : le fanatisme religieux, les abus de justice, la gloutonnerie.
Encadré critique : Rabelais et la subversion du fabuleux
Rabelais se situe à la charnière : il hérite de la tradition médiévale des peuples fabuleux, mais il en révèle l’artifice. Là où Pline et Isidore rapportaient les Sciapodes et les Blemmyes comme des données de savoir, Rabelais invente des peuples absurdes pour faire rire et réfléchir. Le fabuleux, chez lui, n’est plus une curiosité ethnographique : c’est un outil satirique. En ridiculisant ces peuples inventés, il ridiculise aussi la crédulité ancienne. Mais il en garde la fonction : mettre en scène l’altérité, pour mieux réfléchir sur soi. Rabelais transforme donc le fabuleux en grotesque, le savoir en rire, la crédulité en critique.
Cette mutation s’accompagne d’un changement plus profond. Montaigne, dans ses Essais, médite sur les Indiens du Brésil rencontrés par les voyageurs. Il écrit : « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » (Essais, I, 31). Pour lui, les peuples fabuleux de Pline et d’Isidore sont des fables ; la vraie leçon, c’est que notre regard fabrique l’altérité. Les « sauvages » du Nouveau Monde ne sont pas plus barbares que nous : ils révèlent notre propre barbarie. L’admiratio naïve devant les peuples fabuleux se transforme en étonnement critique devant la diversité réelle des hommes.
Ainsi, du Moyen Âge à la Renaissance, on assiste à une véritable reconfiguration. Les peuples fabuleux ne disparaissent pas, mais leur statut change : d’éléments du savoir encyclopédique, ils deviennent objets de satire et de réflexion. L’admiratio ne s’éteint pas, mais elle change de cible. Ce n’est plus l’étonnement devant des hommes sans tête ou à un pied, mais devant la variété infinie des usages, des coutumes, des croyances. L’altérité n’est plus projetée dans des confins imaginaires : elle est reconnue au cœur même du monde.
Ce basculement annonce déjà la modernité. L’Europe cesse de croire aux Sciapodes et aux Cynocéphales, mais elle continue de projeter ses peurs et ses désirs sur d’autres figures. L’Amérindien devient à la fois barbare et bon sauvage ; l’Africain, objet d’exotisme ou de dénigrement. Les peuples fabuleux n’ont pas disparu : ils se sont transposés dans de nouveaux imaginaires.
VI. L’admiratio, moteur du savoir ancien et question pour aujourd’hui
Pour comprendre pourquoi les peuples fabuleux ont occupé une telle place dans les textes antiques et médiévaux, il faut revenir à une notion qui nous échappe souvent : celle de l’admiratio. Ce terme latin désigne à la fois l’étonnement et l’admiration. Il ne s’agit pas d’un simple sentiment, mais d’une disposition fondamentale de l’esprit. Dès Aristote, le thaumazein — l’étonnement — est posé comme l’origine de la philosophie. « C’est par l’étonnement que les hommes, maintenant comme au début, commencèrent à philosopher » (Métaphysique, A, 2). Pour les Grecs comme pour les Romains, ce n’est pas la certitude qui fonde le savoir, mais l’ouverture devant ce qui étonne.
C’est précisément dans cette logique que Pline l’Ancien construit son Histoire naturelle. Son encyclopédie n’a pas pour but de séparer le vrai du faux selon nos critères modernes. Elle vise à montrer toute la diversité du monde, du plus ordinaire au plus extraordinaire. C’est pourquoi, au côté de ses descriptions rigoureuses des éléphants ou des pierres précieuses, il consigne aussi les Cynocéphales, les Blemmyes, les Sciapodes. Il les appelle des mirabilia, des choses dignes d’admiration. L’encyclopédie antique ne se veut pas seulement exacte : elle veut être source d’étonnement.
Le Moyen Âge a prolongé cette disposition. Les mirabilia deviennent un genre en soi : des recueils de merveilles, où s’accumulent faits curieux, anecdotes prodigieuses, récits fabuleux. Le Livre des merveilles de Jean de Mandeville, au XIVᵉ siècle, en est un exemple éclatant. Le voyageur y raconte avoir vu, en Orient, des hommes aux têtes de chien, d’autres aux oreilles démesurées, d’autres encore sans bouche. Peu importait qu’il s’agisse d’inventions ou de reprises de Pline : ce qui comptait, c’était la capacité du récit à susciter l’admiratio du lecteur. La fonction n’était pas scientifique mais spirituelle : admirer la diversité du monde, c’était entrevoir la richesse de la création divine.
À la Renaissance, cette notion change de statut. Rabelais garde l’étonnement, mais il le détourne vers le grotesque : ses peuples absurdes ne sont plus objets d’admiration mais de rire. Montaigne, lui, transforme l’admiratio en critique. Face aux Indiens du Brésil, il refuse de les considérer comme des monstres : il choisit de s’étonner de leur humanité, et de retourner cet étonnement contre l’ethnocentrisme européen. L’admiratio devient un instrument de relativisme culturel.
Ce basculement marque un tournant. La science moderne, à partir du XVIIᵉ siècle, valorise la preuve et l’expérimentation. L’étonnement reste, mais il se déplace : il n’est plus devant des peuples fabuleux, mais devant les lois mathématiques et les mécanismes du monde. Galilée, Newton, Descartes s’émerveillent eux aussi, mais de l’ordre caché que révèle l’expérience. L’admiratio se rationalise : elle n’est plus l’accueil du fabuleux, mais la contemplation du calculable.
Or, ce déplacement n’est pas neutre. En reléguant les peuples fabuleux au rang de fables, nous avons perdu une dimension essentielle : la capacité d’intégrer le merveilleux comme partie du savoir. L’admiratio, jadis moteur de connaissance, s’est fragmentée : d’un côté la science et ses preuves, de l’autre la littérature et ses fictions. Nous avons cessé de penser que le fabuleux pouvait être vrai autrement, qu’il pouvait porter une vérité symbolique.
Pourtant, cette disposition n’a pas disparu. On la retrouve dans la science-fiction, qui invente de nouveaux peuples fabuleux — extraterrestres, civilisations parallèles — pour nous étonner et nous instruire. On la retrouve aussi dans la vulgarisation scientifique, où l’on parle volontiers « d’émerveillement devant l’univers ». On la retrouve même dans les théories alternatives, parfois complotistes, qui remettent en circulation l’imaginaire des terres inconnues et des peuples cachés.
L’admiratio demeure donc une force vitale. Elle nous rappelle que le savoir n’est pas seulement accumulation de preuves, mais aussi ouverture à l’inattendu. Les Cynocéphales et les Sciapodes de Pline n’étaient pas des réalités ethnographiques, mais ils étaient des réalités symboliques : ils disaient l’étrangeté du monde, la fragilité de nos certitudes, l’infinie variété du vivant. Aujourd’hui encore, nous avons besoin de cette disposition, non pour confondre savoir et croyance, mais pour garder vivant le lien entre connaissance et imagination.
VII. Savoir, preuve et vérité : un triptyque instable
Si les peuples fabuleux nous fascinent encore, c’est qu’ils mettent en crise trois notions que nous avons tendance à confondre : le savoir, la preuve et la vérité. Aujourd’hui, nous croyons souvent que ces trois termes se recouvrent, comme si ce qui est su devait être prouvé, et comme si ce qui est prouvé devait être vrai. Mais l’histoire des peuples fabuleux nous rappelle que les choses sont plus complexes.
Le savoir, d’abord, est toujours situé. Il correspond à l’ensemble des connaissances qu’une culture considère comme légitimes à un moment donné. Pour les Grecs, savoir = ce qu’ont dit Homère, Hérodote, Ctésias. Pour Pline, savoir = tout ce qui a été consigné par les autorités reconnues, sans tri radical entre le plausible et l’invraisemblable. Pour Isidore de Séville, savoir = organiser ce que la tradition a transmis. Dans ce contexte, les Cynocéphales et les Sciapodes faisaient partie du savoir, non parce qu’ils étaient prouvés, mais parce qu’ils étaient repris par les autorités. Le savoir est collectif et historique, il se construit par accumulation et transmission.
La preuve, ensuite, est un critère plus restrictif. Pour nous, elle suppose démonstration, vérification, reproductibilité. Mais ce critère n’a pas toujours été le même. Les Anciens ne cherchaient pas à « prouver » l’existence des peuples fabuleux comme on prouve une expérience de laboratoire. Leur preuve était d’un autre ordre : le témoignage d’un voyageur, l’autorité d’un texte, la concordance de plusieurs traditions. Ce n’était pas une preuve scientifique, mais une preuve culturelle. Au Moyen Âge, le fait qu’Isidore ou Vincent de Beauvais rapportent une chose suffisait à l’attester.
La vérité, enfin, est encore plus large. Elle n’est pas réductible au savoir transmis ni à la preuve expérimentale. Elle est ce que les hommes jugent conforme au réel, ce qui donne sens à leur existence. Dans l’Antiquité et au Moyen Âge, la vérité des peuples fabuleux n’était pas ethnographique : elle était symbolique. Ils étaient vrais comme signes de l’altérité, comme figures de l’inconnu, comme rappels de la diversité infinie du monde. Leur vérité ne se mesurait pas à la vérification empirique, mais à leur capacité à faire sens.
Notre époque a tendance à réduire la vérité à la seule vérité scientifique, c’est-à-dire à ce qui peut être prouvé. C’est une conquête précieuse, mais elle produit des biais. Elle nous pousse au réductionnisme, en écartant comme faux tout ce qui n’est pas prouvé selon nos critères. Elle engendre aussi une méfiance généralisée : face à cette réduction, certains cherchent des vérités ailleurs, dans les mythes, les complots ou les croyances alternatives. Enfin, elle entraîne un appauvrissement symbolique : nous oublions qu’un récit peut être vrai autrement, par sa valeur existentielle ou poétique.
Les peuples fabuleux en sont un exemple parfait. Ils n’étaient pas vrais du point de vue ethnographique. Ils n’étaient pas prouvés selon nos critères expérimentaux. Mais ils faisaient partie du savoir antique et médiéval, et ils portaient une vérité symbolique : ils exprimaient le rapport des hommes à l’altérité et aux confins. Les réduire à de simples fables, c’est manquer cette dimension.
On pourrait dire que le savoir, la preuve et la vérité forment un triptyque instable, dont l’équilibre varie selon les époques. Dans l’Antiquité, le savoir dominait : ce qui comptait, c’était de tout rapporter, preuves ou non. Au Moyen Âge, c’est la vérité symbolique qui primait : les peuples fabuleux étaient vrais parce qu’ils enseignaient une leçon morale et spirituelle. À l’époque moderne, c’est la preuve qui prend le dessus : ce qui n’est pas vérifiable est relégué au rang de fiction. Aujourd’hui encore, nous vivons dans cet héritage, oscillant entre fascination pour l’exactitude scientifique et nostalgie pour des vérités plus larges.
En somme, les peuples fabuleux nous rappellent une leçon essentielle : savoir, preuve et vérité ne se confondent pas. Ils nous obligent à reconnaître que la connaissance n’est jamais pure accumulation de faits, mais toujours un mélange de ce que l’on croit, de ce que l’on montre, et de ce que l’on juge digne de sens.
.
VIII. Mécanique quantique et littérature contemporaine : un retour de l’étrange
Ce qui rend les peuples fabuleux fascinants, c’est qu’ils nous rappellent que l’observateur n’est jamais extérieur au monde qu’il décrit. Les Cynocéphales de Ctésias ou les Sciapodes de Pline ne sont pas de simples erreurs : ils révèlent la manière dont l’Antiquité se projetait sur les confins. Ce que les Anciens croyaient voir était autant le reflet de leurs peurs et de leurs désirs que le miroir du réel.
La mécanique quantique, dans un registre tout différent, a bouleversé notre conception de la connaissance en réintroduisant ce principe : l’observateur fait partie de l’expérience. L’expérience des fentes de Young a montré que les particules ne se comportent pas de la même manière selon qu’on les observe ou non. Le principe d’incertitude d’Heisenberg rappelle qu’on ne peut pas mesurer simultanément la vitesse et la position d’une particule sans que la mesure elle-même modifie le phénomène. En physique comme en anthropologie, le réel n’est jamais donné brut : il est co-produit par la manière dont nous l’interrogeons.
Cette leçon a des conséquences profondes pour notre rapport au savoir, à la preuve et à la vérité. Le savoir n’est jamais neutre, il est situé. La preuve n’est jamais pure, elle est produite par un dispositif d’observation. La vérité n’est jamais absolue, elle est relationnelle. Nous ne sommes pas en dehors du monde que nous décrivons : nous en faisons partie. De ce point de vue, les peuples fabuleux de l’Antiquité et les quanta de la physique contemporaine nous enseignent la même chose : la connaissance est toujours médiée, partielle, et en partie construite par l’observateur.
La littérature contemporaine a, elle aussi, intégré cette leçon. Depuis le début du XXᵉ siècle, le récit linéaire hérité du XIXᵉ siècle a éclaté. Les écrivains modernes et postmodernes ont mis en crise la narration classique pour introduire de nouvelles formes d’« observation littéraire ». Joyce, dans Ulysse ou Finnegans Wake, démultiplie les voix et les perspectives. Borges imagine des mondes parallèles, des bibliothèques infinies, des récits où chaque bifurcation produit une réalité différente. Calvino, dans Si par une nuit d’hiver un voyageur, fait du lecteur un acteur de l’expérience narrative. Perec, avec La Vie mode d’emploi, construit une fiction comme une combinatoire de possibles. Duras, Woolf, ou encore les écritures hypertextuelles contemporaines, déstabilisent l’idée d’un narrateur unique et omniscient.
Dans toutes ces expériences, la narration devient « quantique » : elle multiplie les possibles, elle inclut le lecteur comme observateur, elle ne propose pas une vérité unique mais une constellation de vérités provisoires. Le récit n’est plus un fil tendu du début à la fin, mais un champ de potentialités. L’acte de lecture devient une mesure : chaque lecteur actualise un chemin parmi d’autres, comme l’expérience quantique fixe un état parmi les possibles.
Sous cet angle, les peuples fabuleux ne sont pas si éloignés. Ils sont les ancêtres mythiques de ces mondes multiples : des êtres imaginés pour dire ce que l’on ne connaissait pas, des figures de l’altérité que l’observateur produisait en même temps qu’il les décrivait. Aujourd’hui, nous inventons des extraterrestres, des intelligences artificielles conscientes, des réalités parallèles. Ce sont nos Cynocéphales modernes. La fonction est identique : s’étonner, se décentrer, interroger les limites de l’humain.
La littérature et la science convergent ainsi vers une même conclusion : il n’existe pas de vérité unique, donnée une fois pour toutes. Il existe des récits, des expériences, des preuves situées, qui révèlent chacune une facette du réel. Le rôle de l’homme n’est pas de trancher définitivement, mais de maintenir vivant le lien entre connaissance et imagination.
C’est peut-être ici que l’admiratio retrouve sa place. Non plus naïveté devant des récits invraisemblables, mais étonnement devant la complexité du monde et de nos propres représentations. Admirer ne signifie pas croire aveuglément : cela signifie reconnaître que le monde est toujours plus vaste que ce que nous en disons, et que notre regard en fait partie.
Ainsi se dessine une continuité paradoxale. Les peuples fabuleux de l’Antiquité, les mappemondes médiévales, les satires de Rabelais, les expériences quantiques, les récits de Borges ou de Calvino appartiennent tous à la même histoire : celle de l’homme qui se cherche en se confrontant à l’altérité. Du fabuleux ancien aux narrations modernes, il y a moins rupture que déplacement. Nous n’avons pas cessé d’inventer des peuples fabuleux : nous les avons simplement transposés dans d’autres espaces, scientifiques, littéraires, imaginaires.
La conclusion s’impose alors : ce que nous appelons « peuples fabuleux » n’est pas un simple vestige d’un savoir naïf, mais une nécessité constante. L’homme a besoin d’altérités radicales pour se définir. Il a besoin de récits pour organiser l’inconnu. Et il a besoin d’admiratio pour transformer l’étrange en connaissance. Le défi contemporain est de réapprendre à tenir ensemble preuve et merveille, science et récit, savoir et imagination — non pour confondre, mais pour reconnaître que la vérité se trouve souvent à la frontière entre ce que nous observons et ce que nous inventons.
IX. Conclusion générale
De l’Antiquité à nos jours, les peuples fabuleux tracent une histoire continue. Les Cynocéphales, les Sciapodes, les Blemmyes, les Rākṣasa indiens, les peuples emplumés du Shanhai jing, les Wendigo et les Seigneurs de Xibalba n’appartiennent pas au même univers, mais ils remplissent la même fonction : dire ce qui est aux confins. Ils dessinent une frontière, géographique ou symbolique, qui permet à chaque culture de se penser au centre. L’oikouménè grecque, le Zhongguo chinois, le Bhārata-varṣa indien, les territoires amérindiens : partout, la même logique centre/périphérie se déploie. Le peuple fabuleux, qu’il soit monstrueux ou idéal, permet d’affirmer une identité par contraste.
Ces récits ne sont pas de simples naïvetés. Ils appartenaient pleinement au savoir de leur temps. Pline les consigne comme des données ethnographiques ; Isidore les classe dans ses encyclopédies ; les mappemondes médiévales les illustrent aux marges des continents. Le critère de leur légitimité n’était pas la preuve au sens moderne, mais l’admiratio. Susciter l’étonnement, montrer la variété du monde, inviter à contempler la puissance créatrice de la nature ou de Dieu : telle était leur vérité. Ils n’étaient pas vrais factuellement, mais ils étaient vrais symboliquement.
La Renaissance change la donne. L’exploration du monde révèle l’absence de ces peuples fabuleux : on ne rencontre ni Sciapodes ni Cynocéphales aux Indes. Le fabuleux bascule alors dans la satire (Rabelais) ou dans la réflexion critique (Montaigne). Ce que nous admirons désormais, ce n’est plus l’étrange lointain, mais la diversité réelle des hommes. Puis la science moderne installe de nouveaux critères : le savoir doit être prouvé, et la vérité se confond avec l’expérimentation. L’admiratio n’est pas abolie, mais elle est déplacée vers les lois physiques, les découvertes astronomiques, la puissance des mathématiques. Le merveilleux ancien est relégué à la littérature et au mythe.
Mais l’équilibre entre savoir, preuve et vérité n’a jamais cessé de bouger. Les peuples fabuleux montrent que le savoir est situé et collectif, que la preuve dépend des critères d’une époque, et que la vérité peut être symbolique autant que factuelle. En exigeant aujourd’hui que la preuve soit le seul garant de la vérité, nous oublions que d’autres types de vérités — poétiques, mythiques, existentielles — peuvent être tout aussi fécondes. Les peuples fabuleux nous rappellent que la connaissance n’est pas seulement accumulation de faits, mais aussi mise en récit de l’altérité.
La mécanique quantique, à sa manière, a rouvert cette question. En montrant que l’observateur fait partie de l’expérience, elle a ébranlé l’idée d’un savoir neutre et d’une preuve absolue. La vérité scientifique apparaît désormais comme une co-construction entre le monde et notre manière de l’interroger. Ce que Pline faisait en accumulant récits fabuleux et observations zoologiques n’était pas une erreur radicale : c’était déjà une manière de reconnaître que le regard humain invente autant qu’il constate. La science contemporaine, au lieu de réduire le monde à des certitudes, redécouvre l’étrange au cœur du réel : incertitude, indétermination, multiplicité.
La littérature contemporaine, elle aussi, a intégré cette leçon. En abandonnant le récit linéaire, elle a inventé des formes où l’observateur — le narrateur, le lecteur — devient partie prenante. Borges, Calvino, Perec, Woolf, Duras et bien d’autres construisent des mondes multiples, où chaque lecture est une mesure, chaque voix une potentialité. La narration devient « quantique » : elle ne propose pas une vérité unique, mais une constellation de possibles. Là encore, l’homme n’est plus au-dessus du monde : il est inclus dans l’expérience du récit.
Ainsi, des peuples fabuleux de l’Antiquité aux récits éclatés de la modernité, une même leçon traverse le temps : nous avons besoin de l’altérité, du fabuleux, de l’étrange, non pour fuir la réalité, mais pour apprendre à la penser. Nous avons besoin de l’admiratio, non comme crédulité naïve, mais comme disposition à accueillir l’inattendu. Nous avons besoin de récits, parce que la vérité n’est jamais donnée toute nue, mais toujours médiée par nos histoires, nos images, nos perspectives.
Peut-être faut-il conclure par une ouverture : les peuples fabuleux n’ont jamais disparu. Ils ont simplement changé de lieu. Hier, ils vivaient aux confins de l’Inde, de l’Éthiopie ou des cartes médiévales. Aujourd’hui, ils habitent nos récits de science-fiction, nos théories quantiques, nos imaginaires littéraires. Nous continuons d’inventer des altérités radicales — extraterrestres, intelligences artificielles, réalités parallèles — qui remplissent la même fonction que les Cynocéphales ou les Wendigo : nous rappeler que nous ne connaissons pas tout, que nous ne sommes pas seuls, et que le monde, pour être compris, doit d’abord être admiré.
En définitive, les peuples fabuleux sont moins des mensonges que des révélateurs. Ils disent que la vérité ne réside pas seulement dans ce qui est prouvé, mais aussi dans ce qui nous étonne et nous fait penser. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais des observateurs neutres : notre regard crée autant qu’il découvre. Et ils nous invitent, encore aujourd’hui, à cultiver l’admiratio comme une vertu intellectuelle, capable de relier le savoir, la preuve et la vérité dans une même expérience humaine.