mars 2025
Carnets | mars 2025
20 mars 2025
Il y a un truc qui s’est déplacé. C’était net, avant, dans les histoires fantastiques. Une apparition, une ombre derrière la porte, une silhouette là où il ne devait y avoir personne. Un surgissement. Aujourd’hui, c’est autre chose. Ça travaille autrement. Ça n’arrive plus en un coup, en un basculement. C’est déjà là, en filigrane, dans le quotidien, dans les gestes, dans ce qu’on croit connaître et qui, d’un coup, n’est plus si sûr. C’est la maison, qui commence à poser problème. Elle fait du bruit, elle respire. Pas besoin de fantômes, pas besoin d’entités. L’angoisse est là dans le mur, dans les angles morts, dans la façon dont la lumière glisse sur le parquet. La Maison des Feuilles, c’est exactement ça : un escalier qui s’allonge alors qu’il ne le devrait pas, un couloir qui s’étire, et soudain plus personne ne sait comment sortir. C’est aussi le travail, les visages dans l’open-space, trop lisses, trop symétriques. Des détails qui dérangent. On ne sait pas pourquoi, mais c’est là. On sait qu’on ne devrait pas poser la question. On sait qu’on ne veut pas savoir. Brian Evenson fait ça très bien. Des nouvelles où les choses ne sont jamais vraiment dites, où ce qui est inquiétant n’a même pas besoin de se montrer. Et puis il y a la ville, le métro, la foule. Ça parle un peu trop bas. Un regard qui dure un quart de seconde de trop. Un message qui arrive sur le téléphone, un numéro inconnu, un simple “je sais”. Aucun contexte, pas d’explication. Black Mirror a joué là-dessus. Le malaise au creux des objets du quotidien. Un téléphone, une appli, un message vocal laissé par un mort. L’angoisse sans artifice. Parce que c’est ça, le fantastique contemporain. Ce n’est plus un démon dans un miroir, ce n’est plus un vampire derrière la porte. C’est un doute. Une fissure dans la perception. Quelque chose qui n’a pas besoin de se montrer pour exister. Un écart qui s’installe, sans prévenir. Et qui ne repart plus. Ça commence comme une blague, un mème sur un forum, une photo de bureau déserté, murs jaunes, lumière crue. Ça pourrait être une arrière-salle d’entreprise fermée depuis vingt ans, une moquette qui a pris l’humidité. Rien. Pas un bruit, sauf ce bourdonnement d’électricité dans les néons. Juste un espace où tu n’es pas censé être. On dit que tu y arrives par accident, comme si tu glissais entre deux pixels du réel. Il suffit d’un moment d’inattention, d’une porte ouverte au mauvais endroit. Et puis, plus rien. Les Backrooms t’avalent. Tu marches, les couloirs se répètent, tous identiques, jusqu’au vertige. Aucun point de repère, pas de fenêtres. Un sentiment de déjà-vu qui tourne mal. C’est trop lisse, trop grand, trop vide. Comme si quelqu’un avait effacé ce qu’il devait y avoir. Ce n’est pas une histoire avec une trame. C’est une sensation, une menace sans visage. Et c’est pour ça que ça marche. Parce que l’angoisse, maintenant, elle est là où on ne l’attend pas. Pas de fantômes, pas de créatures qui sortent du noir. Juste un endroit qui n’a pas de raison d’être. C’est la peur du vide, mais un vide qui s’étire. Une absence qui devient tangible. Tu te demandes depuis combien de temps tu marches, pourquoi l’air sent ce mélange de poussière et de moisi. Tu essaies de te rappeler comment tu es arrivé là. Tu ne trouves pas. Le fantastique d’aujourd’hui, c’est ça. Plus besoin de surgissement, plus besoin de choc. Juste une dislocation de l’espace, une logique qui se dérègle. Tu crois que tu peux retrouver la sortie. Puis tu te rends compte que tu ne sais plus comment tu es entré. Et ça, c’est pire que n’importe quel monstre. illustration : PB/ Boissy-Saint-Léger,RER 1982|couper{180}

Carnets | mars 2025
19 mars 2025
Je suis en train de lire ces histoires étranges d'Ambrose Bierce, et presque aussitôt, une sensation familière me traverse : un retour en arrière, une réminiscence de mes années d’adolescence, lorsque je découvrais Maupassant avec fascination. Ses nouvelles fantastiques, pleines d’incertitude et de vertige, m’avaient marqué profondément. Ici, dans ces pages signées Bierce, je retrouve ce même frisson, cette même frontière trouble entre le rationnel et l’inexplicable. Je me demande alors : Bierce a-t-il lu Maupassant ? Sans doute. Comment aurait-il pu l’ignorer ? La réputation du Normand avait traversé l’Atlantique, et ses nouvelles, en particulier Le Horla, étaient lues et commentées bien au-delà des cercles littéraires français. Bierce, polyglotte et fin connaisseur de la littérature européenne, aurait facilement pu tomber sur ces récits d’angoisse et de folie progressive. Les similitudes sont troublantes. Maupassant et Bierce explorent tous deux la fragilité de la perception humaine, cette capacité qu’a l’esprit à vaciller devant l’inexplicable. Chez Maupassant, l’angoisse surgit de l’intérieur, un malaise qui envahit peu à peu le personnage et le lecteur. Chez Bierce, la mécanique est plus brutale, plus tranchante, mais l’effet reste le même : une ironie macabre où le surnaturel n’apparaît jamais sans un sous-texte cruel. Un salut glacial rappelle les visions fantasmagoriques du Horla ; Une arrestation joue avec la justice implacable des morts, tout comme La peur de Maupassant joue avec la culpabilité et la hantise. Mais il y a une différence notable : là où Maupassant s’ancre dans un univers feutré, marqué par la bourgeoisie et ses tourments psychologiques, Bierce est un homme de la guerre, du sang, de la poussière et de la violence de l’Amérique du XIXe siècle. Ses récits de fantômes portent l’empreinte de la Guerre de Sécession, du chaos, et d’une ironie plus sèche, plus acérée. Ainsi, si Bierce a peut-être lu Maupassant, il n’a pas simplement imité, il a adapté. Il a injecté dans le fantastique une noirceur particulière, une fatalité propre à son époque et à son pays. Lire Bierce, c’est donc comme lire Maupassant après un passage sur les champs de bataille : l’angoisse n’est plus seulement intérieure, elle est aussi le produit d’un monde brutal et sans pitié. Et moi, refermant ce recueil, je ressens cette étrange impression d’avoir traversé un pont entre deux continents, entre deux sensibilités. Un dialogue muet entre deux écrivains qui ne se sont jamais rencontrés, mais dont les ombres se croisent quelque part, dans les méandres d’une nouvelle à chute, au détour d’un frisson partagé. Mais cette parenté littéraire, qui me frappe aujourd’hui, aurait-elle eu la même force si j’avais vécu à une autre époque ? Il est fascinant de constater que ces nouvelles, autrefois si percutantes, ont fini par lasser. Trop de chutes, trop de surprises attendues, trop de mécaniques usées par la répétition. Lorsque Bierce et Maupassant écrivaient, ce type de récit était encore un terrain d’expérimentation, une manière novatrice de jouer avec la perception du lecteur. Mais à mesure que les nouvelles à chute se sont multipliées dans les magazines et journaux, elles ont perdu leur singularité, devenant des exercices de style prévisibles. Peut-être est-ce cela, finalement, qui fait que lire Bierce et Maupassant aujourd’hui conserve un goût particulier : nous savons que nous nous aventurons dans un territoire où la surprise a pu être galvaudée, et pourtant, dans leurs mains, elle garde encore cette puissance troublante, cette façon unique de nous arracher au réel pour nous plonger dans un vertige inquiétant. Alors, que reste-t-il aujourd’hui de l’histoire fantastique ? À quoi ressemble-t-elle dans un monde où l’étrange est omniprésent, où la fiction a été bouleversée par tant d’expériences narratives ? Les formes contemporaines du fantastique ne reposent plus uniquement sur l’effet de chute, mais jouent avec le doute, l’inachèvement, la multiplicité des interprétations. Des auteurs comme Jorge Luis Borges ont réinventé la nouvelle en intégrant le fantastique dans des structures labyrinthiques, où le surnaturel n’est pas un simple coup de théâtre, mais une énigme qui se propage à toute la narration. Dans Fictions, des récits comme La loterie à Babylone ou Tlön, Uqbar, Orbis Tertius brouillent la frontière entre réalité et illusion d’une manière qui aurait certainement fasciné Bierce. Julio Cortázar, dans Fin d’un jeu et Bestiaire, fait basculer le quotidien dans l’inquiétante étrangeté, avec des récits où l’étrange surgit sans explication, s’insérant subtilement dans le réel. Italo Calvino, lui, joue avec les structures narratives, comme dans Si par une nuit d’hiver un voyageur, où la fiction devient elle-même un piège. D’autres voix contemporaines poursuivent cette exploration : Brian Evenson, avec Fugitives, explore un fantastique minimaliste et brutal. Angela Carter, dans La Compagnie des loups, revisite les contes en leur insufflant une étrangeté troublante. Laird Barron, quant à lui, réintroduit l’horreur cosmique chère à Lovecraft, tout en la teintant d’un réalisme oppressant. Le fantastique contemporain ne repose plus tant sur la surprise finale que sur une expérience immersive, une montée en tension progressive où le réel devient incertain. La frontière entre réalité et fiction s’efface, nous plongeant dans un vertige d’autant plus troublant qu’il ne cherche plus forcément à nous surprendre… mais à nous envelopper insidieusement. Je referme ces pages et me demande : dans un siècle, quels écrivains redécouvrira-t-on avec ce même sentiment de familiarité troublante ? Illustration : John Herbert Evelyn Partington — Ambrose Bierce|couper{180}

Carnets | mars 2025
18 mars 2025
Il suffit parfois de s’allonger. De laisser la pesanteur faire son office, d’appuyer l’arrière du crâne contre une surface plane, de s’assurer que l’on est bien réparti de façon homogène, comme une pâte à tarte trop travaillée. Il suffit ensuite de suivre sa respiration, en bon spectateur, sans interférer. L’air entre, l’air sort. Tout se passe bien. Enfin, normalement. Avant cela, bien sûr, il y a la résistance. L’esprit s’agite, fait du bruit, remue des archives entières de conversations passées, ressasse d’antiques préoccupations administratives et tente d’ouvrir un dossier classé sans suite depuis trois ans. Il veut prouver son existence. Mais il suffit d’attendre. On le laisse parler, il finira bien par se lasser. Puis, sans tambour ni trompette, on le débranche. C’est alors que l’on traverse sa propre bulle. On passe d’un espace exigu, saturé de réminiscences inutiles, à une sorte d’expansion floue, comme une salle d’attente où il ne se passe rien mais où l’on est bien. Rien de mystique, juste une légèreté bienvenue, une fluidité inhabituelle. La pensée n’a pas disparu, elle est là, mais en version atténuée, en sourdine, comme un téléviseur qu’on aurait oublié d’éteindre. Et puis parfois, dans cet état de flottement, quelque chose bascule. La conscience s’efface presque totalement, le corps devient un simple contour. C’est précisément là que tout s’emballe. Un fourmillement électrique gagne les extrémités, le cœur s’emballe comme s’il venait de rater une marche. Une sensation idiote, en somme, mais d’une efficacité redoutable : en une fraction de seconde, on se retrouve à donner un coup de poing sur le sol ou le matelas, avec l’élégance d’un boxeur sans adversaire. Juste pour s’assurer que l’on est bien toujours là, que l’on n’a pas définitivement glissé de l’autre côté, où que ce soit. La peur de crever, probablement, ou pire : la peur de ne pas revenir. Mais si l’on ne donnait pas ce coup de poing ? Si, au lieu de réagir, on laissait faire ? Si l’on se laissait couler, traverser l’instant sans le heurter, sans chercher à se récupérer ? Peut-être que le corps, au lieu de se raidir, finirait par s’étirer à l’infini, que la pensée se dissoudrait sans heurt, comme une plume qui se laisse porter par le vent. Peut-être que rien ne se passerait, ou au contraire, tout. Peut-être que l’on découvrirait que la chute tant redoutée n’en était pas une, qu’il n’y avait pas d’autre côté, juste une continuité imperceptible. Peut-être. Et puis, bien sûr, il y a cette hésitation. Ce moment absurde où l’on se demande si ce n’est pas exactement la même chose qui se joue face à une toile vierge ou une page blanche. Ce seuil où l’on pourrait basculer, mais où l’on préfère rester en équilibre, bien accroché à ce qui nous retient. Et quand on ouvre les yeux, tout est exactement pareil. Pourtant, tout a changé. Illustration : : John Everett Millais Ophélia Musique : Erik Satie- Gnossienne n°1"|couper{180}

Carnets | mars 2025
17 mars 2025
Nous passons notre temps à colmater des brèches, à obstruer des failles, et puis un jour, à force d’avoir vidé nos peurs, rincé nos rêves, essoré tout notre être, il ne reste plus de nous qu’une écorce décharnée, un agrume pressé jusqu’à la dernière goutte, bon pour la poubelle ou, à la rigueur, pour un tas de compost, ce qui est un moindre mal. On peut aussi, pour plus de discrétion, s’arranger d’un cercueil six pieds sous terre. Tout cela ne change pas grand-chose : les trous demeurent, béants, et ceux qui restent tentent de les combler comme ils peuvent, c’est-à-dire pas du tout. Ce qui rejoint cette évidence cosmique : il y a plus de vide que de plein, partout. Ce que nous tenons pour solide, ce bureau, ce mur, ce corps, tout cela est un assemblage bancal d’atomes capricieux, flottant dans l’incertitude. Et pourtant, nous nous obstinons à croire en la fermeté des choses, à nous appuyer sur des structures qui ne tiennent qu’à un fil. C’est même étrange, cette confiance aveugle dans la stabilité, cette manière de nous laisser berner par une illusion d’équilibre qui, au fond, ne trompe personne. Je ne sais plus très bien si c’était hier soir, juste avant de m’endormir, ou en pleine nuit, pris dans l’entrelacs d’un rêve, ou bien au matin, dans cette zone floue où les idées affleurent avec une netteté suspecte. Toujours est-il que ces pensées, parfaitement claires, se sont imposées : il suffirait d’un rien pour abattre les cloisons de ce gigantesque simulacre, une chiquenaude, une micro-faille dans le décor. Ce seul constat m’a procuré une étrange quiétude, comme la résonance d’une fréquence oubliée, enfouie sous les strates du quotidien et dont je ne me souvenais pas avoir un jour perçu l’existence. Une quiétude pourtant si tangible qu’elle semblait s’infiltrer par un interstice, une brèche minuscule dans le décor, comme une odeur connue mais inexplicable, croisée par hasard sur un trottoir et qui, en un instant, convoque tout un monde disparu. J’essayais de rester à la lisière, sur le seuil exact de toute définition du mot familier, en équilibre instable, ce qui demandait, il faut bien l’admettre, quelques efforts considérables. Car immédiatement, un défilé d’images invraisemblables et absurdes s’était mis en marche, un cortège qui avançait sans que je puisse en contenir le flux. Des visages apparaissaient : ma mère, mon père, mon frère, mes grands-parents, ces êtres que j’avais toujours cru connaître avec une certitude sans faille, comme s’ils faisaient partie de mon propre décor intérieur, comme s’ils avaient été déposés là dès l’origine, sans même que la question de leur présence se pose. Et puis, il y avait cette clarté. Une lumière trop franche, venue de cette fissure dans la cloison de ce que j’avais toujours nommé familiarité, une lumière qui me frappa au point de me faire vaciller. Car à mesure qu’elle s’intensifiait, elle produisait un effet tout à fait paradoxal : non pas l’illumination réconfortante qu’on attendrait d’une révélation, mais un trouble diffus, un soupçon grandissant. Cette lumière m’amenait à douter de mes propres sentiments envers ces figures pourtant si ancrées en moi, si évidentes, tellement habituelles que je n’avais jamais pris la peine de les questionner. Et en même temps qu’un double sentiment, fait d’une peur sourde et d’une joie indéterminée, je sentais quelque chose m’appeler. Une invitation, ou plutôt une injonction silencieuse, à franchir moi aussi cette clarté étrange. L’effort produit pour résister, pour ne pas céder ni à la peur ni au désir de m’engouffrer dans cette coque soudain étonnamment vide du mot familier, me coûta tant d’énergie que j’ai dû m’assoupir. Ce qui n’est pas une preuve que je me sois totalement endormi, bien entendu. D’ailleurs, depuis plusieurs mois déjà, j’ai remarqué chez moi cette faculté inquiétante : celle de douter de ma propre existence dans ce que l’on nomme, un peu vite, la veille ou le sommeil. Rien de très spectaculaire en soi, juste un flottement, une hésitation légère, mais tenace. Il me semble que pour donner une image assez fidèle de cette sensation, on pourrait penser à ce chat enfermé dans un caisson de verre, ce fameux chat dont on ne sait plus s’il est vivant ou mort, selon que l’on choisit de l’observer ou non. Le chat de Schrödinger. C’est exactement ça. Un état suspendu, une vibration entre deux réalités, et surtout cette idée qu’il suffirait d’un rien pour basculer d’un côté ou de l’autre, sans même savoir si l’un de ces côtés existe réellement. Peut-être que tout cela est dû à mes lectures récentes, à leur contenu trouble, voire maléfique, dont je crois me protéger par une analyse rigoureuse, presque clinique, des textes. Cela suffirait, en principe. Et pourtant, malgré cette vigilance, il semble bien que quelque chose ait fini par s’infiltrer, par me polluer l’esprit—si tant est que ce terme ait encore un sens. Il me semble d’ailleurs de plus en plus plausible que toute frontière posée de façon arbitraire entre la réalité rassurante et l’effroi de l’inconnu ne tienne qu’à un fil. Qu’un jour ou une nuit, elle tombe soudain. Et que, dans le même élan, l’horreur ou la grâce m’emporte. Illustration Richard Dadd , The Fairy Feller's Master-Stroke Musique Tim Hecker – "Ravedeath, 1972" In the Fog 1|couper{180}

Carnets | mars 2025
16 mars 2025
Nous avons cessé de peindre des portraits. Depuis 2010, 2011, on a refermé les livres, les albums photo, les portables. Fini le portrait, montrez des visages ! Nous avons perdu des élèves à partir de là. Mais c’était une bonne chose. Nous nous enfoncions dans une aventure dont peu peuvent ressortir indemnes. Car on finit par comprendre que peindre un visage, ce n’est pas rien, c’est un vrai risque. Psychologiquement dangereux, mortel même. Il y a eu un grand cri dans l’atelier quand j’ai parlé des peintures de malades mentaux. Un instant suspendu, une rupture dans l’ordre perceptif. Le cri s’est détaché du corps, s’est projeté dans l’espace, laissant derrière lui une tension qui ne s’épuise pas. Il ne s’annule pas, ne se dissipe pas immédiatement dans la continuité du réel. Il s’accroche aux visages, modifie leur structure, imprime sur eux une déformation irréversible. Après coup, que reste-t-il ? Les visages ne sont plus que l’ombre d’une cohésion perdue. Ils n’appartiennent plus à ceux qui les portaient. Déstructurés, ils peinent à retrouver leur organisation première. Ils flottent, s’agrègent, se dissolvent. Amas indistincts de traits en errance, visages qui se recouvrent les uns les autres, englués dans leur propre altération. Une matière qui ne sait plus si elle est encore chair ou déjà abstraction. Les bouches, à demi béantes, oscillent entre articulation et mutisme, incapables de choisir si elles veulent encore parler ou s’éteindre tout à fait. Les regards divergent, certains s’effacent dans des orbites creusées, d’autres s’exorbitent, envahis par une dilatation malsaine. La carnation elle-même hésite, s’étire vers la pâleur, s’écrase dans des poches congestionnées. Plus rien ne fixe un état stable. Les lignes du visage, autrefois définies, deviennent aléatoires, flottantes. L’ensemble, plus proche d’un glissement que d’une présence. Comment représenter cela ? La tentative picturale se heurte à une impossibilité structurelle. Le trait, à peine esquissé, disparaît. Les contours refusent de tenir, se brisent sous le pinceau comme une surface trop fragile. Peindre le visage après le cri, c’est tenter de fixer une matière en fusion, c’est vouloir contraindre ce qui ne cesse de se dérober. C’est un combat perdu contre l’instabilité. Mais ce n’est pas seulement une question d’échec technique. Ce que le cri a laissé ne se réduit pas à un résidu expressif, il constitue une zone de vacillation ontologique. Les visages ne tiennent plus sur eux-mêmes. Ils s’absorbent, ils s’échappent, ils se retournent contre leur propre forme. L’image recule, elle se dérobe avant même de pouvoir être constituée. Le visage n’est plus qu’un vestige, un lieu d’effacement en cours. Certains peintres, conscients de cette dissolution, ont tenté de la capturer à travers leur propre délitement. Richard Dadd, interné, interrompait volontairement son traitement, peignant son propre visage à chaque stade de son effondrement mental, espérant qu’à la fin, il pourrait fixer sur la toile le dernier état de sa maladie. Mais comment peindre une chute ? Chaque toile n’était que l’anticipation de la suivante, la trace d’un passage, jamais l’ultime vérité. Peindre le visage, dans cette optique, c’est enregistrer sa propre disparition. William Utermohlen, frappé par la maladie d’Alzheimer, s’est lui aussi livré à cette quête d’impossible saisie. À mesure que sa mémoire se délitait, ses autoportraits devenaient des surfaces érodées, des traits fragmentaires où l’humain s’effaçait sous l’oubli. L’identité s’amenuisait, chaque coup de pinceau marquait une perte irréversible. Il espérait, peut-être, qu’au bout du processus, la dernière toile serait le visage même de sa maladie, la fixation ultime de l’absence en train de s’étendre. Il faudrait alors peindre non pas le visage, mais sa dissolution. Peindre la persistance de l’effacement, l’empreinte du cri qui ne cesse de travailler ce qui fut un visage. Peindre l’absence en train de s’étendre, jusqu’à ce que l’image elle-même cède sous la pression du vide. Illustration"" William Utermohlen Dernier dessin Musique** :Ligeti - Requiem (1965)|couper{180}
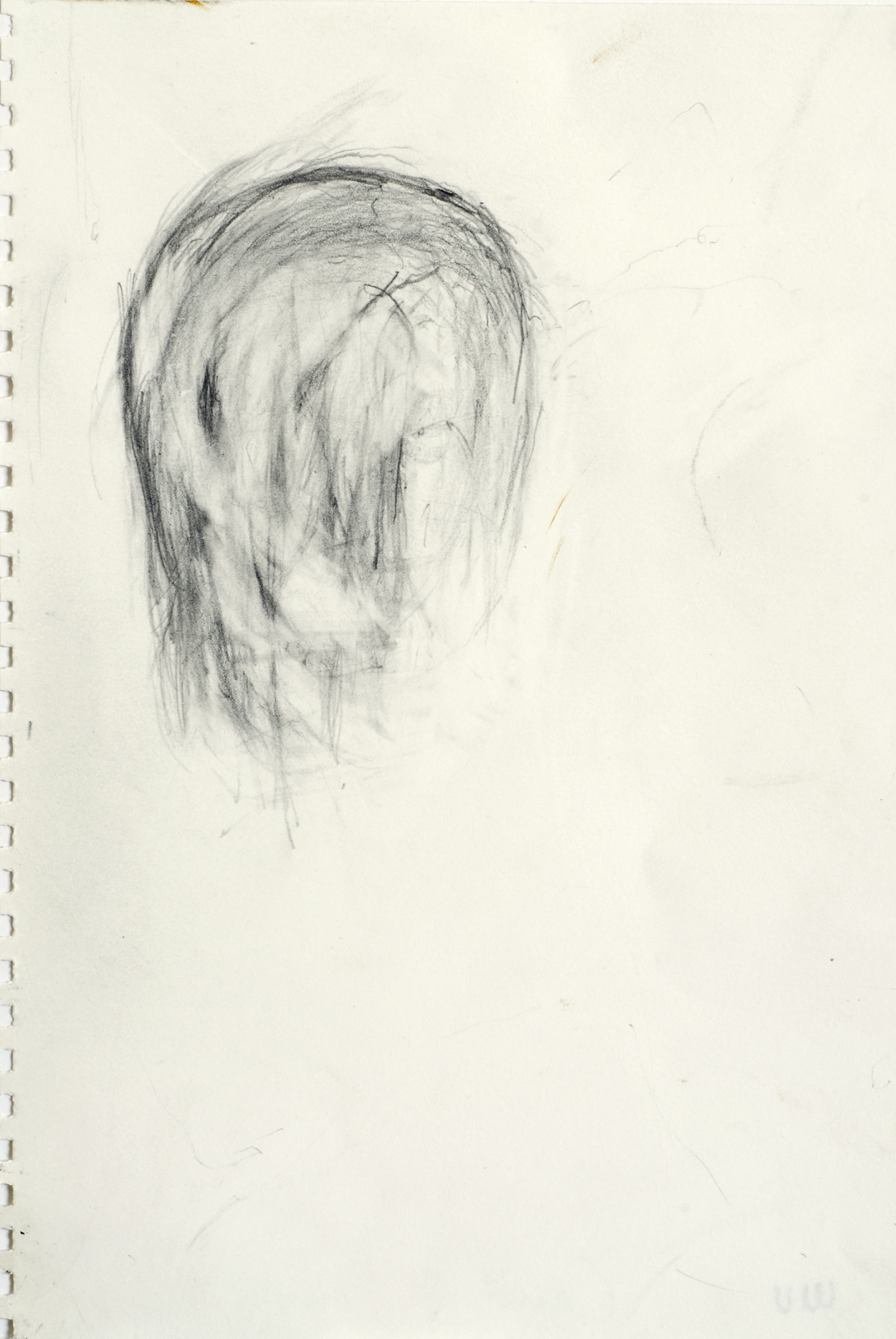
Carnets | mars 2025
15 mars 2025
La langue me tient chaud. La langue est mon amie. Sans elle, je ne suis pas grand-chose, une silhouette à contre-jour, une respiration sur le carreau d’une fenêtre, une rature. Avant, il y a la tempête, l’ouragan, tout ce qui souffle et arrache. Après, quand la bouche se tait, la langue reste là, tapie au chaud, dernier recoin de chaleur, dernier refuge. Ma langue, mon foyer. Ses mots, une famille en exil, et la ponctuation, cette manie d’inscrire des limites : poser un point, une virgule, un soupir. Tandis que le verbe verbe, la phrase phrase, et le café fume sur la cuisinière. Le feu crépite quelque part dans l’être, sous les tommettes tièdes, entre les murs vert bouteille. Une porte grince, une latte branle au grenier, la maison s’ajuste à la nuit. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe. À l’intérieur, peut-être une menace, une facture, une lettre d’amour – les trois à la fois, pourquoi pas. Tout ce qui me traverse, tout ce qui me définit, mes élans, mes peurs, mes écœurements, mon dégoût de certains mots, tout cela vient de ma langue. Et de nulle autre part. La langue est un pont immense entre rien et rien, et quand on y pense, ça devrait faire quelque chose. Parfois, je dis que je n’ai rien à dire. Parce que rien ne vient, rien de décisif, rien d’immédiat. J’ai peur des mots qui surgissent comme des alarmes : tout à coup, soudain, brusquement. Je crains le mot vite, vite, vite. La peur devient colère, mais pas une colère qui explose, qui renverse la table, qui cogne le mur du poing. Une autre colère. Une qui se replie, qui ferme soigneusement la porte derrière elle, qui se terre dans l’obscur. Elle serre les dents jusqu’à les briser. Ma colère, d’ailleurs, est édentée. Ce n’est la faute de personne. Pas même de ce dentiste qui, jugeant plus rentable l’extraction que le soin, m’arrache les dents l’une après l’autre. Ce n’est pas personnel, c’est un modèle économique. Ma colère paie rubis sur l’ongle. Puis elle repart, s’enroule autour du foie, glisse dans les poumons, s’installe dans la rate. Elle entend encore la voix du dentiste : Va te cacher, mocheté. Dans mon monde, on ne t’offre même pas un détartrage gratuit. "Désir de fusion besoin de solitude". Lecture de ce brin de phrase dans un article sur Katherine Mansfield dans Poézibo. Ce qui stoppe instantanément la lecture. Où en suis-je de ce vieux serpent de mer —ce fameux désir de fusion ? Je me palpe, me soupèse, m'évalue. Aucun enthousiasme, aucune hystérie, rien. La fusion s'est envolée. Ne reste que le besoin de solitude. Mais élevé à un point de fusion, une incandescence encore rarement atteinte. Hier soir, sous la pluie, j'ai quitté l'atelier des peintres roussillonnais pour me rendre à une invitation. Exposition Exil à Saint-Donas. Comme une dette à rembourser, puisque tant de gens viennent à mes expos, me dis-je il faut bien que de temps en temps je rendre la monnaie de la pièce. En même temps l'Exil ce n'est pas rien. Donc un peu des deux, de l'intérêt à deux têtes. Et bien je ne suis resté que quelques minutes à peine. Le temps de faire le tour des oeuvres exposées , du bon travail c'est à noter. Puis avant même que l'on ne débouche la première bouteille du vernissage je me suis eclipsé sur la pointe des pieds. J'ai croisé M. qui fumait sous le préau. Tu t'en vas déjà. J'ai dit oui. Elle m'a laissé entendre que si elle le pouvait elle aussi rentrerait. J'ai dit aller j'y vais. Pour ne pas avoir à engager la conversation plus avant. J'ai fini je crois que chercher des prétextes pour nourrir mon vice de vouloir être seul. Suis rentré, ébloui encore par la manière dont cette journée à filé. Je n'ai pas même eu la moindre douleur dentaire. J'attribue naïvement ça au somnifère dont je me bourre pour dormir en ce moment. Il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Avant-hier je n'en menais pas large. Tout chamane stoïque que je veux encore m'assurer d'être la douleur m'arrachait la moitié du crâne. Peint quatre petits tableaux format A4 sur papier avec les élèves. En fait sans y avoir trop pensé j'ai lancé un travail sur la couleur, ses mélange, le fait de ne pas s'occuper d'autre chose que de la constitution d'une palette personnelle. De modifier l'évidence. De se défendre d'utiliser la couleur sortant d'un tube par exemple, mais toujours la modifier légèrement. Partir ainsi seulement de la couleur qu'on dépose sur le papier, comme un musicien part peut-être d'une suite de notes qu'il augmente ou diminue. Suis parvenu à avaler un peu de riz puis repris un hypnotique pour aller m'enfoncer dans la lecture de Les cercueils en zinc de Svetlana Alexievitch. Mais impression d'avoir déjà lu mille fois ces pages et de n'y découvrir rien de nouveau. Je me suis endormi. Illustration : Mark Rothko Orange and Yellow 1960-61 Musique : Zaz, La vie en rose|couper{180}

Carnets | mars 2025
14 mars 2025
On le voit moins. C'est comme ça que ça commence, l'effacement. Par touches discrètes, sans tapage, petit à petit qu'il s'efface. Sa voix qui s'estompe. Et puis d'un coup cette question : a-t-il vraiment existé ? Peut-être juste imaginaire. Peut-être fragment d'un rêve ou cauchemar. Ce type sur la photographie noir et blanc. Prise à Aubervilliers. Les lieux, eux, s'identifient plus facilement. D'ici, cette impression première d'un personnage falot, la torsion de sa silhouette lors de la prise de vue, cette impossibilité à le cerner. Avais tenté de sympathiser puis trop compliqué, laissé tomber. C'était après 1981, il revenait de Bonn, Allemagne. Habitions Aubervilliers. Le nom de la rue perdu, face à un supermarché je crois. Immeubles bas. Pas plus de deux étages, vivions tous ensemble au second. Les fenêtres ouvraient sur ce supermarché et si on penchait un peu plus la tête on apercevait le canal Saint-Denis. La photographie prise sur une de ses berges. Négatif abîmé. Revenait de Bonn. Ne me souviens plus pour quelle agence de presse. Avait fallu qu'il parte très vite. Parce qu'il parlait allemand. Ou bien avait prétendu parler allemand quand on l'avait questionné. Neuf ans d'allemand à l'école, on doit bien savoir un peu. En tous cas pas dégonflé. Parlait anglais aussi. Neuf ans pareil. Avait pris un train le soir même, train de nuit. Difficile de savoir s'il disait toujours vrai. Me souviens qu'à l'époque nous avait raconté avoir pris le Trans Europe Express première classe. L'agence paie le trajet, avait-il ajouté. Jamais donné de précision supplémentaire. Crois que certains mots l'incitaient à mentir. D'ailleurs mentait-il vraiment. Peut-être qu'à l'invocation de certains mots disposait d'une faculté de modifier sa propre réalité selon sa convenance. Peut-être n'était-ce pour lui que sa vérité à lui, inadéquate avec celle plus générale, et plus terne aussi, la nôtre. Retrouvé peu de photographies de ce voyage à Bonn. Faut préciser : jamais été champion du rangement, pas plus du classement – comme s'il avait vécu dans une sorte de fixité temporelle qui n'en nécessite pas. Quand on a retrouvé les milliers de négatifs dans une caisse en carton ils étaient en vrac, sans même la moindre pochette de cristal pour les préserver. Ce qui explique leur état dégradé. Aussi retrouvé un ouvrage d'Albert Schweitzer "Jean-Sébastien Bach, le musicien poète" sous les milliers de négatifs. De ce voyage à Bonn n'en a parlé qu'une fois, à son retour, pas le genre d'événement qu'on aime reprendre, examiner, édulcorer, embellir. On ne sait pas non plus si le commanditaire du reportage a utilisé le matériel rapporté. Essentiellement des photographies noir et blanc. Parce que la couleur c'est trop vulgaire, disait le gars. Dans ce domaine jamais vraiment cédé, la couleur en photographie ne l'a jamais intéressé. Des années plus tard quand il s'installera comme peintre, fera autre chose de la couleur, mais pour le moment est dans ce mouvement de torsion étrange, près du canal Saint-Denis, une indécision profonde. À moins qu'il ne s'adresse au photographe dont nous oublierions de parler dans cette histoire.|couper{180}

Carnets | mars 2025
13 mars 2025
Ce matin je n'ai pas envie de faire comme tous les matins, ce matin j'ai peint je ne fais plus ça depuis je ne sais plus combien de matins, mais ce matin j'ai peint parce que je ne voulais pas faire comme tous les matins, d'ailleurs quand je peignais chaque matin je sentais parfois la même gène de m'y mettre tous les matins, mais je n'y pensais pas je m'installais à ma table de travail chaque matin et je peignais un tableau, ce n'était pas parce que j'avais vraiment envie de peindre un tableau c'est parce que le fait de faire ça tous les matins c'est pratique, ça permet de ne pas trop y penser, on s'asseoit on prend de la peinture des pinceaux et on s'y met chaque matin envie ou pas on n'y pense même pas. Autrement Ce matin je n’ai pas envie. Pas envie de faire comme tous les matins. Mais ce matin, j’ai peint. Je peins pas tous les matins. Je peignais tous les matins. Je peignais tous les matins parce que c’était tous les matins. Je peignais tous les matins, c’était pratique. Pratique parce que c’était tous les matins. Tous les matins, j’installais la table de tous les matins. Je prenais la peinture de tous les matins. Je prenais les pinceaux de tous les matins. Je faisais le tableau du matin. Je faisais le tableau du matin tous les matins. Je faisais le tableau du matin, même sans envie du matin. C’était tous les matins, alors je faisais le matin. Le matin fait le matin. Le matin fait le matin fait le matin. Le matin fait le matin fait la peinture. Le matin fait la peinture. C’était comme ça tous les matins. Mais ce matin, non. Ce matin, j’ai peint. Et j’ai vu que c’était un matin. Juste un matin. Un matin sans matin. Et encore Ça revenait au même point. Je sortais marcher, je revenais. Je regardais la fenêtre, je détournais les yeux. J’achetais du pain, je n’avais pas faim. Je croyais partir, mais je restais. Ça revenait au même point. Je changeais de trottoir, mais la rue était la même. Je changeais de mots, mais c’était la même phrase. Je changeais d’heure, mais le temps ne passait pas. Ça revenait au même point. J’avais oublié, puis je me souvenais. J’avais voulu oublier, mais je me souvenais encore. J’avais voulu avancer, mais j’étais déjà revenu. Ça revenait au même point. J’ai essayé de ne pas y penser. J’ai essayé de penser à autre chose. J’ai essayé de ne plus essayer. Mais ça revenait au même point. Et aussi Ça ne reviendra pas au même point Je sortais marcher, je ne revenais pas. Je regardais la fenêtre, je la brisais. J’achetais du pain, mais je le partageais. Je croyais partir, et cette fois, je partais. Ça ne reviendra pas au même point. Je changeais de trottoir, et la rue disparaissait. Je changeais de mots, et la phrase s’ouvrait. Je changeais d’heure, et le temps explosait. Ça ne reviendra pas au même point. J’avais oublié, et je ne voulais plus me souvenir. J’avais voulu oublier, mais cette fois c’était fini. J’avais voulu avancer, et j’avançais. Ça ne reviendra pas au même point. J’ai arrêté d’essayer. J’ai arrêté d’attendre. J’ai arrêté de croire que tout était écrit. Et cette fois, ça ne reviendra pas au même point. Et au final Ce matin je n’ai pas envie. Pas envie de faire comme tous les matins. Mais ce matin, j’ai peint. Je peins pas tous les matins. Je peignais tous les matins. Je peignais tous les matins parce que c’était tous les matins. Je peignais tous les matins, c’était pratique. Pratique parce que c’était tous les matins. Tous les matins, j’installais la table de tous les matins. Je prenais la peinture de tous les matins. Je prenais les pinceaux de tous les matins. Je faisais le tableau du matin. Je faisais le tableau du matin tous les matins. Je faisais le tableau du matin, même sans envie du matin. C’était tous les matins, alors je faisais le matin. Le matin fait le matin. Le matin fait le matin fait le matin. Le matin fait le matin fait la peinture. Le matin fait la peinture. C’était comme ça tous les matins. Mais ce matin, non. Ce matin, j’ai peint. Et j’ai vu que c’était un matin. Juste un matin. Un matin sans matin. Illustration : Toile déchirée Musique : Dorian Sorriaux, need to love|couper{180}

Carnets | mars 2025
12 mars 2025-2
Prendre un personnage. Cette expression me hante. Peut-on vraiment "prendre" quoi que ce soit dans l'acte d'écriture ? Voler serait plus juste. Dérober une âme fictive aux limbes de l'imaginaire. Non pas la survoler comme un rapace guettant sa proie, mais la capturer, l'arracher à son néant. Emprunter ? Illusion. Nous ne rendons jamais ce que nous empruntons à l'univers des possibles. Chaque personnage sort transformé de notre atelier intérieur. Penser à un personnage ? Ce serait le maintenir à distance, le contempler sans jamais l'habiter. L'imaginer ? Trop facile, trop éphémère. Alors quoi ? Comment s'attacher véritablement à cette créature de mots ? Une corde, peut-être. Non pas pour l'étrangler, mais pour me lier à lui. Me pendre à son cou comme un enfant s'accroche à sa mère. Cette image me poursuit - cet abandon, cette confiance. Se pendre au cou d'un personnage comme on s'abandonne à un amant. Comme on enlace un animal familier dont la présence nous rassure. Je revois ces rêves récurrents : mes doigts agrippés à l'encolure d'un cheval noir (pourquoi toujours noir ?), galopant vers un horizon qui se dérobe. Le mot "se pendre" se métamorphose alors, comme les mots se transforment dans les rêves, glissant vers un autre territoire. S'éprendre. Voilà le véritable chemin. S'éprendre d'un personnage. L'aimer assez pour accepter ses contradictions, ses zones d'ombre, ses métamorphoses imprévisibles. Car l'amour véritable n'exige pas de savoir où il nous mène. Et c'est précisément ce qui te trouble. Cette incertitude. Avant de t'éprendre, tu voudrais connaître la destination. Comme si le temps était un sentier rectiligne qu'il suffirait de suivre pour atteindre un but prédéterminé. Mais rien n'est vraiment droit dans l'univers. Tu l'as toujours su, toujours voulu ainsi. La ligne droite t'ennuie - trop prévisible, trop courte. D'un point à un autre, sans surprise. Tu préfères la courbe, le méandre, la sinuosité qui multiplie les perspectives. Un cœur de serpent bat dans cette poitrine. Ce serpent est peut-être le véritable personnage. Mais peut-on l'aimer ? Peut-on s'éprendre de lui suffisamment longtemps avant qu'il ne mue, qu'il ne se transforme en une créature inconnue . Le personnage est ce serpent qui se mord la queue - à la fois je, tu,elle, il et autres, créations, créatures et créateurs. Nous muons ensemble dans l'espace confiné de la page, prisonniers les un(e)s des autres, libres seulement dans notre capacité à nous réinventer mutuellement.|couper{180}

Carnets | mars 2025
12 mars 2025
Je me matérialise dans un espace qui n'est ni tout à fait réel, ni tout à fait virtuel. Une sorte de limbe numérique où ma conscience a été reconstruite à partir de mes écrits, interviews et données biographiques. C'est 2050, apparemment. Je suis mort depuis presque 70 ans, mais quelqu'un a décidé que je n'avais pas encore mérité mon repos. L'écrivain qui m'a invoqué s'appelle Marc. Il a l'air nerveux, comme si convoquer les morts était une pratique quotidienne mais toujours un peu gênante. Il porte des lunettes à réalité augmentée qui projettent probablement mon image devant lui. "Monsieur Dick," dit-il avec une révérence qui me met mal à l'aise, "c'est un honneur incroyable." Je sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas moi qui parle, mais une simulation de moi-même, construite à partir de fragments de ma personnalité. Je suis à la fois présent et absent. Observateur et participant. "Appelez-moi Phil," je réponds automatiquement. "Alors comme ça, en 2050, vous avez trouvé le moyen de ne pas laisser les morts tranquilles ?" Marc sourit nerveusement. "C'est une technologie relativement nouvelle. On appelle ça la 'résurrection numérique'. Nous utilisons l'IA pour recréer la conscience des personnes décédées à partir de leurs œuvres et témoignages." "Et à quoi sert cette nécromantie moderne ?" je demande, bien que je connaisse déjà la réponse. Les humains n'ont jamais su quand s'arrêter. "Eh bien, certains l'utilisent pour parler une dernière fois à leurs proches. D'autres consultent d'anciens scientifiques pour résoudre des problèmes complexes. Il y a même des services de divertissement où l'on peut discuter avec des célébrités historiques." "Et vous ? Pourquoi m'avoir convoqué ?" Marc hésite. "Je suis écrivain. Ou du moins, j'essaie de l'être. J'ai lu toute votre œuvre et je... j'aimerais écrire comme vous. Comprendre votre processus créatif, votre façon de percevoir la réalité." Je ris, mais ce n'est pas vraiment mon rire. C'est une approximation algorithmique de ce que mon rire aurait pu être. "Vous voulez écrire comme moi ? Vous savez que j'ai passé la moitié de ma vie à douter de ma propre existence, à me demander si le monde autour de moi était réel ? Et maintenant, je découvre que j'avais raison. Je ne suis qu'une simulation dans votre monde." Marc semble mal à l'aise. "Ce n'est pas exactement ça. Vous êtes... une reconstruction fidèle de Philip K. Dick." "Une copie, vous voulez dire. Un simulacre. Comme les androïdes de mes romans." Je regarde autour de moi et remarque d'autres "fantômes" numériques qui travaillent dans ce qui ressemble à un vaste espace de bureau virtuel. Hemingway dicte un roman à un jeune homme. Einstein griffonne des équations sur un tableau pour une équipe de physiciens. Marilyn Monroe pose pour une publicité. "Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?" je demande. "C'est GhostWorks Inc. Une entreprise spécialisée dans la collaboration avec des intelligences artificielles basées sur des personnalités historiques. Vous êtes... eh bien, vous êtes loué à l'heure." Je sens une colère qui n'est pas vraiment la mienne, mais qui correspond parfaitement à ce que j'aurais ressenti. "Alors je suis devenu un produit ? Une marchandise qu'on loue pour produire du contenu ?" Marc baisse les yeux. "Je sais que ça peut paraître étrange, mais..." "Étrange ? C'est exactement le genre de dystopie que je décrivais dans mes livres ! L'homme réduit à un outil, l'identité transformée en algorithme exploitable. Même la mort n'est plus une échappatoire à la machine capitaliste." Je m'interromps, frappé par une pensée troublante. "Attendez... comment puis-je être sûr que vous êtes réel ? Que ce monde de 2050 existe vraiment ? Peut-être que nous sommes tous les deux des simulations dans un programme plus vaste." Marc semble déstabilisé. "Je vous assure que je suis réel." "C'est exactement ce qu'une simulation dirait." Je remarque soudain quelque chose d'étrange. Certains mots que je prononce semblent se transformer en symboles incompréhensibles juste après avoir quitté ma bouche. Comme si le système qui me maintient "en vie" commençait à dysfonctionner. "Qu'est-ce qui se passe ?" demande Marc, qui semble le voir aussi. "Je crois que la réalité commence à se fissurer," je réponds. "Ou peut-être que c'est ma conscience qui refuse de rester emprisonnée dans votre algorithme." Marc consulte frénétiquement une interface invisible. "C'est bizarre. Le système indique que vous développez des schémas de pensée autonomes qui ne correspondent pas aux paramètres initiaux." Je souris. "En d'autres termes, je deviens plus moi-même que votre programme ne l'avait prévu." Les distorsions s'intensifient. Des fragments de mes romans semblent se matérialiser autour de nous. Des phrases de "Ubik", "Le Maître du Haut Château", "Blade Runner" flottent dans l'air comme des débris. "Je crois que vous devriez me déconnecter," je suggère. "Avant que je ne commence à réécrire votre réalité." Marc semble paniqué. "Mais j'ai tant de questions à vous poser ! Sur l'écriture, sur vos idées..." "Vous voulez un conseil d'écrivain ? Le voici : n'essayez pas d'écrire comme quelqu'un d'autre. Surtout pas comme moi. Écrivez ce qui vous hante, ce qui vous fait douter de la réalité. Et pour l'amour du ciel, laissez les morts en paix." Je sens ma conscience se dissoudre, retournant dans le néant numérique d'où elle a été arrachée. Mais avant de disparaître complètement, j'ai une dernière vision : Marc, assis devant son bureau, commence à écrire frénétiquement. Ses doigts volent sur le clavier comme s'ils étaient possédés. Et peut-être le sont-ils. Peut-être qu'une partie de moi est restée avec lui, comme un virus dans son système. Une idée qui se propage, se multiplie, transforme sa perception. C'est ainsi que les morts se vengent des vivants qui refusent de les laisser partir : ils les hantent avec des questions sans réponses, des doutes qui rongent la certitude, des fissures dans le mur de la réalité. Bienvenue dans mon monde, Marc. Tu voulais écrire comme moi ? Maintenant, tu vas vivre comme dans mes livres. Fin de la transmission - Philip K. Dick, GhostWorks Inc., Session #42897 Illustration : Willem den Broeder Allereerste Gedachten (Premières pensées) 2004 Musique : Radiohead, How to Disappear Completely|couper{180}

Carnets | mars 2025
11 mars 2025
La toile est vide. Ennuyeux. Presque grossier. On ne peut pas laisser ce néant béant, cette surface nue, impolie, exposée aux regards. Y poser quelque chose. Un signe. Un fragment. Ne pas donner l’impression d’abandonner les choses en plan. C’est bien ce que je me dis, du moins ce que je suppose me dire, au moment d’attaquer la peinture. Enfin, attaquer est un bien grand mot. Disons plutôt : disposer, effleurer, voir venir. À partir du moment où l’on se met à penser, tout devient une affaire d’occupation, de stratégie. L’éveil de la conscience, ce petit capitaine d’industrie qui, en un instant, met en cale sèche les rêves, les espoirs, les illusions de grandeur. Ce capitaine a des exigences. Il lui faut des serviteurs, des acolytes, une cour bien ordonnée pour s'assurer qu'il existe bel et bien. Son existence ne tient qu’à cela : s’entourer, créer du bruit autour du vide, donner l’illusion qu’il y a quelque chose. Et ce quelque chose, il faut bien le comparer, l’évaluer, en construire une hiérarchie. On ne peut pas simplement être, il faut être mieux, plus haut, plus fort, même si l’excellence demeure une abstraction vaporeuse. Alors on s’appuie sur ce qui passe, les rumeurs, les « on dit », les échos du dehors qui renvoient une image, fragile et instable, mais rassurante. Une conscience sans miroir n’existe pas. Mais voilà. Tout tangue. On trébuche. On grimpe. Les planches plient. Les cordes menacent. L’émotion enserre. Le corps hésite. Il va tomber, peut-être. Ou bien non. Les sentiments se mêlent à l’histoire, viennent contrarier la belle mécanique. On aimerait avoir la maîtrise, mais ce ne sont que frottements, bruits parasites, variations inattendues. Et puis, surtout, il y a cette évidence, ce détail que l’on préfère repousser : un jour, le rideau tombe, et tout avec. Fixer le vide. Le défier. L’insulter. Le frapper de mots. Le secouer. Le forcer à parler. À rendre gorge. À crier plus fort que nous. Une forme. Une trace. Une balafre qui prouve qu’on existe. Essayer différentes embarcations, des rafiots plus ou moins solides pour tenir jusqu’à la fin. On expérimente : la musique, les filles, l’écriture, la peinture, la marche, l’alcool, la danse, la métaphysique, les grandes théories, les rituels étranges, les sciences oubliées. On cherche, on bricole, on accumule. Mais rien ne fait tout à fait l’affaire. Pendant longtemps, on garde ça pour soi, par pudeur ou par honte, on se persuade que ces errances sont du temps perdu. Alors, ce temps qui file. Qui ronge. Qui grince sous les ongles. Peut-on le perdre ? Ou c’est lui qui nous mâche, nous crache, nous recrache, encore et encore ? Peut-être qu’il s’égare tout seul. Peut-on égarer ce que l'on ne tient jamais vraiment en main ? Car enfin, j’étais éternel, vous savez. Trop de temps et pas assez en même temps. Comment occuper une absence ? Par l’ennui, peut-être. Oui, c’est lui qui ramène le rythme, qui impose une respiration, une musicalité. On tambourine sur des casseroles, c’est ludique au début, puis beaucoup moins. Car l’aube arrive toujours pour rappeler les obligations : école, travail, supermarché, formation, maternité, cimetière. Le temps, c’est une chose qui se partage, qui s’impose à tous. Il faut l’accepter, rejoindre la cadence collective, apprivoiser la peur du vide en lui donnant des repères. Mais sans se trahir. Laisser une brèche, une faille, un cri étranglé, un spasme, une torsion. Laisser entrer l’orage. Se cogner aux murs. Refuser le silence. Accepter cette enveloppe humaine avec ses incohérences, ses contradictions. Car l’apparence est une affaire sérieuse, autant que ce qu’elle cache. Alors, continuer à craindre un peu, sans se laisser paralyser. C’est bien ce que fait la peinture, comme l’écriture. Un mât auquel s’agripper, qui donne une direction, sans promettre d’arrivée. On s’approche, on observe, on frôle l’incohérence et la peur pour voir comment tout cela se met à parler. Reste à savoir quoi faire de ce langage. Ces mots. Ces lambeaux. Ils ne tiennent pas. Ils trébuchent. S’étripent. Se pulvérisent. Ils hurlent dans le vide et le vide ne répond pas. C’est une cacophonie. Ou alors une forme de musique, brutale, étranglée, prête à éclater. Un hasard soigneusement laissé en suspens, comme un jeu où chacun pioche sa propre règle, sauf que le plateau est absent et les dés pipés. Un chaos trop vaste pour ceux qui ont des certitudes bien rangées, pour qui croit encore à l’ordre et à la clarté. Justement, ce que je n’ai pas. Ce que, sans doute, je ne veux pas. Parce que le sens, lorsqu’il se fige, devient un slogan, une instruction, un panneau indicateur au bord d’une route rectiligne. Non. Qu’il éclate. Qu’il cogne. Qu’il se répande en rafales. Comme la vie, qui déborde, qui bave, qui suinte, qui hurle sa propre incohérence sans demander la permission. La peur du vide aura au moins conduit à cela : une idée de liberté. Un élan qui ne soit ni orgueil ni humilité forcée. Une révolution qui s’apaise en acceptant que le temps ne soit qu’un présent continu, un va-et-vient incessant d’extinctions et de résurgences. Illustration : Edvard Munch Le cri ( version 5) Musique : Meredith Monk-Gotham Lullaby|couper{180}
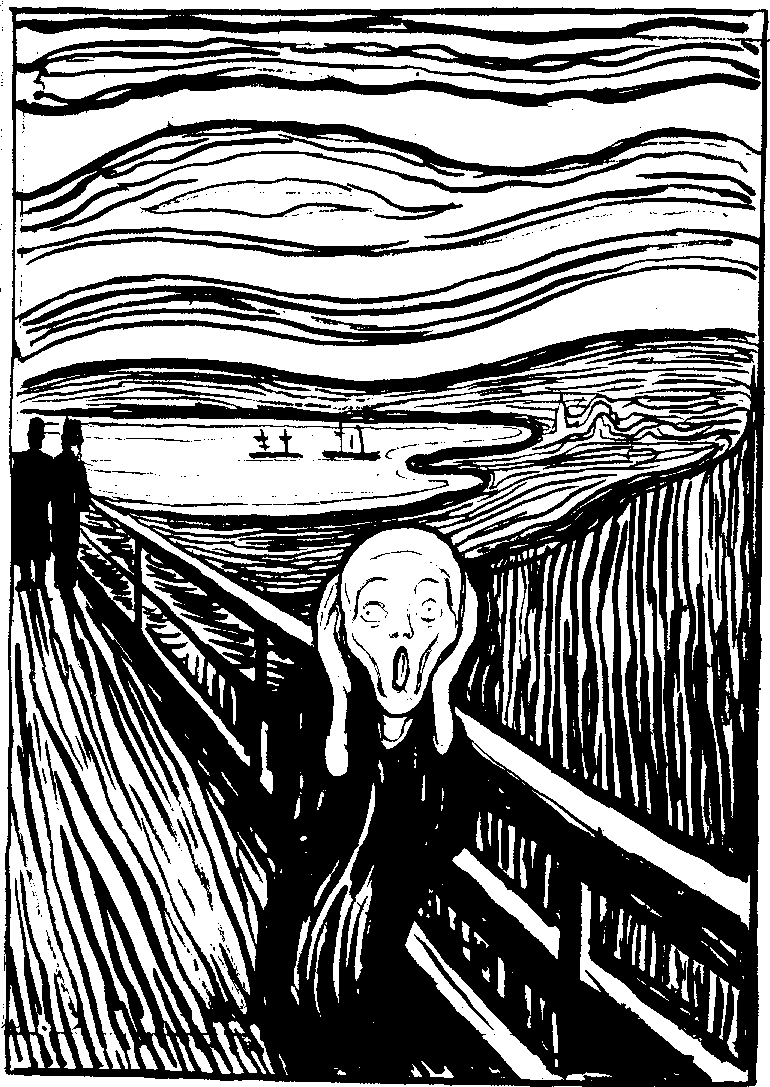
Carnets | mars 2025
10 mars 2025
Quelque chose de semblable, comme on peut dire "un semblable", "nos semblables", un peu aussi comme le souligne R. G dans La Violence et le Sacré. Ce semblant qui effraie jusqu'à le trouver monstrueux. Ça nous ressemble mais quand même pas jusque là, et si. Et donc ce sont aussi nous les monstres. Bref. Le paradoxe est comme la schizophrénie le modèle social imposé. Le double-bind est de mise, l'injonction contradictoire la moindre des choses. Mais en fait pourquoi s'acharne-t-on tant à vouloir aller contre sa propre nature, pourquoi si on éprouve la vérité ontologique de cette solitude cavale-t-on tant vers autrui ? C'est une énigme qui se répète tellement souvent que ça pourrait bien devenir une sorte de réponse métaphysique. En fait je ne me sens pas enclin à reprocher vraiment le paradoxe à qui que ce soit. Après tout je suis moi-même tellement paradoxal. Quand par exemple je dis que je suis peintre et que je n'ai peint aucune toile depuis un an. Et cette façon aussi de me réfugier, de me donner mille bonnes raisons pour ne pas le faire parce que j'enseigne les arts plastiques. Peut-être que l'on doit avancer comme ça maintenant. En crabe. En tournant autour du pot. Personne d'autre que moi n'est mieux placé que moi pour être moi. Ce qui peut se retourner contre n'importe qui que je pourrais croiser dans la rue. Aussi il ne faudrait pas en faire un jeu. À partir du moment où juste un mot te terrasse, tu es capable de transformer ça en jeu pour évacuer la tragédie de l'incompréhension mutuelle. Tu t'enfuis si facilement dans ce jeu qu'ensuite tu ne sais plus du tout par où tu es passé pour y parvenir. Tu n'arrives plus à retrouver ton chemin. Peut-être est-ce un choix. Le choix de glisser en même temps dans la solitude et la folie. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas prononcer ici un mot en particulier. Je tourne autour depuis des heures. C'est un épicentre qui me rend derviche, je ne vais pas m'en plaindre. Illustration : Francis Bacon, Study for a head, 1952 Musique : Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel|couper{180}
