décembre 2024
Carnets | décembre 2024
16 décembre 2024
Bien des minutes plus tard, alors que j'étais sur le point de disparaître dans cette nouvelle journée, je me suis souvenu que je n'avais rien écrit sur la journée d'hier. Ce serait alors une journée perdue, une journée pour rien, une journée comme tant d'autres que, pour rien au monde, je n'aimerais revivre. Pourtant, tout avait commencé par l'arrivée d'un camion devant le portail de notre maison. C'était la livraison de bois, cette cargaison qui devait nous permettre de passer l'hiver. Le camion effectuait sa manœuvre pour déverser les rondins dans la cour, et moi, pendant ce temps, je comptais mentalement le nombre de cheminées dans la maison. Je les énumérais une à une, comme si le simple fait d'établir cette liste pouvait m'occuper l'esprit et m'empêcher de voir la montagne de travail qui m'attendait. En un clin d'œil, le souvenir de ces foyers m'a fait traverser les deux étages et toutes les pièces de la maison. Puis, tout à coup, il y avait de nouveau ce tas monumental dans la cour. Le chauffeur a refermé les grilles derrière lui, et j'ai vu le camion repartir vers la scierie de La Grave, laissant derrière lui ce monticule de bois, un silence ensuite comme un défi. À cette époque, j'avais environ sept ans. J'avais déjà cette manie d'accorder une attention particulière aux petites choses du quotidien, mais je ne les écrivais pas encore. Elles restaient enfouies quelque part, peut-être dans mon corps. Parfois, elles remontaient vers la surface de la conscience , une sorte de capillarité le long des parois tremblantes des rêves ou des cauchemars, mais jamais sous forme de mots. Ces souvenirs, je ne le savais pas encore, finiraient par réapparaître bien des années plus tard, au détour de l'écriture. Je me souviens encore du poids de la brouette remplie de rondins. Chaque trajet jusqu'à l’appentis, au fond du jardin, était une épreuve. Il fallait empiler le bois avec soin, sur plusieurs strates, jusqu’à ce qu’il forme une muraille vertigineuse. Le bois était humide, moussu, visqueux , et nous savions qu’il deviendrait encore plus lourd si nous n’agissions pas avant les pluies. Alors, on me confiait la tâche de travailler avec cette sorte d’urgence. Il fallait soulever, déposer, rouler durant de longues minutes, puis décharger, aligner , accumuler. Sans savoir que, bien plus tard, ces efforts resteraient inscrits quelque part, non pas dans une mémoire immédiate, mais dans le corps. Des années après, je peux encore sentir les ampoules sur mes paumes, les éraflures sur mes mollets, mes genoux, la fatigue de mes bras, et l’odeur entêtante du bois humide, simplement en repensant à ces journées. Cette mission, répétée chaque fois à l'entrée de l' hiver, était une tâche banale. Pourtant, elle laissait en moi des marques plus profondes que je ne l’aurais imaginé. Aujourd'hui, je vois cela différemment. Peut-être qu’une partie de l’écriture commence là, dans cet entrepôt qu'est le corps tout entier , là où les souvenirs s’accumulent sans être conscients d'eux-mêmes. Et un jour, ils ressortent, non pas sous forme de simples réminiscences, mais transformés : en listes de doléances, en inventaires de nostalgies, ou encore en rage, rarement en joies ou satisfactions à coucher sur une page blanche. Sans doute que le peu de joies et de satisfactions qu'on en retient est aussi une sorte de moteur trompeur de l'écriture. Bien des années plus tard, et presque surpris d'avoir écrit ces quelques lignes, je me demande pourquoi ce souvenir particulier a ressurgi aujourd'hui. Désormais, je ne commande plus de bois. La maison où je vis est chauffée au gaz de ville. J’approche de mes soixante-cinq ans, et je ressens de plus en plus cette impression étrange que ma vie s’est écoulée comme un rêve. Cette idée m'obsède, le jour comme la nuit. Les années, que je pensais avoir empilées comme ces tas de bûches destinées à nous réchauffer, m’échappent. Dans mes rêves, je revois souvent ce tas de bois. Il s’effondre sous son propre poids, comme si sa hauteur vertigineuse n’avait été qu’un équilibre fragile, une illusion. Une ivresse éprouvée par le vertige en lui-même. Le temps s’écroule avec lui. Ce qui paraissait solide et continu se brise en fragments. Et ces fragments, je ne peux les relier les uns aux autres que par une sensation : celle de l’effondrement. Une chute, lente mais inéluctable, où je comprends que toutes ces années que j’ai cru accumuler en briguant une sorte de méthode, une autobiographie, un livre, n’étaient en réalité qu’un mensonge. Un tas de bois ordinaire, en apparence, mais dont la fragilité m’échappait.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
14 décembre 2024
Fatigue, résignation, silence : les gestes se répètent, les regards se vident, et le 'moins pire' devient la norme. Que reste-t-il quand tout semble perdu d’avance ? Peut-être les mots griffonnés sur un coin de table de bistrot, derniers actes de résistance face à un monde qui ne laisse plus d’espace pour rêver. Écrire, non pas pour changer l’histoire, mais pour refuser de disparaître.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
13 décembre 2024
La nuit. La peur. Les dents claquent. Froid, toujours. Un corps. Pas stable. Un souffle ? Non. Plus rien. Cage. Dedans, tambour — pas de rythme. Bruit. Bruit sourd. Peut-être le cœur. Peut-être rien. Et toi. Pas toi. Une ombre. Juste derrière. Non, pas dehors. Ni dedans. Tu hésites. Pourquoi ? Ce n’est rien. Rien que toi. Je suis toi, dit-il. Pas d’échappatoire. Regarde. Regarde ce poids. Ce corps. Tu refuses. Pourtant, il est là. Moi, toujours. Silence. Non, un rire. Cassant. Tu veux fuir ? Impossible. Ce soir. Ce corps. Et moi. Dans l’ombre. Une image. Un éclat. L’enfant. Assassiné. Meurt, meurt encore. Cri blanc. Un éclatement sourd dans l’obscurité. Ils ricanent. Coups de pied. Des gestes flous, répétés. Ils cognent. Ils déchirent. L’enfant tombe, se relève dans l’esprit, encore et encore. Un souffle. Trop faible. L’air glisse, traverse. Vide. Toi, pas là. Pas vraiment. Mais eux, si. Ils bougent. Tremblent. Leurs mains. Ces mains. Serrent. Frappent. Arrachent. Maintenant immobiles. Toi, dans le coin. Ou au centre. Peu importe. Plus de poids. Plus de place. Pourquoi ? dis-tu. D’abord doucement. Puis. Plus fort. Pourquoi moi ? Pourquoi pas vous ? Ils ne bougent pas. Ne regardent pas. Ne répondent pas. Ta main. Petite. Douce. Translucide. Elle aurait grandi. Aurait tenu des choses. Joué. Dessiné. Aimé ? Non. Rien. Seulement ce silence. Tu avances. Si près. Maintenant. Tu veux hurler. Le son. Monte. T’étouffe. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Rien. Pas un souffle. Juste leur respiration. Ce bruit. La vie. Immonde. Et toi. Ton corps. Il colle. Pèse. Chaque pas. Une lutte. Chaque souffle. Une faille. Tu voudrais t’en débarrasser. Mais il reste. Accroché. Implacable. Pas moi, dis-tu. Pas ce soir. Pas jamais. Dire. Dire encore. Il faut mourir à en écrire. Je ne sais pas ce que j’écris. Ce n’est plus moi. Moi n’a jamais été. Ne sera plus. Le fantôme revient. Une ombre contre ton ombre. Retourne. Essaie encore. Mais l’enfant murmure. Ne pars pas, dit-il. Ils n’en valent pas la peine. Regarde. Ils tremblent. Ont déjà tout perdu. Mais toi... toi, tu peux encore. Encore quoi ? Tu ne sais pas. Pas encore. Je trace une ligne. Je veux écrire une entrée de journal. Espoir. C'est pour rire non. Je pense qu’après la ligne, je reviens. Qui revient. Dans quel état. Mon corps est assis là à la table. C’est un étranger, je ne reconnais rien de lui. On ne badine pas avec la mort, le meutre. Il faut se dépêcher. Ça part. Sort. Tout s’efface. Je ne sais plus si je veux le conserver. L’éjecter. Le perdre. Encore le perdre. Porter à bout de bras. L’amabilité. La politesse. La gentillesse. C’est pas trop lourd pour toi superman ? Regarde, t’es tout seul. Ils ont laissé tomber depuis belle lurette. Tu peux y aller. Laisse tomber. Fauve redeviens. Hurle à la mort. Un poids glisse. Ce qui reste ? Des lambeaux d’images. Une fausse lumière. Ils ont voulu faire croire que ça comptait. Être aimable, poli, gentil. Toujours poli. Toujours aimable. À quoi ça a servi ? Tu regardes tes mains. Toujours vides. Toujours tremblantes. Tu relèves la tête. Une ombre passe. Ou peut-être toi. Fauve, redeviens. Assis toi sur ton cul. Hume l'air. Il fait froid. L'air est tonique. Prononce à voix haute tout ce qui s'achève en hic : synthétique, élastique, onomastique, sac en plastique, colique néphrétique, pathétique. Le son ricoche, monte, éclate. Une rythmique absurde qui cogne les murs invisibles. Tu continues, encore et encore. Jusqu'à ce que les mots deviennent étrangeté, presque un râle, quelque chose qui n'est plus tout à fait humain. Fauve, redeviens. Sinon tu peux aussi examiner les lieux. Le périmètre de la scène de crime. Sors ta loupe, tes lorgnons, ton monocle. Penche toi sur la merde qui git étalée de tout son long sur le sol. Examine la dureté des étrons. Tâte de l'index la température de l'excrément. C'est encore tiède, ce n'est donc pas encore tout à fait mort pour de vrai. Mets ça dans un sac en plastique. Pièce à conviction. Si tu veux encore une conviction. Ce n'est pas politiquement correct. Excuse-moi. C'est pour rire, bien sûr. Quel malaise, mazette. Rire sarcastique, parallélépipédique, scolastique, empirique...|couper{180}

Carnets | décembre 2024
12 décembre 2024
Essayer de reprendre les faits les uns derrière les autres sous la forme d'une liste, d'un plan, à la façon du petit Poucet avec ses miettes de pain ou ses petits cailloux.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
10 décembre 2024
H.P. Lovecraft Retour de la permanence à Saint-Donat en écoutant des textes de H.P Lovecraft lus sur la chaine Youtube Tindalos. Plus que l'histoire en elle-même, mon attention est sur la prononciation de chaque phrase. Je me suis amusé à repéré l'accent tonique, à compter le nombre d'adverbes, d'adjectifs destinés à inspirer l'horreur. Il en résulte à la fin une sorte de gaité, de bonne humeur, une euphorie. Notamment cette histoire du Temple, cet Allemand qui reste seul dans son sous-marin après que tout son équipage a perdu la raison et c'est enfui ou noyé, sans doute les deux. Cette rigidité qui revient dans un rythme lancinant en parallèle du récit— Ma volonté allemande, mon intelligence prussienne, ma volonté teutonne, le tout primant sur le simple péquin vivant par hasard au bord du Rhin au bout d'un moment fait rire . Ce mélange d'humour, d'adverbes et d'adjectifs sensés installer la peur tout au contraire me met en joie. C'est que c'est le style justement l'important dans toute cette histoire, un style exagérément gonflé, superfétatoire, dont on ne prend pas la mesure exacte lors des lectures adolescentes de HP Lovecraft. Il faut que je note sur nom J. B, cette peintre qui vit à Bourg de Péage et qui est restée un long moment à me montrer ses tableaux sur son smartphone. J'ai eu peur au début, elle parlait de Notre Dame, que Notre Dame l'avait inspirée. Qu'elle avait commencé à peindre cette série de tableaux ( 12 ) depuis l'incendie de Notre Dame. Heureusement dans ces cas là on attend que ça passe poliment, que ça s'arrète tout seul si on ne relance pas. Et puis je ne sais pas est-ce que l'on se présente aux gens en disant dans les années 77 j'ai beaucoup vendu, c'est tout à fait grossier, c'est même carrément vulgaire. Puis j'apprends qu'elle a traversé toute une cohorte de malheurs, je m'attendris, je compatis. Je n'irais pas mettre un cierge pour autant. Lui ai laissé mon adresse mail au cas ou elle veuille m'inviter à son exposition prochaine. Une demie- heure après mon arrivée à la maison coup de fil de S. qui me hurle dans l'oreille qu'elle est perdue que son GPS ne marche pas qu'elle ne sait pas où elle est. Qu'est-ce que j'y peux ? je monte voir la carte sur l'ordinateur Eysin Pinet tu as le choix entre revenir en arrière vers Pont l'Eveque, ensuite Vienne ou bien te diriger vers cours et Buis et il y aura une route sur ta droite directe pour Vienne. Elle me hurle à nouveau dans l'oreille Je suis perdue , je suis perdue. J'en ai marre —qu'est-ce que j'y peux ? ... on raccroche . Elle me rappelle je suis perdue j'en ai marre etc. Calme toi tu conduis. Je répète. On raccroche encore. Du coup suis énervé aussi maintenant Je suis redescendu pour aller visiter le frigo. Pas grand chose. Je vais faire des pâtes. Il reste un peu de fromage rapé et du beurre. Tout va bien. Je me demande ce que ça pourrait donner si je racontais ça dans le style de Lovecraft. Et tiens bizarre, pas beaucoup de personnages féminins dans ses histoires maintenant que j'y pense.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
09 décembre 2024
« Il ne faut pas avoir honte de se souvenir qu'on a été un « crevard », un squelette, qu'on a couru dans tous les sens et qu'on a fouillé dans les fosses à ordures [...]. Les prisonniers étaient des ennemis imaginaires et inventés avec lesquels le gouvernement réglait ses comptes comme avec de véritables ennemis qu'il fusillait, tuait et faisait mourir de faim. La faux mortelle de Staline fauchait tout le monde sans distinction, en nivelant selon des répartitions, des listes et un plan à réaliser. Il y avait le même pourcentage de vauriens et de lâches parmi les hommes qui ont péri au camp qu'au sein des gens en liberté. Tous étaient des gens pris au hasard parmi les indifférents, les lâches, les bourgeois et même les bourreaux. Et ils sont devenus des victimes par hasard. » — Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 1978 Il écrit aussi comme la prison l'a aidé pour écrire. Ou peut-être ce que l'on attend comme prétexte pour écrire. Il est tout à fait possible également— toute proportion gardée — que je comprenne désormais bien mieux la notion de prétexte pour faire ceci ou cela. Ou plutôt ne pas le faire. La jeunesse a besoin de prétexte, comme la violence. Mais le prétexte n'a jamais été vraiment une raison, même pas une excuse. Repense encore une fois à tout ça, en écoutant cette émission sur Chamalov ( France Culture) sur la route de Saint-Donat à ces années passées d'une chambre d'hôtel à une autre, à l'indigence volontaire dans laquelle je me suis obligé de vivre sous prétexte que l'art, la peinture, l'écriture exigeait que l'on assassine ce qui nous est le plus cher pour récupérer des boyaux, fabriquer des cordes de violon. D'où l'expression joue moi un p'tit air de violon, aller. Une prétention à l'exacte mesure du total manque de confiance en soi. Qu'aurais-je supporté encore pour avoir ne serait-ce que le droit d'écrire une seule ligne sans m'en rendre malade, je n'en ai jamais eu le droit alors je l'ai pris voilà tout. Avec l'effroyable suite de conséquences que l'acte d'écrire provoque. Ecrire c'est provoquer, je suis toujours parti de ce principe, rien ne dit qu'il soit bon ou nécessaire voire utile. C'est comme pisser dans un violon parfois aussi. Il fait si froid. Nous avons mis en route les chauffages mais la surface est si grande et ce ne sont que des grille-pains. Le Palais Delphinal n'a rien à voir avec Sevvostlag un des plus grands réseaux de camps de la région de la Kolyma, où Chalamov a été transféré en 1937. J'ai récupéré "récits de la Kolyma" que je parcours durant cette journée de permanence, j'ai même eu le temps de réorganiser un peu mes notes pour rédiger un billet dans la rubrique "lectures". Autre idée qui me vient : écrire un article plus spécifique sur la poétique du froid chez Chalamov. À la Kolyma, le froid est omniprésent, inévitable. Il n’est pas un simple élément du décor, mais un véritable protagoniste qui détermine les actes et les pensées des prisonniers. Dans un passage saisissant, Chalamov écrit : « Le froid était une force universelle, indifférente à la volonté humaine. Il tuait, il brisait, il gouvernait. » Ce froid n’a pas de visage, mais il est doté d’une volonté propre. Il réduit l’homme à un état de survie, rappelant que la nature, dans sa neutralité absolue, est souvent plus implacable que la cruauté humaine. Pour les prisonniers, le froid est le premier et le dernier ennemi, celui contre lequel aucune lutte n’est vraiment possible. Le froid, chez Chalamov, n’est pas seulement une température, mais une métaphore du dépouillement. Tout se réduit à l’essentiel : l’homme perd ses illusions, ses ambitions, ses croyances. Le froid efface les détails superflus pour ne laisser qu’une réalité brute. Dans ce cadre, les mots de Chalamov sont eux-mêmes taillés dans une langue glaciale et précise. Pas de place pour les fioritures ou les ornements. Il écrit : « Le froid nous apprenait l’économie de tout—des gestes, des mots, des pensées. Une sorte de silence gagnait même nos esprits. » Dans cette poétique du froid, l’écriture elle-même reflète cette économie. Chaque phrase semble gelée dans sa perfection austère, comme si la survie de l’idée dépendait de la précision du mot choisi. Dans cet environnement polaire, l’homme devient pierre. Chalamov décrit cette lente transformation, où le corps se durcit, où les émotions s’éteignent. Le froid agit comme une machine à effacer, réduisant l’être à un simple organisme luttant contre l’entropie. Dans l’un de ses passages les plus frappants, il écrit : « La neige recouvrait tout. Les corps, les chemins, les souvenirs. Nous devenions nous-mêmes de la neige, quelque chose qui pouvait disparaître sans laisser de trace. » Cet effacement n’est pas seulement physique. La personnalité, les liens sociaux, même le langage se dissolvent sous la pression du froid. L’homme, dans la poétique de Chalamov, devient un fragment anonyme du paysage. Mais Chalamov ne se contente pas de décrire le froid comme une force oppressive. Il le transforme en une épreuve métaphysique, un test ultime pour l’esprit et le corps. Face au froid, les prisonniers sont confrontés à des questions fondamentales : qu’est-ce que vivre ? Qu’est-ce que l’humain ? Dans un passage clé, il observe : « Nous n’étions pas des héros. Le froid décide pour nous. Il montre que l’esprit n’est pas plus fort que le corps. Que ce sont toujours les instincts qui gagnent. » Ce constat pourrait sembler nihiliste, mais il contient une forme d’éloge paradoxal de la condition humaine. Même réduit à l’essentiel, même confronté à sa propre annihilation, l’homme endure. Cette résilience passive devient une forme d’éthique, un humanisme minimaliste ancré dans la survie elle-même. Une esthétique du vide Le paysage polaire de la Kolyma n’est jamais décrit comme spectaculaire ou sublime. Chalamov rejette tout exotisme. Pourtant, dans cette austérité, une beauté paradoxale émerge. Le vide, la blancheur, le silence deviennent des éléments esthétiques à part entière. Il écrit : « Dans ce monde où il n’y avait rien, nous découvrions que ce rien avait un poids. Le vide nous entourait, mais il était vivant, il était palpable. » Cette esthétique du vide reflète l’état d’âme des prisonniers, pris entre la mort et la survie, entre l’épuisement et une sorte de transcendance inconsciente. En milieu d'après-midi le visage jaune part pour Romans, c'est la soeur de O. qui l'achète, l'opération a duré même pas cinq minutes. Encore une fois ne jamais se faire d'idée sur les lieux, le public qui visite les expositions, sur l'issue bonne ou mauvaise de celles-ci. Aperçu une nouvelle proposition d'écriture passer mais j'étais si profondément installé dans le bouquin de Chalamov et la rédaction de mes notes que je ne l'ai pas encore regardée en détail. Si encore nuit d'insomnie la quatrième à la suite cette semaine , j'aurai le temps certainement.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
08 décembre 2024
Il n'est d'aucun côté, il surgit de nulle part, sans crier gare.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
07 décembre 2024
Il y a un hiatus, entre ce que j'éprouve face au réel et ce que je suis en mesure, ou non, d'en dire. Quand je veux en dire quelque chose c'est rarement ce que je veux dire qui est dit. Cela peut s'en approcher. Je peux avoir l'impression d'avoir dit quelque chose qui colle à la réalité. Puis quand je relis ensuite non, pas du tout. C'est un oignon avec de nombreuses peaux, et parfois il n'y a même pas de germe.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
06 décembre 2024
https://youtu.be/s0CUdAG6px4?si=-IwYS_9aklapU60a L’intérêt. Que dis-je, le plaisir. L’étonnement qu’apporte avec lui ce plaisir. Ou peut-être le contraire. Celui d’entendre le mot flèche. Puis marcher, avec ce léger doute, vers la cible. Est-ce un neuf, un dix ? Sans lunettes, je n’y vois rien. À cheval sur la ligne, le doute subsiste. On attend l’arbitre. C’est donc un neuf. Un neuf prometteur, qui manque de peu d’être un dix. Un œuf, presque. Un œuf vaut ici mieux qu’un dix. Respire. Puis vient l’acte suivant : empoigner le corps de carbone, extraire la flèche d’un coup sec, d’abord du blason, puis plus profondément encore, de la paille. Retourner enfin sur le pas de tir. Observer les autres. Le tir à l’arc développe une attention particulière : non pas en force, mais en ou par patience. Patience et humilité. Si toutefois on parvient à se rapprocher de cette idée d’humilité jamais atteinte. Être attentif à chaque geste, le décomposer, le répéter. Épauler, lever, viser, relâcher. À force – non justement, inutile la force – le geste s’affine, s’inscrit dans le corps. Et ainsi que je le devinais déjà enfant, le véritable défi n’est pas tant de "mettre dans le mille" (le fameux dix) que de pouvoir répéter, à l’infini, le même enchaînement de mouvements. S’y essayer, joyeuse contrainte. À la virgule près. Toujours à la virgule près. "Mais tu peux briguer le dix tout de même", me dit l’entraîneur, qui pense compétition. Et là, un souvenir s’impose : le "dix", c’est aussi la note que l’on donne à l’école. La meilleure note d’une échelle de 0 à 10. À l’époque déjà, je humais, reniflais, aspirais, espérais que viser toujours la perfection posait la question de cette perfection elle-même. (C’était forcément très intuitif.) Elle me paraissait à la fois louche et idéale. Bref, je me méfiais des dix avant qu’ils ne deviennent des vingt. Un œuf vaut mieux qu’un dix. Au grand regret de mes parents. Pourquoi, soudain, parler de Maïakovski ? Pour ne pas oublier de me souvenir de Lili Brik, sa muse inséparable, sœur d’Elsa Triolet. Peut-être aussi pour tisser, sans trop m’y attarder, un lien avec mes pensées récentes sur Aragon. Maïakovski me ramène à une tension essentielle : celle d’une poésie qui brûle tout sur son passage, une poésie amoureuse et explosive, souvent brisée. Et pourtant, tout en contraste, je me demande encore si cette intensité brûlante a quelque chose à voir avec l’humilité dont je parlais plus haut. J’ai eu moins peur de dire je en écrivant en lisant Maïakovski. Le je, c’est-à-dire ce narcissisme paradoxal qui devient un outil pour lutter contre le maelstrom qu’impose le travail de la langue : son chaos, son autorité. Je pense alors à Montaigne. À son je qui s’installe tranquillement, presque en souriant, face à des cadres de pensée imposants, face à des langages figés. Un je qui s’étonne, qui tâtonne, et qui explore – ce même je que j’ai peut-être reconnu en lisant Maïakovski. Quant à Khlebnikov ? Lui, c’est autre chose. Je l’invoque à cause du bruit imaginaire d’une flèche qui part : zaoum. Ce mot qui n’est pas un mot, cette langue au-delà ou en deçà, un trait, une lettre qui traverse l’air, dépourvu de sens immédiat, seulement chargé de vibrations. Un son de flèche, purement inventé, mais tellement réel qu’on pourrait presque l’entendre. Une flèche zaoum. Aucun rapport avec la lecture de Maïakovski ou de Khlebnikov, ai-je dit. Et pourtant, une intuition : écrire, comme tirer à l’arc, relève d’une succession de mouvements. Mais ici, sous une surface : la feuille, peut-être. Ou une autre, plus abstraite. Dans tous les sens du terme, un enchaînement : des gestes précis, un effort millimétré. Ou encore une bonne grosse pierre attachée à la cheville (ouvrière) pour être certain de rester immergé, de ne pas céder à la tentation de remonter trop vite à la surface. Mouvement. Quelle sorte de mouvement, exactement ? Dans l’expérience du tir à l’arc, je crois saisir – à peu près. Écrire, en revanche, reste une autre affaire. C’est là, sur le bout de la langue. Impossible de dire précisément de quoi il s’agit. Peut-être d’une envie : briser quelque chose à grand cri. C’est souvent trop ridicule. Et justement parce que c’est ridicule, j’en crève d’envie. Hier, j’ai appris, par un compte Bluesky que je viens tout juste de créer, la mort de Jacques Roubaud. Il m’a accompagné, plusieurs fois l’été dernier, sur l’itinéraire qui mène au marché de Roussillon. J’enfilais mes écouteurs, et il me parlait : des noms des rues parisiennes, de la manière d’écrire plusieurs autobiographies en une seule. Même en remplissant mon cabas de pommes de terre et d’oignons, même en recevant la monnaie, je ne lâchais pas un mot de peur d’en perdre l’essentiel. Mais quel essentiel ? Peut-être rien d’autre que sa voix : calme, apaisante, drôle. Et, au bout du compte, amicale. C’est bien cela, le mot : amicale. Ça fait de la peine, parce qu’on se sent un peu plus seul. Cette présence se dissipe dans l’absence, devient un autre genre de présence, qui nous renvoie à notre propre absence. C’est à chaque fois pareil. Ça fait de la peine et, en même temps, on espère. Une sorte de soulagement, un dénouement. Ce que je retiens ? La répétition. Au tir à l’arc. Dans l’écriture. Dans le fait aussi de voir partir ces présences, de voir tout se métamorphoser en quelque chose qui n’est pas non plus rien. Dans cette mémoire de gestes et de voix. Répéter jusqu’à ce que le geste devienne précis. Répéter pour inscrire dans le corps une mémoire qui hurle à force de rester muette. Ne plus avoir cette peur panique du hurlement. Répéter, encore, pour que quelque chose, enfin, advienne. Un dix. Ou presque. Un œuf, peut-être.|couper{180}
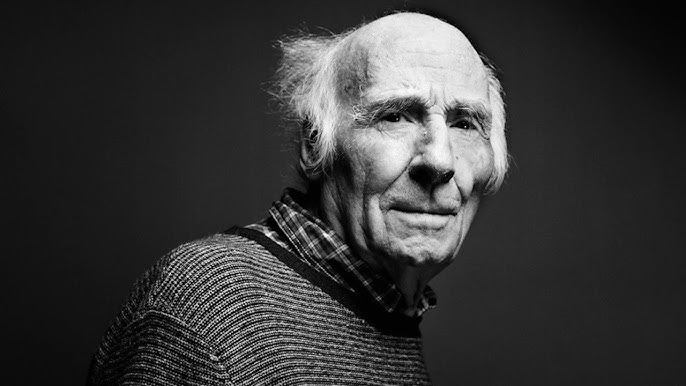
Carnets | décembre 2024
05 décembre 2024
Hier aprés-midi. Sur la route.Hier, j'hésite. Un ou une aprés-midi. Je ne savais plus mon genre. Et ma conjugaison. Plus trés sûr de rien. Plus sûr du tout. Ce qui me rappelle quelque chose. Chose. Un personnage. Le petit Chose de Daudet. Non. Chose qui croît au phallus de la mère. Chose comme dans Le Meurtrion. Il fait beau et voilà que tout à coup je pense à ce Chose ou cette Chose. Tout s'entrechoque. La langue. Et me voici face aux éoliennes. Du côté de Fay-le-clos. Je suis monté pour redescendre. Pas que ça m'enchante. C'est le boulot. Mais les arbres ne sont pas encore nus. Le soleil tape sur les feuilles jaunes. Le premier mot qui vient c'est l'or. Puis du métal en fusion. Une chose en fusion. Ce qui fut utile. Car à Saint-Donat, tout était glacé. J'ai dû voir au moins six personnes. Leur tête disparaissait. Leur tête était interchangeable. Un Cerbere divisé. s'essayant à l'autonomie. Individualisé. Mais tu gardes quoi comme enfer. Essouflé au bout de trois marches gravies de ce grand escalier. Observé une mouche qui montait.Observé la même qui descendait. Entre un panneau de bois frappé de soleil et la vitre dont le verre ( le mot m'échappe pour dire sa nature de verre qui rend le monde flou) Peut-être bien "dépoli". La mouche donc monte et descend. Le même trajet durant un bon quart d'heure. Et mes globes oculaires la même chose. On commence à devenir chose par l'oeil si ça se trouve. C'est à partir de là que le hiatus démarre. Dire ensuite ce que l'oeil voit si possible or voilà la plupart du temps, justement, c'est impossible. Et donc tout le jeu ( passionnant mais fatiguant, éreintant, exténuant) consiste à se rapprocher de ça en s'éloignant de papa, maman, la bonne et moi. C'est à peu près ainsi que le démoniaque se manifeste. Bouh ! Comment vas-tu vieille chose me dit-il. Pas très bien. Pas très bien. L'écart m'a eu. Pas encore jusqu'à la corde. Je m'y aggripe. Sacré Je, si je ne t'avais pas. Mon petit fil à la patte, mon lambeau de chair qui pend entre la gencive et la dent. Breloque.|couper{180}

Carnets | décembre 2024
04 décembre 2024
"Ne pouvoir vivre sans représenter notre vie mais ne trouver dans aucun discours constitué l’exacte résonance de l’expérience que nous faisons du « réel » de cette vie : voilà la contradiction qui nous écartèle." ( lu dans l'introduction de "La langue et ses monstres" de Christian Prigent|couper{180}

Carnets | décembre 2024
03 décembre 2024
archive Dauphiné Libéré Aragon et Elsa Accrochage aujourd’hui à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, dans le nord de la Drôme. Une quarantaine de toiles au Palais Delphinal, et au moins autant de l’ami G. Pour l’occasion, j’ai relu Le Traité du Style et Le Paysan de Paris, m’imaginant croiser le couple Andrieux dans les ruelles alentour. Peut-être en apprendrai-je davantage samedi, lors du vernissage. L’autre ami G., poète de son état, connaît, il me semble, quelqu’un de l’association qui s’occupe de préserver la mémoire des promenades de Louis et Elsa dans les environs. Je n’ai que peu de connaissances précises sur Aragon. Je sais qu’il s’est battu pendant les deux guerres, pas qu’un peu, en tant que médecin. Qu’il a connu Breton dans la biffe, ce terme ancien désignant les tranchées, qui ajoute à la violence de l’époque. Que leur désaccord fut certainement politique par la suite. Quelques poèmes de lui me reviennent, glanés sur les bancs de l’école, notamment La Rose et le Réséda. J’ai toujours imaginé Aragon plus frêle qu’il ne devait l’être, sans savoir pourquoi, mais il m’est devenu admirable au fil du temps, presque malgré moi, et sans même avoir lu l’ensemble de ses livres. En additionnant ses prises de position contre le franquisme, sa fidélité au Parti communiste – quoi qu’on en dise – et ce que j’ai appris de son enfance tourmentée, peu à peu une figure d’homme, bien avant celle de l’écrivain, s’est imposée. Comme ça. Tout bonnement. Quand je redécouvre Feu ( Feu sur le Parti socialiste ! ) je trouve qu'il irait tout à fait bien dans le contexte actuel, il me semble si éclatant. Toute la rage mise ainsi en mots, formidable. Mais ce n’est pas tant ses positions politiques, que son style, qui parachève mon admiration. La lecture de quelques pages du Paysan de Paris m’a renvoyé à mes propres déambulations urbaines. Ce sentiment de proximité m’a pris aux tripes, comme si je plaçais mes pas dans les siens, presque au même endroit, presque avec les mêmes pensées. Errer dans une ville, laisser l’esprit divaguer, c’est une expérience que je connais tellement. Moi aussi, je préfère les passages aux grands boulevards, qui n’ont jamais été ma tasse de thé. Dès que je le pouvais, je m’y engouffrais, à la recherche de cette suspension onirique que seuls ces lieux intermédiaires semblent offrir. Un souvenir m’est revenu en lisant ces lignes d’Aragon. Ce restaurant où je me rendais parfois, chez Chartier, qui incarnait à mes yeux une forme de modestie joyeuse. On pouvait y déjeuner pour des sommes correctes, mais ma bourse plate m’obligeait tout de même à regarder à deux fois avant d’y mettre les pieds. C’était un autre temps, où les serrures des portes – comme celles évoquées par Aragon – semblaient réellement s’ouvrir sur l’infini. Aujourd'hui, je m'y suis rendu il y a quelques années ce n'est plus tout à fait le même établissement et nous avons préféré tourner les talons pour aller manger un couscous à Belleville. Voir des choses que personne ne prendrait le temps de regarder. Perdre du temps, en somme, rêvasser. Transformer, en continu, ce que la réalité nous impose. La lire chez d'autres est toujours un bonheur, un pincement au coeur, on aimerait écrire rien que pour pouvoir provoquer ça. Mais, à l’époque, je ne savais pas poser de mots sur ce que je voyais, ou plutôt sur ce que j’imaginais. J’avais ce regard mais pas encore la langue pour le dire. Et c’est en cela que la lecture a du bon. Souvent, les sots pensent que lire n’est qu’une activité inutile, passive, un simple passe-temps. Mais c’est tout le contraire. On refait le plein de souvenirs qu’on croyait perdus, d’émotions qu’on n’avait pas su avec raison capter. À chaque nouvelle page, paragraphe, phrase, c’est comme si un chalut invisible ramenait à la surface ce qui avait sombré dans les eaux profondes de l’oubli. Aragon, finalement, a cette faculté rare d’éclairer ce qu’il y a de flou et d’illisible en nous. Il nomme ces "serrures s’ouvrant sur l’infini", et je comprends. Je le comprends à travers lui, et je me comprends un peu aussi. Ce que je n’ai jamais su écrire, il l’a posé sur papier. Ses mots réveillent en moi un monde oublié, et je pense qu’il est là, le véritable miracle de la lecture. Pas seulement découvrir l’autre, mais redécouvrir ce qu’on porte en soi. Il y a encore aller vingt ans j'en aurais été jaloux, aujourd'hui ce que je ressens est bien plus un sentiment de fraternité. Je ne sais pas si samedi, lors du vernissage, je croiserai quelqu’un de cette association qui saura me parler des itinéraires empruntés par Elsa et Aragon , apprendre encore autre chose, autrement, sous un autre angle. Mais peu importe. Ce qu’il m’a déjà donné dans ses pages, ces souvenirs greffés aux miens, me suffit déjà amplement. Il faut que ma cervelle saisisse le moment où la satiété l'atteint, l'apaise, toute avidité n'étant que passage à vide.|couper{180}
