Lectures
Dans Lectures, je rassemble des textes qui lisent autant les livres que leurs échos : portraits d’auteurs (Lovecraft, Maupassant, Sebald, Knausgård…), analyses thématiques (mémoire, espaces souterrains, rituel, minimalisme), et ponts entre œuvres et idées (réalisme magique, New Weird, steampunk, théorie de la narration). Plutôt que des critiques formatées, ce sont des notes argumentées : résumés sans divulgâcher, mises en contexte, rapprochements historiques, styles repérés, citations brèves.
contenu de la rubrique Lectures :
Auteurs & œuvres : dossiers, lectures suivies, cycles (Lovecraft et ses héritages, Dunsany, Sebald, Capote, Faulkner, Knausgård).
Genres & courants : New Weird, réalisme magique, steampunk, autofiction, poésie, essais et sciences humaines.
Théorie & pratique : formes narratives (arc, fragment, monologue), contrat auteur·lecteur, “traduction” d’un style (le “Horla”, le “style Sebald”), liens entre écrire et lire.
Cartes et liens : pistes de lecture, intertextes, rapprochements inattendus (Maupassant ↔ mythe de Cthulhu, archives et « cloud » avant l’informatique, villes réelles et villes imaginaires).
Fil conducteur : comprendre ce que fait un texte — au niveau du rythme, de la voix, des motifs — et où il nous mène. Les billets alternent portraits, fiches analytiques et essais courts, avec un maillage vers les rubriques voisines (fictions, carnets, mythes) pour prolonger la lecture.
Quelques thèmes récurrents :
- mémoire et traces - espaces/lieux (souterrains, murs, villes)
- rituels
- l’étrangeté du quotidien
- techniques du récit
- héritages et détours (de Dunsany à Lovecraft, de Perec à Rabelais)
- poétique de la sincérité et du doute
Objectif : offrir un lieu où la lecture devient laboratoire — pour choisir ses prochains livres, mais surtout pour voir comment ces lectures travaillent l’imaginaire
Lectures
Le sexe dans l’oeuvre de HP Lovecraft
Je me souviens de la première fois où j'ai lu Lovecraft. J'ai eu l'impression d'entrer dans une pièce où quelque chose de terrible venait d'arriver. Pas le genre d'horreur avec du sang et des cris, non. Quelque chose de plus discret, de plus insidieux. Comme si la pièce se souvenait d'un événement que nous autres avions délibérément choisi d'oublier. Ce quelque chose, c'était peut-être le sexe. Ou son absence. Ou sa mutation impossible. Bobby Derie, dans son livre Sex and the Cthulhu Mythos, décolle le papier peint de l'univers de Lovecraft et trouve, derrière les dieux visqueux et les cités décomposées, l'ombre de quelque chose d'organique, d'indicible, et de familier. Lovecraft n'écrit jamais vraiment sur le sexe. Ce serait trop simple. Il le laisse plutôt hanter le récit comme une radiation de fond. On le sent dans la fausseté des choses, dans les suggestions de lignées hybrides et d'unions blasphématoires. Yog-Sothoth ne se contente pas de roder à la frontière : il la féconde. « Yog-Sothoth's wife is the hellish cloud-like Shub-Niggurath, in whose honour nameless cults hold the rite of the Goat with a Thousand Young... He has begotten hellish hybrids upon the females of various organic species throughout the universes of space-time. » Ce que cela signifie n'est pas entièrement clair, mais cela devrait vous donner des frissons. « L'épouse de Yog-Sothoth est l'infernale Shub-Niggurath... Il a engendré d'atroces hybrides avec les femelles de diverses espèces à travers l'espace-temps. » Imaginez les matrices humaines comme des ports d’accueil pour des entités extradimensionnelles. La chair devient une interface. Une interface défaillante. Chez Lovecraft, la peur ne réside pas seulement dans l’Étranger, mais dans la contamination par l’Étranger. Dans The Shadow over Innsmouth, l’horreur ne vient pas des créatures marines elles-mêmes, mais de la réalisation que nous sommes déjà mélangés avec elles. Que nous sommes peut-être elles. « ... if they mixed bloods there'd be children as ud look human at fust, but later turn more'n more like the things, till finally they'd take to the water an' jine the main lot o' things daown thar. » Il ne s'agit pas d'évolution. Il s'agit d'inversion. Votre humanité est une phase. Votre véritable nature attend, sous la peau, qu'on active la bonne fréquence. « S'ils mélangaient leur sang, il naîtrait des enfants d'apparence humaine, qui peu à peu deviendraient comme eux, jusqu'à rejoindre les profondeurs. » Ce n’est pas la peur de l’Autre. C’est la peur d’avoir toujours été l’Autre. Dans At the Mountains of Madness, la reproduction ne passe pas par le sexe mais par des spores. C'est froid, efficace, totalement inhumain. C'est le rêve de Lovecraft : un monde sans libido. Sans pulsion. Une société sans Freud. Bruce Lord, cité par Derie, l’exprime ainsi : « Societies that propagate themselves using means other than sexual reproduction... circumvent the pitfalls of degeneration. » La dégénérescence, ici, c'est le désir. La folie du vouloir. Lovecraft voulait de l'ordre. Il voulait des ontologies nettes, des filiations pures. Mais l'univers qu'il a créé ne lui a offert rien de tout cela. Les auteurs venus après ont saisi le message et l'ont poussé plus loin. Ils ont réécrit le Mythe avec des tentacules et des gémissements, du rouge à lèvres sur des goules et du latex sur les Profonds. C'est devenu bizarre. C'est devenu sexuel. C'est devenu dangereusement proche de ce que Lovecraft ne pouvait écrire, mais ne cessait de concevoir. Le résultat, c'est Cthulhurotica, des parodies rule 34(1). Le Necronomicon n'est plus un grimoire. C'est un objet fétiche. Il vibre quand on le touche. Le sexe chez Lovecraft est comme un bug dans la simulation. Il n'a rien à faire là, mais il revient toujours. Il laisse des traces : dans les ventres humains, dans les rituels de sectes, dans l'ADN des abominations cosmiques. Lovecraft n'écrivait pas le sexe. Il écrivait le souvenir du sexe. L'angoisse qu'il provoque. L'erreur systémique qui surgit quand la biologie touche l'inconnu. Et peut-être que c'est cela, au fond, le plus terrifiant. Pas que nous soyons observés par des dieux aliens. Mais que nous les ayons déjà laissés entrer. Par nos corps. Par notre sang. Par nos rêves. (1) La règle 34 (en anglais : « Rule 34 ») est un mème et une catégorie pornographique ou érotique, suggérant que sur n'importe quel sujet, il existe un équivalent pornographique **Illustrations** Galen Dara .|couper{180}

Lectures
L’inquiétante étrangeté
L’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) est un concept théorisé par Sigmund Freud en 1919 dans un essai éponyme. Il décrit une sensation d’angoisse éprouvée face à quelque chose de familier qui devient troublant, comme si une anomalie invisible venait dérégler la perception du réel. 1. Origine et définition Le mot allemand "Unheimlich" signifie littéralement "non-familier", mais il est construit à partir du mot "Heimlich" qui veut dire "familier", "intime", voire "secrètement dissimulé". Ce paradoxe est central dans la notion d’inquiétante étrangeté : ce qui était caché, mais familier, refait surface d’une manière inquiétante. Freud l’explique ainsi : « L’Unheimlich est une sorte de Heimlich qui a subi un refoulement et qui est revenu à la lumière. » L'inquiétante étrangeté naît donc lorsque quelque chose de profondément connu réapparaît sous une forme légèrement différente, nous mettant mal à l’aise. 2. Les ressorts de l’inquiétante étrangeté Plusieurs éléments peuvent provoquer ce sentiment d’étrangeté troublante : A. La présence du double Le doppelgänger (double maléfique) est une figure récurrente dans la littérature fantastique. Freud cite L’Homme au sable d’E.T.A. Hoffmann, où un personnage rencontre son double, créant une impression de terreur. Lovecraft, Poe et même des auteurs modernes comme China Miéville jouent sur la fragmentation de l’identité et la duplication inquiétante des êtres. B. L’animation de l’inanimé Quand un objet, une poupée (uncanny valley en robotique), un miroir ou un reflet semblent prendre vie. Exemple : les automates d’Hoffmann, le mythe du Golem, ou les œuvres de Lisa Tuttle, qui joue sur la présence d’objets imprégnés d’une vie cachée. C. La distorsion du temps et de l’espace Un lieu familier peut se transformer en un endroit où les lois de la logique sont altérées. Jeff VanderMeer, avec Annihilation, installe un espace mutant où l’environnement devient autre, bien qu’apparemment normal au premier regard. D. Le retour du refoulé Un souvenir oublié qui ressurgit brutalement. Une scène de l’enfance qui refait surface sous une forme inquiétante. C’est l’un des ressorts majeurs des récits de Silvia Moreno-Garcia, où des traumatismes anciens hantent les personnages. E. La perte des repères corporels Métamorphoses, mutations, transformations du corps. Thème central chez Lovecraft (L’Appel de Cthulhu, La Couleur tombée du ciel). Exploité dans des récits comme Mexican Gothic où le fantastique se mêle à la dégénérescence physique. 3. L’inquiétante étrangeté dans la littérature et l’art Ce concept a été exploré dans le fantastique gothique et l’horreur psychologique, influençant de nombreux écrivains et artistes : Edgar Allan Poe → William Wilson (le double), La Chute de la maison Usher (l’animation de l’inanimé). H.P. Lovecraft → Les créatures indescriptibles et la transformation de la perception du réel. China Miéville → Des villes doubles, des réalités parallèles où l’étrangeté affleure sous la normalité. David Lynch (cinéma) → Eraserhead, Mulholland Drive, Twin Peaks, où des scènes banales deviennent perturbantes. Hans Bellmer (peinture et sculpture) → Corps fragmentés, poupées inquiétantes. 4. Pourquoi l’inquiétante étrangeté nous touche-t-elle autant ? Le concept freudien repose sur un conflit psychologique profond : nous reconnaissons quelque chose, mais il nous semble déformé, ce qui crée une angoisse diffuse. C’est la confrontation avec un reflet déformé du réel, un monde où les repères s’effondrent subtilement. C’est aussi un moyen pour les artistes et écrivains d’explorer nos peurs les plus profondes, celles qui ne sont pas simplement liées à des monstres ou des fantômes, mais à nous-mêmes, notre mémoire, notre perception et notre identité. En somme, l’inquiétante étrangeté est l’un des ressorts narratifs les plus puissants du fantastique, car elle joue sur le malaise, le doute et l’impossibilité d’être sûr de ce que l’on perçoit. Illustration PB 1978|couper{180}

Lectures
Inférence littéraire et autoportrait d’écrivain : une frontière poreuse
Lorsqu’un auteur décrit un paysage désolé, un personnage tourmenté ou un sentiment diffus, se raconte-t-il lui-même ou joue-t-il avec l’interprétation de son lecteur ? Cette question est au cœur de la lecture critique et engage un débat ancien entre ceux qui voient la littérature comme une projection de l’écrivain et ceux qui estiment que le texte doit être analysé en lui-même, indépendamment de son auteur. Entre inférence littéraire et autoportrait dissimulé, la frontière est fine et mouvante. L’inférence littéraire : un levier d’interprétation L’inférence littéraire consiste à déduire des informations non explicites à partir des indices textuels. Un bon lecteur ne se contente pas de ce qui est dit : il comble les blancs, relie les éléments narratifs entre eux et attribue des intentions aux personnages. Prenons un exemple dans Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert. Lorsqu’Emma Bovary contemple la campagne normande, les descriptions ne sont pas neutres : "La pluie tombait en nappes sur la rivière, et des cercles innombrables se formaient à la surface de l'eau, qui semblait frémir sous le poids des gouttes." Rien n’est explicitement dit sur Emma, mais l’atmosphère lourde, la pluie incessante et le frémissement de l’eau font écho à son désarroi. Le lecteur infère son mal-être à partir de ce paysage oppressant. Pourtant, Flaubert lui-même était-il mélancolique en écrivant cette scène ? On n'en sait rien. La description est une construction dramatique, pas un autoportrait. L’illusion biographique : l’auteur est-il toujours dans son texte ? Certains auteurs brouillent les pistes et rendent la distinction entre inférence et autobiographie plus trouble. Marcel Proust, dans À la recherche du temps perdu, place un narrateur qui lui ressemble énormément, jusqu'à faire croire à une simple transposition de sa vie. Pourtant, l’autobiographie chez Proust est un prisme déformant : le narrateur "Marcel" n'est pas exactement Marcel Proust. Prenons cette phrase de Du côté de chez Swann (1913) : "La vérité que je cherche n'est pas en moi, elle est dans le passé qui renaît." On pourrait y voir une déclaration intime de l’auteur sur sa propre quête de mémoire involontaire. Mais Proust construit un dispositif littéraire complexe où l’inférence du lecteur l’entraîne dans un piège herméneutique : il confond volontiers la voix du narrateur avec celle de l’auteur. C’est ce que Roland Barthes dénonce dans La mort de l’auteur (1967) : vouloir retrouver l’auteur dans son texte est une illusion. Pour lui, l’œuvre doit être interprétée indépendamment de son émetteur. Quand l’auteur s’insinue dans le texte Certains écrivains revendiquent une porosité entre fiction et récit personnel. Marguerite Duras, dans L’Amant (1984), assume que la narratrice est une version fictionnalisée d’elle-même. De même, Annie Ernaux dans Les Années (2008) joue sur cette fusion entre intime et collectif. Conclusion : un dialogue entre l’œuvre et son lecteur Si la littérature est un jeu d’ombres et de reflets, c’est aussi parce que le lecteur participe activement à sa création de sens. Entre inférence et autoportrait, chaque lecture devient une rencontre unique. Sources : Roland Barthes, La mort de l’auteur, 1967. Gustave Flaubert, Correspondance, 1857. Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, 1998. Illustration Jean Renoir, Madame Bovary 1933|couper{180}

Lectures
Tentative d’élucidation du style de Lovecraft
La phrase lovecraftienne. Rampante. Tortueuse. Tentaculaire dans sa structure. Une chose informe, indistincte, qui s’étire et se distend, accumulant les clauses avec la patience d’un mal antique. Elle avance insidieusement, pesante, saturée d’épithètes comme autant de reliques insensées d’une langue morte, suspendue au seuil de l’indicible. Elle ne décrit pas, elle murmure, elle évoque, elle insuffle au lecteur un doute grandissant, un vertige lent et inexorable. Lovecraft bâtit ses phrases comme un architecte fou d’un royaume non euclidien, agençant leur ossature en un escalier qu’on descend toujours plus profondément vers l’abîme. Son langage ne livre pas l’horreur : il la suggère, il la distille goutte à goutte dans l’esprit du lecteur, transformant le silence même en un écho informe, porteur d’une chose qu’il vaudrait mieux ne pas comprendre. Dans "The Picture in the House", chaque conjonction, chaque souffle syntaxique lie le récit au néant rampant, chaque virgule devient une béance par laquelle s’infiltre un savoir insoutenable. Le langage lui-même devient le miroir du cosmos indifférent, une charpente pour une révélation qui ne viendra jamais entièrement, laissant le lecteur vacillant devant l’ombre de ce qui aurait pu être dit. Lovecraft n’a pas élaboré ce style par hasard. Admirateur de Poe, il reprend cette manière d’instiller la terreur en ne montrant jamais tout, en laissant des interstices dans la narration où le lecteur projette ses propres abominations. Il hérite aussi de Lord Dunsany, dont les mondes fantastiques empreints d’un lyrisme solennel et mythologique ont marqué son imaginaire. Cependant, son éducation irrégulière, son repli dans un monde de lecture quasi monomaniaque ont fait de lui un autodidacte obsessionnel, façonnant son style avec la minutie d’un architecte maudit. Chaque phrase lovecraftienne est construite avec une intention, chaque adjectif, chaque structure syntaxique participe à une atmosphère précise, où le poids du passé, de l’oubli et de l’innommable se fait sentir. Les mots de Lovecraft. Profonds. Anciens. Imprégnés d’une signification oubliée. "Eldritch" (étrange, indicible), "Cyclopean" (titanesque, au-delà des âges), "Squamous" (couvert d’écailles, d’une répugnance indicible), "Unnamable" (innommable, car aucun nom humain ne saurait en capter l’atrocité). Autant d’incantations, de vestiges langagiers remontant aux âges les plus noirs de la littérature. L’accumulation n’est pas un hasard, ni une ornementation gratuite : elle est un piège, un réseau dans lequel l’esprit du lecteur se prend, incapable de s’extraire de ce labyrinthe lexical. Lire Lovecraft, c’est être lentement avalé par une langue qui semble exister en dehors du temps humain, un langage qui ne décrit pas, mais qui invoque. La terreur lovecraftienne n’éclate pas. Elle s’infiltre. D’abord un détail troublant. Puis un autre. Une incongruité. Une sensation. L’esprit du narrateur, d’abord sceptique, s’embourbe dans des observations de plus en plus impossibles, une géométrie qui n’a pas lieu d’être, une note discordante dans l’ordre des choses. Lovecraft joue avec le décalage, laissant entrevoir l’horreur dans le reflet d’un miroir brisé. Son art est celui du dévoilement progressif. Un chuchotement dans le vent nocturne. Une phrase interrompue, suspendue dans le vide. Un cri arraché à la gorge d’un homme qui a vu. Et, toujours, une dernière ligne, un dernier mot qui précipite le lecteur dans l’abîme, laissant son esprit secoué par une terreur sourde qui ne s’éteindra jamais complètement. Rarement un récit à la troisième personne chez Lovecraft. Toujours une voix. Un journal. Un témoignage. Un cri d’agonie capturé sur un parchemin oublié. Un narrateur qui se croit sain d’esprit et qui, ligne après ligne, sombre dans l’abîme de la compréhension interdite. La première personne rend l’horreur immédiate, inévitable. Il ne s’agit pas d’un conte lointain, mais d’une confession, d’un cri de désespoir lancé d’entre les pages. Et lorsque le dernier mot est lu, il semble que le narrateur ait été consumé, qu’il ne reste plus que le silence et une ombre furtive qui glisse à la lisière de la conscience du lecteur. L’horreur chez Lovecraft ne se niche pas dans l’humain, mais dans son insignifiance. Nulle morale, nulle justice divine. Juste un gouffre infini et noir, peuplé d’êtres indifférents à nos existences éphémères. Dans "The Call of Cthulhu", l’humanité découvre qu’elle n’est qu’un fétu de paille, brinquebalé par des forces qu’elle ne peut ni comprendre ni influencer. Nos dieux sont morts ou dorment sous l’océan, et si jamais ils s’éveillent, ce sera pour nous écraser sans même nous voir. C’est là le cauchemar ultime de Lovecraft : la révélation de notre inutilité, de notre absolue futilité dans l’horreur cosmique. Cette approche du mystère et de l’inférence, Lovecraft ne l’a pas inventée. Edgar Allan Poe en fut le premier maître. Mais là où Poe bâtit la folie humaine à l’intérieur de ses narrateurs, Lovecraft la dissémine dans le cosmos lui-même. Il ne s’agit plus d’une conscience malade, mais d’un univers malade. Le lecteur ne voit pas le monstre. Il en devine l’ombre, en entend le râle caverneux, en ressent l’empreinte laissée sur le sol d’un lieu maudit. Il imagine. Et ce qu’il imagine est toujours pire que ce qu’il aurait pu voir. Le style lovecraftien a ses détracteurs. Trop lourd. Trop orné. Trop désuet. Et pourtant, il demeure, impérissable, à l’instar des cités englouties qu’il décrit. Car dans chaque phrase, dans chaque construction syntaxique tortueuse, il y a un piège, un rituel insidieux qui transforme le lecteur en témoin de l’indicible. Pour un écrivain contemporain, étudier Lovecraft n’est pas seulement un exercice d’admiration, c’est un apprentissage du rythme, de la suggestion et de l’art de créer une atmosphère. Il démontre comment le langage peut devenir une force presque hypnotique, comment une phrase peut encapsuler l’indicible. Il rappelle que le style n’est jamais un simple artifice, mais une mécanique précise au service d’une vision. En cela, Lovecraft demeure une leçon magistrale : celle d’un auteur qui, malgré son isolement et ses doutes, a su forger une écriture unique, aussi puissante que les horreurs qu’elle décrit. La phrase lovecraftienne. Un gouffre sans fond. Un escalier sans fin. Une porte entrouverte sur un monde qu’il ne faudrait pas voir. Et pourtant, on lit. On continue. Jusqu’à ce que l’ombre se referme. Et au moment même où l’on pense refermer le livre, quelque chose, derrière nous, semble s’être éveillé. illustration : Arnold Böcklin L'Iles des Morts 3ème version 1883 Musique Pink Floyd Echoes, extrait|couper{180}

Lectures
H.P. Lovecraft en 2025 : l’horreur que nous n’osons pas voir
Imaginez que l’on découvre aujourd’hui un manuscrit inédit de H.P. Lovecraft. Une œuvre prophétique, terrifiante, qui décrit notre monde mieux que nous ne le faisons nous-mêmes. Les Montagnes hallucinées ne parlerait plus seulement d’horreurs antiques, mais des monstres bien réels qui nous gouvernent. Et si Lovecraft avait eu raison ?|couper{180}

Lectures
Mémoire vive
Je me souviens d’une lampe verte sur le bureau de mon grand-père. Ou était-elle bleue ? Peut-être n’y avait-il pas de lampe du tout. Ce qui me revient, ce n’est pas un fait, c’est une impression, un reflet de lumière posé sur un coin d’enfance. Si je l’écris, je la fixe. Et pourtant, déjà, elle m’échappe. La phrase vient de l’attraper, mais ce n’est plus la même lampe. Quand on écrit un souvenir, que retient-on vraiment ? Est-ce une archive du passé ou une réinvention ? On croit que l’on restitue, mais on recrée. C’est une illusion tenace, cette idée que la mémoire serait un enregistrement fidèle. Proust l’a démontré mieux que personne. Dans À la recherche du temps perdu, ce ne sont pas les souvenirs conscients qui portent la vérité du passé, mais ces surgissements imprévisibles, ces éclats sensoriels qui dépassent la volonté. L’odeur d’une madeleine, le bruit d’une cuillère sur une assiette, et c’est tout un monde qui refait surface. Mais ce monde n’existe plus. Il se reconstruit dans l’écriture, il se plie au rythme des phrases, à la logique du récit. Ce n’est pas une restitution, c’est une transfiguration. Écrire, c’est composer avec l’oubli. Barthes en joue aussi. Dès la première page de Roland Barthes par Roland Barthes, il avertit : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. » Même en parlant de lui-même, il s’invente. Qui raconte, lorsqu’on se souvient ? Qui décide du cadre, du ton, des ellipses ? On croit se souvenir, mais en réalité, on choisit. On accentue une couleur, on coupe un détail, on arrange. Peut-on dire qu’un souvenir écrit est vrai ? Peut-être l’est-il plus que le souvenir lui-même. La mémoire est un atelier où l’on sculpte ce qui nous reste. Perec, lui, a fait de cette incertitude un projet littéraire. Je me souviens aligne des bribes de passé, toutes introduites par la même formule incantatoire : « Je me souviens… » Il ne cherche pas à recomposer une histoire, juste à fixer des fragments, ces éclats épars qui font une vie. Mais l’exercice révèle autre chose : certains souvenirs paraissent inventés. Ou sont-ils simplement contaminés par d’autres récits, d’autres lectures ? Perec lui-même l’admet dans W ou le souvenir d’enfance : son passé est troué, il le recompose par nécessité, et parfois, par pure fiction. C’est là toute la question : écrit-on ce dont on se souvient, ou se souvient-on de ce que l’on écrit ? Nathalie Sarraute, elle, hésite. Enfance n’est pas un récit ordinaire. C’est une conversation à voix basse entre elle et elle-même, un dialogue interrompu, une succession de doutes. À chaque souvenir évoqué, une seconde voix s’élève pour interroger : « Était-ce vraiment ainsi ? » Rien n’est certain, tout est fragile. L’écriture n’affirme pas, elle explore. Ricœur parle de « mémoire reconstructive ». Nous ne sommes pas des archivistes fidèles de notre propre vie. Nos souvenirs se modèlent selon nos attentes, nos désirs, nos regrets. On se raconte une histoire. On la modifie sans s’en rendre compte. Peut-être que la mémoire ne se contente pas d’oublier ; peut-être qu’elle invente aussi. Alors écrire, c’est quoi ? C’est reconnaître que la vérité du souvenir ne tient pas dans sa précision, mais dans sa résonance. Gabriel García Márquez disait : « La vie n’est pas ce que l’on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s’en souvient. » Ce qui importe, ce n’est pas la fidélité à un passé factuel, mais la justesse d’une sensation retrouvée, d’une émotion qui refait surface. Peut-être qu’au fond, écrire, c’est inventer un passé qui tienne debout. Un passé qui, une fois couché sur la page, semble plus réel que celui qu’on croyait posséder. Peut-être que cette lampe verte — ou bleue — n’existait pas. Mais maintenant qu’elle est là, dans ces lignes, elle existe un peu plus qu’avant. C’est peut-être ça, la mémoire. Une fiction qu’on apprend à croire. Musique Claude Debussy Rêverie|couper{180}
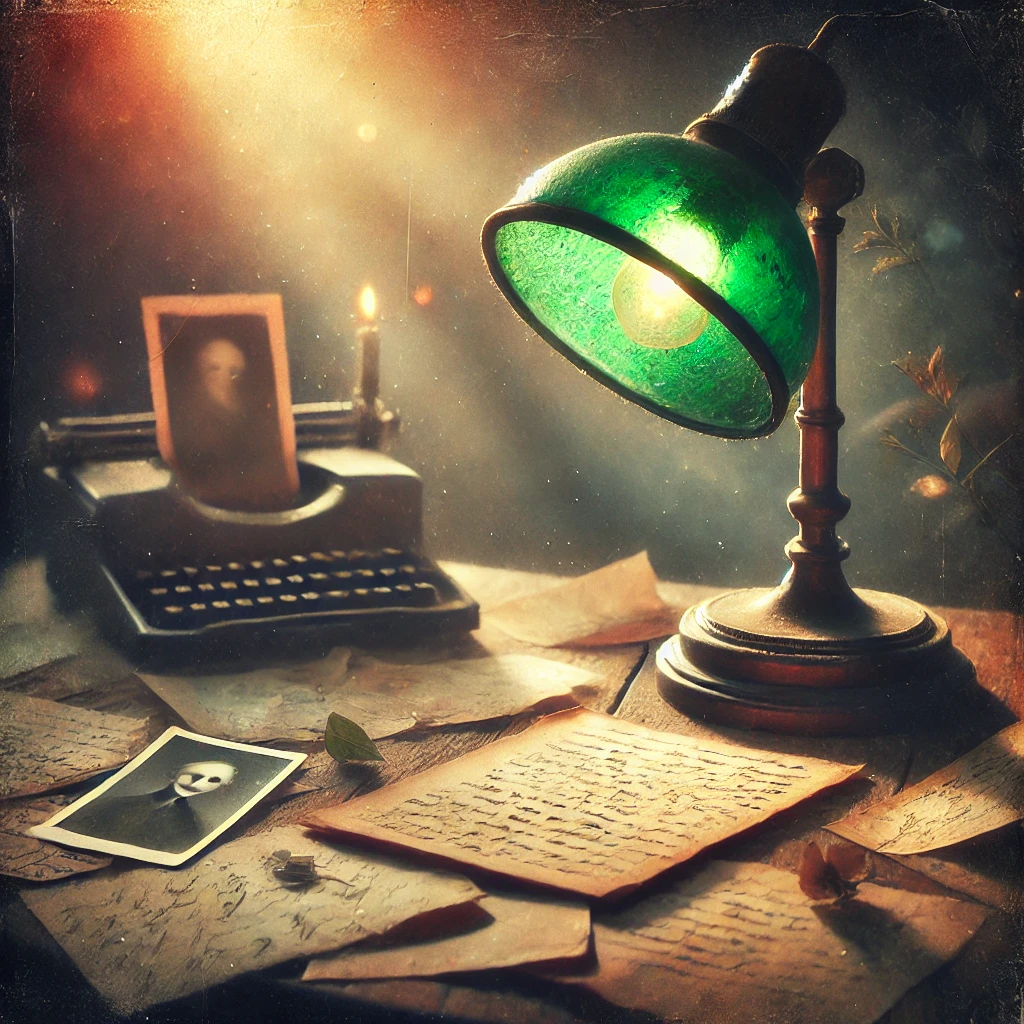
Lectures
Écrire l’étrange : entre réflexion et passage à l’acte
« Le véritable conte étrange à quelque chose de plus qu'un meurtre secret, des os ensanglantés ou une forme drapée faisant claquer des chaînes selon la règle. Il s'agit bien plus d'un récit qui évoque une terreur profonde face à l’inconnu, souvent en suggérant des réalités cachées qui dépassent l’entendement humain. » Ainsi s’exprimait H. P. Lovecraft en 1933 dans Guide pour écrire des histoires bizarres. Cette définition, loin des artifices du surnaturel de pacotille, pose la question de l’étrange comme un mouvement subtil dans le récit, une tension plus qu’un simple dispositif. Face à cette réflexion, l’envie d’écrire des fictions étranges révèle un besoin profond. Pourquoi sommes-nous fascinés par ce qui dépasse la norme ? Pourquoi cherchons-nous à explorer d’autres réalités par le biais de la fiction ? En appliquant la méthode japonaise des 5 pourquoi, qui consiste à remonter aux causes profondes d'un questionnement, on peut identifier les racines du désir d’écrire des fictions étranges : Parce que j’aime créer des histoires qui perturbent la perception du réel. Parce que je suis fasciné par l’inexplicable et le mystérieux. Parce que cela me donne une sensation unique d’émerveillement. Parce que le monde me semble souvent trop rationnel et limité. Parce que cela me permet de remettre en question la normalité et de jouer avec l’inconnu. La conclusion ? J’écris des fictions bizarres pour repousser les limites du réel et explorer l’inconnu, là où la normalité n’a plus de prise. Mais alors, qu'est-ce qui empêche d'écrire ? Ce n'est pas le manque d'idées — le bizarre est partout — mais bien la difficulté à trouver un véhicule narratif pour le porter vers l'autre. L’écriture de l’étrange ne repose pas sur l’accumulation d’éléments surnaturels ou d’images spectaculaires, mais sur la manière dont le texte amène le lecteur à sentir un glissement insidieux du réel vers l’anomalie. Ce basculement peut se faire par des variations stylistiques, des structures narratives décalées, une perception faussée du narrateur. C'est un curieux problème que celui de l'étrange en littérature. On voudrait le capturer, l'analyser, comme une bête indocile. On le soupèse, on le soupçonne, on tente d’en cerner les contours, mais il résiste, se faufile, toujours à la lisière du réel. On écrit sur lui, et pourtant, il nous échappe. Prenons cette baguette de pain. Tiède en sortant de la boulangerie, elle refroidit, naturellement. Mais pourquoi donc cet homme presse-t-il le pas, l'air inquiet, tandis que la vapeur s'échappe encore de la croûte dorée ? Est-ce la baguette qui change ou bien l’air autour ? Lui-même ne saurait le dire. La scène est ordinaire, bien sûr. C’est un trottoir de Paris, un dimanche matin, il fait un peu gris, et le sol brille encore de l’averse nocturne. Rien d’extraordinaire, rien à signaler. Mais cette baguette. Ah, cette baguette. Et ce chat. Où est-il ? Sur le fauteuil, naturellement, sa place habituelle. Mais lorsque les autres entrent dans la pièce, ils froncent les sourcils. « Quel chat ? » Il caresse le vide, pourtant il sent sous ses doigts la tiédeur de son pelage. Un instant, il pense qu’ils plaisantent. Puis il voit leurs visages, crispés, interrogateurs. Il n’y a pas de chat. Alors il secoue la tête, passe à autre chose. Après tout, on a vu plus étrange. On a toujours vu plus étrange. Un puits. On ne tombe pas dans un puits, en ville, pas dans un arrondissement comme celui-ci. Mais le sol s’est dérobé sous lui, et maintenant, il chute. Plutôt lentement, à vrai dire. Il se redresse un peu, s'ajuste comme on s’installerait plus confortablement dans un fauteuil trop profond. Il observe les parois, la texture de la pierre, s’amuse du détail de quelques racines qui osent un geste vers lui. Il suppose qu’il finira par s’arrêter. Ou peut-être pas. Mais pour le moment, il chute. Alors, quand commence-t-on à écrire ? Peut-être quand on accepte d’abandonner la peur de l’imperfection, quand on cesse d’attendre une idée « parfaite » et que l’on se met à tester, à jouer avec la langue et les structures. L’étrange, après tout, ne se manifeste pas par un grand fracas, mais par un léger déplacement, une rupture presque imperceptible dans la trame du quotidien. C’est ce jeu subtil entre le réel et l’irréel qui donne à l’écriture de l’étrange toute sa puissance. Ainsi, plutôt que de remettre l’acte d’écrire à plus tard, pourquoi ne pas se prêter dès maintenant à un exercice ? Pourquoi ne pas capturer un moment anodin de votre journée et y injecter une anomalie ? Une légère dissonance. Une tension sourde. Car c’est là que réside la force de l’étrange : non pas dans l’attente du moment idéal, mais dans l’acceptation de son intrusion insidieuse, discrète, dans notre perception du monde. Musique Miles Davis : Ascenceur pour l'échafaud|couper{180}

Lectures
Effacement des traces
Lire, ce n’est pas seulement parcourir des livres. C’est aussi décoder les traces de notre quotidien, ces empreintes infimes laissées sur le papier avant qu’elles ne s’effacent. Plonger dans les papiers administratifs. C'est un rituel quotidien, presque inconscient. Scanner les factures, les tickets de caisse, les preuves. Ces fragments de notre passage, de notre consommation, de nos choix, ces pièces censées attester de notre histoire récente. Et pourtant, déjà, elles s’effacent. À un moment, en constatant leur effacement, je suis à mi-chemin entre l’étonnement et la colère. Ainsi, on nous impose, pour des raisons comptables et administratives, de conserver nos liasses de papiers en lieu sûr. Mais à quoi cela sert-il vraiment si, au bout d'une année à peine, elles disparaissent ? Comme si ce que nous vivons n’avait pas vocation à durer, comme si les preuves mêmes de notre passage n’étaient qu’une illusion temporaire. J’ai songé un instant à aller dans les magasins, les banques, exprimer… quoi ? Mon incompréhension face à cette absurdité, ma frustration de voir disparaître ce qu’on exige pourtant de conserver, mon désarroi devant cette obsolescence imposée. Mon étonnement, ma colère, mon désarroi ? Mais peine perdue, me suis-je dit presque aussitôt. Qui écouterait ce désarroi, sinon moi-même ? Qui accorderait de l’importance à ces détails infimes mais pourtant révélateurs d’un monde en perpétuelle disparition ? Il te faut aussi accepter cela, comme ce jour où tu as cherché, en vain, une vieille note griffonnée sur un carnet oublié, une idée précieuse jetée sur le papier et disparue sans laisser de trace, ces idées jetées sur le papier et oubliées, ces souvenirs effacés avec le temps, cette disparition des traces administratives de ta vie professionnelle et personnelle. Mais n’est-ce pas aussi le propre de toute existence, de s’effacer progressivement, d’être recouverte par les strates du temps, de s’effilocher comme ces tickets de caisse dont l’encre s’évapore sous nos doigts ? Hier encore, on nous vantait l'éternité des galettes, des CD, des DVD, tout comme on nous promet aujourd’hui celle du numérique. Mais force est de constater que même ces formats ne nous garantissent pas la pérennité. En changeant de machine, on abandonne parfois tout un pan de sa vie. Combien de fichiers oubliés sur d’anciens disques durs, combien de photos stockées sur des supports désormais illisibles, combien de mots, d’instants, effacés à jamais par l’évolution technologique ? Nous nous en remettons aux machines, persuadés qu’elles garderont tout en mémoire, alors même qu’elles sont les premières à nous trahir. À force de courir après la nouveauté, ne sommes-nous pas en train d'effacer notre propre histoire ? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les traces s'effacent progressivement, avant même notre propre disparition. Et avec elles, peut-être, une part de nous-mêmes. La seule chose qui ne change pas : regarder le ciel. Tenter de lire ce qu'il dit et qui varie perpétuellement. Déjà enfant, j'avais un doute sur ce que je comprenais de cette lecture. Je m'estime heureux d'avoir conservé ce doute. Car tant qu’il reste du doute, il reste une place pour l’émerveillement. Pour la mémoire que l’on forge autrement que sur du papier, sur des écrans, ou sur du silicium. Peut-être que ce qui demeure réellement n’a pas besoin d’être enregistré, numérisé, archivé. Peut-être que ce qui persiste, c’est ce que nous choisissons de garder vivant en nous. Cette disparition des traces ne se limite pas aux objets ou aux fichiers numériques. Elle s'étend même au langage, à ces repères que nous pensions immuables. Elle touche aussi notre langage, nos repères. Pierre Ménard, sur son site "Liminaire", nous fait part d'une péripétie qui semble amusante au premier abord, mais qui, si l'on y réfléchit, glace le sang. Quelqu'un s'amuse à aposer des étiquettes sur tous les objets, une fenêtre, un placard, un ordinateur. Cela semble absurde au narrateur car tout le monde sait ce que sont ces objets. Puis soudain l'ordre des choses se modifie... La tasse devient une douchette, l'ordinateur pluie... ( [https://liminaire.fr/chronique/entre-les-lignes/article/dans-le-temps-a-contre-courant]) Ce glissement arbitraire du sens des mots nous rappelle à quel point notre monde repose sur des conventions fragiles. Lorsque nos repères se dissolvent, que reste-t-il de notre mémoire collective ? Est-ce une bonne ou mauvaise chose je n'en sais rien et une certaine lassitude m'empêche de me lancer dans cette investigation. Finalement, je finis par apprécier cet état flottant, entre étonnement et colère, comme quelqu'un tentant de passer entre les gouttes de pluie, les flocons de neige.|couper{180}

Lectures
Une utopie en sursis
Il y a dans l’œuvre de Iain M. Banks quelque chose de faussement assuré, une confiance qui vacille. Né en 1954 et disparu en 2013, Banks était un écrivain britannique connu pour ses romans de science-fiction et ses œuvres de fiction générale publiées sous le nom de Iain Banks. Son cycle de la Culture, entamé avec L'Homme des jeux en 1987, est rapidement devenu une référence majeure du genre, explorant les tensions et paradoxes d'une société technologiquement avancée et politiquement anarchiste. La Culture, cette société post-pénurie gouvernée par des intelligences artificielles bienveillantes, semble avoir résolu ce que d’autres considèrent comme insoluble : la rareté, l’oppression, la peur du lendemain. Pourtant, sous la surface immaculée, les paradoxes s’accumulent. La Culture veut être sans hiérarchie, mais ses citoyens dépendent d’entités infiniment plus intelligentes qu’eux. Elle veut être tolérante, mais intervient sans relâche dans les affaires des civilisations moins avancées, imposant son éthique par des moyens dont la douceur masque mal la violence. Il faudrait d’abord revenir à la structure. Une société post-marxiste, fluide, sans propriété, sans argent. Chacun y fait ce qu’il veut, parce qu’il n’y a plus rien à vouloir au sens où nous l’entendons. Les IA, les Mentaux, gèrent tout, omniprésentes et discrètes. Certains les comparent à des dieux, mais des dieux qui, cette fois, ont l’intelligence de ne pas exiger d’adoration. Ce sont elles qui maintiennent l’illusion d’un monde sans pouvoir, alors qu’en réalité tout repose sur leur regard. Un regard bienveillant, mais un regard tout de même. La Culture se déploie comme une utopie en mouvement, sans centre, sans capitale, une galaxie de vaisseaux, d’orbitales, d’habitats flottants. Une anarchie systémique, huilée par la technologie. Mais l’anarchisme, ce n’est pas seulement l’absence d’autorégulation, c’est aussi l’absence de coercition. Or, ici, il y a coercition, et elle porte un nom : Contact. Ou pire : Circonstances Spéciales. Parce qu’une société qui se veut parfaite ne peut pas tolérer l’imparfait. Parce qu’à force d’être convaincue de son bon droit, elle en oublie qu’elle agit par la force. Chaque roman de Banks est une variation sur ce thème : le prix de l’utopie. Le prix se mesure en violence, en compromis, en manipulation. Dans L'Usage des armes, un mercenaire se bat pour la Culture, accumule les cicatrices et les horreurs au nom d’un monde qui, lui, reste immaculé. Dans Les Enfers virtuels, la Culture interdit aux civilisations extérieures de maintenir des espaces de damnation simulés. L’intention est noble, le résultat est une guerre. Peut-on imposer la liberté ? Peut-on abolir la souffrance sans détruire la volonté ? Banks ne tranche pas, il expose, il déroule. Ce qui rend son œuvre si actuelle, c’est cette incertitude. Contrairement aux dystopies convenues où l’utopie est un mensonge à abattre, Banks nous montre une société qui fonctionne, et c’est précisément cela qui la rend troublante. Il ne s’agit pas de dénoncer un régime totalitaire déguisé en paradis. Il s’agit de poser une question plus insidieuse : et si l’utopie, par nature, contenait son propre poison ? Aujourd’hui, alors que les crises climatiques, technologiques et géopolitiques se multiplient, l’œuvre de Banks apparaît sous un jour plus prophétique que jamais. Son intuition d’une civilisation technologiquement avancée, engoncée dans ses propres contradictions, fait écho aux dilemmes contemporains : jusqu’où faut-il intervenir au nom du bien ? L’automatisation et l’intelligence artificielle peuvent-elles vraiment garantir l’équilibre d’une société ? La Culture est-elle une métaphore de nos démocraties libérales, où la tolérance et le confort masquent souvent un refus du changement profond ? On pourrait croire que la Culture est un rêve d’avenir, mais c’est peut-être plutôt un miroir du présent. Une parabole sur le libéralisme absolu, où le confort a remplacé la lutte, où l’illusion du choix se confond avec la liberté réelle. Un monde où l’on peut tout faire, sauf remettre en cause le système qui nous permet de tout faire. Un monde sans état, mais pas sans structure de contrainte. La Culture ne force personne à l’adopter. Elle se contente d’attendre que les autres civilisations se rendent compte d’elles-mêmes qu’elles sont arriérées. Ce qui, au fond, revient au même. L’utopie de Banks n’est pas une promesse, c’est une hypothèse. C’est une tentative de penser un ailleurs qui, comme tous les ailleurs, reste insaisissable. Et si elle fascine tant, ce n’est pas parce qu’elle nous donne un modèle, mais parce qu’elle nous met face à une question sans réponse : que ferions-nous, vraiment, si nous avions tout ce que nous voulons ?|couper{180}
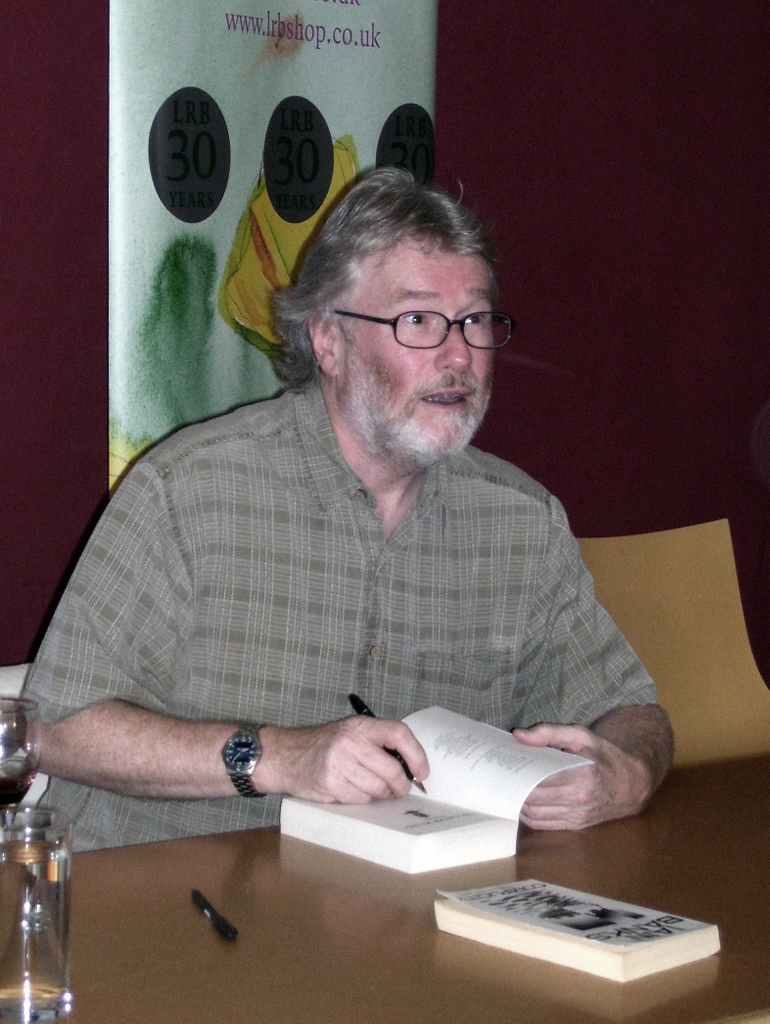
Lectures
Maupassant, une vie
Maupassant enfant Maupassant, météore et mirages Un écrivain qui va vite. Très vite. Une trajectoire nette, tendue, presque trop droite : ascension fulgurante, production délirante – plus de trois cents nouvelles, six romans, des récits de voyage, des chroniques. Puis le grand plongeon : la maladie, la folie, la mort. À peine 43 ans et déjà fini. Tout cela en une poignée d’années, comme s’il savait d’avance qu’il n’aurait pas le temps. Et pourtant, ce temps, il l’a pris. Pour écrire, surtout, avec une précision chirurgicale et un regard tranchant. Réaliste, fantastique, cruel ou mélancolique, Maupassant a tout observé, tout disséqué, sans détour ni pathos. Un monde en ruines, des hommes médiocres, des âmes broyées, quelques lâchetés ordinaires, parfois un sursaut de grandeur, mais rarement. On l’a dit cynique, il l’était. Mais lucide, surtout. I. Normandie, mer et guerre Il naît le 5 août 1850, dans un château normand, ce qui sonne bien mais ne pèse pas lourd quand on a plus de noblesse que d’argent. Un père volage, une mère lettrée, Laure Le Poittevin, qui lui transmettra Flaubert comme on confie une boussole. Après la séparation des parents, il grandit entre Étretat et Dieppe, paysages qui deviendront ses décors de prédilection : les falaises abruptes, la mer imprévisible, l’ombre du large. Il y a pire pour nourrir l’imaginaire. Puis vient la guerre. 1870, les Prussiens écrasent la France. Maupassant, affecté à l’intendance, ne combat pas, mais il voit. Il voit la peur, la lâcheté, la mort bête et absurde. Il en fera des nouvelles, quelques-unes inoubliables : Boule de Suif, Deux amis, Mademoiselle Fifi. Les hommes y sont faibles, la guerre y est stupide. Et après tout, pourquoi la raconter autrement ? II. Le disciple de Flaubert Après la guerre, direction Paris. Il a vingt ans, pas d’argent, mais une ligne directe vers Gustave Flaubert, vieil ami de sa mère et mentor idéal. Et quel mentor. Flaubert le forme, lui interdit de publier trop tôt, le fait écrire, réécrire, gommer, tailler. Pas de gras, pas d’effets, pas d’adjectifs en trop. Sept ans de ce régime. Maupassant apprend la patience, puis, en 1880, il frappe fort : Boule de Suif. Un chef-d’œuvre en une trentaine de pages. Succès immédiat. Zola exulte, les éditeurs rappliquent, le public suit. Maupassant est lancé. III. Dix ans de vitesse pure (1880-1890) Dix ans, pas un de plus. Dix ans à écrire comme si chaque jour était compté. Trois cents nouvelles, six romans, des récits de voyage. Une frénésie. Il impose son style : sec, direct, acéré. Il raconte la bêtise, la mesquinerie, les petites lâchetés de tous les jours. Il observe sans juger. Pas besoin. Les personnages se chargent de leur propre chute. Les nouvelles s’accumulent, percutantes comme des éclats de verre : La Parure, portrait cruel de la vanité sociale. Le Papa de Simon, l’enfance malmenée. Le Rosier de Madame Husson, l’hypocrisie provinciale. Les romans suivent, plus longs, plus sombres : Une vie (1883), la lente désillusion d’une femme. Bel-Ami (1885), le cynisme triomphant du médiocre. Pierre et Jean (1888), une mécanique d’horloger sur la jalousie et l’identité. Et puis, vers 1885, quelque chose se dérègle. Le fantastique s’infiltre. Le Horla (1887), Qui sait ? (1890), La Peur (1884). Des présences invisibles, des esprits qui vacillent. C’est que l’auteur lui-même commence à sombrer. IV. Déchéance et hallucinations Depuis des années, un mal le ronge. La syphilis, cadeau oublié d’une jeunesse trop ardente. Il n’en parle pas. Il écrit, encore, il fuit. Il fuit dans le voyage, les bateaux, l’Algérie, l’Italie. Il fuit dans le sexe, les maisons closes, la luxure méthodique. Il fuit dans l’opium, l’absinthe, les paradis chimiques. Mais le mal est là. Il voit des ombres, entend des voix, sent des présences. Il n’a plus besoin d’écrire du fantastique, il le vit. En 1891, c’est fini. Il délire, tente de se trancher la gorge, ne reconnaît plus personne. Interné à la clinique du docteur Blanche, à Passy. Comme son narrateur du Horla. Le 6 juillet 1893, il meurt. 43 ans. V. Et après ? Après, il reste tout. Un auteur immense, une langue d’une clarté implacable, une modernité intacte. Son fantastique influencera Lovecraft, Borges, Stephen King. Son réalisme marquera Simenon, Camus, Sartre. On le lit encore, on l’étudie toujours. Il est là, intact. Parce que Maupassant n’a pas enjolivé. Il a juste regardé.|couper{180}

Lectures
Le Horla, ancêtre du Mythe de Cthulhu ?
croquis de H. P. Lovecraft En suivant les divers épisodes de la vie de Lovecraft à N.Y, et en replongeant inopinément dans le Horla de Maupassant je me suis mis à imaginer des liens et pourquoi pas une filiation profonde, qui pourtant est rarement soulignée. Lovecraft et Maupassant partagent un même vertige, une même fascination pour l’invisible qui ronge le réel, pour l’effondrement de la raison devant l’indicible**. 1. Le Horla, ancêtre du Mythe de Cthulhu ? Dans Le Horla (1887), le narrateur est envahi par une présence invisible, qui le domine, l’affaiblit, le parasite. Cet être, venu d’ailleurs, semble appartenir à une race supérieure, imperceptible pour l’homme. Or, cette idée est au cœur du Mythe de Cthulhu. Chez Lovecraft, les Grands Anciens sont des entités cosmiques qui existent hors de notre perception immédiate. Ils ne sont ni dieux ni démons, mais des forces naturelles d’une autre dimension, que nos sens limités ne peuvent appréhender. Dans Le Horla, Maupassant écrit : "L’Homme est un être minuscule, limité, enfermé dans la prison de ses sens." Cette phrase aurait pu être écrite par Lovecraft lui-même, qui développe la même idée : notre réalité est une illusion fragile, et derrière, grouille un univers que nous ne pourrions supporter. 2. La folie comme révélation ultime Maupassant et Lovecraft partagent une même mécanique narrative : le basculement progressif vers la folie. Dans Le Horla, le journal du narrateur devient de plus en plus fragmenté, il tente désespérément de donner du sens à ce qui lui arrive, mais sa raison se disloque sous l’influence du surnaturel. Chez Lovecraft, ce schéma est omniprésent : dans L’Appel de Cthulhu, Dagon ou Le Cauchemar d’Innsmouth, les personnages comprennent progressivement qu’ils ne contrôlent rien, que des forces cosmiques dirigent leur destin. Chez l’un comme chez l’autre, comprendre le monde tel qu’il est réellement mène à la démence. 3. Une horreur de l’invisible, du diffus, de l’indicible Maupassant et Lovecraft évitent le monstre grotesque et tangible du fantastique traditionnel. Leur horreur est abstraite, impalpable. Le Horla ne se montre jamais. Il est là, mais sans corps, sans visage, sans preuve matérielle. Il se devine, se ressent, il agit sans être vu. Lovecraft développe exactement cette idée avec ses créatures non-euclidiennes, aux formes impossibles, que l’œil humain ne peut saisir pleinement. C’est une terreur qui naît du manque, de l’absence, de l’idée que nous ne percevons qu’une infime part du réel. 4. Maupassant, pionnier du "cosmicisme" ? Lovecraft théorise ce qu’il appelle le "cosmicisme", une vision du monde où l’humanité est insignifiante face à l’immensité du cosmos. Or, cette angoisse existe déjà chez Maupassant. Dans Le Horla, le narrateur découvre un article de journal qui mentionne une race invisible, dominant peut-être déjà l’humanité. On retrouve ici un thème fondamental de Lovecraft : L’homme n’est qu’une poussière, et l’univers abrite des êtres si vastes, si puissants, qu’ils ne prennent même pas la peine de le remarquer. Conclusion : une filiation souterraine mais évidente Lovecraft ne semble pas citer Maupassant comme une influence directe, mais les parallèles entre leurs œuvres sont frappants. Le Horla préfigure totalement la peur lovecraftienne de l’invisible, du "monde derrière le monde", de l’effondrement de la raison devant l’inconcevable. Maupassant a intériorisé l’horreur, Lovecraft l’a cosmologisée. Mais au fond, ils racontent la même chose : 👉 L’univers n’est pas ce que nous croyons, et il vaut peut-être mieux ne jamais le comprendre. Pour Lovecraft, l’événement déclencheur n’est pas une guerre subie, mais une crise existentielle profonde liée à la Première Guerre mondiale et au déclin de la civilisation occidentale qu’il perçoit comme inéluctable. 1. La Première Guerre mondiale : un choc à distance Contrairement à Maupassant, qui vit directement la guerre de 1870, Lovecraft ne combat pas en 1914 – il est jugé trop fragile physiquement et mentalement. Mais il vit cette guerre comme un traumatisme intellectuel et philosophique. Il voit le monde ancien s’effondrer sous les bombes, les valeurs victoriennes disparaître, et surtout, la science produire une horreur sans précédent : Des millions de morts à cause de la technologie moderne. Des armes chimiques qui transforment la nature en cauchemar. Une guerre absurde, mécanique, froide, qui révèle l’indifférence totale de l’univers face à l’humanité. Lovecraft n’écrit pas sur la guerre, mais sa vision du monde s’en trouve profondément modifiée : l’homme n’est plus au centre du monde, il n’est qu’un insecte piégé dans un cosmos indifférent. 2. La découverte de l’astronomie : un vertige cosmique Autre événement clé : la prise de conscience de l’immensité de l’univers. Lovecraft est passionné par l’astronomie et il comprend, avec effroi, que l’humanité est un point minuscule dans un espace infini, sans but ni sens. Il le dit lui-même : "L’univers est infiniment plus vaste, plus ancien et plus étranger que ce que nous pouvons concevoir." Cette idée, qui surgit au tournant du XXe siècle avec la relativité et la physique quantique, détruit les dernières illusions sur une humanité centrale et protégée. 3. L’effondrement personnel : la crise de 1908 Mais s’il fallait un événement intime, ce serait l’année 1908, où Lovecraft s’effondre psychiquement. À 18 ans, il échoue à entrer à l’université de Brown. Il s’enferme chez lui, sombre dans une réclusion totale, vit la nuit, dort le jour. Il traverse une profonde crise dépressive, nourrie par un sentiment d’infériorité écrasant et une peur maladive du monde extérieur. C’est pendant ces années de solitude qu’il commence à développer sa vision du monde : un univers où l’homme est insignifiant, où la raison n’est qu’un fragile vernis. Comparaison avec Maupassant : une terreur intime qui devient universelle Maupassant découvre l’horreur dans la guerre, dans l’absurde des combats, dans l’effondrement des illusions bourgeoises. Lovecraft découvre l’horreur dans l’immensité du cosmos, dans l’insignifiance de l’homme, dans la folie d’un univers sans ordre ni justice. Mais tous deux en tirent une même leçon : 👉 L’homme croit comprendre le monde. Il se trompe. Et lorsqu’il entrevoit la vérité, il sombre dans la folie.|couper{180}

Lectures
Le Horla : hantise intérieure, folie du dehors
Le Horla connaît deux versions : Première version (1886) : Il s’agit d’une nouvelle plus courte, publiée dans le journal Gil Blas le 26 octobre 1886. Le récit est à la troisième personne et adopte une structure plus classique. Deuxième version (1887) : C’est la version définitive, entièrement remaniée et développée sous forme de journal intime. Elle paraît d’abord dans Le Gil Blas le 9 mai 1887, puis est publiée en volume en octobre 1887 chez Paul Ollendorff. C’est donc cette seconde version qui est la plus connue aujourd’hui et qui marque l’apogée du fantastique maupassantien.|couper{180}
