Lectures
Dans Lectures, je rassemble des textes qui lisent autant les livres que leurs échos : portraits d’auteurs (Lovecraft, Maupassant, Sebald, Knausgård…), analyses thématiques (mémoire, espaces souterrains, rituel, minimalisme), et ponts entre œuvres et idées (réalisme magique, New Weird, steampunk, théorie de la narration). Plutôt que des critiques formatées, ce sont des notes argumentées : résumés sans divulgâcher, mises en contexte, rapprochements historiques, styles repérés, citations brèves.
contenu de la rubrique Lectures :
Auteurs & œuvres : dossiers, lectures suivies, cycles (Lovecraft et ses héritages, Dunsany, Sebald, Capote, Faulkner, Knausgård).
Genres & courants : New Weird, réalisme magique, steampunk, autofiction, poésie, essais et sciences humaines.
Théorie & pratique : formes narratives (arc, fragment, monologue), contrat auteur·lecteur, “traduction” d’un style (le “Horla”, le “style Sebald”), liens entre écrire et lire.
Cartes et liens : pistes de lecture, intertextes, rapprochements inattendus (Maupassant ↔ mythe de Cthulhu, archives et « cloud » avant l’informatique, villes réelles et villes imaginaires).
Fil conducteur : comprendre ce que fait un texte — au niveau du rythme, de la voix, des motifs — et où il nous mène. Les billets alternent portraits, fiches analytiques et essais courts, avec un maillage vers les rubriques voisines (fictions, carnets, mythes) pour prolonger la lecture.
Quelques thèmes récurrents :
- mémoire et traces - espaces/lieux (souterrains, murs, villes)
- rituels
- l’étrangeté du quotidien
- techniques du récit
- héritages et détours (de Dunsany à Lovecraft, de Perec à Rabelais)
- poétique de la sincérité et du doute
Objectif : offrir un lieu où la lecture devient laboratoire — pour choisir ses prochains livres, mais surtout pour voir comment ces lectures travaillent l’imaginaire
Lectures
La vie des maîtres, Spalding
Années 1920, à Los Angeles : fin d’après-midi sur Broadway, un panneau lumineux diffuse une réclame pour une conférence sur les “mystères de l’Orient”. Dans une salle bondée du Trinity Auditorium, les badauds se pressent. On peut y croiser Manly P. Hall, auteur et ésotériste en vue . Là aussi aurait pris la parole, selon la légende, Baird T. Spalding, un homme dont le nom est aujourd’hui oublié, mais qui affirmait avoir côtoyé des maîtres immortels au Tibet. Spalding, Américain né en 1872 à Cohocton (New York), issu d’un milieu ordinaire, ingénieur, prospecteur, orateur. Il ne s’est jamais proclamé maître spirituel, mais raconte, avec pudeur, un voyage initiatique — réel ou fantasmé — dans l’Himalaya. Aucun élément solide ne confirme son périple . Mais en 1924, il publie La Vie des Maîtres, un récit de contact avec des êtres invisibles, placés dans le pendant exotique de cet âge de l’entre-deux-guerres. Dans ce Los Angeles d’émerveillement consumériste — cafés enfumés, néons, jazz, Hollywood naissant — Spalding n’est pas charlatan, juste un homme qui capte l’air du temps. Là où la ville recherche du sensationnel, une harmonie cosmique ou un sens invisible au tumulte moderne, lui propose un récit : la sagesse venue d’ailleurs, offerte comme une promesse douce, non revendicative, irrésistible. L’Amérique sort de la Grande Guerre avec le sentiment d’entrer dans un âge neuf. Les usines tournent, les rues de New York, Chicago, Los Angeles s’emplissent d’automobiles rutilantes. La Bourse flambe, les fortunes s’affichent dans les gratte-ciel. Mais derrière ce vernis prospère, une inquiétude sourd : modernité trop rapide, crise religieuse, peur que le progrès matériel ne laisse l’âme à la traîne. Dans ce climat, la demande d’« autre chose » explose. Sur la côte Est, on lit les écrits de la Société Théosophique. À Chicago, des loges rosicruciennes tiennent réunion dans des hôtels anonymes. À Los Angeles, les salles de conférence accueillent Manly P. Hall et ses causeries sur la sagesse antique. Partout, les librairies voient fleurir des volumes aux titres prometteurs : Les Lois de la pensée constructive, Les Puissances de l’esprit, La Science de la prospérité. Spalding se glisse dans ce marché culturel. Ingénieur de formation, familier du langage scientifique, il sent que le public veut des preuves, des récits concrets, pas seulement des théories. Là où Blavatsky avait bâti une doctrine, il choisit l’histoire. Il transforme l’imaginaire des « Maîtres himalayens » — déjà popularisé par la Théosophie — en une narration vivante, présentée comme témoignage. Ce n’est pas seulement l’inspiration orientale qui séduit : c’est la forme. Un voyage, des rencontres, des dialogues. Un roman spirituel camouflé en journal de bord. Dans une Amérique qui croit aux récits de self-made men et de conquêtes, La Vie des Maîtres épouse la même logique : la sagesse orientale servie comme une aventure moderne, à la première personne, pour un public qui n’a pas besoin d’y croire entièrement pour se laisser emporter. En 1924 paraît à DeVorss & Company, Los Angeles, un volume au titre modeste : Life and Teaching of the Masters of the Far East. Couverture austère, texte en anglais simple, sans apparat. Mais le contenu frappe d’emblée : un récit de voyage initiatique, où un petit groupe d’Occidentaux, mené par Spalding, traverse l’Inde et le Tibet à la rencontre de maîtres immortels. Les pages regorgent de scènes miraculeuses : matérialisation instantanée d’objets, guérisons par l’esprit, traversée de rivières à pied sec. Les dialogues avec les Maîtres alternent sentences édifiantes et démonstrations de pouvoir. Tout est raconté comme un carnet de route : nous étions là, nous avons vu, voilà ce qu’ils nous ont dit. Le livre ne tarde pas à trouver son public. Dans l’Amérique des Années folles, avide de récits exotiques, il devient un succès d’édition inattendu. Les lecteurs n’y cherchent pas seulement des preuves, mais un rêve : confirmation qu’au-delà du monde affairé des usines et des marchés, il existe un autre plan, accessible à ceux qui osent le croire. Le succès est tel que Spalding publiera cinq autres volumes, entre 1924 et 1955, tous variations autour du même motif. Aucun ne renouvelle vraiment la matière : toujours le voyage, les maîtres, les enseignements. Mais peu importe. Le filon est trouvé, et le public suit. La Vie des Maîtres n’est pas présenté comme une fiction, ni même comme un roman édifiant, mais comme un témoignage direct. C’est ce qui fit sa force : ce n’était pas un livre de doctrine, mais un récit. Et dans une Amérique qui croyait aux récits plus qu’aux systèmes, cela suffisait pour séduire. Très vite, des voix s’élèvent. Des journalistes et des chercheurs tentent de vérifier le récit de Spalding : aucun registre de voyage, aucune trace douanière, aucun témoin indépendant. Les lieux décrits ne correspondent pas toujours à la réalité, les « dialogues » avec les Maîtres reprennent parfois, mot pour mot, des éléments issus de la Théosophie ou du New Thought. Les critiques dénoncent un montage littéraire, une fiction habillée en témoignage. Dans les cercles ésotériques plus exigeants — guénoniens, rosicruciens ou théosophes fidèles à la doctrine originale — La Vie des Maîtres passe pour une contrefaçon. Pas de lignée, pas de légitimité initiatique : une simple mise en scène pour séduire le public. Mais le scandale ne prend pas vraiment. La majorité des lecteurs n’attendent pas de preuves. Ils ne cherchent pas une démonstration, mais une histoire à laquelle se laisser porter. Le succès commercial du livre montre que la critique n’atteint pas son cœur : l’imaginaire. Spalding, lui, reste insaisissable. Pas de défense agressive, pas de justification détaillée. Il continue de publier, donne des conférences, entretient sa légende sans s’exposer. Comme s’il savait que l’essentiel n’était pas de convaincre, mais de maintenir vivant le rêve. Avec le recul, la trajectoire de Spalding ressemble moins à une carrière d’écrivain qu’à l’exploitation obstinée d’un filon. Les cinq volumes qui suivirent La Vie des Maîtres ne s’écartent jamais du premier canevas : voyages en Orient, rencontres avec des sages, dialogues édifiants, miracles. Aucune variation formelle, aucune autre tentative littéraire. Pas de roman, pas de poésie, pas de nouvelle. En cela, il diffère radicalement de figures comme Clark Ashton Smith ou Lovecraft. Eux savaient qu’ils écrivaient de la fiction, et la poussaient jusqu’à l’excès, l’expérimentation, l’invention de mondes. Spalding, au contraire, présente son récit comme un témoignage. Là où Lovecraft tire de la Théosophie un décor cauchemardesque, Spalding en fait une chronique spirituelle naïve. Ce qui frappe, c’est sa posture. Il ne revendique pas le statut d’écrivain, mais celui de voyageur qui rapporte. Il ne cherche pas à rivaliser sur le terrain littéraire, mais à séduire par la simplicité de son ton, par l’illusion du vécu. Son succès tient justement à cette ambiguïté : il n’offre pas un roman à lire, mais une histoire à croire. Spalding n’est donc pas un auteur au sens classique, mais un conteur spirituel. Son livre unique, répété en série, appartient moins à la littérature qu’à la tradition du récit édifiant. Et c’est peut-être ce qui lui a donné sa force : parler à des lecteurs qui n’avaient pas besoin de littérature, mais d’une légende rassurante. Malgré les doutes, malgré l’absence de preuves, Spalding ne passe pas pour un imposteur cynique. Son récit n’a rien d’une doctrine oppressante ni d’une idéologie politique. Pas d’aryanisme, pas de hiérarchie raciale, pas de manipulation collective. Seulement l’histoire d’hommes simples qui rencontrent des sages immortels et apprennent auprès d’eux des vérités de compassion, de maîtrise de soi, de reliance au cosmos. C’est peut-être cette modestie relative qui le rend encore attachant. Là où d’autres mouvements ésotériques cherchaient à imposer des dogmes, Spalding se contente de proposer un rêve. Son livre n’endoctrine pas, il transporte. Le lecteur n’y trouve pas un système, mais une suite d’images : un maître qui marche sur l’eau, une guérison instantanée, une parole qui apaise. On peut sourire de la naïveté, dénoncer l’invention, mais on peine à le charger de malveillance. Il n’a pas bâti une église, il n’a pas levé de disciples armés, il n’a pas transformé sa fiction en pouvoir. Il a écrit un livre qui a plu, et il a su en prolonger l’écho. Spalding reste ainsi une figure paradoxale : suspect pour les puristes, inspirant pour les lecteurs, inoffensif dans ses ambitions. Un écrivain malgré lui, qui aura donné à l’Amérique des années 1920 une légende douce, plutôt qu’un catéchisme. Ce qui rend La Vie des Maîtres intéressant aujourd’hui, ce n’est pas tant la question de savoir si Spalding a menti que ce qu’il révèle d’un basculement. Son livre n’est ni un roman assumé comme chez Lovecraft, ni un traité doctrinal comme chez Blavatsky. Il est entre les deux : une fiction présentée comme un témoignage. Cette ambiguïté a fait son succès et explique sa longévité. Le lecteur n’était pas obligé d’y croire totalement. Il suffisait de suspendre son scepticisme, le temps de la lecture, et d’accepter l’hypothèse : « et si c’était vrai ? » Dans ce glissement, on retrouve un trait majeur de la modernité spirituelle : la porosité entre récit et réalité. Depuis, ce brouillage n’a cessé de s’accentuer. Le New Age des années 1960-70 a repris les Maîtres, les Archives akashiques, les énergies invisibles. Les forums du tournant des années 2000 ont recyclé l’Himalaya, l’Atlantide, les civilisations perdues comme autant de pseudo-preuves. Aujourd’hui encore, des discours complotistes ou transhumanistes reprennent ces mythes en les habillant de vocabulaire scientifique. Spalding, à sa manière, a anticipé cette confusion. En écrivant un récit qu’on pouvait lire à la fois comme fiction et comme témoignage, il a incarné cette zone grise où l’imaginaire devient croyance. Et cette zone grise, loin de se réduire, semble être devenue le régime normal de nos récits contemporains.|couper{180}

Lectures
critique de la théosophie, René Guénon
En 1921 paraît à Paris un livre au titre sec, presque polémique : Le Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion. Son auteur, René Guénon, a trente-cinq ans. Peu connu encore, déjà redouté. Son style tranche : pas d’emphase, pas de décor. Il ne raconte pas l’aventure de Blavatsky, il l’exécute. Guénon ne se place pas sur le même terrain qu’elle. Là où Blavatsky promettait un savoir total, une synthèse de l’Orient et de l’Occident, il revendique un autre critère : la légitimité. Un ésotérisme n’a de valeur que s’il s’inscrit dans une lignée, une chaîne initiatique, une transmission. Tout le reste n’est que jeu de façade, illusion moderne. Dans ses autres livres — La Crise du monde moderne, Le Règne de la quantité— Guénon élargira cette critique au rationalisme, à la démocratie, à la science occidentale. Mais dans le cas de la Théosophie , sa cible est précise : Blavatsky et ses disciples ont bâti, dit-il, une pseudo-religion qui mime l’ésotérisme, en détourne les symboles, mais n’a ni racine ni autorité. C’est une autre voix qui surgit au XXᵉ siècle, implacable. Là où la Théosophie séduisait par son vertige de totalité, Guénon impose la coupe nette : il n’y a pas de savoir sans filiation, pas d’initiation sans transmission. Le reste, pour lui, n’est qu’imposture moderne. Pour Guénon, tout commence par là. Une tradition n’est pas un assemblage d’idées séduisantes ni une esthétique de l’ésotérisme. Elle ne vaut que par la continuité d’une filiation, la reconnaissance d’une chaîne initiatique. C’est ce lien invisible qui fonde l’autorité, qui distingue la connaissance vraie de l’improvisation. Ainsi le soufisme en islam, l’hindouisme avec ses écoles métaphysiques, le taoïsme en Chine, ou même certains courants ésotériques du christianisme : chacun s’appuie sur une transmission vivante, sur des maîtres identifiables, sur une mémoire reçue et transmise. La Théosophie n’a rien de cela. Blavatsky évoque des maîtres invisibles, des Mahatmas entrevus dans les replis de l’Himalaya. Des lettres tombées du ciel, des communications mystérieuses. Mais pas de lignée, pas d’initiation, pas de continuité vérifiable. Pour Guénon, tout repose sur du sable. La clé de sa critique est simple : sans filiation, pas de légitimité. Et sans légitimité, pas de véritable ésotérisme. La Théosophie n’est pas une sagesse oubliée retrouvée, c’est une invention moderne qui singe la forme de l’initiation mais en a perdu la substance. Une façade brillante, un décor. Derrière : rien. Au cœur de la mise en scène de Blavatsky se trouvent les Mahatmas. Ces maîtres orientaux censés dicter la doctrine depuis leurs retraites himalayennes, invisibles, inaccessibles. On montrait des lettres mystérieusement matérialisées, tombées d’un placard ou glissées sous une porte, comme preuve d’un contact direct avec une sagesse supérieure. Pour Guénon, c’est là que l’imposture éclate. Les Mahatmas ne sont pas une lignée, mais une fiction commode. Ils servent d’autorité fictive à un système sans racine, garantissent une façade exotique pour séduire un public occidental avide d’Orient. Derrière l’apparence, rien de transmissible. Le danger, dit-il, n’est pas seulement la naïveté. C’est la contrefaçon. Une pseudo-initiation qui mime les formes sacrées mais détourne les chercheurs de la vraie voie. Le prestige du secret et du caché ne remplace pas l’autorité d’une tradition vivante. Guénon tranche : ces maîtres invisibles ne sont qu’un mirage. Leur invocation ne révèle pas une profondeur, mais un vide. Une manière moderne d’inventer une légende pour masquer l’absence de filiation. La Théosophie a séduit parce qu’elle parlait la langue de son temps. Blavatsky et ses disciples ont mêlé des bribes d’hindouisme et de bouddhisme à une kabbale réinventée, saupoudré le tout de termes scientifiques : énergies, vibrations, fluides. Le XIXᵉ siècle voulait concilier science et mystère ; la Théosophie a offert ce mélange prêt-à-consommer. Pour Guénon, c’est là tout le problème. Les concepts orientaux sont simplifiés jusqu’à devenir caricatures. Le karma devient une mécanique de récompense et de punition, la réincarnation une succession d’existences à comptabiliser, les cycles cosmiques une sorte d’histoire naturelle des peuples. Rien de l’intériorité subtile des doctrines originelles ne subsiste. Ce qu’il voit, c’est une fabrication moderne, taillée pour flatter la curiosité occidentale : exotisme, spectaculaire, promesse d’accès immédiat aux secrets du monde. Le public croit accéder à une sagesse antique ; il ne fait que consommer un produit adapté à son goût. Guénon appelle cela une contrefaçon spirituelle. Une doctrine qui brille par son vernis, mais dont le cœur est vide. Le piège de la modernité : donner l’illusion du sacré en reprenant ses signes extérieurs, alors que la substance a disparu. Guénon ne s’est jamais voulu homme politique. Dans sa jeunesse, il a croisé l’Action française et les milieux ésotéristes catholiques, mais il s’en est vite détourné : trop de manœuvres, pas assez de substance. Ce qui l’intéresse, c’est l’ordre spirituel, pas la conquête du pouvoir. Son antimodernisme radical l’a pourtant rapproché de penseurs conservateurs. Son rejet du rationalisme, de la démocratie, de la science profane pouvait séduire certains milieux d’extrême droite. Julius Evola, par exemple, s’inspire largement de Guénon, mais pour en faire une arme politique, guerrière, fasciste. Guénon s’en est toujours méfié. Il n’était ni nationaliste ni raciste. Pour lui, la Tradition primordiale dépasse les peuples et les frontières. Ce qui compte, ce n’est pas l’identité politique, mais la filiation spirituelle. Sa conversion à l’islam soufi et son installation définitive en Égypte, sous le nom d’Abdel Wahid Yahia, en disent long : il choisit l’ancrage dans une tradition vivante, et le retrait des combats politiques. Reste que ses écrits ont été récupérés par des camps très divers : catholiques intégristes, traditionalistes européens, chercheurs de voies spirituelles orientales. Guénon refusait ces usages, mais son œuvre, par son intransigeance et son refus du monde moderne, prêtait à toutes les appropriations. Pour Guénon, la Théosophie n’est pas seulement une erreur parmi d’autres : c’est l’exemple type de ce qu’il appelle une contre-initiation. Tout y est : les signes extérieurs de l’ésotérisme, le vocabulaire du secret, l’appel aux traditions orientales, et derrière, l’absence de filiation, l’absence d’autorité réelle. Elle sert de modèle à ce qu’il dénonce ailleurs : les pseudo-religions modernes, les mouvements qui imitent la structure du sacré pour séduire mais ne transmettent rien. Le spiritisme, les néo-rosicruciens, les occultismes de pacotille — tous fonctionnent selon lui sur la même logique. Mais la Théosophie occupe une place centrale, car elle a réussi à se donner une aura internationale et à séduire jusqu’aux élites. Dans sa critique, Guénon n’épargne pas non plus le public. Si la Théosophie prospère, c’est parce que les modernes sont avides d’ésotérisme rapide, de révélations sans travail, d’un accès immédiat au savoir total. Le succès de Blavatsky dit quelque chose du vide spirituel de l’époque. La Théosophie devient ainsi, sous la plume de Guénon, le symptôme par excellence : celui d’un monde en quête de substituts, fasciné par l’apparence, incapable de reconnaître la profondeur véritable. Blavatsky avait proposé un savoir total, une carte grandiose où tout pouvait se relier — science, religion, mythe, Orient et Occident. Guénon, trente ans plus tard, a tranché net : ce n’était pas une tradition, mais une contrefaçon. D’un côté, la Théosophie comme laboratoire de mythes, fécondant les artistes, alimentant la culture populaire, nourrissant des imaginaires jusqu’à aujourd’hui. De l’autre, la Théosophie comme pseudo-religion paradigmatique, signe de la décadence moderne, piège séduisant pour des chercheurs d’absolu mal orientés. Ces deux récits ne peuvent pas se rejoindre. Ils parlent du même objet mais en changent le sens. L’un regarde la fécondité culturelle, l’autre juge la validité spirituelle. Entre eux, une ligne de fracture. La question reste ouverte : que vaut un mythe qui inspire et irrigue si, pour un métaphysicien, il n’est qu’illusion ? Peut-on mesurer une doctrine à ce qu’elle transmet, ou à ce qu’elle déclenche ? Deux manières d’évaluer l’héritage, et peut-être deux manières irréconciliables d’habiter le monde. illustration dessin portrait de R. Guénon, Pierre Laffille|couper{180}

Lectures
Parcours d’une idée, la théosophie
New York, 1875. Dans un salon enfumé, encombré de livres et de bibelots orientaux, Helena Petrovna Blavatsky et Henry Steel Olcott posent les bases de ce qui deviendra la Société théosophique. Elle, aventurière russe, grande raconteuse d’histoires, revenue d’Inde et du Tibet avec des récits de maîtres invisibles. Lui, avocat américain, organisateur méthodique et propagandiste efficace. À deux, ils scellent une alliance improbable : la flamboyance d’une visionnaire et la rigueur d’un fonctionnaire. Leur époque vacille. Les religions traditionnelles perdent leur emprise, le spiritisme fait fureur dans les salons, Darwin bouleverse l’idée d’origine, l’Orient attire les imaginaires fatigués de l’Occident. Dans ce mélange d’incertitude et de curiosité, la promesse de Blavatsky tombe comme une évidence : il existe une sagesse universelle, plus ancienne que les religions, plus profonde que la science, capable de réconcilier toutes les contradictions. La Théosophie se présente comme un savoir total. Elle promet de relier la physique moderne et les Védas, la kabbale et le bouddhisme, les sciences naturelles et l’occultisme. Pas seulement un système de croyances : une clé pour comprendre l’histoire entière de l’humanité, son origine, son destin, ses cycles. Les continents disparus, les civilisations englouties, les « races-racines » : tout trouve une place dans cette cartographie grandiose, à la fois érudite et fantasmatique. C’est ce vertige de totalité qui séduit : un récit où rien n’est laissé au hasard, où tout se relie. Une promesse de pouvoir aussi : détenir la connaissance des origines, des fins et des lois secrètes, c’est déjà s’installer dans la position d’une élite éclairée. Helena Blavatsky est la grande prêtresse de ce système. Dans Isis dévoilée (1877) puis La Doctrine secrète (1888), elle prétend révéler la trame invisible de l’univers. Les textes mêlent citations érudites, fragments d’écritures sacrées, spéculations pseudo-scientifiques et visions personnelles. Tout est agencé comme si une logique profonde liait le passé de l’humanité et son avenir. On y croise des civilisations perdues, des maîtres invisibles, des cycles d’évolution immenses. Blavatsky se présente moins comme une autrice que comme la porte-parole d’une tradition universelle, transmise par des initiés tibétains ou indiens. Autour d’elle gravitent d’autres figures. Henry Steel Olcott, cofondateur, assure l’assise administrative et politique de la Société, notamment en Inde où il contribue à un renouveau du bouddhisme. Annie Besant, ancienne militante féministe et socialiste, prend la tête du mouvement après la mort de Blavatsky : elle allie ésotérisme et action politique, devenant une voix importante de l’indépendance indienne. Charles Webster Leadbeater, plus controversé, revendique des dons de clairvoyance et de télépathie. C’est lui qui pousse la Société à présenter un jeune Indien, Krishnamurti, comme « l’instructeur du monde » — messie à peine adolescent, destiné à guider l’humanité. Mais ce qui fixe l’imaginaire, ce sont les grands mythes : les « races-racines », sept humanités successives traversant les âges ; les continents disparus comme la Lémurie et l’Atlantide, préfigurations d’une Hyperborée idéalisée ; les cycles cosmiques où chaque civilisation naît, s’élève, décline et s’efface. Tout y est présenté comme une science, mais une science du caché, du secret. Ces images sont puissantes parce qu’elles combinent deux forces : la rigueur apparente d’une classification quasi scientifique, et la démesure de récits mythologiques. Elles donnent l’impression qu’un ordre secret gouverne l’histoire et que certains, les initiés, en détiennent la clé. La force de la Théosophie vient aussi de sa capacité à recycler. Blavatsky ne crée pas un univers ex nihilo : elle assemble, traduit, simplifie. Elle puise dans des traditions anciennes, les met en correspondance et les réécrit pour un public occidental avide d’exotisme et de certitudes nouvelles. Côté Occident, elle revendique l’héritage du néoplatonisme, des rosicruciens, de l’hermétisme de la Renaissance, de la kabbale chrétienne. Autant de courants où le monde est pensé comme un enchevêtrement de correspondances entre haut et bas, visible et invisible. Elle les modernise en leur donnant le langage du XIXᵉ siècle : un vocabulaire scientifique, fait d’énergies, de vibrations, de fluides. Côté Orient, elle s’appuie sur des fragments d’hindouisme et de bouddhisme — karma, réincarnation, cycles cosmiques. Mais ces concepts sont simplifiés, transformés en lois quasi physiques de l’univers, bien loin de leur subtilité d’origine. Le bouddhisme devient une « science de l’esprit », l’hindouisme une cartographie de l’âme. Enfin, elle croise ces influences avec les modes de son temps : le magnétisme, les expériences spirites, les sciences psychiques. Les médiums et les tables tournantes trouvent place dans le grand récit théosophique comme autant de « preuves » des mondes invisibles. La Théosophie se présente ainsi comme une machine à réactiver les traditions. Elle traduit l’ancien dans une langue neuve, et offre à ses lecteurs l’illusion d’un savoir total : l’impression que toutes les religions, toutes les sciences, toutes les philosophies disent la même chose depuis toujours — mais que seuls les initiés savent l’entendre. Ce grand récit n’a pas seulement séduit des croyants. Il a servi de réservoir à des créateurs en quête de formes nouvelles. La Théosophie offrait un langage où l’art pouvait devenir expérience spirituelle, outil de révélation, presque rituel. Le poète irlandais W. B. Yeats adhère à la Société théosophique avant de s’en éloigner, mais il garde toute sa vie ce goût pour l’ésotérisme et les correspondances invisibles. Dans sa poésie, l’image n’est jamais seulement décor : elle est signe, clé, accès à un autre plan. Les peintres de l’abstraction, Kandinsky, Mondrian, Hilma af Klint, ont puisé eux aussi dans cet imaginaire. Hilma af Klint, en particulier, affirme peindre sous la dictée de « maîtres spirituels » ; ses toiles circulaires, vibrantes de formes géométriques, sont pensées comme des cartes cosmiques. Mondrian, derrière ses lignes droites et ses aplats de couleur, cherche une harmonie universelle. Kandinsky écrit Du spirituel dans l’art : un manifeste où chaque forme, chaque couleur doit traduire une vibration intérieure. En musique, Scriabine rêve d’une œuvre totale, une symphonie cosmique qui unirait sons, lumières et parfums pour déclencher l’extase collective. Sa dernière partition, inachevée, devait s’intituler Mysterium et être jouée au pied de l’Himalaya, dans un temple ouvert sur l’infini. Du côté de la littérature de l’imaginaire, Lovecraft et Clark Ashton Smith se saisissent de ces mythes à leur manière : fascinés par l’Atlantide, l’Hyperborée, mais sceptiques, ils les transforment en décors de cauchemar, en ruines inquiétantes. Chez eux, la théosophie est détournée, ironisée, mais elle irrigue pourtant leurs mondes. La Théosophie devient ainsi un laboratoire de mythes : certains artistes y trouvent une foi, d’autres un matériau, d’autres encore un repoussoir. Tous y rencontrent une même promesse : qu’au-delà du visible, quelque chose vibre et attend d’être révélé. Là où Blavatsky parlait de fraternité universelle, d’autres ont retenu surtout l’idée de « races-racines ». Ce vocabulaire, encore teinté d’ésotérisme chez elle, s’est rigidifié en doctrine racialiste dans l’Europe germanique de la fin du XIXᵉ siècle. Des auteurs comme Guido von List ou Lanz von Liebenfels transforment les mythes théosophiques en idéologie. L’Hyperborée devient le berceau d’une race aryenne pure, les continents disparus des preuves d’une grandeur perdue à restaurer. On ne parle plus de cycles cosmiques mais de hiérarchie entre peuples, d’élection d’une élite nordique. Cette aryanisation de la Théosophie prend le nom d’Ariosophie. De là naît la Société Thulé, cercle occultiste où se mêlent mythologie germanique, nationalisme radical et antisémitisme. C’est dans cet arrière-plan que s’organisent les premiers cercles du parti nazi. Au sein du régime, l’occultisme reste marginal et ambivalent. Hitler méprise ces illuminés, qu’il juge dangereux pour la discipline du Reich. Mais d’autres, comme Himmler, s’y plongent avec ferveur. Le château de Wewelsburg est pensé comme un centre spirituel de la SS. L’Ahnenerbe, institut de recherches créé en 1935, envoie des expéditions au Tibet ou en Scandinavie pour « prouver » l’existence d’anciennes civilisations aryennes. La Théosophie, ainsi dévoyée, devient une arme idéologique. Elle offre une mythologie pseudo-scientifique qui justifie la hiérarchie raciale et légitime la violence. Ce qui était présenté comme une quête de sagesse universelle s’est transformé en langage de pouvoir, outil de domination. Le passage est révélateur : les mêmes mythes peuvent servir à rêver d’unité ou à construire l’exclusion. Tout dépend de la main qui s’en empare. Après 1945, l’occultisme nazi devient un repoussoir. Mais les mythes théosophiques, eux, ne disparaissent pas. Ils se déplacent, se métamorphosent. Dans les années 1960-70, le New Age reprend presque mot pour mot certains thèmes de Blavatsky et de ses successeurs : les Maîtres ascensionnés, la mémoire akashique, l’idée que l’humanité traverse des cycles et qu’une nouvelle ère de lumière s’ouvre. Ces concepts, qui avaient servi de caution idéologique aux pires dérives, sont recyclés en promesse d’harmonie, d’éveil personnel et de guérison spirituelle. La science-fiction et la fantasy s’emparent à leur tour de ce réservoir. Les continents engloutis, les races anciennes, les bibliothèques cosmiques deviennent des décors, parfois critiques, parfois exaltés. Les pulps d’hier irriguent les blockbusters d’aujourd’hui. On retrouve des traces de la Théosophie dans l’imaginaire des comics, des jeux de rôle, des sagas de fantasy planétaire. La culture populaire diffuse ainsi, souvent sans le savoir, des fragments de ce grand récit : civilisations perdues, énergies invisibles, élus promis à guider l’humanité. De fil en aiguille, ces mythes nourrissent aussi les spiritualités alternatives et les complotismes ésotériques. Dans les années 1990-2000, les forums en ligne bruissent de références à l’Atlantide, aux Archives akashiques, aux initiés cachés qui gouverneraient le monde. La Théosophie n’est plus une doctrine centrale, mais un filigrane persistant : une réserve de symboles qui ressurgit sous d’autres noms, dans d’autres discours, toujours prête à réenchanter ou à justifier. Aujourd’hui, la Théosophie n’apparaît plus en vitrine. Mais ses fragments circulent, comme un langage discret, souvent dans des cercles où pouvoir économique et quête spirituelle se confondent. On en retrouve l’écho dans certains milieux de la Silicon Valley, fascinés à la fois par le transhumanisme et par les récits de civilisations perdues. Derrière les discours sur l’immortalité technologique, le téléchargement de la conscience, la colonisation de Mars, résonne la même promesse que celle de Blavatsky : dépasser les limites de l’humain, franchir un seuil d’évolution. Les « races-racines » deviennent ici générations augmentées, sélectionnées par la biotechnologie et l’accès au capital. Chez certains ultra-riches, on voit se mêler pratiques spirituelles alternatives, recours à des gourous privés, fascination pour les mythes d’élection. L’idée d’appartenir à une minorité éclairée, détentrice d’un savoir secret ou d’un pouvoir de régénération, se répète presque à l’identique. Là où la Théosophie rêvait d’une sagesse universelle, on assiste à une réappropriation élitiste : les mythes deviennent outils de distinction sociale, justificatifs d’un droit à dominer ou à s’extraire du commun. Ce regain n’est pas visible dans les masses, mais il circule dans les marges du pouvoir, comme un soft power spirituel. La méditation de façade, les retraites chamaniques privatisées, la rhétorique de l’éveil personnel, tout cela fonctionne comme une réécriture contemporaine de la vieille promesse théosophique : posséder la clé d’un savoir total. Ainsi, la Théosophie n’a peut-être jamais autant ressemblé à ce qu’elle prétendait être : non pas une religion pour tous, mais un langage secret des élites, un outil symbolique de différenciation et d’influence. La Théosophie est née comme une promesse d’universalité : tout relier, tout expliquer, offrir à l’humanité une carte des origines et des fins. Mais cette promesse a connu des destins contrastés. Elle a nourri des artistes en quête de formes spirituelles, elle a été dévoyée en idéologie raciale, elle s’est recyclée dans le New Age et les spiritualités de masse, et elle refait surface aujourd’hui dans certains cercles élitistes, sous la forme d’une quête d’exception, de dépassement ou d’immortalité. Ce qui frappe, c’est la résilience du mythe : Atlantide, Hyperborée, races-racines, maîtres cachés. Ces récits survivent parce qu’ils comblent toujours le même vide : le besoin d’un sens global, d’une explication totale qui dépasse les religions établies et les sciences incertaines. Ils fascinent parce qu’ils sont malléables. Tantôt fraternité universelle, tantôt hiérarchie raciale. Tantôt quête artistique, tantôt justification du pouvoir. La Théosophie apparaît ainsi comme un laboratoire moderne de mythes : un dispositif où chacun vient puiser ce qu’il veut voir confirmé. Reste une question ouverte : pourquoi ces récits séduisent-ils aussi bien les marges que les centres du pouvoir ? Peut-être parce qu’ils donnent à la fois un vertige de totalité et un sentiment d’élection. Ils promettent de voir derrière le rideau, d’accéder à ce qui est caché. Et cette promesse — savoir ce que les autres ignorent, ou ce qu’on ne devrait pas savoir — continue d’être l’un des moteurs les plus puissants de l’imaginaire humain.|couper{180}
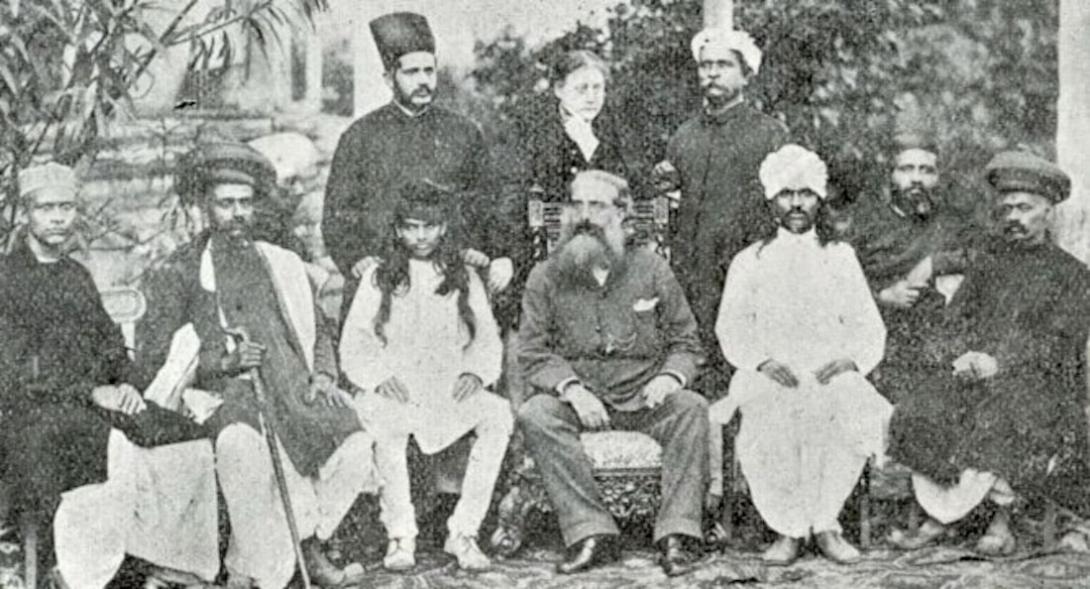
Lectures
Working Note : Writing to Live (or at Least to Try)
Il faudrait commencer par un chiffre, ou par un rêve. Peut-être les deux sont la même chose. Dix cents le mot pour les premiers milliers de mots, puis huit cents ensuite. Je l’ai vu noir sur blanc, dans les submission guidelines de Clarkesworld. Dix cents ! C’est presque obscène quand on le compare à la maigre enveloppe qu’une revue française glisse, parfois, dans une enveloppe craft. Dix cents multiplié par deux mille, par trois mille, ça donne assez pour payer un mois de loyer, quelques factures, un peu de nourriture. Et tout ça pour ce que je fais déjà chaque nuit : écrire. Mais aussitôt que je calcule, je sens le piège. Ce n’est pas si simple. Ils ne prennent qu’un texte sur cent. Une machine triant les manuscrits, ou pire, des humains épuisés lisant en diagonale, jugeant en trois phrases si votre texte vaut quelque chose. Ce n’est pas seulement une affaire d’argent, c’est une question de survie littéraire. Être choisi par eux, ce serait une légitimation, un tampon invisible sur le front : « publiable ». Alors je cherche. Je fouille internet. Je liste les noms des grandes revues : Asimov’s Science Fiction, Fantasy & Science Fiction, Clarkesworld, Lightspeed, Strange Horizons, Uncanny. Certaines existent depuis les années cinquante, d’autres sont nées avec le web. Toutes reçoivent des centaines, parfois des milliers de textes par mois. Et toutes promettent la même chose : un paiement « pro rate », si vous êtes dans les élus. Je recopie les règles. Je m’en fais un petit cahier. Police standard, pas de fantaisie typographique, pas d’italiques forcées. Double interligne. Pas de PDF. Nom du fichier : NomTitre.docx. Toujours la même liturgie. Et une phrase qui revient partout : No simultaneous submissions. Pas le droit d’envoyer le même texte à deux revues. C’est le contraire du jeu de hasard : vous misez sur une seule case, et le temps de réponse peut durer des semaines, parfois des mois. Je note quelques consignes précises : -- Uncanny Magazine : « We want passionate, emotional, experimental SF/F. Stories that hurt and heal. Max 6000 words. Pay rate : 0.12 $/word. » -- Strange Horizons : « We’re particularly interested in stories from traditionally marginalized voices. Length : under 5000 words. Pay rate : 0.10 $/word. » -- Asimov’s : « Short stories up to 20 000 words. Pay rate : 8–10 cents/word. Looking for character-driven SF. » Tout est clair, net, balisé. Comme si l’univers littéraire pouvait se résumer à un tableau Excel. Le plus étrange, c’est de découvrir à quel point les thèmes sont déjà programmés. On ne veut plus de vampires, ni de loups-garous, ni de quêtes à la Tolkien. On veut du climat, des diasporas, des corps mutants, des IA sensibles. J’écris tout ça dans le cahier, comme si c’était une loi physique. Le futur est déjà écrit, balisé, codifié. Moi, Français un peu à côté, je devrais entrer dans cette danse, glisser mes phrases dans ces cases comme dans un formulaire administratif. Et pourtant, au détour d’une page, je tombe sur une précision : We are looking for strong voices. Une voix forte. Voilà. Tout est dit. Ce n’est pas le thème, ce n’est pas la longueur. C’est la voix. Mais comment traduire ma voix en anglais ? Est-ce que mes constructions, mes ruptures tiendront une fois traduites ? Ou bien seront-elles réduites à un brouhaha maladroit, un accent qu’on entendrait même sur le papier ? Je fais des tests. Je traduis un de mes fragments. Le français est elliptique, tendu. En anglais, ça devient presque lyrique, involontairement. Je me relis et je ne sais plus si je suis encore moi. C’est ça, peut-être, la schizophrénie qu’impose le marché américain : il faut être deux à la fois. L’auteur français, avec son rythme, ses digressions. Et l’auteur anglais, calibré, net, lisible, rapide à séduire. Je cherche des témoignages. J’apprends que même les auteurs américains essuient des dizaines de refus. Certains ont publié après cinquante tentatives. Le taux d’acceptation est d’un pour cent, parfois moins. Cela veut dire que, statistiquement, je devrais écrire cent textes pour en voir un accepté. Et qui a la force d’écrire cent textes pour un seul oui ? Ce n’est plus de la littérature, c’est une loterie déguisée. Mais alors je pense à Lovecraft. On le rejetterait aujourd’hui. Trop long, trop lourd, trop archaïque. Je pense à Clark Ashton Smith. Lui aussi, recalé. Howard, peut-être, s’en tirerait encore, avec ses récits de bataille directe. Mais le reste ? Non. Les critères ont changé. Et pourtant, eux sont immortels. Alors peut-être que la vraie sélection ne se fait pas dans les comités de lecture, mais dans la durée, dans la façon dont une voix résonne encore des décennies plus tard. Ce que je note là, c’est une contradiction. D’un côté, je dois plaire à la machine, calibrer ma prose pour entrer dans la grille. De l’autre, je dois cultiver ce qui n’entre pas dans la grille, ce qui dépasse, ce qui fera que dans trente ans, dans cent ans, quelqu’un dira : cette voix-là, elle tenait encore. Alors que faire ? Écrire deux fois ? Une version pour eux, une version pour moi ? Je recopie les thèmes. Climat. Corps mutants. Diaspora. Surveillance. Post-colonialisme spatial. Je fais comme si je révisais pour un examen. Mais plus je les note, plus ils me paraissent identiques aux thèmes d’hier. Chez Lovecraft, l’Autre était monstrueux. Aujourd’hui, il est une voix à entendre. Chez Smith, le corps mutant était une punition. Aujourd’hui, il est une émancipation. Rien n’a changé. Tout a muté. Alors la vraie question, ce n’est pas le thème. C’est la langue. La composition. Comment j’ouvre le texte, comment je le ferme, comment je tiens le fil. Je note ça en grand : Ce n’est pas ce que je raconte, c’est comment je le raconte. Je m’imagine écrivant en anglais. Je ne sais pas si je trahis ma langue ou si je lui donne une chance nouvelle. Peut-être qu’écrire pour eux, c’est aussi écrire contre moi. Comme si une partie de moi devait disparaître pour que l’autre survive. Et puis il y a l’argent. Je fais semblant de ne pas y penser, mais c’est là. En France, on ne vit pas de la nouvelle. Même pas du roman, parfois. Là-bas, peut-être. Mais le prix, ce n’est pas seulement le travail de la langue. C’est d’accepter d’entrer dans une compétition qui ressemble à une machine à broyer. Une IA invisible qui classe les voix, qui dit « toi oui, toi non ». Et dans mes nuits blanches, je me demande si ce n’est pas déjà arrivé : que des IA lisent les soumissions à la place des humains. Elles se nourriraient de nos textes, elles apprendraient nos thèmes, et elles décideraient mieux que nous ce qui fait une « bonne nouvelle ». Alors la boucle se ferme : écrire pour survivre, oui. Mais survivre à quoi ? Aux factures ? Aux refus ? Ou à la machine qui engloutira tout, jusqu’à nos voix ? Je ferme le carnet. Le café est froid. Demain, je recommencerai la même recherche. Mais une phrase reste inscrite dans ma tête, comme un mot de passe : écrire, non pas pour la revue, mais pour la sélection invisible du temps. Maybe it should start with a number, or with a dream. Maybe they’re the same thing. Ten cents a word for the first few thousand words, then eight cents beyond that. I saw it, black on white, in Clarkesworld’s submission guidelines. Ten cents ! Almost obscene compared to the meager envelope a French magazine might hand you, sometimes, in brown paper. Ten cents times two thousand, three thousand—that’s enough for a month’s rent, some bills, food. And all for what I’m already doing each night : writing. But the trap reveals itself the moment I calculate. It isn’t that simple. They take only one text out of a hundred. A machine scanning manuscripts, or worse, humans exhausted enough to skim diagonally, judging in three sentences whether your text is worth anything. It isn’t just about money anymore—it’s about literary survival. Being chosen would be a kind of invisible stamp on my forehead : “publishable.” So I search. I dig around the internet. I list the names of the big magazines : Asimov’s Science Fiction, The Magazine of Fantasy & Science Fiction, Clarkesworld, Lightspeed, Strange Horizons, Uncanny. Some have been around since the fifties, others were born online. All of them drown in submissions, hundreds, thousands each month. And all of them promise the same thing : pro-rate payment, if you’re chosen. I copy the rules into a notebook. Standard font, no typographic tricks, no forced italics. Double-spaced. No PDF. File name : NameTitle.docx. Always the same liturgy. And one line repeats everywhere : No simultaneous submissions. The opposite of gambling : one bet, one square, and weeks or months of waiting. I jot down a few specifics : -- Uncanny Magazine : “We want passionate, emotional, experimental SF/F. Stories that hurt and heal. Max 6000 words. Pay rate : 12 cents/word.” -- Strange Horizons : “We’re particularly interested in stories from traditionally marginalized voices. Length : under 5000 words. Pay rate : 10 cents/word.” -- Asimov’s : “Short stories up to 20,000 words. Pay rate : 8–10 cents/word. Looking for character-driven SF.” Everything is clear, precise, charted. As if literature could be reduced to a spreadsheet. The strangest thing is how mapped-out the themes already feel. No more vampires, no more werewolves, no Tolkien-style quests. They want climate collapse, diasporas, mutant bodies, sentient AIs. I write it all down in the notebook, as if it were a physical law. The future already written, charted, coded. Me, a Frenchman slightly off to the side, supposed to join the dance, slip my sentences into these boxes like an administrative form. And yet, on the next page, I stumble on a line : We are looking for strong voices. A strong voice. That’s it. That’s everything… I test myself. I translate one fragment. In French it’s elliptical, tense. In English it becomes lyrical, almost by accident. I reread and I no longer know if it’s me. Maybe that’s the schizophrenia this market demands : being two at once. The French author, with his rhythms, his digressions. And the English author, trimmed, neat, seductive in record time. I look up testimonies. Even Americans are rejected dozens of times. Some only publish after fifty tries. Acceptance rates : one percent, sometimes less. Statistically, I’d have to write a hundred stories for one “yes.” Who has the strength to do that ? It’s no longer literature—it’s a disguised lottery. But then I think of Lovecraft. He’d be rejected today. Too long, too heavy, too archaic. I think of Clark Ashton Smith. Same fate. Howard, maybe, would still sneak through with his direct battles. The others ? No. The criteria have shifted. And yet, they survived. They’re immortal. So maybe the real selection isn’t made in the slush piles, but across time, in the echo a voice carries decades later. This is the contradiction I scribble in the notebook. On one side, I have to please the machine, calibrate my prose to fit the grid. On the other, I must cultivate whatever doesn’t fit, whatever exceeds, the thing that might, in thirty years, in a hundred, still be heard. So what do I do ? Write twice ? One version for them, one version for me ? I copy the themes. Climate. Mutant bodies. Diaspora. Surveillance. Postcolonial space. Like revising for an exam. But the more I write them down, the more they look like yesterday’s obsessions. In Lovecraft, the Other was monstrous. Today, the Other speaks. In Smith, mutation was punishment. Today, it’s emancipation. Nothing has changed. Everything has mutated. So the real question isn’t the theme. It’s the language. The composition. How I open the story, how I close it, how I keep the thread alive. I write this in capital letters : It’s not what I tell, it’s how I tell it. I imagine myself writing in English. I don’t know if I’m betraying my language or giving it a new chance. Maybe writing for them means writing against myself. As if one half of me must die so the other can survive. And then there’s the money. I pretend not to care, but it hovers anyway. In France, you can’t live off short fiction. Hardly even off novels. Over there, maybe. But the price isn’t just labor. It’s accepting the competition, the machine that grinds voices into silence. An invisible AI sorting through slush, learning from our stories, deciding better than us what makes a “good” one. So the loop closes : writing to survive, yes. But survive what ? Bills ? Rejections ? Or the machine that will one day swallow everything, even our voices ? I shut the notebook. The coffee is cold. Tomorrow I’ll search again, the same research. But one phrase keeps repeating in my head, like a password : write not for the magazine, but for the invisible selection of time.|couper{180}

Lectures
Comment X sans Y
Il arrive que la matière d’un texte surgisse d’un endroit inattendu : un mail reçu tôt le matin, une proposition de formation glissée dans l’ordinaire d’une boîte de réception. Celui-ci, signé Jean Rivière, affirmait détenir une formule capable de transformer n’importe quelle idée banale en offre irrésistible. La promesse tenait en quatre mots : « X sans Y ». X, c’est ce que tout le monde désire. Y, c’est l’obstacle qui décourage, la barrière la plus répandue. L’efficacité du procédé tient à ce raccourci brutal : perdre du poids sans sport, apprendre l’anglais sans grammaire, vivre du web sans audience. La formule ne crée pas de nouveaux désirs, elle s’empare de ceux qui existent déjà et efface la peine censée les accompagner. Le mail parlait de business et de ventes, mais ce qui m’a frappé, c’est la force nue de cette structure. Une promesse qui tient debout toute seule, presque comme un aphorisme, et dont la logique pourrait glisser ailleurs, du côté de l’écriture. Déplier la formule, c’est voir apparaître deux pôles très simples. D’un côté, le X : l’objet du désir, clair, immédiat, universel. De l’autre, le Y : l’obstacle, celui qui rebute la majorité, celui qui décourage avant même d’avoir commencé. Toute la mécanique repose sur ce geste : isoler l’obstacle le plus commun, le plus douloureux, et l’effacer d’un trait. Ce n’est pas forcément la difficulté réelle, mais celle qui pèse dans l’imaginaire collectif. Dans l’apprentissage des langues, par exemple, ce n’est pas le temps qui bloque, c’est la grammaire. Dans le travail en ligne, ce n’est pas l’effort, c’est l’absence d’audience. Ce geste — dire en ôtant — n’est pas une invention récente. La rhétorique classique le connaissait déjà : persuader, c’est souvent soustraire. On parle d’ellipse lorsqu’on retire un mot pour renforcer le sens. On parle d’enthymème lorsqu’on retire une prémisse dans un raisonnement, en laissant l’auditeur la compléter lui-même. « Socrate est mortel puisqu’il est un homme » : la phrase supprime « tous les hommes sont mortels », mais chacun l’entend sans qu’il soit besoin de l’écrire. La suppression ne diminue pas, elle aiguise. Elle attire l’attention vers ce qui manque et sollicite l’esprit du lecteur. Le « sans Y » fonctionne exactement de cette manière. En apparence, il allège le chemin, promet un raccourci. En réalité, il met toute la lumière sur l’obstacle qu’il prétend effacer. Sans sport, sans grammaire, sans audience : chaque fois, la négation souligne ce qu’on redoute le plus, et c’est cette mise en relief qui séduit. La formule obtient son pouvoir non par ce qu’elle ajoute, mais par ce qu’elle retranche. Si la rhétorique de la suppression est si puissante dans la persuasion, c’est qu’elle repose sur un paradoxe : dire en ne disant pas. En littérature, ce paradoxe devient un moteur formel. On connaît l’exemple radical de Perec : écrire un roman entier sans la lettre e. Le manque devient la règle, et c’est lui qui produit la créativité. Chez Beckett, c’est une suppression progressive : le vocabulaire s’épuise, la syntaxe se réduit, jusqu’à ce que le texte semble s’écrire à la frontière du silence. Dans l’autofiction contemporaine, la contrainte « sans » est partout : parler de soi sans employer « je », relater un rêve sans images, écrire un silence sans blancs. Chaque fois, c’est l’obstacle qui devient matière. Ce qui distingue l’usage littéraire de la formule « X sans Y » de son usage commercial, c’est que la littérature ne cherche pas à effacer l’obstacle mais à l’habiter. Elle ne promet pas un raccourci, elle invente une forme qui tienne malgré le manque. Là où le marketing exploite la suppression comme argument, l’écrivain la transforme en contrainte esthétique. Ce déplacement est décisif : il fait du « sans » non pas une promesse de facilité, mais une condition d’existence du texte. Si la formule « X sans Y » sert de promesse en marketing, elle devient en littérature un déclencheur. Le « sans » agit comme une contrainte volontaire : il force à déplacer l’écriture, à inventer un chemin qui contourne l’interdit. Ces formules n’ont pas vocation à être vraies ou fausses, mais à fonctionner comme moteurs de texte. Elles ouvrent des zones d’exploration, parfois minimes, parfois radicales. Comment parler de soi sans “je”. Comment écrire un journal sans dates. Comment relater un rêve sans images. Comment décrire un lieu sans nommer l’espace. Comment se souvenir sans mémoire. Comment écrire un silence sans blancs. Comment raconter une histoire sans personnages. Comment décrire un corps sans le toucher. Comment évoquer une émotion sans l’adjectif qui la désigne. Comment finir un texte sans conclusion. Ces dix variations peuvent sembler paradoxales. Mais chacune contient une conséquence pratique sur la langue. Parler de soi sans « je », c’est déplacer la voix narrative vers le « tu », le « il », ou vers une forme impersonnelle. Écrire un journal sans dates, c’est suspendre le temps plutôt que le mesurer. Relater un rêve sans images, c’est se tourner vers les sensations, les odeurs, les rythmes. Décrire un lieu sans le nommer, c’est faire passer les matières et les gestes avant l’identification. Se souvenir sans mémoire, c’est travailler dans le défaut, l’incertain. Écrire un silence sans blancs, c’est inventer un rythme qui suggère l’arrêt sans jamais marquer la page. Raconter sans personnages, c’est donner aux objets ou aux climats le rôle de protagonistes. Décrire un corps sans le toucher, c’est s’en tenir aux effets, à la distance. Évoquer une émotion sans son adjectif, c’est passer par les manifestations concrètes plutôt que par l’évidence du mot. Et finir sans conclusion, c’est ouvrir une fissure plutôt qu’un point final. En marketing, la formule « X sans Y » sert à vendre une promesse immédiate : obtenir le résultat désiré sans passer par l’obstacle redouté. En littérature, le même canevas ne délivre pas de promesse, il ouvre une contrainte. Le « sans » ne supprime pas vraiment, il creuse, il met en tension. C’est ce vide qui déclenche l’invention, qui pousse la langue à trouver d’autres appuis. On pourrait dire que la différence est là : d’un côté, l’économie du désir, de l’autre, l’économie de la forme. Le publicitaire attire en effaçant l’effort ; l’écrivain invente en gardant l’effort vivant, mais déplacé. La suppression, au lieu de lisser le chemin, fait surgir des zones nouvelles où la langue tâtonne. Peut-être que l’écriture, au fond, n’est rien d’autre que cela : chercher comment obtenir quelque chose sans l’obtenir vraiment.|couper{180}

Lectures
typologie des écrivains contemporains face à l’explication
Trop d'explications, de discours qui n'intéressent pas le lecteur. Comment font les autres, tu te demandes. Intuition : L'intime ne s'explique pas il se montre. L'enveloppe explicative ne regarde que l'auteur et, dans ce cas, il ne s'agit pas tant de littérature que d'une auto-thérapie. Comment font les autres. Créer une typologie des auteurs contemporains selon leur rapport à l'explication. On pourrait structurer cela en plusieurs groupes : 1. Ceux qui assument l’explication comme matière littéraire : -Ils transforment l’explication en style, jusqu’à en faire leur marque de fabrique. Annie Ernaux (Les Années, Journal du dehors) : l’explication devient une manière de clarifier, de « mettre au net » les expériences, en assumant le didactisme. Pierre Bergounioux : mêle récit et conceptualisation historique/philosophique, la phrase elle-même est un commentaire. Pascal Quignard : construit ses livres comme des méditations, où l’explication, la digression et la note savante sont au cœur du texte. Ici, l’explication n’est pas un défaut mais une esthétique : on lit pour l’intelligence, pas pour la scène. 2.Ceux qui détournent l’explication en système ou en jeu Ils en font un procédé ironique, mécanique, presque absurdement répétitif. Jacques Roubaud : l’explication devient l’armature du texte, mais tournée vers le jeu combinatoire. Christian Prigent : explique pour mieux détruire l’explication, ses textes vibrent d’une langue critique qui se mord elle-même. Thomas Clerc (Paris, musée du XXIe siècle) : l’explication devient un inventaire infini, qui produit de l’humour par son excès. Ici, l’explication est acceptée, mais poussée jusqu’au vertige ou au comique. 3.Ceux qui coupent l’explication pour garder la chair nue Ils refusent le discours explicatif et misent sur le détail, le geste, l’action. Jean Echenoz : narration plate, neutre, fausses pistes discrètes, pas de commentaire psychologique. Christian Gailly : dépouillement extrême, phrases brèves, peu d’analyses. Jean-Philippe Toussaint : description précise, gestes minuscules, pas de surplomb explicatif. Ici, la règle est : le lecteur doit sentir, pas comprendre par avance. 4.Ceux qui oscillent entre les deux Ils commencent par expliquer, mais injectent du concret, ou l’inverse. Ils sont sur le fil. Maurice Blanchot : l’explication philosophique se mêle à des scènes concrètes, créant une tension permanente. Jérôme Orsoni (Des vérités provisoires) : mêle réflexions abstraites et notations brutes, parfois au risque de perdre le lecteur. Joy Sorman (À la folie, L’inhabitable) : mêle récit concret, reportage, et commentaires analytiques. Ici, le texte est travaillé par une lutte interne — très proche de ce que tu décris dans ton écriture. Il me semble que si j'avais à me situer je choisirais la catégorie 4, ceux qui oscillent entre les deux. Le travail reste encore à faire sur la nature de cette oscillation : l'assumer comme style hybride à la Ernaux ou Orsoni ou bien apprendre à la tailler pour laisser plus de place au concret comme Echenoz ou Toussaint. Possible aussi que je réfute totalement cette typologie et que je n'en fasse comme d'habitude qu'à ma tête que ce qui me plaise le plus soit de naviguer librement entre ces différents registres.|couper{180}

Lectures
D’ailleurs
En littérature, la notion d’ailleurs renvoie à un ensemble d’usages qui viennent de plusieurs héritages à la fois linguistiques, rhétoriques et philosophiques. Le mot ailleurs vient du latin médiéval aliorsum (alius = autre + orsum = direction), signifiant « vers un autre lieu ». Le d’ contracté devant marque une provenance (de ailleurs → d’ailleurs) ou une transition logique. Dès l’Ancien Français (XIIᵉ siècle), d’ailleurs peut désigner à la fois :un changement de point de vue (par ailleurs) ; une référence à une autre origine (provenant d’un autre lieu). En rhétorique À partir du XVIIᵉ siècle, notamment dans les lettres et essais, d’ailleurs devient une particule de transition : elle introduit une remarque incidente qui enrichit ou nuance ce qui précède. Chez Madame de Sévigné, par exemple, c’est une manière élégante de glisser une précision ou un contrepoint, presque comme un aparté oral. Exemple typique : « Il est très aimable. D’ailleurs, il m’a rendu service. » → On se déplace mentalement « vers un autre plan » du discours. Dans la littérature moderne À partir du XIXᵉ siècle, d’ailleurs prend aussi une dimension poétique et spatiale. Les romantiques et symbolistes l’emploient pour marquer un ailleurs imaginaire, un déplacement hors du cadre immédiat. Chez Baudelaire, Rimbaud ou Segalen, cet ailleurs est autant géographique (voyage, exotisme) que intérieur (paysage mental). Valeur contemporaine Au XXᵉ siècle, dans la prose contemporaine, d’ailleurs garde cette double force : discursive (enchaînement, nuance, contradiction douce) ; évocatrice (ouverture sur un autre lieu, réel ou fictif). Dans l’écriture diaristique ou narrative minimaliste, il peut presque servir de coupure rythmique, une respiration qui crée un effet de confidence ou de glissement de sens, comme chez Annie Ernaux ou Georges Perec. En résumé : d’ailleurs n’est pas seulement un mot de liaison, c’est un pivot mental. Il relie un présent du texte à un hors-champ — que ce hors-champ soit un argument, un souvenir, ou un ailleurs au sens littéral. En littérature moderne, surtout minimaliste ou fragmentaire, on observe plusieurs procédés pour effacer d’ailleurs tout en conservant ou en transformant son effet. La juxtaposition sèche (méthode minimaliste) On supprime d’ailleurs et on colle les deux segments, parfois en les séparant par un point ou un point-virgule. Avant : Il ne viendra pas. D’ailleurs, il ne m’avait rien promis. Après : Il ne viendra pas. Il ne m’avait rien promis. → Effet : plus abrupt, plus Beckett ou Ernaux, moins conciliateur. Le glissement par asyndète On laisse les phrases se suivre sans lien logique explicite (asyndète = absence de connecteur). Avant : J’aime cette ville. D’ailleurs, je m’y sens chez moi. Après : J’aime cette ville. Je m’y sens chez moi. → Effet : impression de constat neutre, mais le lien subsiste dans l’esprit du lecteur. L’intégration dans le verbe Au lieu de marquer la transition par un mot, on transforme le verbe ou le sujet pour incorporer l’idée. Avant : Elle connaît bien l’histoire. D’ailleurs, elle y a participé. Après : Elle connaît bien l’histoire : elle y a participé. → Effet : la cause ou l’explication devient structure interne. Le déplacement vers l’ellipse On conserve le sous-entendu, mais on le rend implicite, souvent par une coupe. Avant : Il aime l’hiver. D’ailleurs, il vit dans le nord. Après : Il aime l’hiver. Il vit dans le nord. → Effet : le lecteur fabrique le lien tout seul, ce qui donne plus de densité. La substitution poétique ou imagée Pour conserver la fonction évocatrice sans garder d’ailleurs, on remplace par une image ou un micro-saut narratif. Avant : Il ne parle jamais. D’ailleurs, on dirait qu’il écoute. Après : Il ne parle jamais. On dirait qu’il écoute. → Effet : le lien devient plus organique, presque cinématographique. 📌 Règle implicite chez les modernes : Si d’ailleurs est logique → supprimer ou remplacer par ponctuation forte (point, deux-points). Si d’ailleurs est évocateur → le traduire en changement de plan narratif ou en détail concret.|couper{180}

Lectures
Requalification du récit autour du réel et contrat auteur-lecteur
Il y a, comme je le disais, cette histoire de contexte . Mais pas seulement. En relisant certains textes dits « de fiction », on perçoit aussi une notion centrale : le contrat tacite entre l’auteur et le lecteur. Requalifier la narration autour du réel constitue, à mes yeux, l’essence même de ce contrat. Cette requalification porte sur le type de fiction : on passe d’une fiction d’invention romanesque (personnages et intrigues imaginés) à une fiction d’assemblage et d’angle sur le réel. Pour ma part, et depuis de nombreuses années, je crois que le réel, dès qu’on tente d’en parler, est déjà une fiction. Le simple fait de l’affirmer ne résout rien. Ce qu’on appelle « réel » est toujours médiatisé par la perception, la mémoire, le langage. Dès qu’on le raconte, on le met en forme, on sélectionne, on cadre, on ordonne : c’est déjà de la fiction au sens de fabrique. Dans ce changement de point de vue sur la fiction et le réel, il ne s’agit donc pas de prétendre à la pure vérité, mais de se placer dans un régime d’écriture où la source est un donné extérieur — vérifiable ou vécu — et où le travail consiste à laisser cette matière dialoguer avec la forme plutôt que de tout inventer. On déplace ainsi la fiction de l’invention d’univers vers l’invention de formes pour interroger le réel. Quelques écrivains ayant remis en question les conventions traditionnelles de narration En France Georges Perec (Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Je me souviens, années 1970) → Observation méthodique du réel, contraintes formelles, travail d’inventaire comme matière littéraire. Annie Ernaux (La Place, 1983 ; Journal du dehors, 1993) → Auto-socio-biographie ancrée dans le vécu et les traces sociales, style dépouillé, observation du quotidien. Jean Rolin (Zones, 1995 ; L’Organisation, 1996) → Récits de terrain, errance documentaire, mélange reportage / prose littéraire. Jean-Luc Lagarce (journal, carnets, 1980-1990) → Écriture du quotidien et de soi, quasi documentaire dans la notation. Jean Echenoz (Cherokee, Lac) → Bien que plus romanesque, a pratiqué dans les années 1980-90 des fictions nourries d’observations concrètes et de documentation. François Bon → Pionnier par la combinaison de cette requalification du récit autour du réel et de son investissement précoce dans les formes numériques. À l’international Truman Capote (De sang-froid, 1966) → “Non-fiction novel” : enquête journalistique traitée avec les techniques narratives du roman. Joan Didion (Slouching Towards Bethlehem, 1968) → Reportages-essais où l’angle subjectif et la précision documentaire sont indissociables. James Agee (Louons maintenant les grands hommes, 1941) → Enquête poétique et documentaire sur les métayers américains. Ryszard Kapuściński (Ébène, Le Négus, années 1970-80) → Reportage littéraire, mélange de vécu, d’observation politique et d’art narratif. W.G. Sebald (Les Émigrants, 1992 ; Austerlitz, 2001) → Narration hybride, photographies, mémoire et histoire tressées dans une prose documentaire-poétique. 📌 Cette liste n’est pas exhaustive mais trace un fil commun : une remise en cause des conventions narratives classiques, un ancrage fort dans le réel, et une invention formelle qui déplace le rôle de la fiction. .|couper{180}

Lectures
H. P. Lovecraft : lire pour écrire — de la quête au système
Carte interactive Lovecraft Introduction La littérature de Lovecraft ne naît pas dans un vide : elle s’appuie sur une culture accumulée avec méthode. Lui qui se disait « amateur d’antiquités, de science et de rêves » a développé, au fil des années, une véritable stratégie de recherche de lectures. De Providence à New York, ses lieux de prédilection, ses outils et ses habitudes évoluent, passant de l’errance curieuse à une maîtrise méthodique de ses sources. I. Providence : le creuset initial Lieux de lecture : Providence Public Library (225 Washington St.) : terrain de chasse principal pour la littérature, l’histoire et les sciences. Bibliothèque de Brown University (John Hay Library) : accès indirect grâce à des amis, pour consulter des ouvrages plus rares. Librairies d’occasion : Snow & Farnham, petites échoppes du centre-ville. Prêts d’amis et de correspondants : certains envoient des livres par la poste. Matériel à Providence : Carnets de notes : blocs lignés bon marché (Dennison, Eaton’s) pour griffonner résumés et citations. Stylos : Waterman’s Ideal et Sheaffer Lifetime. Papier : Eaton’s Highland Linen pour correspondance soignée, papier générique ivoire pour notes brutes. Organisation : rangement des notes et extraits dans des chemises manille thématiques. II. New York : la boulimie ciblée (1924-1926) Lieux de lecture : New York Public Library (5th Ave & 42nd St.) : accès gratuit, collections massives en histoire, science, folklore. Librairies de 4th Avenue (Book Row) : une dizaine de bouquinistes où il chine éditions anciennes et ouvrages de niche. Wanamaker’s et McBlain’s Stationery : papeterie, parfois rayon livres. Bibliothèques de quartier à Brooklyn Heights et Red Hook. Matériel à New York : Carnets portables : petits blocs spiralés ou cousus (Dennison, Globe-Wernicke). Encre : Carter’s Ink ou Sanford’s (moins chère). Organisation : méthode nomade, notes regroupées dans enveloppes kraft ou chemises, souvent renvoyées à Providence. III. Retour à Providence : la maîtrise (1926-1937) Lieux de lecture : Providence Public Library. John Hay Library pour ouvrages rares. ( à voir le site Tiers-livre pour des images de celle-ci ) Bouquinistes pour constituer sa bibliothèque personnelle. Matériel à Providence (maturité) : Carnets par sujet (science, histoire, etc.). Classement intégré : notes vers chemises manille thématiques, intégrées à la correspondance et réutilisées en fiction. Papier carbone Carter’s Midnight Blue pour conserver un double des notes. Stylos : préférence finale pour le Sheaffer Lifetime. IV. Lire sans moyens : la stratégie d’un pauvre érudit Lovecraft vécut presque toute sa vie dans une grande pauvreté. Pourtant, il lut et posséda un nombre impressionnant de livres, grâce à plusieurs stratégies : Priorité absolue à la lecture, en réduisant toutes les autres dépenses. Achat d’occasion. Échanges et dons d’amis et correspondants. Prêts à long terme. Éditions bon marché comme Everyman’s Library ou Modern Library. Accès massif aux bibliothèques publiques et universitaires. V. De l’amateur au méthodicien Avant 1924 : lectures guidées par le hasard, notes éparses. 1924-1926 : phase boulimique, accès illimité aux grandes bibliothèques, accumulation massive. 1926-1937 : sélection plus ciblée, intégration dans un système épistolaire et thématique. Conclusion Lovecraft n’a jamais cessé de lire, mais il a appris à canaliser ses lectures et à les fixer matériellement pour mieux les exploiter. Sa pauvreté ne l’a pas empêché de se constituer une culture immense — elle l’a forcé à l’ingéniosité.|couper{180}

Lectures
Le "Cloud" avant l’informatique
Le “cloud” avant l’informatique : comment Lovecraft et d’autres écrivains ont sauvé leurs archives Introduction Bien avant que nos vies ne soient stockées sur des serveurs invisibles, certains écrivains avaient déjà inventé leurs propres systèmes de sauvegarde et de classement. H. P. Lovecraft (1890-1937), géant du fantastique et épistolier compulsif, en est un exemple fascinant : son réseau d’archivage reposait… sur ses tantes, à Providence. À travers lui et quelques illustres prédécesseurs, on découvre que l’obsession de préserver ses écrits est presque aussi ancienne que l’écriture elle-même. I. Lovecraft, l’archiviste malgré lui On estime que Lovecraft a rédigé entre 60 000 et 100 000 lettres. Certaines étaient de courts billets, d’autres de véritables essais de vingt ou trente pages. Pour ne rien perdre de ce matériau, il avait deux stratégies : Sur place (à Providence) : Copies au carbone pour les lettres importantes. Chemises cartonnées manille, parfois trois rabats, étiquetées par correspondant ou thème. Classement physique dans des boîtes ou tiroirs, souvent accompagné de coupures de presse ou notes liées au sujet. En déplacement (à New York, 1924-1926) : Version “nomade” du système : chemises fines, enveloppes kraft, valise comme armoire portative. Archives principales stockées chez ses tantes à Providence — un véritable “cloud familial”. Envoi régulier de paquets de documents à College Street, avec consigne implicite de ne rien jeter. Ce dépôt familial n’était pas un hasard : ses tantes savaient que ces papiers étaient essentiels, et elles jouaient le rôle de gardiennes d’archives, assurant que tout lui reviendrait intact. II. Correspondance = mémoire active Pour Lovecraft, la lettre n’était pas seulement un moyen de communication : c’était une extension de sa mémoire. Chaque lecture récente — un article scientifique, un livre d’histoire, un conte ancien — se retrouvait reformulée dans ses lettres. Résultat : Fixation par la reformulation. Multiplication des associations : un même thème abordé avec un correspondant amateur de folklore et un autre passionné d’astronomie produisait des passerelles inattendues. Réemploi littéraire : certains passages de lettres réapparaissent, presque mot pour mot, dans des nouvelles comme The Shadow over Innsmouth. III. Le “cloud” des écrivains Lovecraft n’est pas un cas isolé. Bien avant lui, d’autres écrivains ont développé des systèmes ingénieux pour conserver leurs lettres, brouillons et notes. Auteur Méthode d’archivage Particularité Voltaire (1694-1778) Copies manuscrites ou secrétaires, classement par destinataire dans des chemises Conservation quasi complète de 20 000 lettres Charles Dickens (1812-1870) Chemises étiquetées par année et sujet Lettres traitées comme un fonds éditorial personnel Henry James (1843-1916) Secrétaire classant et reliant la correspondance par série Envoi de lots à la famille pour archivage lors de ses voyages Marcel Proust (1871-1922) Boîtes à chapeaux, enveloppes kraft annotées Mélange de brouillons, lettres reçues et notes Mark Twain (1835-1910) Usage massif du papier carbone, armoires à tiroirs étiquetées Premier à traiter sa correspondance comme un manuscrit H. P. Lovecraft (1890-1937) Copies au carbone, chemises manille, “cloud familial” via ses tantes à Providence Archives comme mémoire et atelier de création Ces systèmes varient dans la forme, mais partagent la même logique : créer une mémoire externe fiable et protéger ses écrits des pertes accidentelles. IV. Une leçon pour aujourd’hui À l’heure où nos archives sont dématérialisées, cette obstination matérielle a quelque chose de salutaire. Lovecraft nous rappelle que : Classer, c’est se donner la possibilité de revenir, de réutiliser, de relire. Conserver, c’est aussi transmettre : ses tantes ne savaient pas qu’elles préservaient un futur monument littéraire, mais elles en avaient l’intuition. Écrire pour quelqu’un fixe mieux les idées que de simplement les penser. Aujourd’hui, un site web personnel, un carnet numérique, ou même une correspondance par e-mail peuvent jouer le rôle de ces chemises manille. L’important est de donner à ses idées un lieu sûr où elles pourront être retrouvées. Conclusion Avant les disques durs et les clouds, il y avait des chemises cartonnées, des enveloppes kraft, des armoires à tiroirs. Lovecraft, Voltaire, Proust, Twain… tous savaient que leur œuvre ne tenait pas seulement à ce qu’ils écrivaient, mais à la manière dont ils la conservaient. Et derrière chaque système d’archivage, il y avait toujours une conviction : ce que l’on écrit mérite de durer. 📚 Références S. T. Joshi & David E. Schultz, Lovecraft’s Library, Hippocampus Press. S. T. Joshi (éd.), Collected Letters of H. P. Lovecraft, Hippocampus Press. August Derleth & Donald Wandrei (éd.), Selected Letters, Arkham House. R. H. Barlow, souvenirs dans Marginalia, Arkham House. Corres. et archives Voltaire, Proust, Twain — Bibliothèque nationale de France, Library of Congress.|couper{180}

Lectures
notes de lecture_Hélène Gaudy / Un monde sans rivage
J'ai téléchargé l'Epub. Il y a quelque chose qui m'attire sur la couverture. Un souvenir de photographie posé sur autre roman, {Je m'en vais } de Jean Echenoz. Je ne sais rien d'Hélène Gaudy. Je fais une recherche. ChatGpt, Qui est Hélène Gaudy ? voici la réponse : Voici ce que l’on peut dire sur Hélène Gaudy, écrivaine française contemporaine : 📚 Biographie Née à Paris en 1979, Hélène Gaudy est plasticienne de formation, diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg (Wikipédia). Membre du collectif Inculte depuis les années 2000, et du comité de rédaction des revues Inculte et La moitié du fourbi (Wikipédia). Elle vit et travaille à Paris, partageant un intérêt entre créativité visuelle et écriture littéraire (Fabrique du Littéraire). 🖋 Carrière littéraire Auteure d'une demi-douzaine de romans pour adultes, ainsi que de nombreux albums et romans jeunesse (Wikipédia). Parmi ses œuvres les plus marquantes : Vues sur la mer (2006) – sélectionné au Prix Médicis (Wikipédia). Plein hiver (2014) – roman au ton poétique et atmosphérique (Wikipédia). Une île, une forteresse (2016) – récit documentaire sur Terezín, camp modèle pendant la Seconde Guerre mondiale (Wikipédia). Un monde sans rivage (2019) – inspiré de l’expédition arctique suédoise de 1897, traduit en anglais (A World with No Shore), sélectionné pour le Prix Goncourt et lauréat du prix François Billetdoux en 2020 (Wikipédia). Archipels (2024) – explorant la vie de son père collectionneur, finaliste du Prix Goncourt 2024 (Wikipédia). 🎯 Thèmes et style Elle travaille souvent à la convergence du texte et de l’image, interrogeant la mémoire, le paysage, la trace (Observatoire d\'éthique universitaire). Ses romans mêlent fiction et investigation documentaire, souvent à partir de lieux chargés d’histoire (Terezín, Grand-Lieu, archipels polaires...) (Observatoire d\'éthique universitaire). Elle mène également des ateliers d’écriture avec divers publics (migrants, élèves, malades, etc.) et enseigne en Master de création littéraire à Paris VIII (Wikipédia). ✅ En résumé Hélène Gaudy est une autrice originale, mêlant influences plastiques et littéraires. Ses récits allient tendresse, rigueur documentaire et poésie, souvent autour de thèmes de mémoire, paysage, exploration et identité familiale. Son œuvre récente Archipels, qui a décroché une place parmi les finalistes du prestigieux Prix Goncourt 2024, illustre parfaitement sa capacité à transformer la vie ordinaire en quête universelle. Bon. Je ne saurais dire si j'en sais plus sur Hélène Gaudy comme ça. Certainement pas. F.B dit qu'il y a eu rencontre zoom. Il faut faire une recherche de ce côté là aussi. Je ne vais jamais sur les zooms. Il arrive que je le visionne en replay plus tard. Mais celui là ne me dit rien. J'ai dû zapper. Pas trouvé. Mais une autre vidéo : Du texte avant. et encore une autre trouvé sur la chaine de Pierre Ménard j'en vois d'autres encore. De quoi se faire peut-être des idées. Toute une liste. Mais bon. Lire le livre plutôt donc. Un monde sans rivage. Puis je tombe sur une phrase : les écrivains hors réseau marchant lentement à leurs ténèbres ? ça me flanque un frisson. Je vais attendre encore un peu. Lire le livre en entier. Peut-être. Et une fois lu je pourrais en faire un résumé comme celui-ci Le livre s’inspire d’un épisode réel : l’expédition polaire suédoise de Salomon August Andrée en 1897. Avec deux compagnons, il tente de rejoindre le pôle Nord en ballon dirigeable. Leur disparition, puis la redécouverte de leurs corps et de leurs carnets plus de trente ans plus tard, forment la trame narrative. Hélène Gaudy part de ces documents, de photos retrouvées et des traces laissées sur la banquise pour imaginer, combler les silences et explorer ce qui se joue dans cet espace entre l’histoire et la fiction. Parlerais-je de sa structure ainsi vraiment ? Structure :Trois mouvements principaux : L’avant : préparation de l’expédition, contexte historique, rêves de conquête et fascination pour les pôles à la fin du XIXᵉ siècle. Le voyage : récit fragmenté et non linéaire du périple, alternant descriptions des paysages, extraits réels ou imaginés des carnets, et moments d’hypothèse. L’après : redécouverte des corps en 1930, travail des archéologues et journalistes, et résonances contemporaines. Narration polyphonique : la voix de l’autrice dialogue avec celles des explorateurs, des témoins, des archives. Le récit avance par touches, comme un collage. Et pourquoi pas aussi du style pendant que j'y suis ? Prose poétique et sensorielle : Gaudy décrit les paysages arctiques comme des tableaux mouvants, travaillant sur la lumière, le blanc, les textures. Écriture fragmentaire : chapitres courts, ellipses, retours en arrière, montage d’images et de souvenirs. Mélange documentaire/fiction : rigueur dans les faits, mais liberté dans l’imagination des émotions, pensées ou gestes quotidiens. Dimension visuelle : influence de sa formation artistique, attention à la composition des scènes. et forcément je me poserais la question du thème, des thèmes de la thématique. La quête et ses illusions : l’obsession d’atteindre un but géographique comme métaphore d’un désir humain d’absolu. La mémoire et ses lacunes : comment on raconte après coup, comment on reconstruit avec des morceaux. L’échec héroïque : ces hommes ne reviennent pas, mais la postérité les érige en figures mythiques. Le rapport au paysage extrême : nature indifférente, sublime et mortelle. En fin de compte en quoi un monde sans rivage est-il remarquable ? Originalité de l’approche : plutôt qu’un récit d’aventure classique, c’est une exploration sensible du vide, de la trace et de l’oubli. Équilibre entre précision historique et poésie : on apprend, mais on rêve aussi. Structure fragmentaire qui reflète la discontinuité des sources et la difficulté de dire l’expérience polaire. Résonance contemporaine : interrogation sur notre rapport à l’exploration, à la mémoire et à l’image. Je ne peux pas dire que je connais encore beaucoup de choses sur Hélène Gaudy. ceci n'est pas une critique littéraire, pas du tout. Ce sont juste quelques notes de recherche, je n'ose pas encore dire de lecture Pour que je puisse le dire il faut que j'ouvre foliate. Que je charge l'Epub. Que je lise... tiens j'aime déjà bien la citation : Tout plonge dans un monde sans rivage, qui ne tolère aucune définition et face auquel, comme beaucoup l’ont déjà dit, toute affirmation est une solitude, une île. H. G. ADLER, Un voyage.|couper{180}

Lectures
note de lecture_Le Temps et les Dieux de Dunsany
Note de lecture : Time and the Gods de Lord Dunsany Lord Dunsany (Edward John Moreton Drax Plunkett, 18e baron de Dunsany, 1878-1957) possède un style tout à fait distinctif dans la littérature fantastique qui a profondément influencé le genre. Son écriture se distingue par une prose lyrique et archaïsante, empreinte d'une solennité biblique. Dunsany emploie délibérément un langage soutenu, parfois archaïque, qui évoque les textes sacrés ou les chroniques anciennes. Cette tonalité confère à ses récits une dimension mythique et intemporelle. Ses textes fonctionnent souvent comme des poèmes en prose. Il crée des mythologies complètes avec leurs panthéons de dieux aux noms évocateurs (Mana-Yood-Sushai, Pegāna). Son style reflète cette ambition démiurgique : il écrit comme un chroniqueur des temps primordiaux, rapportant des légendes d'un monde parallèle. Ses récits sont imprégnés d'une nostalgie particulière, celle des civilisations perdues et des beautés évanescentes. Le style traduit cette mélancolie par des cadences musicales et des images de splendeur fanée. Ce style unique a directement inspiré H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith et toute une génération d'écrivains fantastiques qui ont adopté sa manière de créer des mondes mythologiques par la seule force du verbe. Les ritournelles dunsaniennes L'usage de la répétition comme d'un motif musical me rappelle Gertrude Stein, bien que les intentions diffèrent. Je me suis procuré l'édition Gollancz Fantasy Masterworks datant de 2000 pour consulter le texte original. Dunsany emploie des structures répétitives qui créent un effet d'incantation quasi-liturgique. On trouve des formules récurrentes comme "And it was so" ou des variations sur "In the days when..." qui ponctuent ses récits cosmogoniques. Ces répétitions fonctionnent comme des refrains bibliques, renforçant la dimension sacrée de ses mythologies. Comme Stein, Dunsany joue sur la répétition-variation, mais là où Stein déconstruit le langage pour explorer sa matérialité pure ("Rose is a rose is a rose"), Dunsany utilise la répétition pour construire du mythe. Ses ritournelles visent l'hypnose mystique plutôt que l'expérimentation linguistique. Les deux auteurs créent une temporalité particulière par la répétition : Stein suspend le temps narratif traditionnel, Dunsany évoque le temps cyclique des cosmogonies anciennes. Chez lui, la répétition mime les cycles éternels des dieux et des mondes. La question du souffle et de la période Il faut le lire à haute voix pour comprendre quelque chose de la période. De même que Lovecraft, cela demande du souffle. Ce n'est pas le même air que ces poumons charrient. Je me fais cette réflexion alors que je corrige quelques textes de 2019 où j'avais encore de bons poumons — des longues phrases bourrées de virgules. Ce n'est plus le cas. Que penser de cela ? De la notion de période dans l'écriture ? Les temps actuels semblent plus propices à la phrase courte, au staccato. Ce qui, sans doute, paraîtra tout aussi étrange à des lecteurs de l'avenir, s'ils existent. Néanmoins, il doit y avoir certaines formules qui persistent dans la durée, dans le temps — autrement dit, des structures qui résistent à l'entropie. La musique pure permet cela. Est-ce que lorsque j'écoute Bach ou Mozart je suis dans leur époque, dans la mienne ? Non, je ne le crois pas. Je suis ailleurs. Dans un ici et maintenant qui absout la durée. Mieux : c'est la musique dans son déroulement qui est passé, présent, avenir — trois axes qui convergent dans l'instant où l'on écoute. Donc l'écriture essaie de reproduire ce phénomène, c'est désormais une évidence. C'est sans doute la raison pour laquelle certains textes résistent à l'entendement. On y cherche du sens alors qu'il faut simplement les éprouver.|couper{180}
