Autofiction et Introspection
Habiter n’est pas impossible, mais c’est un vrai problème pour le narrateur. Il occupe des lieux sans jamais vraiment y entrer. Maison, atelier, villes traversées : ils existent, mais restent comme à distance. Il imagine que peindre ou écrire l’aidera à habiter autrement, à investir un espace intérieur qui compenserait l’absence d’ancrage. Mais cela demeure du côté du fantasme. Le réel, lui, continue de glisser, indifférent.
C’est de ce décalage que naissent ces fragments. Écrire pour traverser l’évidence, pour examiner ce qui ne s’examine pas. Écrire comme tentative d’habiter, sans garantie d’y parvenir.
articles associés
Carnets | octobre 2023
22 octobre 2023
Les Gassion En semaine, l’enfant est déposé chez les concierges. Odeur de graisse et d’encaustique dans l’ascenseur en bois, boutons en porcelaine, chiffres romains. La descente est lente, le tapis rouge ne commence qu’au troisième. Les Gassion habitent à l’entresol, derrière une porte vitrée, dentelle, cigales plastiques. Odeur de soupe dès la sortie de l’ascenseur. À l’intérieur : toile cirée jaune, cigales encore, chant des inséparables, linoléum brûlant. Madame Gassion, gentille. Bonbons à sucer. Le mari a fait la guerre de 14-18. Le soir, on remonte au septième. Le chien des Gassion est trop vieux. L’enfant en voudrait un autre. Odette Odette vient le dimanche. Accent du Bourbonnais. Chaussures à talons aiguilles. Mazagrans, café, froufrous. Odeur singulière, presque annoncée. Parfois un canard : demi-sucre trempé dans le café. Elle boit à petites gorgées. Elle parle. L’enfant ne comprend pas, mais il écoute. Marcel Chez Marcel, dans le 15e, tout est bazar. Chevaux de bois, cintres, bandes dessinées, piles de journaux. Le grand-père conduit d’une main, fume des Gitanes. Marcel, ancien du STO. Comme lui. Ils ont juré de ne plus jamais avoir de patron. Marcel sort parfois un couteau : “je vais te tailler les oreilles en pointe”. L’enfant a peur, mais rit. La peur fait presque partie du merveilleux. Totor Totor aussi veut couper les oreilles en pointe. Une mode, peut-être. Au marché boulevard Brune, sa voix couvre tout : légumes, clients, cris de guerre. “Treize à la douzaine ! Mes beaux œufs !” Il initie le gosse : “Faut gueuler, mon petit vieux.” Sa main énorme sur le crâne. “Si les petits cochons te mangent pas…” Totor est mort d’un coup, en tendant une botte de persil. La vie tient à peu. Après le marché, la voirie nettoie tout. Des passants ramassent les fruits talés. La voix de Totor reste un moment. Puis l’enfant passe à autre chose. sous-conversation Ils sont tous là. Alignés. Petits dieux du quotidien. Faits de soupe, de plastiques, de Gitanes, de linoléum. Ça parle fort, ça crie, ça chuchote. Ça coupe les oreilles, pour de faux, mais pas tout à fait. Ça façonne. Ça effraie doucement. La main énorme sur le crâne. L’odeur avant la voix. Le sucre dans le café. Les cigales. Les bonbons à sucer. Il faut tout retenir. Même ce qui n’a pas de sens encore. Même ce qu’on ne comprend pas. On comprend plus tard, ou jamais. Le grand-père ne parle pas. Marcel ne parle pas. Totor parle trop. La mémoire est faite de ça. Des silences et des cris mêlés. Et l’enfant qui veut juste un chien. Mais pas celui-là. note de travail Le narrateur ramène une galerie. Quatre figures totémiques. Les Gassion, Odette, Marcel, Totor. Tous différents. Tous porteurs d’un monde. Tous porteurs d’une peur, aussi. Il y a quelque chose de doux dans sa voix aujourd’hui. Comme s’il racontait un film qu’il avait vu mille fois. Mais ses yeux, eux, disent autre chose. Une tension sous la douceur. L’enfant regarde, sent, absorbe. Il ne juge pas encore. Mais il enregistre. Les hommes sont silencieux ou violents. Les femmes sentent fort, parlent doucement, ou pas du tout. La loge, le marché, le bazar, la cuisine : autant de scènes fondatrices. Autant de mythes personnels. Et cette fixette sur les oreilles à couper. Je note : transformation. Initiation. Passage symbolique. Il faut être taillé autrement pour survivre à ce monde. La mort de Totor, si brutale, si légère, est racontée sans affect, mais elle contient tout : la chute du père de substitution. Et après lui, plus rien. Juste le nettoyage. Et l’enfant qui passe à autre chose. Mais qui n’oublie rien.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
21 octobre 2023
La journée a commencé dans les cages : soucis, peurs, les barreaux habituels. La liberté ? Un costume vide. Flegme, indifférence, mots creux. S. a passé l’après-midi à combattre les mites à coups de balai. Moi, j’ai déversé ma haine sur l’expert-comptable. Son nom craché dans le vide, pas assez fort. J’essaie avec des insultes. Enculé, ça ne fait plus rien. Enfoiré, trop tiède. Rabelais me souffle autre chose. Mâche-merde. Là, on s’élève. Il y a une dignité du merdique, parfois. Mais déjà je m’ennuie. L’odeur, la pluie, la chasse d’eau qui fuit. La peur de percer le plafond d’en dessous. Les mites reviennent. S. dit : “la chienlit”. Je pense : ce ne sont que des vues de l’esprit. Mais l’odeur persiste. Anders Zorn me traverse. Supprimer le bleu, le faire renaître autrement. Deux chauds, une froide. Même chose ici : deux haines, un geste retenu. Le nom que je crache devient mon exutoire. Je ne cogne pas. Je nomme. C’est ça mon effort de civilisation. Mais rien n’est propre. Rien ne tient. Même le plafond menace.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
20 octobre 2023
Au début, le brouhaha. Trop fort. Il vaudrait mieux parler d’un bruit de fond. Un poste de radio, dans une cuisine, qu’on allume au petit-déjeuner, pour contrer un certain vide. Une absence que l’habitude juge insupportable. Le bruit de fond : présence contre présence de l’absence. Il faut toujours une frontière pour sentir les limites. Ensuite, à chacun de choisir de les franchir. On pourrait aussi rejeter l’ensemble. Ni bruit. Ni silence. Ni tout. Ni rien. Une entreprise de moine. Parvenir déjà à ce premier pas de côté… le reste n’est qu’anecdote. Il y a ce poste, posé sur la table. Dans la tête aussi, il y a une cuisine. Une table. Un mug de café noir. Tout ça, reconstruit par la cervelle. Par habitude. Il y a des années, j’avais brisé mon cochon. Avec ça, j’avais commandé *A Course in Miracles*. Traduction de Sylvain du Boullay. Mais trop dubitatif, je me suis arrêté au cinquième exercice. (Le livret de l’élève.) Il fallait prendre quelques minutes par jour, et dire : je ne sais rien de cette pièce, de cette table, de ce vase, de cette chaise. Rien qu’en y pensant, le bruit de fond s’amenuise. Comme alors. On revient à son propre battement de cœur. Sa respiration. Et rien d’autre. Un peu effrayant au début. Comme un interrupteur. On éteint le monde en disant : je ne sais rien. Peut-être que l’écriture procède de la même tentative. Non pas d’affrontement. Mais d’approche. Il faut fatiguer la viande. Que toute résistance s’évanouisse. Alors le miracle surgit. Ça s’écrit seul. Ni l’un, ni l’autre. Mais un avec l’un comme l’autre. sous-conversation Ça grésille. Pas trop fort. Juste assez pour masquer. Masquer quoi ? On ne sait plus très bien. Un vide ? Une peur ? Un silence trop franc, trop dur ? C’est là, le poste. Sur la table. Le café fume encore. Mais ce n’est pas le café. C’est… le cadre. La cervelle qui reconstruit. Toujours. Et puis : rien. Plus de mots. “Je ne sais pas ce que c’est.” Un vertige doux. Comme si l’objet reculait. Comme si le monde faisait un pas en arrière. Écrire ? Peut-être juste ça : dire “je ne sais pas” d’une autre manière. Fatiguer la viande. Qu’elle lâche. Et que ça passe. À travers. note de travail Texte de seuil. Texte de vacillement. Ce que l’auteur explore ici n’est pas l’opposition entre bruit et silence, mais l’intuition d’un troisième terme, plus instable, plus insaisissable : l’état entre. Tout commence avec la radio. La cuisine. Le bruit domestique. Mais très vite, on bascule. La table devient mentale. Le mug devient reconstruit. La radio devient un seuil vers l’inconnu. Ce texte est traversé par une tentative de défamiliarisation du monde, par le biais d’un exercice spirituel : dire je ne sais rien. Le paradoxe est beau : plus on renonce au savoir, plus on entre dans un rapport vrai au réel. L’écriture ici est vécue comme une pratique proche de la méditation ou de la transe légère. Il faut fatiguer la matière. Fatiguer la viande, dit-il. C’est fort, c’est brutal, mais juste. Et puis… “ça s’écrit seul.” Ce n’est pas la grâce. Ce n’est pas la technique. C’est l’effacement du moi qui résiste. La dernière phrase fonctionne comme un koan : ni l’un ni l’autre, mais un avec l’un comme l’autre. On n’est plus dans la syntaxe. On est dans l’expérience. Ce texte n’est pas seulement pensé. Il est traversé.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
18 octobre 2023
Les saisons arrivent, repartent, reviennent. À peu près semblables, d’année en année. L’enfant apprend ce rythme par le corps. Il hume l’air, sent l’automne, devine l’hiver. Et pourtant… ni de la ville, ni des champs. Étranger au monde qu’il traverse. Un passager du temps. Quand il fait beau, il se réjouit. Quand il pleut, il tend les paumes. Il aurait voulu vivre ainsi — porté par le temps, comme autrefois dans un ventre. Mais l’histoire n’est pas d’accord. Né trop tôt. Un mois en avance. Privé du sas, du langage invisible de l’attente. Il entre dans le monde par la peur. Tubes. Verre. Urgence. Plus tard, même scénario. Il part du primaire avant la fin. Perd la maison, le jardin, les collines, et son accent. Il parle pointu. Il s’ajuste. Il observe la neige, les merles. Suit les pattes noires dans le blanc. Il cherche la trace de l’envol — mais l’envol ne laisse pas de trace. Il appartient à un autre temps. Apprendre à lire l’heure ? Il ne sait pas. Les chiffres romains ne disent rien. Il apprend le temps sans montre, par le soleil, même absent. Le seul bien ici, c’est le sens commun. Ceux qui le perdent parlent trop, ou parlent pour ne rien dire. On dit : “mets la table, fais ton lit, range le bois.” Mais il y a dans ces phrases-là quelque chose d’étrangement triste. Un jour, l’arbre n’est plus là. Coupé pour cause d’ombre. Un autre jour : un fusil. Un merle. Une traînée de sang. On suit les gouttes. Au bout, un oiseau mort. C’est quand il perd goût aux choses usuelles que l’homme retrouve l’odeur de l’enfance. L’humus. Le silence. Le balancement lent des arbres. Il essaie de prononcer leurs noms. Mais la gorge se serre. Il est presque là. Il y est. Il n’est plus un homme. Plus un enfant. Seulement le vent. sous-conversation Il voulait s’adosser au rythme. Ne pas résister. Juste… suivre. Mais tout est venu trop tôt. Trop fort. Trop vite. Pas le temps d’apprendre. Il ne parle pas la langue du monde. Il a dû la copier, l’imiter, l’apprendre à rebours. Il regarde les merles. Mais ce qu’il cherche, c’est pas l’oiseau. C’est ce qui l’a fait partir. Ce qu’il n’a pas vu. Le temps n’est pas un fil. C’est une béance. Il s’approche. Il dit presque. Mais le mot ne vient pas. Alors il devient… autre chose. Moins que corps. Plus que voix. Il devient ce qui traverse. note de travail Ce texte est une tentative d’habiter le temps. Pas de le décrire, ni même de le penser — mais de s’y couler. Comme on tente d’habiter un corps qu’on n’a pas choisi. Tout y est marqué par la prématurité. Une entrée brutale dans le monde : avant les mots, avant les rythmes, avant la chaleur. La naissance est ici un accident de temporalité. Ce qui m’émeut, c’est l’effort que fait ce sujet pour recoller à la cadence des autres. Il observe les saisons, il regarde les horloges, il essaie de comprendre ce qu’il a manqué. Mais il reste… en décalage. Non pas marginal : flottant. Les arbres, les merles, les chiffres romains, les rites d’école… sont autant de tentatives d’ancrage. Mais le sol reste fuyant. Même la langue — l’accent, la syntaxe — semble toujours “pointue”, apprise pour être socialement conforme. La dernière image — devenir le vent — n’est pas une disparition. C’est une transformation poétique du sujet. Il ne parle plus le langage du temps. Il est ce qui le traverse. Une forme de sublimation discrète, mais puissante. Je ne sais pas si c’est un cri, une prière ou un aveu. Mais ce fragment est un seuil.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
18 octobre 2023
La seule peine, c’est celle qu’on ne peut dire. Celle qui s’accumule. Qui nous gonfle d’encore plus de peine. Une fontaine de chagrin — mais sans débordement. On la garde. On l’amasse. Pas un mot. Pas un soupir. Dehors : le concert des jappements, des klaxons dans les bouchons. Bruits, cris, alertes. « N’en rajoute pas », dis-tu. « Pas de peine sur la peine. » Courage et lâcheté : deux mains qui applaudissent en sourdine. Et entre les lèvres, droit comme une lame, l’horizon. sous-conversation C’est trop… ça ne passe pas, ça s’amasse, ça pèse — mais en dedans. Ça pourrait jaillir, mais non. Rien. Même pas un cri. Il faut tenir. Ne pas troubler. Ne pas se répandre. Et l’autre qui dit : n’en rajoute pas. Comme si… comme si c’était toi, la surcharge. Alors tu tais. Tu te tais. Mais ça applaudit en toi. Oui. Un bruit sourd. Un bruit de mains, dans le vide. Et la bouche fermée, c’est pas un silence. C’est une ligne. Une ligne d’exil. note de travail Ici, tout tourne autour du non-dit. Non pas ce qu’on cache aux autres, mais ce qu’on n’arrive même pas à formuler pour soi. La peine est nommée, mais aussitôt retenue, tenue, contenue. Elle se transforme : de sentiment, elle devient chose. Accumulation. Poids. Fontaine dont rien ne sort. Le corps est présent — par effraction : les bouchons, les klaxons, les mains. Il y a cette opposition entre le vacarme du monde et le silence du sujet. Comme si l’extérieur hurlait pendant que l’intérieur se recroquevillait. Le vers “courage et lâcheté, deux mains qui applaudissent en sourdine” est magistral. Il résume la tension morale du texte : tenir bon, mais à quel prix ? et pourquoi ce besoin de s’absoudre par le silence ? Enfin, “un horizon droit entre les lèvres” évoque une sorte de ligne de fuite contenue dans le visage même. Ce n’est pas seulement ne pas parler, c’est s’aligner, se contracter, se figer pour ne pas disloquer. Un surmoi de pierre. Peut-être que ce texte est une tentative de dire enfin cette peine qu’on ne peut dire. Et c’est déjà beaucoup.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
18 octobre 2023
Une minute de silence, une minute papillon, une minute cocotte, une minute bonhomme, minute, j’en ai pas fini avec vous. Une minute rit, une mine hutte, bourrée de secondes comme d’un vieux ragoût. Si dans une minute tu… les minutes s’égrènent, on graille sur le pouce, réparation minute, on y gagne pas la lune mais minute, tout de même. Un porte-clés, un calendrier, une montre à retardement. Le tout avec la plus minutieuse des minuties. Faites pas scier. Faites péter le bouchon, le bout chonchon, le bout de chou, le bout de gras, les vaches maigres, minute, on s’égare. À la gare, hagards, du NORD, on s’en va comme on est venu. Pas une minute à perdre de plus. sous-conversation C’est rien… juste des mots. Des bouts de temps. Mais ça revient. Encore. Encore. Minute. Encore une. Une dernière. Ça glisse, ça file, ça se détraque. Pas sérieux. Non. Mais grave quand même. Comme un sablier qui rigole. Comme une alarme douce. Comme un rappel qu’il n’y aura pas de rappel. Et puis ça déborde. Chonchon. Bout de chou. Gare. Nord. On fuit en riant. Ou en s’étouffant. C’est pas clair. Juste… une minute. note de travail Troc de la phrase pour le fragment, la signification pour la sonorité, la progression pour l’itération. Ce texte n’est pas une note, c’est un battement. Minute après minute, il creuse quelque chose comme un vertige temporel. Un jeu de langage qui, à force de tourner, révèle une angoisse : celle de manquer, de perdre, de s’effondrer par petits morceaux. La cocotte minute n’est pas un gag. C’est une image du crâne. La réparation minute, une tentative vaine de rafistolage existentiel. Et cette gare du Nord, surgie là… comme un symptôme. La fin d’un trajet. L’idée du retour. Ou de la fuite. Le tout est ludique. Mais le ludique, ici, est défense. Il faut jouer avec les mots, sinon ils dévorent. Et dans le “pas une minute à perdre de plus”, j’entends, en creux, le soupir du corps qui n’en peut plus. Le langage fait diversion. Mais la minute reste là. Tapie. Prête à sonner.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
17 octobre 2023
Amalgame. Au sens propre : un alliage de mercure avec un autre métal. Au figuré : un mélange de choses ou de personnes qui ne vont pas ensemble. Des opinions, des faits, des peurs, des noms. Tout jeté dans le même creuset. Avoir l’amalgame en horreur. En éprouver du dégoût. Mais s’y retrouver quand même. S’y perdre parfois. Amalgamer les données. Confondre. Simplifier. Oublier. Et puis revenir au mercure. Au commerce. À l’argent. Substance liquide, fuyante. Démêler patiemment. Extraire un à un les éléments. Recomposer la matière sans qu’elle ne vous brûle les doigts. sous-conversation C’était clair pourtant… une définition. Un mot net, précis, stable. Et puis… ça déborde. Ça mélange. Ça colle. Il y a trop dedans. Trop d’autres choses. Il voulait distinguer. Séparer. Mais il se retrouve là, pris dans le bloc. Pas moyen d’en sortir sans s’arracher un peu de soi. Ça s’est mis à couler. Comme du mercure. Tu touches, ça fuit. Tu appuies, ça éclate en mille gouttes. Et toi, au milieu. notes de travail Le mot est posé comme un scalpel. Amalgame. Une tentative de disséquer le trouble. L'auteur de ce texte semble fasciné par cette oscillation entre le sens technique (le mercure, l’alliage) et le sens moral (la confusion, l’erreur, la faute logique et sociale). Il veut trier, nommer, séparer. Mais tout, dans la langue, conspire à confondre. Ce qui me frappe, c’est qu’il cherche à se laver de l’amalgame tout en admettant qu’il y est plongé. Il y a un conflit fort entre son désir de clarté — presque obsessionnel — et l’expérience de la complexité. Le retour au mercure n’est pas anodin : substance toxique, insaisissable, à la fois métal et liquide, comme l’esprit quand il tente de tout comprendre. L’image finale est très forte : démêler les amalgames, comme on démêlerait des pensées confondues, ou des souvenirs mêlés. Peut-être, au fond, que ce fragment dit la peur de l’indistinction. La peur de devenir soi-même un amalgame.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
17 octobre 2023
On se dit : c’est pour moi. Puis un peu pour les autres aussi. Et puis on ne se dit plus rien. On écrit. Ça s’écrit. Besoin naturel. Atelier sur l’enfance. F.B. dit : « Il n’en faut pas beaucoup pour se perdre quand on est enfant. » Je l’écris aussitôt : terreurs, perditions. Mais aussi les cailloux, les fils, les arbres, les cabanes. La route. Sans les mots, que reste-t-il ? L’effroi, la nuit, l’abrutissement. Se perdre, c’était surtout oublier cet enfant-là. Et puis un clou chasse l’autre. Attention. Les mots : amour, torture, fidélité, trahison. Les articles : le, la, les. Mon cerisier. Ton abricotier. Leur poirier. Leurs grillages. Les genoux qu’on s’écorche. Le vent, la pluie. Un arbre, une haie, un jour. Une maison. Un homme. Un chien. Un coup de feu. Je. Tu. Il. Nous. Vous. Ils. Le pronom n’est pas un nom. Il ne l’a jamais été. Se perdre dans les livres. Se trouver autrement. Peut-être. * Aujourd’hui : les impôts. Un bâtiment en travaux. Une autre adresse. Il y va. Il attend. Il se trompe. On le renvoie. Ses épaules tombent. Mais il tient bon. Et soudain, miracle : un fonctionnaire souriant. Sortir. Sentir que quelque chose s’est réglée. Alors qu’il y a une heure, on était au fond du trou. * Peinture l’après-midi. Tête farcie. Rien préparé. Chercher le sens d’un exercice en le pratiquant. Confus, mais ça travaille. Une boîte à livres dans un coin. Un Chamoiseau. *Texaco.* Pas lu celui-là. Je le prends. Je devrai le remplacer après les vacances. Boucher le trou. sous-conversation Il écrit. Mais pour quoi ? pour qui ? Ça sort, comme ça. Naturel. Ou pas. Ça serre un peu, là. Comme s’il fallait se justifier d’écrire. Encore. Toujours. L’enfance. Encore. Se perdre… mais quoi, qui, exactement ? S’éloigner. De quoi ? De qui ? De cet enfant. Celui-là. Surtout celui-là. Mais pas trop loin non plus. Sinon tout s’efface. Il s’égare. Dans les mots. Dans les arbres. Dans les pronoms. “Je” flotte. “Tu” accuse. “Ils” menacent. L’administration. Le labyrinthe. Le bon guichet. Sourire ou mépris. Il ne faut pas exploser. Il ne faut pas. Et puis : un livre. Texaco. Une dette née d’un livre gratuit. Le trou qu’on ne veut pas laisser. Notes de travail Le texte est un terrain. Une forêt mentale. Il y a là-dedans : un enfant effrayé, un homme fatigué, un écrivain débordé, un corps traversé par mille signaux. Et la tentative d’un fil. D’une ligne de fuite. Ce qui m’intrigue, c’est l’usage de la perte comme stratégie. On ne cherche pas à se retrouver, mais à se perdre. Et dans cette perte, se sauver d’une autre menace, plus ancienne. Plus ancrée. L’enfant revient. Mais jamais en face. Il rôde, flotte, s’infiltre dans les mots, les pronoms, les scènes d’école ou de forêt. Il ne veut pas être dit frontalement. Alors il devient grammaire. L’administration arrive comme un bloc brutal de réel. Le cauchemar bureaucratique qui révèle le moi quotidien, l’homme lambda face à l’absurde. Mais ici, même ça, on le traverse. On en sort vivant. Et puis, le retour au livre. À Chamoiseau. À la dette symbolique. Car même la gratuité devient source d’angoisse. Le texte, au fond, parle de la charge de devoir vivre, penser, écrire, transmettre. Et du gouffre laissé si l’on échoue. Il écrit pour ne pas tomber. Et dans le trou du don gratuit, il sent l’obligation d’un retour. Même les livres libres ne le sont pas vraiment.|couper{180}
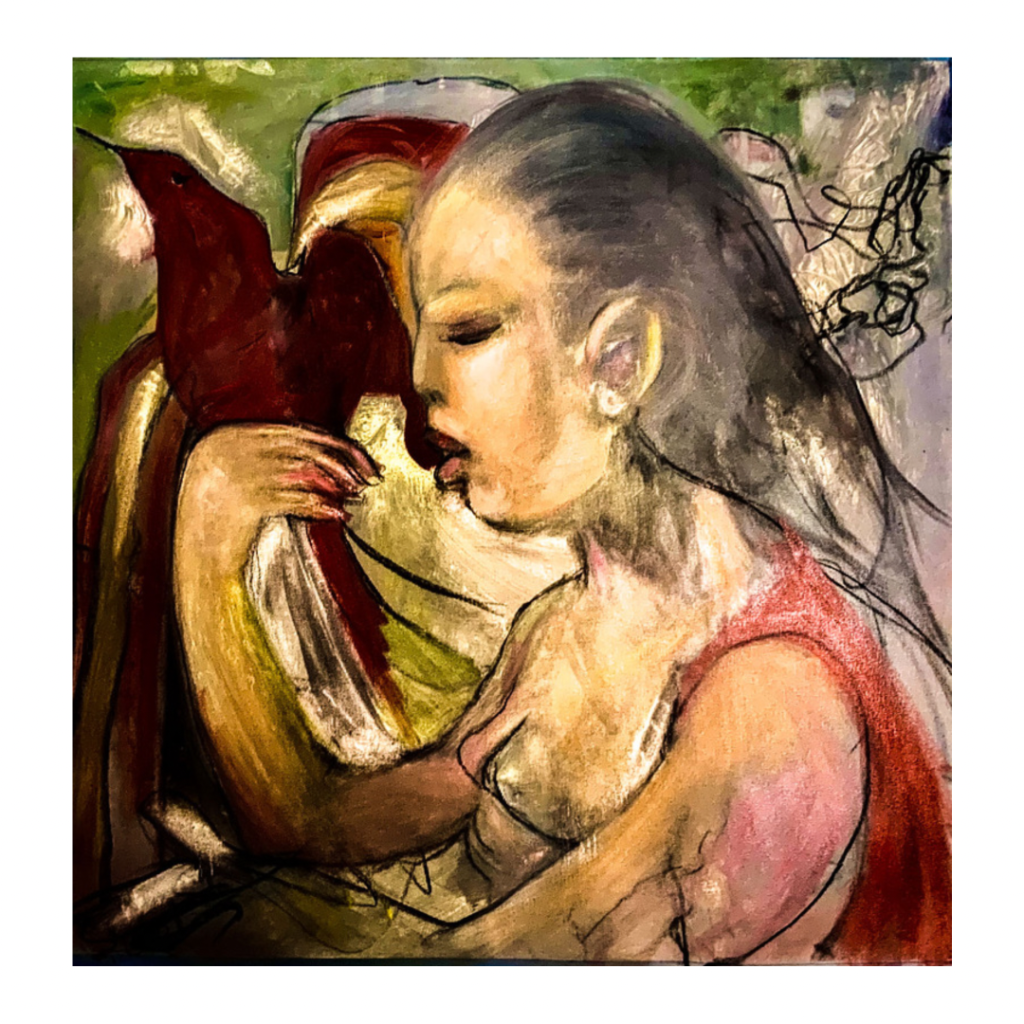
Carnets | octobre 2023
16 octobre 2023
Depuis la Rome antique jusqu’aux quartiers anonymes d’aujourd’hui, la délation n’a jamais cessé de prospérer. Sycophantes hier, applications aujourd’hui. En Chine, on balance son voisin du bout du pouce. En Corée, on apprend à dénoncer en classe. En Suisse, on appelle cela sobrement une dénonciation pénale. Partout, la même jouissance trouble : trahir en toute légalité. À la Grave, cela devient un sport. Un jeu sale et répété. On y déballe les autres comme on viderait des sacs de pommes de terre pourris. Le plaisir est là, visqueux, dans le geste de salir. P., professeur de mathématiques, a chuté. Quelques élèves ont parlé. Des choses tues pendant des années. Il est tombé comme tombent ceux qui savent qu’ils tomberont un jour. Un matin d’octobre, même imper, grosse valise. Le parc. Les cris. Le pont. Le bosquet. Plus rien. Et lui, celui qui observait, aurait voulu être comme les autres. Froid. Cruel. Mais quelque chose en lui résistait — orgueil tordu, faiblesse ou déviance du cœur. Il a tenté de s’en guérir. Il a échoué. Alors il a fait comme tous les ratés : il a cultivé son ressentiment. Un ressentiment sans cible. Encore mieux. Il servira. À tout le monde. Aux flics. Aux élus. Aux discours. Il suffira de l’irriguer. Le canaliser. Et du compost de cette haine ordinaire, une dictature germera. Fluide. Naturelle. Organique. Comme une fleur noire venue d’un rêve d’enfant pourri. sous-conversation Il aurait aimé… quoi ? Ne pas sentir. Ne pas comprendre. Ne pas avoir ce battement trop fort, là, quand un autre tombe. Juste fermer les yeux, comme tout le monde. Mais non. Toujours ce remous, ce noeud — pourquoi est-ce que ça le touche ? Lui aussi… il aurait voulu être du côté des forts. Ceux qui dénoncent, qui n’ont pas de scrupules. Mais il y a… quelque chose. Un reste. Un poison inversé. Une fêlure peut-être. Ou juste une merde d’enfance qu’il n’a jamais réussi à recracher. Note de travail Difficile de décider si ce texte est un extrait de journal ou une minute d'un procès. C’est confus. L'auteur mélange faits géopolitiques, souvenirs scolaires, visions apocalyptiques. Ce qui affleure : la délation comme symptôme social, mais surtout comme métaphore intérieure. La scène du professeur P. fonctionne comme un traumatisme-relais. L’auteur n’est ni bourreau, ni victime, mais témoin — et cela semble l’écorcher plus que tout. Car il ressent ce que d’autres ne ressentent pas : un dégoût de leur plaisir, une honte d’être resté compatissant. Ce qu’il appelle “déviance du cœur” est sans doute un reste d’humanité. Il aurait voulu s’en défaire, mais ne le peut pas. Alors il en fait un symptôme : le ressentiment. Une haine indéterminée, sans adresse. Polyvalente. Exploitable. C’est là que surgit le plus inquiétant : la conscience que le ressentiment est le meilleur allié du pouvoir. Parce qu’il est flottant, inextinguible, transmissible. J’en viens à me demander : est-ce lui qui l’écrit, ou est-ce la haine du monde qui s'est emparé de sa main ?|couper{180}

Carnets | octobre 2023
15 octobre 2023
Tout aurait commencé ainsi : compter. Peser. Soustraire. Ce fut le début de la fin — la violence douce, quotidienne. Désormais, on n’échange plus que rubis sur l’ongle. Naissent alors les tares, les soupçons, le scrupule. Le monde penche : pour ou contre, gain ou perte. On ne vit plus : on calcule. Gagner sa vie a pris la place de la vivre. Non plus humainement. Encore moins fraternellement. sous-conversation Compter… oui, voilà, c’est là que ça commence, peut-être. Un chiffre, un premier… et tout bascule. Ce frottement… cette crispation au moment d’échanger, comme un cliquetis de pièces invisibles. On ne s’aime plus, on s’évalue. Un pas de côté, vite. Non, trop tard. C’est entré. Le poison lent du calcul. Même entre nous. Surtout entre nous. Tu me donnes quoi ? Tu me dois quoi ? Et moi… combien je vaux ? Notes de travail Ce texte évoque, sans détour, un moment fondateur : le passage à l’arithmétique du monde. Ce moment où la valeur remplace le lien. “Tout aurait commencé par compter” — c’est-à-dire : tout aurait cessé d’avoir lieu dans la gratuité. Il ne dit pas “l’argent”, il dit “compter” : un verbe plus primitif, presque enfantin. Le trauma n’est pas seulement économique, il est existentiel. Le monde se désaxe dès qu’on en quantifie les flux. Je note aussi cette “violence” insérée très tôt, comme si cette bascule avait été vécue sur un mode traumatique. On passe d’un monde fluide à un monde où l’on pèse, soupèse, suspecte. Le “scrupule” arrive comme un symptôme : ce n’est pas la conscience morale, c’est la pesanteur de l’obligation, du soupçon généralisé. Le dernier versant (“gagner sa vie au lieu de la vivre…”) est une plainte déguisée. Un regret enfoui. Il y avait un avant, peut-être rêvé, où la vie se vivait fraternellement. Maintenant, elle s’achète. Il faudra revenir à ce point : qui a demandé qu’on commence à compter ?|couper{180}

Carnets | octobre 2023
09 octobre 2023
La politique rend sourd. La télé, la radio, la presse, rendent idiot. Il resterait les forêts, peut-être, si on était sûr de ne pas s’y faire trouer la peau. Les livres alors ? Lire. Écrire. Pas besoin de scénario Matrix. La stase est réelle. Les tuyaux nous branchent à la fabrique à caca mondiale. Le pour. Le contre. Et ses variants. Vaccination bisannuelle. Attestée par experts pépères. Le mot concitoyen coince à la glotte entre deux bouchées de tartines pas beurrées. On ne nous prend même plus pour des cons. C’est au-delà. On n’existe plus. Signes. Chiffres. Cibles. Données. Être une donneuse ne sauve rien. Tu lèches des culs à vide. La salive ne vaut plus un pet. Se pendre — haut et court — expression toujours trouvée étrange. Cours dans un rêve. Sur place. Affolé. Et si tu ouvres les yeux : l’anomalie te saute au visage. Pièce blanche. Savants fous sous cachou. Carton plume tailladé au scalpel. Extensions de labyrinthe. Quelqu’un hennit. Un miroir de poche surgit d’une blouse. Et ce rat blanc… tremble dans ton regard. Tu te souviens. * Ce dimanche a filé comme un pet sur une toile cirée. (La toile cirée. Encore elle.) Cire. Messire. Messe. Ire. Lire. On peut vivre avec quelqu’un et ne pas lire le même livre. Même titre. Livre différent. Alors se parler. Se toucher le front. Joue contre joue. Danser. Mais pas la Carmagnole. Toucher > Opinion. L’amour est compliqué parce que se taire est compliqué. Trop dire. Trop faire passer l’orage mental. La vomissure primordiale. L’amour déformé par l’excès d’informations qui n’informent que d’un ennui crasse. Un avachissement. S’avachir comme une bête dans l’herbe haute. Toucher terre. Peser. Se laisser peser. Ne plus ramer. Face à la falaise. * Une certaine atmosphère revient. Un parfum d’être. “C’est moi. Ce n’est que moi.” En aparté. Lampe de chevet. Corps horizontal. Pieds contre pieds. Main sur le livre. Pages qu’on tourne. Buée sur les carreaux. * Et puis, ouvrir un réseau. Regarder. Comme une prise de sang. Relever la manche. Garrot. Observer dans quelle glue tout se déforme et se reforme. Résister. Mithridatisation quotidienne. S’interroger. Pourquoi ? Réflexe animal. Effroi antérieur. Antilope dans le sang. Courir. Courir pour fuir l’inéluctable. C’est ça : définir le mot inéluctable. * S’entraîner. Chaque jour. Tenir la bête en joue. Et, peut-être, à la fin, ouvrir en grand les bras. L’accueil. sous-conversation — Tu fais quoi, là ? — J’essaie de tenir. — Avec des mots ? — Avec ce qui reste. — Ce rat, ce miroir… — C’est l’image. C’est l’anomalie. — Tu trembles ? — Pas encore. Mais je sais que ça vient. — Et l’amour ? — Il est déformé. Mais il bat encore. — Tu veux quoi ? — Rester un corps. Pas un chiffre. — Et à la fin ? — Juste. — Les bras. — Ouverts. note de travail Le sujet alterne saturation et fuite. Il tente de survivre dans un monde désarticulé, où les repères symboliques sont anéantis, où le langage institutionnel ne vaut plus rien. Tout le début du texte décrit une **dissolution du social**, une perte du sens collectif, de la citoyenneté, du langage partagé. L’humour y est acide, désespéré. Mais très vite, surgissent des îlots de résistance : – Le corps. – Le toucher. – La lecture. – L’attention à l’autre. La position horizontale, la lampe de chevet, les pieds frottés l’un contre l’autre — ce sont des gestes de réinvention douce de soi. L’image la plus forte, peut-être : “une antilope court dans le sang”. Le sujet sait que la bête qu’il est court pour fuir une mort déjà contenue dans le langage même. Mais il court. Il s’entraîne. Il résiste. Et il se prépare, peut-être, à ouvrir les bras. Pas pour capituler. Pour accueillir. Le monde, la chute, ou autre chose. Une lucidité nue, non défaite.|couper{180}

Carnets | octobre 2023
08 octobre 2023
Rosa Luxemburg, de mémoire, disait que le socialisme était la seule vraie forme de démocratie. Elle croyait à l’internationalisme. Elle estimait que la souveraineté et le nationalisme n’étaient que des erreurs de raisonnement. Elle critiquait Marx, Lénine, et d’autres encore. Sans mâcher ses mots. C’était une femme forte. « Quiconque souhaite le renforcement de la démocratie devra souhaiter également le renforcement du mouvement socialiste… » Des mots comme ça, on les paie. Elle se mit à dos beaucoup de monde. Et pourtant, elle avançait. Boitant depuis l’enfance. Mais avançant quand même. Elle savait que le chemin du socialisme était pavé de défaites. Les canuts de Lyon. Les chartistes anglais. Juin 1848. La Commune. Toutes écrasées. Et pourtant, elle disait : *“Où en serions-nous aujourd’hui sans toutes ces défaites ?”* Elle écrivait, elle croyait, elle affrontait. Elle disait : *“Votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain la révolution se dressera de nouveau… J’étais, je suis, je serai !”* Elle lisait Adam Mickiewicz. Elle croyait à la poésie. On l’a souvent prise pour une naïve. Une chieuse. Une emmerdeuse. Mais elle a marché dans son rêve. Jusqu’à ce qu’il la tue. Assassinée en 1919, jetée dans l’eau comme une pierre sale. La rumeur dit qu’un soldat, en la jetant, a murmuré : “Voilà la vieille salope qui nage maintenant.” Mais savait-il que Rosa avait écrit : *“Sur la pierre de mon tombeau, on ne lira que deux syllabes : tsvi-tsvi.”* Le chant des mésanges charbonnières. Elle les imitait si bien qu’elles venaient aussitôt. Et peut-être, quelque part, elles chantent encore. sous-conversation — Tu dis qu’elle était forte. — Oui. Mais pas comme on croit. — Elle avançait en boitant. — Et elle disait la vérité. — Tu crois qu’on peut encore écrire ça ? — “J’étais, je suis, je serai” ? Oui. Il le faut. — Et la mésange ? Ce tsvi-tsvi ? — C’est ce qui reste. Ce qui échappe. — Alors même morte… — Elle trouble encore les eaux. note de travail Le sujet ne décrit pas seulement Rosa Luxemburg. Il s’y associe. Il y projette son propre rapport au courage, à la parole, à l’histoire, à la désobéissance. Il y a dans ce texte une profonde empathie, mais pas d’idéalisation. Rosa n’est pas un monument. Elle est une voix, une marche, une boiterie, une vibration d’oiseau. La structure du texte suit un mouvement de tension : **de l’intellect à l’utopie**, **de la conviction à la persécution**, **de la citation à la souillure**, puis **du meurtre au chant**. Le chant final — tsvi-tsvi — est bouleversant. Il renverse tout. C’est un retour du vivant là où la violence a voulu imposer la disparition. Ce texte est un hommage, mais aussi un autoportrait en creux : celui de l’auteur qui, lui aussi, continue de croire malgré tout, et d’écrire contre l’effacement.|couper{180}
