27 janvier 2025
Le vol des idées. Un concept absurde, presque grotesque, et pourtant terriblement obsédant. Depuis que P.M., un auteur que je lis en ligne, a évoqué ce pincement au cœur en découvrant un ouvrage "jumeau" du sien, cette question me hante : peut-on réellement posséder une idée ? Et pire, peut-on se la faire voler ? À bien y réfléchir, je n’en suis pas sûr. Les idées ne nous appartiennent jamais. Ce sont des oiseaux volages, des coucous . Les idées nichent un temps dans nos crânes avant de s’envoler ailleurs si on ne les retient pas. Il faut ajouter à cela la course à l’échalotte collective, bien évidemment.
J’ai vécu cette trahison. Une fois, en librairie, je suis tombé sur un roman signé J.O., un auteur dont je suis sporadiquement le blog. Même thème, même obsession sur la possession. Pendant une seconde, j’ai eu envie de crier au plagiat. Mais quoi ? Les idées n’appartiennent à personne. Elles voyagent, elles nous trahissent. Leur nature est infidèle, comme le reste. Il faut être naïf pour croire qu’on peut les retenir, les breveter ou les enfermer.
Aujourd’hui, pendant que N. tape sur le plafond de la cuisine pour tenter de réparer cette maison en ruine qui nous ruine – littéralement –, je rumine tout ça. Chaque coup de racloir résonne comme un rappel cruel : cette maison est un gouffre. Financier, émotionnel. Une prison que je partage avec S., qui veut s’obstiner à rester. Moi, je rêve de fuite. Alaska. Une cabane au bord du monde, loin de tout. Hier soir, j’ai osé le dire : "Et si on vendait ?" L’idée m’a semblé évidente, limpide. Mais S. s’y oppose, avec ses ancrages, ses obligations, cette idée qu’on ne peut pas tout lâcher. Alors j’ai lâché une phrase cruelle : "Fifty-fifty, on vend, je te donne la moitié, et basta." Je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin, mais c’était sincère.
La vérité, c’est que je glisse déjà. Vers où ? Je n’en sais rien. Une solitude plus profonde, peut-être. Une sorte de néant intérieur. Les relations humaines me semblent de plus en plus superficielles, presque décoratives. La vraie bataille, elle, se joue ailleurs. Dedans.
La dépression est là, fidèle, tapie. Elle n’a rien d’extraordinaire, rien de spectaculaire. Une "mélancolie administrative", comme je l’appelle. Elle revient par vagues, régulières, inévitables, comme un chien qu’on a essayé de perdre mais qui retrouve toujours sa route. Je n’ai jamais eu besoin de drogues ou de stimulants pour voir les abysses : ils sont déjà là, dans chaque putain de minute. Vieillir n’aide pas. Les années s’empilent comme des couches de poussière, et avec elles, l’obsession idiote de réussir, comme si c’était encore possible de renverser le cours des choses. Mais on ne contrôle rien. La vie, les échecs, les humiliations – tout ça nous tombe dessus, implacable.
Dans ce chaos, il y a l’écriture. Pas celle qui cherche la reconnaissance ou la gloire – cette ambition-là s’efface avec le temps. L’écriture, pour moi, c’est juste respirer. Un acte en soi. Écrire pour exister, pour donner forme à l’informe. Mais même ça, je le complique. J’ai eu cette idée idiote de digests mensuels à partir de mes carnets : extraire des fragments, trier, ranger le chaos. Une entreprise absurde, sans fin. Peut-être qu’il suffirait d’écrire "un petit peu chaque jour". Pas de projets pharaoniques, pas d’envolées ambitieuses. Juste avancer. Lentement. Méthodiquement. Parce que, franchement, je n’ai plus l’énergie pour autre chose.
En attendant, j’ai travaillé sur janvier 2023. Parfois, huit textes dans une journée. Je les corrige, j’extrais des mots-clés. Je vois des répétitions, des liens entre les fragments, mais je ne sais pas encore ce que ça signifie. L’écriture, au fond, est à la fois la maladie et le médicament. Hier, le "dibbouk" – ce spectre obsédant qui hante mes pensées – n’est pas apparu. Pas une fois. Cela m’a presque inquiété. Au petit matin, j’ai eu une vision : un cercueil dans lequel m’allonger, attendre la nuit. Mais le ciel bleu, vers neuf heures, a balayé tout ça.
ça pourrait être le début d’une ficton, c’est probablement le début d’une fiction, le début de la fin.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.
Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.
Pour continuer
Carnets | Atelier
Écrire sous possession
La ville est traversée de voix anonymes. Fragments de conversations captés au vol, slogans publicitaires, injonctions médiatiques : ces paroles ne nous appartiennent pas, mais elles s’imposent, s’accumulent en nous. Ce brouhaha, loin d’être anodin, façonne nos pensées. Il contamine aussi l’écriture. Dans la littérature contemporaine, la possession n’est plus seulement un motif narratif lié au fantastique. Elle est un mode d’écriture. Loin du roman classique, centré sur un sujet maître de son récit, elle introduit des voix étrangères dans le texte, jusqu’à troubler l’énonciation elle-même. C’est ce qui traverse des œuvres comme Sérotonine de Michel Houellebecq, où la voix du narrateur est saturée de discours extérieurs – langage de la publicité, éléments de langage politique – jusqu’à dissoudre son identité. Ou encore Zone de Mathias Énard, où la phrase unique, haletante, absorbe des fragments d’Histoire, comme si le narrateur était lui-même traversé par des voix multiples. La possession, c’est l’échec du roman traditionnel à contenir la pluralité des voix. Là où Balzac ou Flaubert s’attachaient à une narration stable, une voix contrôlée, les écrivains contemporains explorent l’éclatement du discours, la friction entre le soi et l’autre. L’écrivain ne parle plus seul : il est parasité par d’autres voix, d’autres temporalités, d’autres discours. Possession et narration : un texte contaminé Dans Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Stig Dagerman écrit : « Je suis un autre tant que je ne suis pas moi-même. » Cette phrase, qui fait écho à Rimbaud, résume ce que l’on pourrait appeler la poétique de la possession. L’écriture devient un champ de tensions où la voix du narrateur est troublée, hantée par ce qui la dépasse. C’est ce que l’on retrouve dans Lambeaux de Charles Juliet, où la parole oscille entre la voix de l’auteur et celle de sa mère disparue. Le texte est traversé par une autre conscience, comme si l’acte d’écrire relevait d’une forme de spiritisme. De même, dans Sombre dimanche d’Alice Zeniter, les générations se superposent, les voix s’entrelacent jusqu’à faire vaciller l’identité des personnages. Ce trouble de l’énonciation ne relève pas d’un simple procédé stylistique : il met en crise la notion même d’auteur. Dans Les Années d’Annie Ernaux, le « je » disparaît au profit d’un « nous » où l’intime se mêle au collectif. Le texte est possédé par les voix d’une époque, d’une génération. La mémoire individuelle devient une mémoire traversée. Traduire, réécrire : la possession en acte La possession ne concerne pas seulement l’énonciation, mais aussi la réécriture et la traduction. Traduire, c’est déjà altérer, habiter un texte étranger et le transformer. C’est ce que revendique Claro dans ses traductions de Vollmann ou de Pynchon : ne pas chercher à restituer fidèlement, mais accepter la contamination du texte d’origine par la langue d’arrivée. La réécriture fonctionne sur le même mode. Un texte en parasite un autre, le modifie, l’investit. Dans Écrire de Marguerite Duras, l’autrice revient sans cesse sur les mêmes épisodes, comme si son propre texte lui échappait, lui revenait sous une autre forme. De même, dans Un Mage en été d’Olivier Cadiot, la narration semble hantée par d’autres œuvres, d’autres formes, comme si l’écriture était toujours une appropriation, une transformation du déjà-là. Dans cette logique, l’écrivain n’est pas un créateur absolu, mais un médium. Il capte des voix, les transpose, les fait résonner autrement. Son texte n’est jamais clos : il est un champ de forces en perpétuelle mutation. Possession et société : une question politique Mais la possession ne concerne pas que l’écriture : elle est aussi un révélateur social. Qui possède la parole ? Qui en est dépossédé ? Dans les rituels vaudous, le corps du possédé devient le lieu d’une parole qui lui échappe. Il en va de même en littérature : certaines voix sont considérées comme légitimes, d’autres sont marginalisées. Dans Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila, la langue elle-même est travaillée par la possession : elle absorbe les slogans, les discours politiques, les bribes de conversations. Le texte devient une polyphonie chaotique où la parole dominante se heurte à celles des laissés-pour-compte. De même, dans Autoportrait en noir et blanc de Jesmyn Ward, la narratrice est traversée par l’Histoire et ses fantômes : la mémoire de l’esclavage, les récits familiaux, les voix des disparus hantent le texte, jusqu’à rendre poreuse la frontière entre passé et présent. Aujourd’hui, la possession n’est plus seulement un phénomène occulte : elle est une grille de lecture du monde. À l’ère du numérique, nos discours sont infiltrés par des algorithmes, nos mots prédéterminés par des formules automatiques. L’écriture elle-même est contaminée par ces voix extérieures, qu’il s’agisse de discours médiatiques ou de boucles de langage sur les réseaux sociaux. Conclusion : écrire sous emprise Écrire aujourd’hui, c’est accepter cette dépossession. Ce n’est plus construire une voix unique, mais composer avec une polyphonie qui nous dépasse. L’écrivain contemporain n’est pas maître de son texte : il est traversé par des forces qui lui échappent. Cette contamination du texte par l’extérieur n’est pas une perte : elle est une ouverture. Elle permet de penser l’écriture comme un espace de résonance, où se croisent des voix, des mémoires, des héritages. La possession n’est pas un enfermement : elle est un mode d’écriture, une manière d’habiter le monde autrement. Dans ce théâtre hanté qu’est la littérature contemporaine, l’auteur ne possède plus sa langue. Il accepte d’être possédé par elle.|couper{180}

Carnets | Atelier
30 janvier 2025
La vitre, légèrement trouble, laisse deviner l'intérieur d'une pièce exiguë. Dans ce cadre étroit, un homme est assis devant la lueur bleutée d'un écran d'ordinateur. Sa silhouette massive occupe presque tout l'espace. Le haut du crâne, dégarni, capte parfois un reflet de la lumière extérieure. Immobile, il fixe l'écran. Seule sa poitrine se soulève au rythme d'une respiration lente, presque imperceptible. Puis ses mains s'animent soudain sur le clavier, comme répondant à une impulsion invisible. Un bruit, peut-être, ou un mouvement dans la rue, détourne brièvement son attention. Son visage pâle se tourne vers la fenêtre. Les traits sont creusés, le regard absent - celui d'un homme qui a traversé trop de nuits blanches. L'instant d'après, déjà, il replonge dans la lumière artificielle de son écran. À l'aube, une lampe s'éteint, ne laissant que la lueur bleutée de l'écran. À travers la vitre sale, ce point de lueur artificiel troue l'obscurité. Dans le ciel, les cris des martinets s'élevent.. Un train au loin s'annonçe en gare, sa rumeur portée par le vent jusqu'aux abords du village. L'horloge de la place de l'église sonne sept heures, puis les derniers relents de la nuit sont balayés par le fracas de la benne à ordures. À midi, les bruits s'atténuent. Par les fenêtres ouvertes s'échappent des tintements de vaisselle, des bribes de radio, des échos de télévision. Une mère appelle ses enfants pour le repas, sa voix résonne dans l'air immobile. Un chien traverse la grand-rue déserte, son ombre ramassée sous lui glisse sur le sol, mais il file sans s'y attarder, disparaît dans une impasse. Le vent apporte l'annonce lointaine du retard du train de Marseille, quinze minutes. Une odeur de poisson frit monte de la rue, envahit la pièce. La luminosité faiblit. Les derniers cris des martinets disparaissent derrière la silhouette des toits de tuile. Pétarade de la moto d'un voisin qui rentre du travail. Quelqu'un à une fenêtre secoue une nappe ou un drap puis referme celle-ci. Bruit caractéristique d'un rideau électrique qui tombe doucement devant la devanture d'un commerce. Une odeur sucrée monte des jardins alentours, celle des fruits oubliés sur leurs branches, de l'humus des terres retournées. Tout à l'heure, les réverbères s'allumeront l'un après l'autre et ce sera la nuit. Dormi deux heures. Mille guerres. Sensation de fatigue. Paupières lourdes. Moral dans les chaussettes. Le café percole audible depuis l'étage. S. est déjà réveillée. L'odeur du café parvient au nez. Presque déjà le goût. Amer. Le café percole doucement bas dans la cuisine. S. est déjà réveillée, elle a déjà mis trois machines en route et se prépare à allumer le transistor sur la table de la cuisine. Voilà une chose importante, j'aime la simplicité. Dire le plus de choses en le moins de mots possibles.|couper{180}
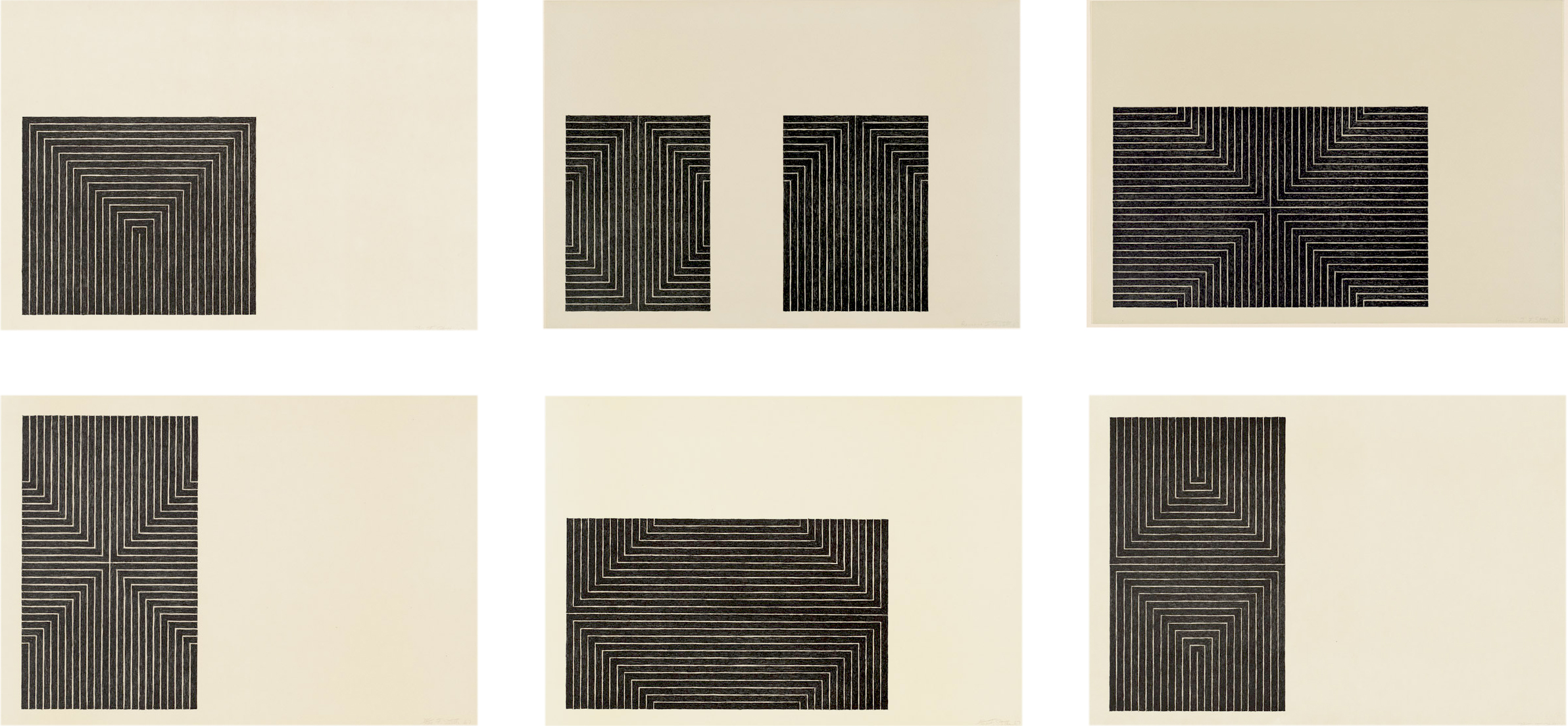
Carnets | Atelier
29 janvier 2025
C'est difficile dans un journal d'aller directement à l'essentiel. En général je prends considérablement le temps de louvoyer. Comme pour retarder l'explosion d'un pétard à mèche. Aussi je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai eu 65 ans aujourd'hui. Nous avons pris la voiture pour aller à Saint-Étienne. Passés par Condrieu, puis la petite route qui serpente en passant par les collines, les plateaux vers Rive-de-Gier. Temps splendide. S. avait réservé un restaurant pour l'occasion. Mais parvenu dans la ville, impossible de s'orienter. Nos deux GPS en panne. Vers 13h nous avons décidé d'annuler la réservation et de rebrousser chemin. Au moment où nous cherchions à sortir de la ville on tombe sur l'adresse du restaurant. Mais on ne s'est pas arrêté. Le patron était furieux au téléphone. Il a dit qu'il avait refusé du monde parce qu'on avait réservé. J'ai pensé à toute la malchance qui s'accumulait ces derniers jours. J'ai aussi pensé baraque de merde, bagnole de merde, portables de merde, vie de merde. Puis j'ai pris une nicotinelle 2mg et je n'ai plus rien dit jusqu'à l'Intermarché où j'ai pu échanger ma bouteille de gaz puisque j'avais pris la précaution de mettre la consigne dans le coffre de la Dacia. En avons profité pour faire quelques emplettes. Les R. passeront vendredi pour prendre l'apéritif. D'ailleurs les premiers à m'envoyer un SMS pour me souhaiter un "bon anniversaire" ce matin. Il a fait beau toute la journée. Je me suis demandé s'il avait fait beau comme ça le 29 janvier 1960. Si j'avais vu le ciel bleu dans ma chambre d'hôpital au fond de ma couveuse. Puis d'imaginer mes tous premiers pas, mes tous premiers mots, comme si la vie ce jour anniversaire pouvait reprendre comme au début. J'ai même senti quelque chose dans l'air, comme un parfum de renouveau, printanier, puis je me suis souvenu que j'avais 65 ans et j'ai dit que je reviendrai demain matin pour décharger la bouteille de gaz, on avait déjà les sacs des courses à porter.|couper{180}

